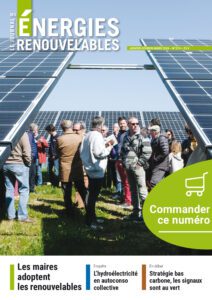L’ACTU
L’ACTU HEBDOMADAIRE DES ENR
Pour recevoir gratuitement notre lettre hebdomadaire d’actualités dédiée aux énergies renouvelables, inscrivez-vous ICI.
Pour vous abonner au magazine Le Journal des Énergies Renouvelables, c’est par ici
Publié le 26/02/2026. Le 19 février, Tenea Énergies a réalisé sa première injection de biométhane dans le réseau grâce à un méthaniseur développé en Ille-et-Vilaine. Créée en 2021 suite à l’alliance entre Homea et Tenergie, l’entreprise vise à accélérer la méthanisation à la ferme, de taille moyenne. Ce premier projet, développé avec un couple d’agriculteurs locaux, valorise effluents d’élevage, sous-produits végétaux, optimise les ressources agricoles et renforce l’autonomie énergétique du territoire. Avec une production de 115 Nm³/h, le site couvrira l’équivalent de la consommation de 2 000 foyers et contribuera à la décarbonation du mix gazier. Deux autres chantiers sont actuellement en phase finale de réalisation et douze nouveaux chantiers seront prochainement ouverts. Au total, plus de 70 projets de méthanisation sont portés par Tenea Énergies. Publié le 26/02/2026. La Commission de régulation de l’énergie a publié un état des lieux au 30 juin 2025 des appels d’offres lancés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie 2029-2028 (PPE2) pour la production d’électricité renouvelable. Le rapport couvre les filières photovoltaïques et éolienne terrestre. Pour ces deux technologies, 2 074 projets ont été retenus entre fin 2021 et mi-2025, pour une puissance cumulée de 18,2 GW, soit 78 % des volumes appelés. Les aides associées aux contrats de rémunération accordés à ces lauréats représenteraient en moyenne 238 millions d’euros par an entre 2024 et 2047 (5,7 milliards d’euros au total sur la période), dans un scénario où le prix de marché atteindrait 70 €/MWh en 2030. Il ressort également du rapport que les prix proposés lors des dernières périodes fin 2025 diminuent pour le photovoltaïque. Ils s’établissent à 96,48 €/MWh pour les installations sur bâtiment (-5 % depuis mi-2023) et à 74,13 €/MWh pour le solaire au sol (-10 %). L’éolien terrestre, lui, se maintient à 86,62 €/MWh. En outre, le paysage concurrentiel demeure diversifié, sans acteur en position dominante. EDF (9 % des projets), Neoen (8 %) et Urbasolar (5 %) restent les principaux groupes lauréats des projets. Enfin, du point de vue de la provenance des équipements, plus de 96 % des capacités éoliennes retenues reposent sur des turbines européennes, dominées par Vestas et Nordex, tandis que 89 % des panneaux photovoltaïques des projets sur bâtiment sont d’origine asiatique. Publié le 19/02/2026. La mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse de l’hôpital de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) marque une avancée vers une énergie locale et durable, couvrant désormais 86 % des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du site. D’une puissance de 1,1 MW, elle remplace 17 anciennes chaudières gaz et permet une baisse de 19,5 % des consommations énergétiques ainsi qu’une réduction de 7 464 tonnes de CO₂ sur huit ans. Exploitée par Engie Solutions, elle est alimentée avec des plaquettes forestières provenant d’un rayon de 40 kilomètres, garantissant un approvisionnement local et limitant l’empreinte carbone du transport. Deux chaudières gaz d’appoint assurent la continuité de service en cas de pic de demande ou de maintenance. La chaleur est distribuée via un réseau interne de 2,5 kilomètres reliant les bâtiments. Soutenu par l’Union européenne, la Région Occitanie et l’Ademe, le projet a bénéficié de 3,9 millions d’euros de subventions couvrant près de 90 % de l’investissement, rendant sa réalisation possible. Cette installation renforce la sécurité énergétique de l’hôpital, réduit sa dépendance aux énergies fossiles, stabilise ses coûts et contribue concrètement à la transition énergétique du territoire. Publié le 19/02/2026. Grâce à la nappe du Dogger, l’Île-de-France est la première région géothermale de France. Parmi les centrales exploitant les calories de ces eaux souterraines, il faut désormais compter celle de Villetaneuse, d’une puissance géothermale d’environ 11 MW, inaugurée en décembre dernier. Un doublet géothermique permet d’utiliser l’eau puisée à environ 60°C à 1 700 mètres de profondeur, pour alimenter le nouveau réseau de chaleur du Syndicat Mixte des Réseaux d’Énergie Calorifique (SMIREC) déployé sur la ville et sur ses voisines Épinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine (commune déléguée de Saint-Denis). Des pompes à chaleur rehaussent la température ce qui permet d’atteindre une production de 55 000 MWh/an, soit de quoi couvrir 67 % des besoins en chauffage des abonnés et éviter l’émission d’environ 9 000 tonnes de CO₂ par an. Le complément est assuré par du gaz qui devrait être remplacé ultérieurement par du biométhane. Actuellement en cours de construction, le réseau de chaleur fera à terme 18,5 km. Ses 70 sous-stations permettront de chauffer l’équivalent de 10 000 logements (logements sociaux, copropriétés et équipements publics, dont l’université). Le projet est porté en régie publique pour un montant total de 63,5 millions d’euros, et soutenu à hauteur de 26,7 millions d’euros par le Fonds Chaleur de l’Ademe et la Région Île-de-France. L’ensemble des réseaux du SMIREC dessert aujourd’hui 85 000 équivalents logements et constitue le deuxième réseau le plus important d’Île-de-France. Publié le 19/02/2026. À l’approche des élections municipales, le syndicat des énergies renouvelables (SER) alimente le débat public avec une étude consacrée aux recettes fiscales générées par les filières renouvelables dans les territoires. Réalisé par Columbus Consulting, ce travail évalue les retombées fiscales directes (Ifer, taxe foncière, CFE, redevances spécifiques), indirectes – notamment via la TVA liée à l’installation et à la maintenance des équipements, dont 25 % sont reversés aux collectivités – ainsi que la fiscalité des entreprises de la chaîne de valeur (emplois, bases foncières, contribution économique locale) à l’échelle de la France métropolitaine. Selon cette analyse, fondée sur le parc et l’activité de 2024, les énergies renouvelables produisant électricité, chaleur ou froid ont généré 2,172 milliards d’euros de recettes fiscales locales. Près de 77 % de ces ressources bénéficient directement aux communes et intercommunalités, contre 15 % pour les départements et 8 % pour les régions. Une manne bienvenue dans un contexte marqué par la baisse des dotations de l’État. L’étude souligne également le rôle structurant des renouvelables dans les territoires ruraux : 85 % des communes accueillant au moins un parc éolien comptent moins de 2 000 habitants. Dans celles de moins de 500 habitants, les recettes liées aux renouvelables représentent en moyenne près d’un quart des recettes fiscales locales. À titre d’exemple, un parc de quatre éoliennes de 2,5 MW génère environ 77 000 euros par an pour le bloc communal, soit de quoi financer la rénovation énergétique d’une école primaire en moins de sept ans. L’ensemble des résultats est accessible à travers un atlas interactif qui permet de visualiser filière par filière et pour chaque niveau de collectivité locale, les retombées fiscales générées. Publié le 12/02/2026. La Métropole Européenne de Lille a confié à un groupement réunissant Coriance et la Banque des Territoires, la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain intercommunal desservant Tourcoing, Wattrelos, Bondues et Neuville-en-Ferrain dans le cadre d’une délégation de service public de 20 ans. Alimenté à 95 % par des énergies bas-carbone issues principalement de la biomasse et de la chaleur fatale industrielle et des eaux usées, le réseau permettra d’éviter environ 22 000 tonnes de CO2 par an. Les partenaires investiront 117 millions d’euros pour construire une chaufferie biomasse de 26 MW, installer des pompes à chaleur, intégrer un stockage d’énergie de 300 m3 et prévoir des chaudières gaz d’appoint et de secours. À terme, 134 GWh de chaleur seront livrés chaque année, soit l’équivalent du chauffage de près de 15000 logements, via un réseau de 46 kilomètres et 219 sous-stations. La mise en service sera progressive jusqu’en 2031. Ce projet vise à fournir une chaleur locale, durable et compétitive, notamment dans les zones de renouvellement urbain. Publié le 12/02/2026. Après avoir finalement adopté son budget pour 2026, le gouvernement entend publier le vendredi 13 février la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), attendue depuis près de trois ans. Cette feuille de route énergétique, qui fixe les orientations du pays jusqu’en 2035, aurait en effet dû être adoptée avant le 1er juillet 2023. Le gouvernement envoie des signaux contrastés aux filières des énergies renouvelables. Certes, aucun moratoire ne sera appliqué mais les objectifs assignés à l’éolien et au photovoltaïque sont nettement revus à la baisse par rapport à la version précédente du texte. Pour l’éolien terrestre, la cible est désormais fixée à 31 GW de capacité raccordée en 2030, puis entre 35 et 40 GW en 2035, contre respectivement 33 GW et une fourchette de 40 à 45 GW auparavant. Un nouveau rythme qui se situe entre les trajectoires R2 et R3 du bilan prévisionnel de RTE de décembre dernier. Cependant, avec 24 GW actuellement en service et 13,5 GW de projets déjà retenus toujours en cours d’instruction, les marges de manœuvre pour lancer de nouveaux parcs via de futurs appels d’offres apparaissent très limitées. En mer, la réduction est plus mesurée. La nouvelle trajectoire prévoit 15 GW d’éolien offshore installés en 2035, contre 18 GW annoncés précédemment. Cette révision entérine surtout le retard pris dans le lancement d’un appel d’offres stratégique d’environ 8 à 10 GW, attendu par la filière depuis plus d’un an. Le photovoltaïque connaît lui aussi un ajustement à la baisse. La PPE3 vise désormais 48 GW de capacité installée en 2030 (trajectoire R3 du bilan RTE) et entre 55 et 80 GW en 2035 (de R2 à au-delà de R3 du bilan RTE), contre 54 GW et une fourchette de 65 à 95 GW dans la version initiale. Après avoir atteint en fin d’année dernière 30 GW de puissance cumulée, grâce notamment à une année 2025 marquée par près de 6 GW de nouvelles capacités raccordées, le secteur devrait désormais évoluer à un rythme annuel proche de 3,5 GW, soit un ralentissement de 40 %. Les professionnels redoutent que ces coups de frein ne fragilisent les efforts de structuration engagés ces dernières années, avec à la clé une casse sociale. Au-delà du seul secteur électrique, la décarbonation de la chaleur – qui représente plus de 40 % de la consommation d’énergie – constitue également un enjeu majeur. La PPE3 prévoit de doubler le rythme actuel de déploiement de la chaleur renouvelable et de récupération. Elle mise en particulier sur l’essor des pompes à chaleur, mais aussi sur le développement du solaire thermique, de la géothermie, du biogaz, du chauffage au bois et des chaufferies biomasse, ainsi que sur l’extension des réseaux de chaleur. Enfin il est à noter que la PPE3 intègre une clause de revoyure en 2027 pour adapter le texte « aux besoins réels ». Publié le 05/02/2026. Le 3 février, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié un rapport consacré à la transition énergétique dans les territoires. Dans cette publication, la CRE souligne que la réussite de la transition énergétique passera nécessairement par sa territorialisation. Pour y parvenir, trois leviers sont identifiés. Le premier concerne l’appropriation par les territoires des enjeux de la transition énergétique, afin de renforcer l’acceptabilité locale. Le second repose sur l’adaptation des projets aux spécificités territoriales. Le troisième porte sur la nécessité d’un assouplissement des contraintes réglementaires et financières. Dans ce cadre, plusieurs recommandations sont formulées. Elles visent notamment à renforcer l’engagement des décideurs publics locaux, à instaurer un dialogue continu avec les citoyens et à diffuser une culture de l’énergie fondée sur des données accessibles et objectivées. Le rapport préconise également la construction de projets de territoire fédérateurs, appuyés sur une gouvernance organisée à l’échelle la plus pertinente et sur un renforcement de l’expertise technique des acteurs locaux. Enfin, plusieurs recommandations portent sur les freins réglementaires et financiers, avec un appel à une application plus lisible des règles, à une plus grande stabilité des dispositifs de soutien et à un renforcement des incitations pour les filières émergentes et les solutions de flexibilité. Publié le 05/02/2026. À Monflanquin (Lot-et-Garonne), une unité de production de biométhane portée par Biogaz Monflanquin, société créée par Valorizon et Avergies, avec la technologie Wagabox de Waga Energy, a commencé le 29 janvier à injecter son gaz vert dans le réseau local exploité par GRDF. Le biogaz issu des déchets enfouis du site de l’Albié à Monflanquin est désormais transformé en gaz renouvelable, substitut au gaz fossile, pour alimenter habitants et entreprises du territoire. L’installation produira environ 12 GWh par an, soit l’équivalent de 2 000 foyers, et évitera près de 3 200 tonnes de CO₂ chaque année. Le site, qui traite environ 30 000 tonnes de déchets par an, devient ainsi un maillon clé de l’économie circulaire locale. Les équipes optimisent le captage du biogaz afin d’assurer une valorisation maximale, y compris pour la mobilité via le bioGNV. Le projet bénéficie du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de Néo Terra, ainsi que de l’accompagnement de Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne via le programme Co’meth 47. Jeudi 5 février, Uniclima a dévoilé les chiffres 2025 de ses activités dans les équipements thermiques, aérauliques et frigorifiques. Pour les filières des énergies renouvelables, le bilan apparaît contrasté. Dans un contexte économique peu porteur, marqué par les évolutions successives des dispositifs d’aide à l’investissement (MaPrimeRénov’ et Coup de pouce chauffage) et par la faiblesse persistante des marchés de la rénovation et du logement neuf, certains segments ont néanmoins fait preuve de résilience. Après un sévère décrochage en 2024, le marché des pompes à chaleur individuelles (PAC) air/eau n’accuse qu’un léger repli, avec 179 377 unités mises en ventes en 2025, soit une baisse de 1,8 % sur un an. Le segment des PAC air/air résiste, affichant une quasi-stabilité à 803 661 unités (-0,1 %). Les épisodes de fortes chaleurs de l’été 2025 ont d’ailleurs généré des pics historiques de ventes, compensant un premier semestre en maussade. Cependant, toutes les filières n’ont pas bénéficié pas de cette dynamique. Les PAC géothermiques et le solaire thermique poursuivent leur recul, avec des baisses respectives de 6,2 % et 18,6 % en 2025. Pour 2026, les perspectives demeurent incertaines, même si un frémissement, qui reste à confirmer, est perceptible du côté de la construction de logements. Dans ce contexte, le message des industriels est sans ambiguïté : leurs équipements, en constante amélioration, sont prêts à se déployer plus largement afin de réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles, dont les importations ont représenté une facture de 60 milliards d’euros en 2025. Pour les PAC, la feuille de route apportée par la SNBC 3 convient aux industriels, avec un objectif de 8,8 millions de pompes à chaleur installées dans le parc résidentiel à fin 2030 (contre moins de 5 millions aujourd’hui). Une trajectoire qui suppose toutefois un cadre d’aides lisible et stable, condition indispensable à la mobilisation des ménages comme des professionnels. Publié le 29/01/2026. Le gouvernement annonce une évolution des aides à l’achat des pompes à chaleur individuelles. Désormais, ces aides seront conditionnées à la performance environnementale des équipements. La production en Europe devient également un critère central d’éligibilité. Cette décision s’inscrit dans le plan national de développement des pompes à chaleur lancé en 2024. L’objectif est de réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles. Les pompes à chaleur permettent aussi d’améliorer le confort thermique des ménages. Les dispositifs d’aide existants, comme MaPrimeRénov’ – interrompue en attendant l’adoption du projet de loi de finances pour 2026 – et les certificats d’économie d’énergie, sont maintenus. Ils restent ciblés en priorité sur les ménages les plus modestes. Seuls les modèles de PAC agréés par l’État pourront bénéficier d’un soutien renforcé. Ces équipements devront répondre à des critères stricts de qualité et de fabrication européenne. Une consultation publique sur les textes réglementaires est actuellement ouverte. Une plateforme permet déjà aux fabricants de déposer leurs demandes d’agrément. La liste officielle des modèles éligibles sera publiée en juillet 2026. La bonification des aides sera conditionnée à la préférence européenne dès septembre 2026. Cette mesure vise à soutenir l’industrie européenne et accélérer la transition écologique. Publié le 29/01/2026. Le 22 janvier dernier, Ember a publié son analyse annuelle du mix électrique de l’Union européenne pour 2025. Il en ressort que, pour la première fois, l’éolien et le solaire ont produit davantage d’électricité que l’ensemble des énergies fossiles. À eux deux, ils ont représenté 30 % de la production européenne, contre 29 % pour les combustibles fossiles. Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond observée depuis cinq ans, avec une montée continue de l’éolien et du solaire et un recul des énergies fossiles. Le photovoltaïque poursuit sa percée, en hausse de plus de 20 % pour la quatrième année consécutive. Le solaire a fourni 13 % de l’électricité de l’UE, dépassant à la fois le charbon et l’hydroélectricité. Malgré une légère baisse de sa production liée aux conditions météorologiques, l’éolien a conservé sa place de deuxième source d’électricité, avec 17 % du total, devant le gaz. Au global, les énergies renouvelables ont assuré 48 % de la production électrique européenne en 2025. Le rapport note toutefois une hausse de la production à partir de gaz, conséquence du recul de la production hydroélectrique. Cette augmentation a entraîné une hausse de la facture d’importation de gaz et contribué à des tensions sur les prix de l’électricité. Le charbon, de son côté, poursuit son déclin et atteint un niveau historiquement bas dans la majorité des États membres. Publié le 22/01/2026. GRDF a lancé un appel à projets visant à démontrer la faisabilité technique de l’injection dans les réseaux gaziers du biométhane issu de la pyrogazéification, une filière innovante de production de gaz vert. La pyrogazéification repose sur un procédé thermochimique à haute température, sans ou avec très peu d’oxygène. Elle permet de valoriser des résidus organiques solides secs. Après épuration, le gaz produit peut être injecté dans le réseau. Trois entreprises ont été retenues lors de cet appel à projets : Charwood Innovation, Elvéa Energy et Novea. Il permet à GRDF de renforcer ses compétences sur la mise aux spécifications de ce type de gaz et de préparer les réseaux à son intégration. Les premières injections de gaz de pyrogazéification sont attendues dès l’an prochain. GRDF soutient chaque projet à hauteur de 400 000 euros afin de financer les études technico-économiques, les essais technologiques et les travaux nécessaires à l’injection. Les dossiers ont été évalués par un jury associant experts académiques, institutionnels et spécialistes de GRDF, garantissant une sélection rigoureuse. Charwood Innovation se distingue par son ambition de démontrer la faisabilité à l’échelle industrielle et son ancrage sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Elvéa Energy propose un procédé optimisé intégrant purification et poste d’injection dédié, avec une forte orientation vers l’industrialisation. Novea valorise son expérience opérationnelle grâce à une unité de démonstration déjà en service et l’intégration d’une brique de méthanation. L’appel à projets cible des unités de taille intermédiaire utilisant aujourd’hui le syngas (gaz de synthèse) localement. Publié le 22/01/2026. La géothermie, énergie locale, renouvelable et décarbonée disponible en continu, présente de forts atouts pour la transition énergétique mais reste marginale en France, représentant environ 1 % de la consommation finale de chaleur. Dans une nouvelle enquête, la Cour des comptes analyse l’efficacité des soutiens publics dédiés à son développement. Elle constate un écart persistant entre des objectifs ambitieux et un déploiement limité. Les freins identifiés sont principalement les coûts d’investissement élevés, les risques techniques et géologiques ainsi que la complexité et la lenteur des procédures administratives. Les aides mobilisées jusqu’à présent n’ont pas permis de lever ces obstacles. Malgré ses bonnes performances environnementales, la géothermie de surface demeure peu développée, notamment dans le logement collectif. Les objectifs de triplement de la production de chaleur d’ici 2035 apparaissent peu réalistes en l’état. La Cour privilégie la simplification des règles et une meilleure priorisation des soutiens plutôt qu’une augmentation des subventions. La géothermie profonde, surtout destinée aux réseaux de chaleur urbains, est jugée compétitive mais freinée par des investissements initiaux importants et des incertitudes sur la ressource. L’atteinte des objectifs suppose une réduction des délais administratifs et une adaptation de la filière. La géothermie électrogène, limitée en métropole, constitue un enjeu stratégique pour les territoires ultramarins. La Cour conclut que le succès repose avant tout sur une meilleure organisation des soutiens, une gestion plus claire des risques et un renforcement de la connaissance du sous-sol. Publié le 22/01/2026. Mercredi 21 janvier, l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) a dévoilé l’édition 2025 de son baromètre de l’électricité renouvelable en France, lors d’une conférence de presse avec les deux partenaires du projet, l’Ademe et la FNCCR. Un document de près de 180 pages qui dresse l’état des lieux de huit filières et analyse leur évolution au cours des douze derniers mois. Le constat est clair : si les capacités installées ont continué de progresser en 2025, les incertitudes sur les trajectoires futures s’accentuent. Avec plus de 5 GW raccordés en un an, le photovoltaïque confirme son rôle de moteur, représentant à lui seul près des trois quarts des nouvelles capacités mises en service. Cette dynamique contraste toutefois fortement avec les difficultés rencontrées par les autres filières. L’éolien terrestre a enregistré son plus mauvais millésime depuis plus de dix ans, tandis que l’éolien en mer peine à rattraper les retards accumulés sur les premiers projets. De son côté, l’hydroélectricité reste cantonnée à la rénovation de l’existant, sans véritables perspectives de nouveaux développements. Au total, l’électricité d’origine renouvelable représente désormais plus de 32 % de la consommation française. Un atout stratégique pour la souveraineté énergétique du pays, dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Pour maintenir la dynamique à l’horizon 2030 et au-delà, l’ensemble des acteurs de la filière – développeurs, industriels et collectivités – appelle l’État à publier sans plus attendre la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Attendue depuis trois ans, celle-ci doit fixer des objectifs clairs et donner de la visibilité aux investissements. Mais les professionnels redoutent une révision à la baisse des ambitions, à la suite du bilan prévisionnel publié par RTE en décembre dernier, qui pointait une électrification des usages trop lente menant à une surcapacité de production électrique. Selon les acteurs du secteur, la France dispose aujourd’hui grâce à cela d’une électricité abondante, décarbonée et compétitive – autant de conditions favorables pour accélérer l’électrification de l’économie et la sortie des énergies fossiles, tout en poursuivant le développement des énergies renouvelables Publié le 15/01/2026. Le projet AeroVerde marque le lancement d’une collaboration entre Haffner Energy et IGNIS P2X pour développer des carburants d’aviation durables en Espagne. Le projet repose sur la technologie de Haffner Energy, qui transforme des résidus de biomasse sans conflit d’usage en gaz de synthèse riche en hydrogène. Ce syngaz (gaz de synthèse) permet la production de carburant vert pour l’aviation, Sustainable Aviation Fuel en anglais ou SAF, via différentes voies technologiques. Le CO₂ biogénique généré pourra être combiné à de l’hydrogène renouvelable produit par IGNIS P2X pour fabriquer le carburant. Le programme ReFuelEU Aviation de l’Union européenne impose une incorporation de 6 % de SAF dans le transport aérien d’ici 2030. Pourtant, les SAF ne représentaient que 0,6 % des carburants aériens en Europe en 2024, selon l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Une grande partie provenait d’importations de matières premières asiatiques, critiquées pour leur empreinte carbone par l’International Air Transport Association. AeroVerde vise à répondre à ces limites par une production locale et circulaire. Le site sera implanté de manière à optimiser l’accès aux résidus de biomasse et la proximité des zones de consommation. Publié le 15/01/2026. Neoen vient d’annoncer la signature d’un contrat avec le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité RTE pour soutenir la stabilité du réseau de transport d’électricité français. L’objet de leur collaboration se nomme Breizh Big Battery (BBB), une batterie ayant une fonction « grid forming », capable de contribuer à l’équilibre du réseau. En France, les centrales de stockage par batterie actuelles fonctionnent en mode « grid following », selon lequel les onduleurs se synchronisent sur une mesure de la fréquence du réseau électrique. Par nature « suiveuses », ces installations offrent une réponse plus lente et plus limitée aux variations du réseau électrique. En changeant le mode de synchronisation des onduleurs (rétrofit), les batteries de grid forming sont capables de contribuer à stabiliser la tension et la fréquence du réseau électrique de manière autonome en compensant les variations. Sans dépendre d’une source de référence externe, le grid forming permet de réagir instantanément aux perturbations du réseau électrique, apportant un effet de stabilisation plus rapide au système. Pour évaluer les bénéfices du grid forming, RTE et Neoen viennent de s’engager, pour une année au moins, dans une expérimentation qui vise à tester le rétrofit de l’onduleur du mode grid following au mode grid forming. D’une puissance de 92 MW / 183 MWh, la BBB sera l’une des plus grandes batteries de France et la plus grande de Bretagne. La batterie lithium-ion sera située dans la commune de Pleyber-Christ, dans le Finistère. Actuellement en construction, elle devrait entrer en service au cours de l’été 2026. Publié le 08/01/2026. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de rendre public son rapport 2025 sur les réseaux dits intelligents. Cet exercice sert à mesurer le degré de « numérisation » et d’agilité du système électrique français, ainsi qu’à évaluer les points d’attention, afin que les volumes de capacités renouvelables et de stockage réellement raccordables restent compatibles avec les trajectoires 2030-2050. Dans l’ensemble, la Commission constate que les technologies numériques sont largement déployées et utilisées de manière industrielle à tous les niveaux des réseaux d’électricité, ce qui place les gestionnaires de réseaux français en bonne position par rapport à leurs homologues européens. La bonne utilisation de ces technologies génère des économies significatives pour le consommateur. Toutefois, la CRE estime que les gestionnaires de réseaux peuvent encore aller plus loin, alors que le système est en pleine transformation. Notamment en matière de raccordements optimisés : si les offres de raccordement dites « intelligentes » ou flexibles (avec modulation de puissance) restent encore minoritaires, leur usage progresse. Quinze parcs d’énergie renouvelable ont été raccordés en raccordement flexible (ORA-MP) en 2024, contre cinq en 2023. Pour aller plus loin, la CRE juge même que le plafond de 30 % de puissance limitée devrait être assoupli, voire supprimé, afin d’accueillir davantage d’énergie renouvelable sur le réseau sans attendre la fin des travaux de renforcement – et même, parfois, d’éviter des investissements coûteux. La CRE demande également aux gestionnaires de réseaux de continuer à veiller à la fiabilité des données qu’ils mettent à disposition des acteurs, compte tenu de leur rôle essentiel dans le développement de nouvelles offres. Les données récoltées et partagées sont de plus en plus nombreuses et variées : cartographie des réseaux, capacités, production, consommation, stockage. Elles sont aussi de plus en plus consultées par les consommateurs sur les plateformes d’open data, dont la fréquentation a quasiment quadruplé depuis 2021, passant de 10 000 visiteurs à 38 500 en 2024. Publié le 08/01/2026. La Ville de Versailles confie à Engie la transformation, la modernisation et la décarbonation de son réseau de chaleur pour une durée de 32 ans. Deux doublets géothermiques seront forés à 1 500 mètres de profondeur afin d’exploiter la nappe du Dogger. À l’horizon 2030, cette énergie locale et renouvelable couvrira 69 % du mix énergétique du réseau, contribuant à verdir durablement le patrimoine immobilier de la Ville. La nouvelle chaufferie, implantée sur le site existant, accueillera quatre échangeurs géothermiques d’une puissance totale de 24 MW et huit pompes à chaleur. Les chaudières gaz actuelles seront rénovées et conserveront un rôle d’appoint. Cette modernisation permettra de réduire d’environ 70 % les émissions de CO₂, soit près de 900 000 tonnes évitées sur l’ensemble de la durée du contrat. Engie prévoit un investissement global de 110 millions d’euros, avec le soutien attendu du Fonds Chaleur de l’Ademe. Parallèlement, le réseau sera étendu en centre-ville et sur le plateau de Satory, pour atteindre 35 kilomètres de canalisations et alimenter à terme près de 19 600 équivalents-logements. Publié le 23/12/2025. Accenta et Foncia ont inauguré, le 15 décembre, un système de chauffage géothermique à la résidence Les Vertes Campagnes, à Gex, dans l’Ain. Construite en 1960, cette copropriété de 61 logements répartis sur trois bâtiments a remplacé ses équipements vieillissants de chauffage au gaz. L’objectif est de réduire à la fois les charges énergétiques et l’empreinte carbone du site. Après une isolation thermique par l’extérieur réalisée en 2014, les copropriétaires ont engagé ce projet en mai 2022. L’installation repose sur un dispositif hybride associant 17 sondes géothermiques de 200 mètres de profondeur, deux pompes à chaleur géothermiques et des panneaux solaires thermiques en toiture. Un appoint au gaz, assuré par trois chaudières, complète le système. L’ensemble est piloté par une régulation automatisée et prédictive, qui ajuste la production de chaleur en temps réel et privilégie le recours aux énergies renouvelables. Les performances attendues font état d’une baisse estimée de 76 % de la consommation énergétique liée au chauffage. Les émissions de CO₂ devraient, quant à elles, reculer de 91 %. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un contrat de performance énergétique conclu sur 30 ans. Ce mécanisme repose sur un engagement d’Accenta qui garantit les économies d’énergie réalisées. Il permet également un financement de long terme, étalé sur 25 ans. Publié le 23/12/2025. L’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) vient de mettre en ligne un travail d’analyse de la dynamique des pompes à chaleur géothermiques dans les bâtiments collectifs. L’étude a été réalisée à partir d’une série d’entretiens menés auprès de professionnels du secteur afin de commenter les principaux aspects de ce segment encore peu connu du grand public. Profitant du plan national d’action en faveur de la géothermie lancé en 2023, et également du travail de plusieurs réseaux d’acteurs, les opérations de pompes à chaleur dans des bâtiments tertiaires, résidentiels collectifs ou industriels ont pris une nouvelle dimension depuis 2021. Les réalisations dans le tertiaire sont ainsi passées de 100 en 2020 à près de 250 en 2024. Solutions trop souvent écartées hâtivement par le passé, les technologies de géothermie dite de minime importance ont largement étoffé leurs réseaux de bureaux d’études, d’installateurs et de foreurs afin de pouvoir proposer leurs services pour produire de la chaleur comme du rafraîchissement sur l’ensemble du territoire de France continentale. Le principal obstacle à un développement plus large réside dans un coût d’investissement (Capex) élevé, qui peut dissuader malgré l’assurance d’un coût d’exploitation (Opex) stable et très allégé pendant les nombreuses années de fonctionnement des équipements géothermiques. Pour avancer sur ce point, et en complément du Fonds chaleur encore essentiel pour l’émergence de nouvelles réalisations, la filière propose depuis quelques années des montages en tiers-investissement. Bien calibrée, cette solution permet à un maître d’ouvrage un investissement indolore grâce à des contrats d’achat de chaleur sur le long terme. Une approche qui a déjà fait ses preuves dans d’autres filières, notamment dans le cadre de grandes opérations de solaire thermique dans l’industrie, comme celle des 15 000 m2 de capteurs installés sur le site de production de Lacto Sérum France, filiale du groupe Lactalis, situé à Fromeréville-les-Vallons près de Verdun – Meuse (voir actu du 4 février 2021). Publié le 18/12/2025. Qair annonce la production de la première molécule d’hydrogène renouvelable de son unité Hyd’Occ, située à Port-La Nouvelle (Aude). Cette étape marque la fin de la phase de tests et le début de la montée en puissance industrielle du site, avant sa mise en service commerciale début 2026. À l’occasion de l’escale du navire Energy Observer, cette première molécule a été transmise symboliquement à son équipage, illustrant un engagement commun en faveur de la transition énergétique. Hyd’Occ, confirme ainsi le bon fonctionnement de ses équipements d’électrolyse. Sa première phase, d’une puissance de 20 MW, permettra de produire 2 700 tonnes d’hydrogène renouvelable par an. Cette production alimentera notamment les stations hydrogène d’Occitanie, à commencer par celle de Béziers. Une seconde phase portera la capacité du site à 40 MW et 5 400 tonnes par an. Cette réalisation s’inscrit dans une dynamique européenne visant à décarboner la mobilité lourde et les transports grâce à l’hydrogène renouvelable. Publié le 18/12/2025. Dans une lettre datée du 11 décembre 2025, le Conseil européen de l’énergie géothermique (EGEC) a interpellé la Commission européenne appelant à l’adoption urgente d’une stratégie et d’un plan d’action européens dédiés à la géothermie. Alors que l’Agence internationale de l’énergie prévoit un quadruplement de la production mondiale de géothermie, l’EGEC alerte sur le risque de voir l’Europe rester à l’écart de cette dynamique, mettant ainsi en danger sa souveraineté technologique, sa sécurité énergétique, son tissu industriel et ses objectifs climatiques. Soutenu par de nombreux acteurs institutionnels et industriels (plus de 140 entités ont cosigné la lettre), l’EGEC plaide pour une approche globale couvrant l’électricité, le chauffage, le refroidissement, le stockage ainsi que l’extraction de matières premières critiques comme le lithium. L’organisation estime qu’un signal politique clair de l’Europe, accompagné d’investissements, de procédures simplifiées et d’outils financiers adaptés est nécessaire afin de libérer le potentiel de cette énergie qui a toutes les vertus : elle est locale, pilotable et peut s’adapter aux besoins des ménages, des collectivités ou d’acteurs industriels. Publié le 11/12/2025. Alpiq et Vialis, l’entreprise locale de distribution (ELD) implantée dans le Haut-Rhin, ont signé un accord stratégique pour développer la future centrale hydroélectrique Lac Blanc / Lac Noir, située à Orbey dans le Haut-Rhin. Ce partenariat vise à répondre conjointement à l’appel à candidature national prévu pour mi-2026 pour l’exploitation de la concession hydroélectrique Lac Blanc / Lac Noir, une ancienne station de transfert d’énergie par pompage (Step). À l’arrêt depuis 2012, le site devra être entièrement reconstruit et les voies d’eau rénovées. Inscrit dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, ce projet doit aboutir à la mise en service d’une centrale affichant une puissance comprise entre 50 et 70 MW, qui offrira environ dix heures de stockage, renforçant ainsi la flexibilité du système électrique. Alpiq apporte son expérience dans l’hydroélectricité et le pompage-turbinage, confirmée par des projets majeurs comme la Step de Nant de Drance de 900 MW, mise en service en 2022, en Suisse. L’entreprise développe également des solutions de stockage en France, dont un projet de batterie de 100 MW dans l’Oise. Vialis, en tant qu’ELD, garantit un ancrage territorial fort et une réponse adaptée aux enjeux énergétiques régionaux. Publié le 11/12/2025. La Commission européenne a accordé à 235 projets énergétiques transfrontaliers le statut de Projets d’Intérêt Commun (PIC) et de Projets d’Intérêt Mutuel (PIM), leur donnant accès à un financement européen et à des procédures accélérées. Cette nouvelle liste vise à renforcer l’interconnectivité énergétique en Europe et avec les pays voisins. Les projets sélectionnés contribueront à l’Union de l’Énergie, à la décarbonation et à la sécurité énergétique. Les besoins d’investissement en infrastructures d’électricité, d’hydrogène et de CO₂ sont estimés à 1 500 milliards d’euros d’ici 2040. La liste inclut 113 projets de réseaux électriques et smart grids pour intégrer davantage de renouvelables. Elle comprend aussi 100 projets dans l’hydrogène et les électrolyseurs, essentiels à la transition énergétique. 17 projets concernent le transport de CO₂ pour développer le captage et le stockage du carbone. 3 projets vont aussi moderniser le réseau gazier européen. Deux projets historiques relient Malte et Chypre au réseau gazier continental. La Commission renforcera la coordination politique avec les États membres pour accélérer les chantiers. La liste des projets sera examinée par le Parlement et le Conseil, qui ont deux mois pour l’accepter ou la rejeter. Publié le 04/12/2025. Le 4 décembre 2025, le SFCB (Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse) a manifesté devant l’Assemblée nationale pour dénoncer le retrait des chaudières bois de MaPrimeRénov’, prévu au 1er janvier 2026. Le syndicat a choisi cette date symbolique, un an après la première décision gouvernementale réduisant les aides à destination de ces équipements, alors que deux rendez-vous politiques consacrés à l’énergie se tenaient le même jour. Selon le SFCB, la réorientation de MaPrimeRénov’ et des primes CEE crée un écart de soutien grandissant entre pompes à chaleur et chaudières bois, deux solutions pourtant décarbonées et complémentaires. Cette évolution modifierait les choix des ménages en matière de solution de chauffage, qui pourraient être davantage guidés par l’incitation financière que par la pertinence technique. L’association rappelle que dans les zones rurales, en bout de réseau électrique ou dans les grandes maisons anciennes, mal isolées ou difficilement isolables, la chaudière bois reste souvent l’option la plus adaptée et la plus pertinente. Le SFCB conteste également la logique d’économies budgétaires, estimant que les 20 millions d’euros d’aides MaPrimeRenov’ supprimées pour la filière représentent près de 200 millions d’euros de travaux non réalisés. Pour toutes ces raisons, le syndicat demande un traitement équitable entre chaudières à bois et pompes à chaleur et appelle au retrait ou au report de l’arrêté prévoyant la fin de l’éligibilité des chaudières bois aux aides de MaPrimeRénov’. Publié le 04/12/2025. Le Service des données et études statistiques (SDES) a dévoilé ses tableaux de bord du troisième trimestre 2025. Comme au premier semestre, les filières des énergies renouvelables évoluent à des vitesses très contrastées. L’éolien terrestre traverse une année particulièrement sombre : seuls 232 MW ont été raccordés entre juillet et septembre, portant le total à 532 MW depuis janvier. Un niveau historiquement bas, en chute de 31 % par rapport à 2024 et de 45 % comparé aux neuf premiers mois de 2023. À ce rythme, la filière pourrait terminer l’année sous la barre symbolique du gigawatt raccordé, une première depuis 2015. En mer, la dynamique est tout autre : le parc des îles d’Yeu et de Noirmoutier est désormais intégralement raccordé, ajoutant 500 MW au réseau. À l’inverse de l’éolien terrestre, le photovoltaïque affiche toujours une belle croissance. Avec 4,5 GW nouvellement raccordés depuis janvier, la filière progresse de 22 % par rapport à 2024. Sur les neuf premiers mois de l’année, la production solaire s’est élevée à 28,6 TWh (hors autoconsommation), couvrant 7,9 % de la consommation électrique nationale. Enfin, l’engouement pour l’autoconsommation ne se dément pas puisque les installations ayant opté pour ce mode de valorisation (de façon partielle ou totale) représentaient 60 % de l’ensemble des installations photovoltaïques du pays et 16 % de la puissance totale installée. Publié le 27/11/2025. Le groupe Bel, acteur français de poids dans l’agroalimentaire, vient d’inaugurer une chaudière biomasse sur son site d’Ulzama, situé en Navarre, qui produit les portions de « La Vache qui rit » destinées au marché espagnol et portugais. Ce nouvel équipement, d’une puissance de 700 kW, sera alimenté en granulés de bois issus de ressources locales et couvrira 100 % des besoins en vapeur du site, permettant ainsi une réduction annuelle de 500 tonnes d’émissions de CO₂. L’investissement de ce projet s’élève à 700 000 € et va permettre au site d’opérer entièrement à partir d’énergies renouvelables, puisque l’usine combinait déjà de l’électricité verte certifiée et des panneaux photovoltaïques installés en toiture. Ulzama devient ainsi le deuxième site international du groupe Bel équipé d’un système biomasse, après celui de Tanger au Maroc. C’est en revanche la première chaudière à granulés du groupe. D’autres projets sont en cours, notamment deux nouvelles installations de biomasse prévues en France, dont celle du site de Lons-le-Saunier (39). Publié le 27/11/2025. Si la géothermie profonde permet de chauffer actuellement l’équivalent d’un million de personnes en France, la très grande majorité des 80 installations existantes est située en région parisienne. D’autres territoires pourraient pourtant profiter de la chaleur présente dans l’eau des nappes souterraines, entre 1 000 et 3 000 mètres de profondeur. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où aucune installation n’est en service, un programme d’exploration a ainsi été mis en place. Baptisé Géoscan Arc, il a pour objectif d’imager une partie du sous-sol régional qui semble propice au déploiement de cette technologie. Le territoire choisi correspond à la structure géologique du synclinal de l’Arc, autour de l’étang de Berre, et s’étend de Fos-sur-Mer à l’Ouest à Aix-en-Provence à l’Est et de Sausset-les-Pins au Sud à Lançon-Provence au Nord. Des données ont été acquises entre le 17 octobre et le 17 novembre 2024 grâce à des camions vibreurs et une barge installée sur l’étang de Berre. Elles sont actuellement croisées avec un travail géologique de terrain et de laboratoire pour tenter d’identifier la présence d’eau chaude dans les roches. L’initiative est portée par l’Ademe et le BRGM, en partenariat avec la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les résultats finaux sont prévus à la fin du premier semestre 2026. Publié le 20/11/2025. La première pierre de la future unité de valorisation énergétique de Labeuvrière (Pas-de-Calais) a été posée le 6 novembre. Le projet est porté par Idex pour le compte de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. La conception a débuté en septembre 2023 et les travaux en septembre 2025, pour une mise en service prévue en 2027. L’investissement global atteint 150 millions d’euros et Spie batignolles génie civil réalisera pour 35 millions d’euros de travaux, notamment le génie civil, le clos-couvert et un bâtiment administratif. L’installation traitera jusqu’à 100 000 tonnes de déchets par an via deux fours et deux chaudières de près de 20 MW chacune. Le site produira 41 GWh de vapeur pour l’usine de chimie Croda, 56 GWh de chaleur pour le réseau urbain de Béthune et 40 GWh d’électricité injectée au réseau. Un double système de filtration garantira la maîtrise des émissions atmosphériques. Publié le 20/11/2025. Newheat et Les Tomates d’Auïtou (Corrèze) annoncent la mise en service d’une centrale solaire thermique dédiée au maraîchage sous serres chauffées. Cette installation permet à l’exploitation de capter la chaleur du soleil pour chauffer ses serres. Grâce à ce système, le site atteint désormais 98 % de chaleur renouvelable. Il s’agit de la première centrale de Newheat dédiée à la culture maraîchère. Le projet a bénéficié du soutien du Fonds Chaleur de l’Ademe. Les Tomates d’Auïtou, cultivent 100 000 plants sous 8 hectares de serres sans pesticides. L’exploitation est déjà très autonome : 100 % en eau et 71 % en électricité grâce au photovoltaïque. Le solaire thermique vient remplacer le propane utilisé en appoint lorsque la chaleur de l’unité de valorisation énergétique voisine n’était pas disponible. L’installation comprend 7 091 m² de capteurs, une cuve de stockage de 1 500 m³ et une intégration complète au réseau de chaleur. Le chantier a été réalisé en seulement trois mois et Newheat assurera deux ans de maintenance et d’optimisation via un pilotage automatisé. Cette centrale, réplicable, permet d’augmenter les rendements agricoles et de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Publié le 13/11/2025. Covéa Immobilier a confié à la start-up Geosophy l’assistance à maîtrise d’ouvrage des équipements de chauffage, ventilation et climatisation de son immeuble parisien emblématique, Oscar, situé rue de Charonne (XIe). Cette restructuration majeure de 15 000 m², vise à transformer un ancien bâtiment du début du XXe siècle en un ensemble moderne de bureaux et commerces, alliant confort, végétalisation et performance environnementale. Pour répondre à ses objectifs de durabilité, Covéa a opté pour un système de géothermie de surface, une première pour un bâtiment centenaire de ce type. Deux forages de 57 mètres ont permis d’installer une thermo-frigo-pompe de 250 kW exploitant la nappe phréatique, complétée par une pompe à chaleur en toiture. Ce dispositif permet de couvrir 80 % des besoins énergétiques annuels du bâtiment et de diviser par sept sa consommation globale. La diffusion de la chaleur et du froid est assurée par des centrales d’air et des panneaux rayonnants à basse température. Grâce à ce système, la consommation de chauffage passera de 1 536 MWh/an à 227 MWh/an, et celle de climatisation à seulement 126 MWh/an. Publié le 13/11/2025. Verso Energy a été sélectionné par le Fonds pour l’Innovation de la Commission européenne pour deux de ses projets de production de carburants durables de synthèse pour l’aviation (e-SAF) : DEZiR et ReSTart. Ces projets figurent parmi les trois initiatives e-SAF retenues au titre du guichet « Large Scale », principal dispositif européen de soutien à la décarbonation industrielle. Implanté dans l’Eure et sur la zone industrielle de Rouen, le projet DEZiR – pour Décarbonation en Seine-Eure et sur la Zone industrielle de Rouen – vise la décarbonation du territoire, tandis que ReSTart, à Tartas (Landes), est développé en partenariat avec l’industriel Rayonier A.M. Les deux projets ambitionnent de faire partie, d’ici 2030, des premières usines européennes de production à grande échelle de carburants de synthèse pour l’aviation, en cohérence avec le règlement ReFuelEU Aviation et les objectifs du Pacte vert européen. Ces projets reposent sur la combinaison de CO₂ biogénique avec de l’hydrogène obtenu par électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable, et de la conversion de e-méthanol en e-kérosène selon le procédé « Methanol-to-Jet ». Le montant des subventions attendues n’a pas été précisé. Publié le 06/11/2025. Le 3 novembre a été posée la première pierre de la chaufferie biomasse La Ribière, au sud de Limoges. Porté par la collectivité et exploité par Engie Solutions pour 30 ans, ce projet s’inscrit au cœur du futur réseau de chaleur urbain Limoges Sud Énergies Services. Située rue Archimède, la chaufferie combinera pompes à chaleur (3,4 MW), chaudière biomasse (8,5 MW) et chaudières gaz d’appoint (16 MW) pour atteindre 98 % d’énergies renouvelables et de récupération. Elle permettra d’éviter chaque année plus de 8 000 tonnes de CO₂ et de garantir une chaleur stable et compétitive. Cette installation de 1 680 m², équipée de 270 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, fournira de la chaleur à près de 5 900 équivalents-logements ainsi qu’à des sites emblématiques comme la Cité du Sablard, le siège social de Legrand, le centre de gérontologie Chastaingt, la polyclinique Chénieux ou le centre sportif Cheops. Représentant un investissement global de 32 millions d’euros, le chantier s’étendra jusqu’à fin 2026 pour un réseau de 14,3 kilomètres et 51 sous-stations. L’énergie biomasse proviendra à 100 % de forêts et scieries locales, soutenant ainsi une filière bois durable et génératrice d’emplois. Publié le 06/11/2025. L’entreprise Solar Brother, spécialisée dans les solutions solaires, a annoncé l’installation de son système de préchauffage solaire aérothermique SunAéro dans une classe de l’école primaire de Carnoules (Var). Le système fonctionne sur le principe suivant : l’air extérieur est aspiré, réchauffé par des panneaux solaires (générant une chaleur supplémentaire de 3 à 5°C), puis diffusé à l’intérieur par un système de ventilation automatisé. Selon les mesures réalisées sur 15 jours depuis la mise en service de la classe pilote Algéco début octobre, la température intérieure naturelle atteignait jusqu’à 25 °C en journée (pour une température extérieure proche de 15 °C), tandis que le taux d’humidité était passé de 60 % à 40 %, avec un renouvellement complet de l’air chaque heure. Une étude de performance détaillée sera publiée au printemps 2026 afin d’évaluer les gains énergétiques et de confort associés à cette technologie. Une nouvelle installation est prévue à La Londe-les-Maures, avant un déploiement plus large dans le Var et à Marseille. Solar Brother étudie également l’application du dispositif à d’autres typologies de bâtiments, tels que les bureaux et les bungalows de camping, confrontés à des besoins similaires en chauffage et en ventilation. Publié le 30/10/2025. Le groupe Voltalia a annoncé le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary (10,5 MW), en Guyane. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Pôle Scierie et Énergie de Petit-Saut. Doté d’un investissement de plus de 200 millions d’euros, le programme comprend trois volets : la récolte du bois immergé dans le lac de Petit-Saut, son exploitation par une scierie locale produisant environ 9 000 m³ de bois de construction par an, et l’alimentation de la centrale biomasse par les essences non valorisables. Prévue pour fonctionner sur une période de 25 ans, la centrale est actuellement en phase finale de tests avant sa mise en service complète. Avec une production estimée à plus de 80 GWh par an, elle pourrait couvrir jusqu’à 8 % des besoins électriques de la Guyane. Ce projet permettra par ailleurs à Voltalia de doubler ses capacités locales et de représenter désormais l’équivalent de 16 % de la consommation d’électricité du territoire, aux côtés de ses centrales biomasse de Kourou (1,7 MW) et de Cacao (5,1 MW). Publié le 30/10/2025. Saint-Gobain Glass, en partenariat avec GRDF et Methagora, a testé l’intégration du biométhane local dans la production de verre plat à son usine Eurofloat de Salaise-sur-Sanne (Isère). La première expérimentation, menée fin août avec GRDF, visait à décarboner un site industriel grâce à l’injection de biométhane dans le réseau local. Le gaz, issu d’une station BioGNV proche du site, a été utilisé lors des périodes de faible consommation locale, les week-ends par exemple. Ce test s’inscrit dans le programme de GRDF pour développer des solutions d’équilibrage du réseau gazier. Une seconde opération, réalisée avec l’expert du gaz porté (transport par camion) Methagora, a consisté à livrer du biométhane par camion-citerne. Ce biométhane, produit à partir de déchets agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes, a été collecté, épuré et compressé localement. Il a ensuite été transporté directement jusqu’à l’usine pour être valorisé dans la production de verre. Les deux expérimentations ont confirmé la faisabilité de l’approvisionnement local en biométhane. Elles illustrent son potentiel de substitution au gaz naturel fossile. Le biométhane, six fois moins carboné que le gaz fossile, permet de réduire significativement les émissions. Publié le 23/10/2025. Spécialiste des biocarburants B100 (100 % biodiesel) et HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), Altens poursuit sa diversification dans les énergies renouvelables dédiées au transport. L’entreprise annonce l’ouverture prochaine d’une station publique bioGNV à Moret-Loing-et-Orvanne, en Seine-et-Marne. Située dans la zone d’activités des Renardières, cette station est le fruit d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en 2023. Altens en a assuré la conception, l’installation et sera également responsable de son exploitation. L’ouverture au public est prévue d’ici la fin de l’année 2025. La station pourra distribuer jusqu’à 1 000 tonnes de bioGNV par an et accueillir trois véhicules simultanément. Elle permettra le ravitaillement d’une dizaine de poids lourds par heure, avec un plein effectué en dix minutes pour un réservoir de 120 kg. Côté approvisionnement, Altens a misé sur une logique d’économie circulaire : le bioGNV proviendra de deux unités de méthanisation locales, Biogaz Charmentray et VDMT Biogaz, toutes deux situées en Seine-et-Marne. La future station servira à la fois les autobus d’Île-de-France Mobilités opérés par Transdev, les bennes à ordures ménagères, ainsi que les transporteurs locaux. Avec ce nouveau site, Altens consolide sa présence sur le marché du bioGNV. Après la station de Guise (Aisne), dont l’ouverture est attendue en octobre, celle de Moret-Loing-et-Orvanne sera la deuxième du réseau Altens. Un troisième projet est en chantier à Gondreville (Meurthe-et-Moselle) avec une mise en service prévue pour le printemps 2026. Publié le 23/10/2025. Organisé par la SPL Occitanie Events avec le soutien de la Région Occitanie, le Forum EnerGaïa s’impose comme un carrefour majeur des énergies renouvelables. Fort d’une croissance de +32 % en 2024, le Forum accueillera en décembre : 550 exposants, 24 000 participants et 150 conférences et tables rondes. Le Forum a dévoilé les 12 nominés des Trophées de l’innovation 2025, lors de sa conférence de presse à Paris le 20 octobre. Les Trophées de l’innovation EnerGaïa distinguent 12 solutions ou produits innovants présentés par les exposants. Quatre prix seront décernés : Prix International, Prix Déployabilité, Prix Ecosystème et Prix Circularité. Cette sélection des projets nominés sera exposée dans la Galerie de l’innovation (Hall B3) pour permettre aux visiteurs de découvrir les innovations qui participent aux projets d’énergies renouvelables de demain. Dans la catégorie International, les projets d’Heliorec, Qannt et SMA France illustrent les avancées dans le solaire flottant, la cohabitation entre éolien et biodiversité, et le stockage d’énergie. En Déployabilité, Celsius Energy, GSE Integration et Soprasolar proposent des innovations facilitant le déploiement rapide et durable du solaire et de la géothermie. Côté Écosystème, Serenysun Énergies, SNEF et Valorem misent sur des projets collaboratifs locaux favorisant l’autonomie énergétique. Enfin, la catégorie Circularité distingue AX Group, Novotegra et Voltec Solar pour leurs solutions axées sur le recyclage, le réemploi et la réduction des ressources.Toutes les innovations nominées sont à retrouver sur le site www.energaia.fr Publié le 16/10/2025. Solar Heat Europe vient de publier son Market Outlook 2024, qui dresse un constat mitigé du secteur solaire thermique : avec 1,2 million de m² de capteurs installés en 2024, la filière n’a progressé que modestement, portant la capacité totale en service à 43,6 GWth en Europe. Le secteur n’enregistre qu’une hausse limitée de 0,4 % par rapport à 2023, un rythme bien en deçà des ambitions fixées par le plan REPowerEU de la Commission européenne. Pour les industriels européens, cette stagnation reflète un manque de soutien politique et des signaux de marché trop instables, notamment en Allemagne et en France. « Nous appelons d’urgence les autorités à accélérer la promotion de la chaleur solaire dans tous les segments – bâtiments, réseaux urbains, industrie », plaide Guglielmo Cioni, président de Solar Heat Europe. Selon lui, cette technologie « renouvelable, décentralisée, prête à l’emploi et fabriquée dans l’UE » répond à tous les critères de la transition énergétique. Malgré un contexte incertain, le secteur observe cependant quelques avancées : des projets de grande envergure émergent, notamment dans les réseaux de chaleur d’Europe centrale et du Nord, et les solutions hybrides PVT (photovoltaïque + thermique) gagnent du terrain. La directrice générale de Solar Heat Europe, Valérie Séjourné, mise désormais sur la Stratégie européenne pour le chauffage et le refroidissement, attendue en 2026, pour donner un nouvel élan. « Cette stratégie peut marquer un tournant décisif pour le solaire thermique, une ressource « made in Europe » capable d’offrir une énergie prévisible et abordable », souligne-t-elle. Publié le 16/10/2025. Geoval s’agrandit. Début octobre, des travaux d’extension de ce réseau de chaleur géothermique, qui s’étend sur Lognes et Torcy et est exploité par Dalkia dans le cadre d’une délégation de service public avec la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (CAPVM), ont été inaugurés. Geoval devrait passer de 13 km à plus de 20 km d’ici à 2027. Quarante nouveaux abonnés seront reliés, parmi lesquels des logements sociaux, des bâtiments communaux et des sites administratifs. Le réseau alimentera alors au total l’équivalent de 10 000 habitants, évitant ainsi 13 000 t CO₂ par an. Cette extension est accompagnée d’une augmentation de la puissance de la centrale géothermique. De nouvelles pompes à chaleur performantes sont intégrées, permettant la livraison de 60 GWh/an contre 40 GWh/an auparavant. Le réseau conservera ainsi un taux d’énergie renouvelable d’environ 90 %. Le coût total du projet s’élève à près de 18 millions d’euros. Il est soutenu par l’État via l’Ademe Île-de-France et la Région Île-de-France à hauteur de 3,7 millions d’euros. Publié le 09/10/2025. Le Fonds Chaleur, dispositif national piloté par l’État et opéré par l’Ademe Île-de-France pour le territoire francilien joue un rôle central dans le développement de la chaleur renouvelable et particulièrement de la géothermie. Face à l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, la région francilienne mise sur cette ressource locale et durable. Le chauffage et l’eau chaude représentent 67 % de la consommation énergétique régionale, mais seulement 12 % proviennent d’énergies renouvelables. Le Fonds Chaleur, créé en 2009, vise à combler cet écart. Depuis 2025, 89 millions d’euros ont déjà été engagés en Île-de-France, pour 335 millions d’euros d’investissements, après 90 millions d’euros en 2024. En 2025, 12 projets sont soutenus, dont 5 en géothermie profonde, représentant 440 GWh d’énergie renouvelable et 110 000 tonnes de CO₂ évitées. Depuis sa création, le fonds a appuyé 480 projets dans la région, générant 6,7 TWh/an d’énergie et couvrant les besoins de 2 millions d’habitants. Un exemple emblématique est le réseau de chaleur de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson, porté par Réseau Terra Confort (Coriance), soutenu à hauteur de 29,25 millions d’euros. Ce projet de géothermie profonde produira 127 GWh/an et chauffera 15 000 logements. Le Fonds Chaleur soutient aussi des Contrats Chaleurs Renouvelables Territoriaux (CCR), signés en 2025 avec le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France) et la Ville de Paris, pour mutualiser les projets d’EnR&R (Énergies renouvelables et de récupération). Enfin, l’Ademe a lancé le Réseau Chaleur Renouvelable d’Île-de-France pour sensibiliser et accompagner collectivités et entreprises vers une transition énergétique locale et durable. Publié le 09/10/2025. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les capacités mondiales d’électricité renouvelable devraient plus que doubler d’ici 2030, avec environ 4 600 GW de nouvelles installations. Le photovoltaïque concentrerait près de 80 % de cette croissance, grâce à la baisse de ses coûts, des procédures d’autorisation simplifiées et une forte acceptation sociale. Viennent ensuite l’éolien, l’hydroélectricité, la bioénergie et la géothermie, cette dernière devant atteindre des niveaux records aux États-Unis, au Japon, en Indonésie et dans plusieurs pays émergents. Les défis liés à l’intégration des renouvelables dans les réseaux ravivent par ailleurs l’intérêt pour l’hydraulique à pompage-turbinage. Portée par la Chine et l’Union Européenne, la capacité éolienne mondiale devrait presque doubler pour dépasser 2 000 GW à l’horizon 2030, et ce, malgré des difficultés persistantes dans les chaînes d’approvisionnement et des retards administratifs. L’éolien offshore voit en revanche ses perspectives revues à la baisse, affecté par des goulets d’étranglement industriels, des coûts en hausse, et de changements de politiques dans plusieurs marchés clés. Toutes filières confondues, l’AIE abaisse légèrement ses prévisions de croissance, en raison notamment de modifications de politiques aux États-Unis et en Chine. Le parc mondial atteindrait 9 529 GW d’ici 2030, en deçà de l’engagement pris à la COP28 de tripler les capacités renouvelables d’ici la fin de la décennie (soit 11 450 GW). Publié le 02/10/2025. Chaque année, l’AARHSE (Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l’énergie), avec le soutien de la FNCCR, organise un prix national récompensant des travaux en histoire ou sociologie de l’énergie. La 12ᵉ édition est ouverte aux candidatures jusqu’au 31 janvier 2027. Depuis 2012, ce prix met en valeur des recherches en sciences humaines et sociales, hors économie et droit. Trois catégories sont ouvertes pour la période 2025-2026. La première concerne les thèses ou HDR (habilitation à diriger des recherches) soutenues dans un établissement français. La deuxième distingue une publication : livre, essai, article, œuvre d’art ou autre support. La troisième est dédiée aux mémoires de master. Au total, 10 000 euros de dotations sont prévus pour valoriser les travaux primés. Les deux premières catégories reçoivent chacune 4 000 euros, répartis entre le lauréat et des actions de diffusion. La troisième catégorie attribue 2 000 euros au mémoire récompensé. En 2025, trois chercheurs ont été distingués, dont Alix Chaplain pour une thèse sur l’électricité au Liban. Radouan Andrea Mounecif a reçu le prix de Publié le 02/10/2025. Le 23 septembre, à Créteil, dans le Val-de-Marne, a été inaugurée une station d’hydrogène renouvelable raccordée à une unité de valorisation énergétique (UVE). Ce projet, baptisé H2 Créteil, a été achevé après 12 mois de travaux. La station est directement alimentée par l’UVE du Syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM), qui traite les déchets de 19 communes du Val-de-Marne. Elle produit une tonne d’hydrogène renouvelable par jour, grâce à l’électrolyse de l’eau. L’électricité nécessaire provient exclusivement de la combustion des déchets ménagers. La capacité pourra être doublée à terme, atteignant deux tonnes quotidiennes. Cette production alimente les acteurs de la mobilité verte du Val-de-Marne. La Banque des Territoires a contribué au financement via le programme européen CEF Transport. Le projet illustre l’intégration entre gestion des déchets et transition énergétique. Publié le 02/10/2025. L’Association Française du Poêle Maçonné Artisanal (AFPMA) annonce l’ouverture d’une formation pour le métier de poêlier-constructeur mainteneur de poêle maçonné artisanal. Cette formation, unique en France, permettra aux participants d’obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP), validé en décembre 2023 par les CPNE du Bâtiment (commissions paritaires nationales de l’emploi) et inscrit au registre de France Compétences en mai 2024. Elle donnera aux stagiaires les compétences nécessaires à la conception, la réalisation et l’entretien d’un poêle de masse et de son conduit. En partenariat avec le Greta du Limousin, la formation sera dispensée au sein du lycée des métiers du Bâtiment de Felletin, dans la Creuse. Le contenu pédagogique est organisé en six modules, qui s’étaleront de novembre 2025 à juin 2026. Pour les candidats venant d’autres régions, des possibilités de logement et de restauration sont proposées par le lycée. Le coût de la formation est éligible à différents dispositifs de financement de la formation professionnelle (CPF, OPCO, France Travail). Les poêles de masse représentent une niche (environ 1 500 ventes annuelles) au sein du marché des appareils de chauffage domestiques au bois. Composé d’un foyer et d’un accumulateur de chaleur, le poêle s’intègre dans un ouvrage maçonné qui peut revêtir une grande variété de formes et de finitions. Ses avantages sont une émission de chaleur très homogène et une consommation réduite de bois. Publié le 02/10/2025. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ouvert le 26 septembre une consultation publique sur le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) publié en février par RTE. Le SDDR prévoit près de 100 milliards d’euros d’investissements entre 2025 et 2039, dont 20 milliards pour le renouvellement de 21 000 kilomètres de lignes, 37 milliards pour le raccordement des parcs éoliens en mer (22 GW attendus en 2040), 16 milliards pour les raccordements terrestres, 14 milliards pour l’adaptation du réseau à très haute tension, 4 milliards pour l’ossature numérique et 2,5 milliards pour de nouvelles interconnexions. Ce schéma décennal a fait l’objet d’un examen par la CRE, qui consulte les utilisateurs du réseau public de transport d’électricité sur la base de ses propres évaluations. Selon les projections de la CRE, l’impact de ces investissements sur les tarifs de réseaux d’électricité (TURPE) serait d’environ 1 % par an, hors inflation, jusqu’en 2040 pour les clients résidentiels. Dans ses premières analyses, le régulateur appelle à accélérer le remplacement d’infrastructures vieillissantes pour les adapter au changement climatique, à lancer rapidement les projets les plus structurants malgré les incertitudes sur l’évolution de la consommation et de la production, et à privilégier les lignes aériennes à très haute tension, dix fois moins coûteuses que les solutions souterraines. Il souligne aussi la nécessité de renforcer la flexibilité du système électrique, de simplifier les procédures de raccordement et de conditionner les futures interconnexions à des analyses coûts-bénéfices positives. La consultation, ouverte jusqu’au 15 novembre, sera suivie d’une délibération de la CRE. Publié le 25/09/2025. Les Métiers de la Couverture et de la Plomberie-Chauffage de la Capeb, associés aux acteurs de la filière biomasse représentés par Propellet, le SER et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB), ont alerté le Premier ministre sur les conséquences de l’exclusion des chaudières biomasse du dispositif MaPrimeRénov’. Dans une lettre ouverte envoyée le vendredi 19 septembre, les signataires dénoncent « une décision incompréhensible pour les professionnels comme pour les ménages, qui va à l’encontre des besoins des Français, des objectifs de transition énergétique et des impératifs économiques ». Les professionnels de la filière mettent en avant la dimension économique et sociale du bois-énergie, qui reste la solution la plus abordable et la plus accessible, notamment dans les territoires ruraux. Cette action a été organisée en réaction à l’annonce faite le 9 septembre dernier de supprimer l’aide aux ménages pour l’acquisition de chaudières biomasse dans le cadre des monogestes du dispositif MaPrimeRénov’. Une décision d’autant plus difficile à accepter que les économies budgétaires espérées ne seraient que d’environ 20 millions d’euros, une somme bien faible au regard de l’activité générée par le segment de marché des chaudières bois (environ 100 millions) et des rentrées fiscales associées. Le retrait des chaudières bois du principal dispositif national de soutien aux équipements renouvelables chez les particuliers constitue une mauvaise nouvelle pour un secteur qui, déjà affecté par la crise énergétique, a perdu plus de 75 % de ses ventes entre 2022 et 2024. Publié le 25/09/2025. Les travaux de forage géothermique vont bon train à Dugny (Seine-Saint-Denis). Débutés mi-juillet, ils devraient s’achever fin octobre. La chaufferie sera ensuite finalisée et mise en service en début d’année prochaine. Installée avec la chaufferie gaz d’appoint et secours sur un terrain mis à disposition pour 30 ans par le Département, elle permettra de puiser la chaleur géothermale dans le dogger à 1 700 mètres de profondeur où l’eau est à 62°C. Elle pourra alors alimenter le réseau de chaleur des communes de Dugny et du Bourget avec l’objectif de fournir 90 % de l’énergie consommée. D’une longueur prévue à terme de 20 km, le réseau est en cours de construction. Il alimentera à terme 9 000 équivalents-logements dont l’aéroport de Paris-Le Bourget et le Village des médias des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, devenu depuis un quartier à part entière. Plus de 15 600 tonnes de CO2 seront évitées chaque année, soit l’équivalent de l’émission de 13 000 voitures. D’un montant global de 55 millions d’euros, le projet est soutenu par l’État via le Fonds Chaleur à hauteur de 18 millions d’euros, par la Région Île-de-France à hauteur de 2,5 millions d’euros, par la Métropole du Grand Paris à hauteur de 2,5 millions d’euros et par le Groupe ADP à hauteur de 2,6 millions. Publié le 25/09/2025. Le Forum EnerGaïa revient les 10 et 11 décembre 2025 à Montpellier pour sa 19ᵉ édition, avec un thème central : l’acceptabilité des projets d’énergies renouvelables dans les territoires. Un thème structurant jugé stratégique à l’approche des municipales de 2026. La plénière d’ouverture traitera du partage de la valeur, clé de l’appropriation locale. Le programme privilégiera retours d’expérience, intelligence collective et interaction. De nombreuses tables rondes aborderont l’éolien, le solaire, le biogaz, l’hydrogène, le recyclage ou encore le repowering. Parmi elles : « Hybridation et éolien + solaire » et « Décarboner l’industrie ». Une matinée spéciale sera consacrée à l’éolien en mer avec deux tables rondes. La seconde journée explorera le solaire thermique, l’autoconsommation, la géothermie et les contrats d’électricité renouvelable. Fidèle à son engagement, le Forum reconduit son Grand Challenge Solidaire avec Énergie Solidaire pour lutter contre la précarité énergétique qui touche 1 Français sur 5. En 2024, l’initiative avait permis de collecter 82 300 € de dons. La collecte 2025, ouverte du 11 septembre au 11 décembre, vise encore plus de dons. Rendez-vous incontournable de la transition énergétique, EnerGaïa 2025 vous attend : réservez dès maintenant votre badge visiteur gratuit sur www.energaia.fr. Le programme complet des tables rondes est à retrouver ICI Publié le 18/09/2025. Qair a lancé officiellement la construction de sa deuxième station hydrogène en Occitanie, située à Narbonne, en partenariat avec l’Arec Occitanie. Implantée dans la zone industrielle Croix-Sud, sur un terrain de la CCI de l’Aude, la station distribuera jusqu’à 600 kg d’hydrogène renouvelable par jour. Elle sera alimentée par l’unité de production d’hydrogène Hyd’Occ qui est actuellement en construction à Port-La Nouvelle. Hyd’Occ disposera d’une puissance initiale de 20 MW, permettant une production annuelle de 2 700 tonnes d’hydrogène. L’hydrogène produit alimentera prioritairement les stations de Béziers et Narbonne. Une seconde phase portera la puissance de l’unité à 40 MW, doublant ainsi la production à 5 400 tonnes par an. Ce développement s’inscrit dans la stratégie régionale de décarbonation de la mobilité et de l’industrie. Ce programme vise à créer un couloir de transport européen zéro émission reliant la Péninsule ibérique au Nord de l’Europe. Il cible principalement la mobilité lourde, en s’appuyant sur l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables. Ce projet bénéficie du soutien de la Région, de la Banque Européenne d’Investissement et de l’Union Européenne. La mise en service de la station de Narbonne est prévue pour fin 2025. Publié le 18/09/2025. CNR inaugure sa nouvelle petite centrale hydroélectrique sur le torrent de la Sarenne, au cœur des Alpes. En service depuis janvier 2025, cette centrale de haute chute se situe sur les communes de La Garde-en-Oisans, Huez et Bourg d’Oisans, dans l’Isère. Le chantier, mené sur trois ans, a permis de construire une infrastructure moderne respectant la biodiversité et l’environnement montagnard. La centrale a une puissance installée de 11 MW et produira annuellement 36 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 16 000 habitants. Les infrastructures principales sont en grande partie souterraines pour limiter l’impact paysager et environnemental. La hauteur de chute naturelle est de 735 mètres avec un débit d’équipement de 1,8 m³/s. Une galerie souterraine de 3 660 mètres relie Huez à Bourg d’Oisans pour le transfert de l’eau. Deux turbines Pelton assurent la production d’électricité dans la centrale de Bourg-d’Oisans. La prise d’eau est équipée d’une passe à poissons, garantissant la continuité piscicole du torrent. Le chantier a inclus des mesures environnementales fortes, comme la re-végétalisation des zones affectées. Le projet représente un investissement de 50 millions d’euros. Publié le 11/09/2025. Le groupe métallurgique SHS, et ses filiales Dillinger, Saarstahl et ROGESA, a signé un contrat de dix ans avec l’énergéticien Verso Energy pour la fourniture annuelle d’au moins 6 000 tonnes d’hydrogène vert à compter de 2029. L’accord, issu d’un appel d’offres lancé par ROGESA en mars 2024, s’inscrit dans le projet Power4Steel visant à réduire l’empreinte carbone de la production d’acier. L’hydrogène, certifié RFNBO, pour Renewable Fuels of Non-Biological Origin ou carburants renouvelables d’origine non biologique, sera produit en France dans le cadre du projet Carling Hydrogen Next Generation, à partir d’électricité renouvelable, grâce à la construction d’un électrolyseur de plus de 100 millions d’euros. Il sera ensuite injecté dans le réseau transfrontalier Moselle-Saar-Hydrogène- Publié le 11/09/2025. Après les premiers indicateurs présentés en juillet dernier (voir actu du 31/07/2025) sur le marché 2024 du solaire thermique résidentiel, Observ’ER publie son rapport complet sur le secteur « Suivi du marché 2024 des applications solaires thermiques individuelles ». L’étude confirme un recul marqué de l’activité, aussi bien en métropole qu’en outre-mer avec des baisses respectives des ventes de capteurs de 36 % et 54 % en une année. Dans les DROM, le marché est estimé à 40 745 m2, soit le niveau le plus bas observé au cours des huit dernières années. Historiquement soutenue par la défiscalisation, la filière outre-mer a vu ces dispositifs exclure en 2024 les applications solaires thermiques individuelles avec un effet direct sur l’activité. L’étude couvre également l’évolution des prix moyens des équipements en métropole et relève un point positif : la grande stabilité des tarifs pratiqués. Le coût d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) s’élève à 1 560 € par m² posé, en hausse de moins de 1 %, tandis que les systèmes solaires combinés restent stables à 1 540 € par m² posé. Après trois années de forte inflation, ce ralentissement constitue un signal encourageant pour le secteur. L’enjeu va désormais être de rester à ces niveaux en 2025 pour espérer aider un redémarrage du marché. Publié le 04/09/2025. En mai dernier, Observ’ER publiait son « Étude qualitative 2025 du marché des appareils domestiques de chauffage au bois », portant sur les chiffres 2024 (voir l’actu du 7/05/25). Il complète aujourd’hui son analyse par un volet qualitatif, fondé sur des entretiens avec des professionnels du secteur. L’année 2024 a été marquée par un net recul des ventes d’appareils manuels à bûches (-40 %), contrastant avec la bonne dynamique des équipements automatiques à granulés (+11 %). Un repli toutefois relativisé par les acteurs de la filière : le niveau d’activité de 2023, jugé exceptionnel, laissait déjà présager un rééquilibrage. Résultat, le marché des appareils à bûches est simplement revenu à son niveau d’avant-crise sanitaire. Autre sujet abordé : les attaques visant la filière ces 18 derniers mois. Les professionnels estiment être la cible d’organismes ou de lobbies qui méconnaissent – ou ignorent délibérément – les réalités économiques, énergétiques et sociales du chauffage au bois. Ils rappellent son rôle essentiel comme énergie populaire et accessible, en particulier pour les ménages les plus modestes. Un rôle de plus en plus difficile à défendre face à un durcissement jugé trop rapide des normes et réglementations. Publié le 04/09/2025. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié, le 1er septembre, un document réalisé pour « démêler le vrai du faux » parmi les affirmations, souvent mensongères, propagées dans le débat public sur l’énergie. Au total, dix questions sur l’électricité et le gaz sont passées en revue. Certaines sont démenties, comme l’idée que les factures d’électricité aient doublé en dix ans, que les énergies renouvelables soient à l’origine de leur hausse, que la France s’apprête à investir 300 milliards d’euros dans le secteur ou encore que le récent black-out en Espagne ait été provoqué par un excès d’énergie solaire. D’autres déclarations sont jugées partiellement vraies, à l’image de celle selon laquelle le développement des renouvelables impliquerait une hausse du budget de l’État. Enfin, certaines assertions sont confirmées, notamment l’augmentation du soutien public aux renouvelables en 2025, le lien entre la baisse des prix de marché de gros et le coût pour l’État, ou encore le fait que la France produise davantage d’électricité qu’elle n’en consomme, sans que cela dispense pour autant de développer les énergies renouvelables, nécessaires à moyen terme. La CRE précise que ce travail de vérification sera actualisé au fil de l’actualité. Publié le 31/07/2025. Le marché des équipements solaires thermiques destinés aux particuliers connaît un fort repli en 2024, d’après les derniers chiffres publiés par Observ’ER, dans son étude « Suivi du marché 2024 des applications solaires thermiques individuelles ». En métropole, la surface totale installée s’effondre de 43 %, pour tomber à 55 295 m². Aucun segment du marché n’est épargné : après trois années de stabilité, les ventes de chauffe-eaux solaires classiques enregistrent une baisse de 36 %, avec seulement 18 500 m² installés, contre plus de 28 000 m² en 2023. Les panneaux auto-stockeurs, qui dominaient le marché l’an dernier, accusent la plus forte chute : -56 %, avec 12 935 m² posés. La fin de leur éligibilité à MaPrimeRénov’, en septembre 2024, a eu un impact direct sur les ventes. Même les systèmes solaires combinés, qui affichaient une croissance régulière depuis 2018, marquent le pas, avec une baisse de 16 % et 18 260 m² installés. Au global, le marché revient ainsi à son niveau d’avant 2020. Côté production, la filière atteint à peine 1,64 TWh fin 2024, très loin des 6 TWh que vise la stratégie française pour l’énergie et le climat à l’horizon 2030. Publié le 31/07/2025. Observ’ER a mis en ligne sur son site l’état des lieux du parc d’installations de méthanisation en service en France au 1er janvier 2025, réalisé en collaboration avec l’Ademe. Le pays compte 1 781 unités en activité, dont une large majorité de sites à la ferme : 1 238 méthaniseurs (70 % du parc). Les autres installations se répartissent pour partie entre unités centralisées (230), sites industriels (117), et méthaniseurs adossés à des stations d’épuration (114). Côté valorisation, la cogénération reste dominante avec 878 unités (49 %). L’injection de biométhane poursuit sa progression, bien qu’à un rythme plus modéré que par le passé, et concerne désormais 704 installations (40 %). En 2024, 11,6 TWh ont été injectés dans le réseau, représentant 3,2 % de la consommation nationale de gaz. La production d’électricité issue du biogaz atteint quant à elle 3 TWh, un volume stable par rapport à 2023. D’un point de vue géographique, le parc reste ancré dans les territoires agricoles, avec plus de la moitié des sites concentrée dans le Grand Est, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Publié le 24/07/2025. Propellet, l’association des professionnels du chauffage au granulé de bois, se réjouit de la publication du rapport sénatorial « Une filière qui sort du bois », adopté par la commission des affaires économiques du Sénat le 9 juillet 2025. Selon l’organisation, ce texte souligne le rôle central du granulé dans la stratégie énergétique française et recommande notamment le retour du taux normal de soutien MaPrimeRénov’ pour les installations d’appareils de chauffage domestique à granulés remplaçant un équipement non performant en zones rurales non raccordées au gaz. Une mesure favorable à la qualité de l’air, à la décarbonation de la production d’énergie et à l’ancrage territorial de nouvelles entreprises du secteur de la production de granulés. L’association rappelle que le granulé, issu des coproduits de l’industrie du bois, valorise une ressource locale et soutient l’emploi. Dans un contexte d’aides publiques en recul, Propellet salue ce signal positif du Sénat, qui plaide pour un rééquilibrage des politiques en faveur des énergies renouvelables thermiques, car pour elle « la transition énergétique ne peut se faire sans solutions adaptées aux réalités des territoires, dans une logique de mix énergétique résilient ne reposant pas uniquement sur une seule énergie ». Publié le 24/07/2025. Les besoins de chaleur représentent 43 % de la consommation énergétique française, encore largement dépendante des énergies fossiles. Le Fonds Chaleur, piloté par l’Ademe depuis 2009, soutient le développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour atteindre 38 % de chaleur verte d’ici 2030. En 2024, 1 350 projets ont été accompagnés, représentant 3,6 TWh/an de chaleur renouvelable supplémentaire. Grâce aux dispositifs France 2030 et Planification Écologique, 1 400 projets au total produiront 5,6 TWh/an d’énergie verte, évitant 1,25 million de tonnes de CO₂ par an. Les investissements ont été concentrés sur la biomasse (68 % de la production), la géothermie (16 %), la chaleur fatale (8 %), la méthanisation (8 %) et le solaire thermique (0,3 %). Le coût moyen d’abattement de la tonne de CO₂ est jugé très efficient (51 €/tCO₂ évitée). En 2025, un budget de 800 millions d’euros a été obtenu, contre 820 millions en 2024, avec une priorité donnée à la géothermie et à la diversification des plans d’approvisionnement en biomasse. Lors de l’adoption de ce budget en février dernier, l’association des collectivités Amorce estimait cependant qu’il était « nettement insuffisant pour rattraper le retard sur les objectifs de chaleur renouvelable ». Plusieurs projets exemplaires ont toutefois vu le jour, comme l’installation solaire pour la production de cognac, une récupération de chaleur dans l’industrie pharmaceutique ou encore un réseau de chaleur géothermique à Malakoff. Publié le 17/07/2025. Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) et Suez ont inauguré une unité de production de biogaz à partir du traitement des eaux usées, située sur le site Seine Aval. Cette station d’épuration traite chaque jour les eaux usées de 6 millions de Franciliens : sept communes des Yvelines (Achères, Conflans-Sainte-Honorine, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye) et du Val d’Oise (Cormeilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine). L’unité permettra de valoriser 130 000 tonnes de boues par an, produisant jusqu’à 350 GWh/an de biogaz. Ce dernier sera brûlé dans des unités de cogénération, pour produire électricité et chaleur directement utilisées par l’usine. Environ 56 % des besoins énergétiques de la station seront ainsi couverts. Le chantier représente un investissement de 401 millions d’euros. Il est aidé par l’agence de l’eau Seine Normandie, à travers une subvention de 32 millions et un prêt à taux zéro de 16 millions d’euros. Grâce à la technologie Digelis Fast, le nombre de digesteurs a été réduit de 26 à 11, tout en conservant la même capacité de production. Le procédé a permis de libérer 70 000 m² pour de futurs projets. L’unité présente des avancées en matière de sécurité, d’efficacité énergétique et de compacité. Elle réduit de 10 % la consommation d’énergie et de 35 % l’usage de béton. Publié le 17/07/2025. Lhyfe, producteur d’hydrogène vert, annonce avoir mené avec succès ses premiers tests de combustion d’hydrogène renouvelable destinés à remplacer le gaz naturel dans les industries à haute température. Ces essais, réalisés dans le secteur de la céramique, utilisent un « kit de mélange » développé par Lhyfe qui permet d’augmenter progressivement la part d’hydrogène dans le mélange de gaz utilisé, sans nécessiter de modifications importantes, hormis le remplacement des brûleurs. Dans ce contexte, Lhyfe a effectué sa première livraison d’hydrogène vert dans la région de Valence, en Espagne, avec 4 tonnes livrées en trois semaines à un fabricant local de céramique. L’hydrogène provient de son site de production à Bessières (France), mis en service en 2024, capable de produire jusqu’à 2 tonnes par jour, grâce à un électrolyseur de 5 MW. Implantée en Espagne depuis 2022, avec des bureaux à Madrid et Barcelone, Lhyfe travaille sur plusieurs projets dans la région. Parmi eux, une usine de 15 MW est en cours de développement à Vallmoll, dans la province de Tarragone, dont la mise en service est prévue pour 2027. Ce projet bénéficie d’une aide de 14 millions d’euros dans le cadre du programme H2 Pioneros du gouvernement espagnol et vise à produire jusqu’à 5 tonnes d’hydrogène vert par jour pour accompagner la décarbonation des industries chimiques et du secteur de la mobilité. Publié le 10/07/2025. Le 30 juin dernier, Teréga et GRDF ont inauguré à Auch (Gers) le premier poste de rebours biométhane d’Occitanie. Cet équipement permet d’inverser le flux habituel du gaz pour rediriger le biométhane injecté du réseau de distribution vers le réseau de transport. Ce procédé est utilisé lorsque la demande locale est trop faible, comme en période estivale ou le week-end. Il permet alors d’éviter les pertes, d’acheminer le gaz renouvelable excédentaire vers d’autres zones ou de le stocker. Les travaux du poste d’Auch ont débuté en décembre 2023. L’ouvrage, d’une capacité de transit de plus de 850 Nm³/h, a été mis en service en juillet 2024 et a nécessité près de 3 millions d’euros d’investissement. Deux autres projets de ce type sont également portés par l’entreprise dans le sud-ouest : l’un est déjà opérationnel depuis le mois dernier près de Nérac (Lot-et-Garonne), et un autre est attendu pour cet été à Boussens (Haute-Garonne). Publié le 10/07/2025. Solar Brother, spécialiste français de la cuisson solaire et des équipements solaires thermiques, ouvre à nouveau son capital au grand public via la plateforme Crowdcube à partir du 10 juillet 2025, avec des tickets d’entrée dès 100 euros. Fondée en 2016, l’entreprise vise à accélérer la commercialisation de masse de sa gamme de produits solaires innovants. Lauréate du Concours Lépine avec son chauffage solaire SunAéro (médaille d’or) et sa marmite solaire COSMO (médaille de bronze), Solar Brother connaît un engouement croissant face à l’urgence climatique et à la crise énergétique. L’entreprise a déjà développé la plus large gamme de produits solaires grand public en Europe : fours, barbecues, douches, chargeurs, chauffage pour l’habitat, etc. Sa technologie repose sur la concentration des rayons du soleil, pour un usage aussi bien domestique qu’en extérieur. Elle a ouvert en 2024 à Carnoules (Var) un premier centre de démonstration solaire, accompagné d’un atelier de production. Cette levée de fonds vise à agrandir l’atelier, structurer la stratégie marketing, et renforcer les débouchés B2B, notamment dans la restauration et le camping. L’entreprise, labellisée Esus (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), défend aussi des valeurs de durabilité, d’open-source et de production locale. Publié le 03/07/2025. Le 30 juin 2025, Suez a inauguré une unité de valorisation de CO₂ biogénique sur son site de méthanisation à Saint-Selve, en Gironde. Ce site, baptisé Terres d’Aquitaine, incarne une approche circulaire complète de la valorisation des biodéchets issus de la grande distribution, des collectivités, de l’agroalimentaire et de l’agriculture. Avec plus de 45 GWh de biométhane injecté chaque année dans le réseau GRDF et 3 500 tonnes de CO₂ valorisées localement, le site devient un modèle de transition écologique territoriale. La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Ademe ont soutenu ce projet à hauteur de 22 millions d’euros. La nouvelle unité, développée avec Prodeval, capte et liquéfie le CO₂, utilisé déjà par deux maraîchers pour enrichir l’air de leurs serres (pour favoriser la croissance des plantes), remplaçant le CO₂ fossile. D’autres usages (production d’algues, froid, extincteurs) sont envisagés. Le digestat solide du site a reçu en janvier 2025 une certification européenne et est distribué comme amendement agricole local. Suez et sa co-entreprise Terrial poursuivent les recherches pour développer sur le site des Terres d’Aquitaine des fertilisants adaptés aux sols difficiles. Publié le 03/07/2025. L’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) vient de mettre en ligne une étude qui met en perspective les différents marchés européens. Au-delà du simple suivi des volumes écoulés, ce travail se penche sur les marchés annuels et les parcs installés de pompes à chaleur (PAC aérothermiques et géothermiques) de plusieurs pays, en calculant le nombre de PAC par habitant. Cette approche permet de distinguer les États qui ont encore du potentiel en termes d’équipement de ceux, plus avancés, où le renouvellement des appareils les plus anciens constitue le segment principal. En la matière, c’est la Norvège qui se distingue, avec un parc de 632 pompes à chaleur en service pour 1 000 foyers, soit un taux d’équipement de 63,2 %. La Finlande vient en deuxième position avec 524 PAC pour 1 000 foyers. En termes de marché annuel, ces deux pays gardent un bon rythme avec respectivement 48 et 33 PAC vendues en 2024 pour 1 000 foyers. À l’opposé on trouve le Royaume-Uni, qui affiche un niveau d’équipement de 19 PAC en service pour 1 000 foyers et un marché de 3,5 équipements vendus, toujours pour 1 000 foyers. Toutefois, l’étude souligne que, malgré une activité annuelle 14 fois moins importante que celle de la Norvège, le Royaume-Uni fait partie des trois seuls pays d’Europe où les ventes ont progressé en 2024 par rapport à l’année précédente – l’Irlande et le Portugal étant les deux autres. L’EHPA en conclut que les pompes à chaleur disposent encore d’une belle marge de progression. Ainsi, si les 19 pays de l’Union européenne couverts par l’étude avaient eu le même niveau d’activité que la Norvège, leurs ventes cumulées auraient été de 21,2 millions d’appareils en 2024, au lieu des 2,31 millions recensés l’an dernier. Publié le 26/06/2025. Le 19 juin, Veolia et Waga Energy ont inauguré une unité de production de biométhane sur le site de valorisation des déchets de Granges, en Saône-et-Loire. En fonctionnement depuis plusieurs mois, cette installation innovante alimente plus de 3 000 foyers du Grand Chalon et permet d’éviter chaque année l’émission de 3 300 tonnes de CO₂. Grâce à la technologie Wagabox, le biogaz issu des déchets est transformé en biométhane, une alternative renouvelable au gaz fossile, et injecté dans le réseau local via un raccordement de 4 kilomètres géré par GRDF. Ce projet remplace un moteur de cogénération sur le site, qui brûlait du biogaz pour produire chaleur et électricité, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et l’impact environnemental du Pôle, qui traite jusqu’à 130 000 tonnes de déchets par an. Publié le 26/06/2025. Coupler passage à la géothermie et rénovation énergétique, c’est le choix pertinent qu’a fait la commune de Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) pour sa mairie. Trois forages descendant jusqu’à 200 mètres de profondeur sont prévus. Associés à une pompe à chaleur, ils auront pour mission d’assurer la totalité des besoins en chauffage l’hiver et le rafraîchissement l’été grâce à un système de géocooling. Cette installation, d’un coût de 345 315 €, est associée à une rénovation énergétique d’ampleur du bâtiment datant de 1865, qui accueille également le CCAS : isolation renforcée en laine de bois, changement des menuiseries, mise en service d’une VMC simple flux et optimisation de l’éclairage avec des Leds performantes. Le coût de l’ensemble des travaux, actuellement en cours, devrait être de 1,45 million d’euros HT financé à l’aide de subventions de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et du Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIELM) ainsi que par une demande de fonds à la communauté de communes Loire, Layon, Aubance. Le programme national Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (Actee) a pour sa part permis de financer en amont un audit énergétique et une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Publié le 19/06/2025. Du 16 au 20 juin, les députés planchent sur la prochaine programmation nationale de l’énergie (PPE) pour un vote sur la proposition de loi le 24 juin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première journée d’échanges a débouché sur des évolutions aussi radicales qu’alarmantes. Sous couvert de « neutralité technologique », les députés ont validé une série d’amendements qui relèguent les énergies renouvelables au second plan, voire les excluent purement et simplement de la stratégie nationale. Ainsi, l’amendement n° 279, adopté dès l’ouverture des débats, impose désormais un objectif annuel de production d’énergie « décarbonée », sans distinction par type de filière. Plus inquiétant, un sous-amendement déposé par un député du Rassemblement national a retiré l’éolien et le photovoltaïque de la liste des énergies décarbonées. Une décision incompréhensible, alors que ces secteurs représentent aujourd’hui une part essentielle de la transition écologique de la France et de l’Europe. Enfin, un dernier amendement appelle à sortir du marché européen de l’énergie, menaçant l’un des piliers de la coopération énergétique européenne. Cette série de modifications place de fait le nucléaire au centre de la transition française, au détriment de la diversité du mix et de l’indépendance énergétique stratégique qu’offrent les renouvelables. Le tout allant dans un sens qui apparaît difficilement cohérent avec le droit de l’Union européenne. Publié le 19/06/2025. Mardi 17 juin 2025, le Cluster Maritime Français a présenté les résultats de l’édition 2025 de son Observatoire des énergies renouvelables en mer. Une publication qui intervient alors que l’Assemblée nationale débat de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), un document stratégique pour la transition énergétique du pays. Ce nouvel opus dresse le portrait d’un secteur qui, s’il a vu son chiffre d’affaires 2024 progresser de 13 % l’an passé, enregistre cependant ses premiers tassements en termes d’emplois ou d’investissements. Avec 8 254 équivalents temps plein (contre 8 301 en 2023) et des investissements de 3 milliards d’euros (-20 % par rapport à 2023), le secteur traverse un premier trou d’air, causé par les hiatus dans le calendrier des appels d’offres des projets éoliens en mer, survenus dans la deuxième moitié des années 2010. Alors que le secteur français des énergies en mer peut mettre en avant de vraies réussites énergétiques (trois parcs en activité pour 1,5 GW) et économiques (l’émergence de plusieurs champions nationaux comme les Chantiers de l’Atlantique), les acteurs s’inquiètent des résultats de la prochaine PPE. Les professionnels réclament une feuille de route claire et ambitieuse pour pouvoir poursuivre le développement des différentes filières, avec notamment l’organisation d’un appel d’offres attendu en 2025 pour encadrer la mise en service des 8 à 10 GW d’éolien en mer encore manquants afin d’atteindre l’objectif de 18 GW fixé à 2035. Autre point attendu de la future programmation : la confirmation d’un appel d’offres commercial pour un parc de 250 MW en énergie hydrolienne, une filière pour laquelle la France est le seul pays à disposer de deux fermes pilotes en observation. Publié le 12/06/2025. Le 6 juin, la Banque des Territoires et la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) ont lancé le Réseau des Epl d’énergies renouvelables, un espace de coopération dédié aux collectivités et à leurs Entreprises publiques locales (Epl) engagées dans la transition énergétique. Ce réseau vise à favoriser les échanges, les synergies et l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables à l’échelle locale. Depuis 2015, les Epl jouent un rôle croissant dans le développement des énergies renouvelables, avec 178 structures actives, dont 140 sociétés d’économie mixte (Sem). Le chiffre d’affaires du secteur a plus que doublé en 5 ans, atteignant 4,72 milliards d’euros. Les Epl permettent un pilotage local, alliant investissement public et expertise technique. La FedEpl soutient ces structures via des services techniques, juridiques et de formation, tandis que la Banque des Territoires, engagée dans un plan stratégique de 1,5 milliard d’euros, a déjà participé à 14 % de la puissance renouvelable installée en France. Le nouveau réseau permettra de partager les bonnes pratiques, renforcer les compétences et accélérer les projets. Une convention de partenariat est aussi prévue avec la FNCCR, renforçant les collaborations pour appuyer les Sem, Spl et SemOp dans leur rôle clé dans la transition énergétique des territoires. Publié le 12/06/2025. L’association Énergies renouvelables pour tous et Observ’ER, l’observatoire des énergies renouvelables, ont présenté mercredi 11 juin les résultats d’une enquête menée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 312 élus disposant de parcs éoliens ou photovoltaïques sur leur commune. À l’approche des élections municipales et dans un contexte de remise en cause des objectifs de la future loi de programmation énergétique, l’étude témoigne d’un fort soutien local au développement des énergies renouvelables, puisque 68 % du panel se déclarent satisfaits de leur présence sur leur territoire. Ce taux atteint même 70 % pour l’éolien. Au-delà de l’impact climatique, salué par 77 % des répondants, les élus soulignent les retombées fiscales importantes, en particulier pour l’éolien (73 %), et plus de la moitié d’entre eux (57 %) souhaitent installer de nouvelles unités sur leur territoire. L’enquête met en valeur des leviers d’amélioration, notamment sur le terrain des simplifications administratives, où des efforts sont attendus. Les réponses expriment également le souhait d’une implication accrue des collectivités dans les projets, via des prises de participation – un axe qui permettrait une meilleure acceptation et appropriation des projets par les populations locales. Présent lors de la conférence de presse, Dominique Ramard, vice-président de la commission Énergies renouvelables et Maîtrise de l’énergie de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) et maire de Saint-Juvat (Côtes-d’Armor), a commenté les résultats : « À rebours de certaines idées reçues, les élus locaux montrent un soutien clair aux énergies renouvelables sur leur territoire, qui leur permettent de réduire leur vulnérabilité énergétique en développant des projets locaux et décarbonés, et dont les retombées économiques abondent au budget des communes. » Les élus sont ainsi au diapason de ce que souhaitent leurs administrés (cf sondage Ifop pour Engie) : une accélération du déploiement des énergies renouvelables. L’association Énergies renouvelables pour tous et Observ’ER, l’observatoire des énergies renouvelables, ont présenté mercredi 11 juin les résultats d’une enquête menée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 312 élus disposant de parcs éoliens ou photovoltaïques sur leur commune. À l’approche des élections municipales et dans un contexte de remise en cause des objectifs de la future loi de programmation énergétique, l’étude témoigne d’un fort soutien local au développement des énergies renouvelables, puisque 68 % du panel se déclarent satisfaits de leur présence sur leur territoire. Ce taux atteint même 70 % pour l’éolien. Au-delà de l’impact climatique, salué par 77 % des répondants, les élus soulignent les retombées fiscales importantes, en particulier pour l’éolien (73 %), et plus de la moitié d’entre eux (57 %) souhaitent installer de nouvelles unités sur leur territoire. L’enquête met en valeur des leviers d’amélioration, notamment sur le terrain des simplifications administratives, où des efforts sont attendus. Les réponses expriment également le souhait d’une implication accrue des collectivités dans les projets, via des prises de participation — un axe qui permettrait une meilleure acceptation et appropriation des projets par les populations locales. Présent lors de la conférence de presse, Dominique Ramard, vice-président de la commission Énergies renouvelables et Maîtrise de l’énergie à la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) et maire de Saint-Juvat (Côtes-d’Armor), a commenté les résultats : « À rebours de certaines idées reçues, les élus locaux montrent un soutien clair aux énergies renouvelables sur leur territoire, qui leur permettent de réduire leur vulnérabilité énergétique en développant des projets locaux et décarbonés, et dont les retombées économiques abondent au budget des communes. » Les élus sont ainsi au diapason de ce que souhaitent leurs administrés (cf sondage Ifop pour Engie) : une accélération du déploiement des EnR. Publié le 05/06/2025. La Commission européenne a adopté quatre actes juridiques et une communication visant à concrétiser l’application du Net-Zero Industry Act (NZIA), le règlement qui vise à accroître la production de technologies propres dans l’UE, comme celle de modules photovoltaïques ou d’éoliennes par exemple. L’objectif du règlement est que l’UE soit en mesure de produire globalement au moins 40 % des équipements dont elle a besoin d’ici 2030. L’un des actes adoptés définit ainsi les composants considérés comme essentiels à la fabrication de technologies net-zéro. Un autre texte introduit des critères d’attribution des aides (dans le cadre des appels d’offre) non liés au prix, tels que la résilience, la durabilité ou la cybersécurité, que les États membres devront intégrer à hauteur de 30 % (ou 6 GW par an et par État membre) dans leurs volumes d’appels d’offres pour les énergies renouvelables à partir du 30 décembre 2025. Une liste de produits finaux et composants critiques a également été publiée. Celle-ci sert à identifier les cas de dépendance excessive à une source d’approvisionnement. Dans ce cas, les autorités devront intégrer le critère de résilience, en plus du prix, dans les procédures de marchés publics. La Commission a en parallèle présenté une communication sur les sources d’approvisionnement de l’Union en technologies net-zéro, soulignant les risques liés à la concentration des importations. Enfin, un cadre harmonisé est proposé aux États pour sélectionner les projets industriels pouvant bénéficier du statut de « projet stratégique ». Ce statut confère plusieurs avantages, dont un traitement administratif accéléré et un accès facilité à des conseils financiers. Publié le 05/06/2025. Le ministère de la Transition écologique a publié ses tableaux de bord pour le 1er trimestre 2025, mettant en lumière des dynamiques très contrastées dans le secteur des énergies renouvelables électriques. Côté éolien, c’est la douche froide : seulement 7 nouveaux sites ont été raccordés entre janvier et mars, représentant une capacité totale de 74 MW. Un chiffre en chute libre, avec une baisse de 76 % par rapport à la même période en 2024. Le secteur n’avait jamais connu un démarrage aussi lent. Seule éclaircie : la mise en service définitive du parc éolien flottant de Provence Grand Large, doté d’une puissance de 25 MW. Il s’agit là du premier raccordement d’éoliennes flottantes de cette envergure en France. À l’inverse, le photovoltaïque poursuit son ascension avec 1 442 MW supplémentaires installés au cours du trimestre, répartis sur près de 58 000 nouvelles installations. Les récentes réformes (entrées en vigueur fin mars), notamment la baisse des tarifs de rachat d’EDF Obligation d’Achat pour les installations de moins de 500 kW, n’ont pas encore freiné l’élan du secteur. Le deuxième trimestre sera à cet égard instructif. Sur les trois premiers mois de l’année, la production d’électricité solaire s’est établie à 5,4 TWh (hors autoconsommation), soit une hausse de 40 % par rapport au 1er trimestre 2024. Elle a couvert 3,8 % de la consommation électrique nationale, à quoi s’ajoute l’autoconsommation. Au premier trimestre, 334 GWh d’électricité photovoltaïque ont été autoconsommés par les producteurs, soit 6,2 % de la production photovoltaïque de la période. Publié le 05/06/2025. La suspension du dispositif MaPrimeRénov annoncée par le Ministre de l’Économie suscite une vive inquiétude parmi les acteurs de la rénovation énergétique. Cette décision est perçue comme un coup dur porté au pouvoir d’achat des Français, à la transition écologique et à la stabilité des entreprises du secteur. Les 19 organisations professionnelles de la filière dénoncent l’absence de concertation préalable avec le gouvernement alors qu’un rendez-vous était prévu demain 6 juin avec le cabinet d’Éric Lombard. La demande de maintien du soutien aux mono-gestes et de MaPrimeRénov’ correspond pourtant aux attentes du marché. Sans stabilité ni simplification du dispositif, des milliers d’emplois sont menacés. L’argument des fraudes, souvent mis en avant, ne doit pas justifier un retrait brutal. La filière souhaite désormais être entendue par le Premier Ministre. Elle appelle à une cohérence urgente entre ambitions écologiques, économiques et industrielles. Publié le 29/05/2025 – Dès octobre 2025, un réseau de chaleur alimenté à 67 % par des énergies renouvelables verra le jour à Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. Porté par le SMIREC (Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique), ce projet s’appuie sur une technologie éprouvée en Île-de-France : la géothermie profonde dont il s’agira du premier site en Seine-Saint-Denis. L’énergie sera captée à 1 700 mètres sous terre, dans la nappe du Dogger. Objectif : produire 55 GWh de chaleur chaque année. Une chaufferie au gaz viendra compléter ce dispositif pour sécuriser les 77 GWh d’approvisionnement annuel. Au total, le réseau desservira 11 500 équivalents-logements via 18 kilomètres de canalisations et une soixantaine de sous-stations. Coût de l’investissement : 63,5 millions d’euros, dont 26,7 millions financés par l’ADEME et la Région Île-de-France. Au-delà des chiffres, ce projet s’inscrit dans la stratégie de transition énergétique engagée par le SMIREC depuis plus de 15 ans. En misant sur des sources locales et durables comme la géothermie et la biomasse, le syndicat est parvenu à faire passer la part d’énergies renouvelables de 2 % à 65 % dans son mix énergétique. Il vise désormais les 75 % à l’horizon 2050. Cerise sur le gâteau : le projet génère aussi de l’emploi local, avec quatre postes pérennes dédiés à son exploitation. Publié le 29/05/2025 – Le jeudi 22 mai, La Poste et ENGIE Solutions ont officiellement inauguré une nouvelle station BioGNC (biogaz comprimé) à Bouloc, en Haute-Garonne. Installée à proximité de la plateforme courrier de Castelnau-d’Estrétefonds, cette station fournira du carburant renouvelable aux poids lourds et aux flottes professionnelles de La Poste. Elle sera également accessible au grand public, en libre-service, 24 heures sur 24. Derrière cette “nouvelle” station se cache en réalité la modernisation d’un site existant, désormais doté de quatre pistes d’avitaillement et d’un compresseur haute capacité de 1 000 Nm³. Une transformation qui répond à la volonté du groupe postal d’accélérer sa transition énergétique. Déjà pionnière dans l’électrification de ses livraisons du dernier kilomètre, La Poste mise aussi sur le biogaz pour atteindre ses objectifs de décarbonation. En Occitanie, plus de la moitié (55 %) des tournées sont aujourd’hui réalisées avec des motorisations alternatives. Une stratégie payante : entre 2019 et 2024, l’entreprise a réussi à réduire de 34 % ses émissions de CO₂. Publié le 22/05/2025. Le 13 mai, un partenariat a été signé entre l’association Solenat et le réseau de chaleur Mans Nord Enr’gie pour la création du futur réseau de chaleur de la ville du Mans. Géré par Engie Solutions, ce réseau de chaleur 100 % renouvelable (biomasse, biogaz) couvrira 15 000 logements, avec 26 kilomètres de canalisations et la mise en service de deux chaudières biomasse. L’approvisionnement en bois se fera localement, dont 30 % seront issus des haies bocagères. Ce partenariat s’accompagne de deux projets portés par Solenat : Carbocage, qui valorise le stockage de carbone via la gestion durable des haies et Carbon Agri, qui aide les agriculteurs à réduire leurs émissions via des plans d’actions sur 5 ans. Environ 35 exploitations agricoles seront accompagnées. Ces démarches, reconnues par le Label Bas Carbone, contribuent à la préservation de la biodiversité et au complément de revenu des agriculteurs. Publié le 22/05/2025. TotalEnergies a annoncé la cession de 50 % de Polska Grupa Biogazowa (PGB), principal producteur polonais de biogaz, à HitecVision, société d’investissement norvégienne spécialisée dans le secteur de l’énergie, pour une valeur d’entreprise de 190 millions d’euros. Fondée en 2007 et intégralement acquise par TotalEnergies en 2023, PGB exploite actuellement en Pologne vingt installations de production de biogaz générant électricité et chaleur par cogénération, pour une capacité de plus de 450 GWh en équivalent biométhane. Deux nouvelles unités sont en cours de construction, et l’entreprise prévoit une montée en puissance de sa production, avec un objectif fixé à 2 TWh de biométhane équivalent à l’horizon 2030. La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. Publié le 15/05/2025. L’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) vient de publier son étude annuelle sur le marché 2024 des pompes à chaleur (PAC) individuelles, géothermiques et aérothermiques. Verdict : après plusieurs années de croissance, le secteur accuse une nette baisse. Pour la géothermie, seulement 3 005 unités ont été vendues en 2024 contre 3 970 en 2023, soit une chute de près de 24 %. Un recul d’autant plus marquant que le segment affichait une belle dynamique depuis 2021, porté par la flambée des prix de l’électricité, du gaz et du fioul. Mais la morosité économique a fini par rattraper le marché. Entre inflation, incertitude politique et pouvoir d’achat sous tension, les ménages freinent leurs investissements. Résultat : les ventes reviennent à un niveau proche de celui observé avant la crise sanitaire. Même constat du côté des PAC aérothermiques (air/eau et air/air), avec une baisse globale de l’activité de 20 %. En 2024, 938 520 unités ont été écoulées, contre 1 167 970 l’année précédente. Le segment air/eau est particulièrement touché, avec une chute spectaculaire de 40 %, en partie imputable aux modifications du dispositif MaPrimeRénov’, qui ont semé le doute chez de nombreux ménages. Moins affecté, le segment des PAC air/air recule de 12 %. Ici, ce sont surtout les conditions climatiques qui ont joué : contrairement à l’été 2023, particulièrement chaud, l’été 2024 n’a pas enregistré de canicules majeures, limitant l’intérêt pour ces équipements prisés en période de fortes chaleurs. Globalement, le secteur des pompes à chaleur subit de plein fouet le climat économique tendu et les arbitrages budgétaires des Français. Hausse des prix de l’énergie, réformes des aides publiques, incertitudes politiques : autant de facteurs qui freinent une technologie pourtant stratégique pour la transition énergétique. Publié le 15/05/2025. Le 13 mai 2025, European Energy, entreprise danoise spécialiste des énergies renouvelables, a inauguré à Kassø, au Danemark, une unité commerciale d’e-méthanol à grande échelle. Cette usine produit 42 000 tonnes par an d’e-méthanol, un carburant synthétique, en combinant hydrogène vert produit à partir d’énergie solaire et de CO₂ biogénique. Elle est entièrement alimentée par des énergies renouvelables, grâce à sa connexion au plus grand parc solaire d’Europe du Nord (304 MW). L’e-méthanol de Kassø affiche une réduction de 97 % des émissions de CO₂ par rapport au méthanol fossile. Ce projet vise à décarboner des secteurs difficiles à électrifier, comme le transport maritime et l’industrie chimique. L’entreprise Maersk utilisera cet e-méthanol pour propulser son navire Laura Mærsk, premier porte-conteneurs au monde fonctionnant au méthanol. Des industriels comme Lego et Novo Nordisk utiliseront également ce carburant propre pour remplacer le méthanol fossile dans leurs processus de production, notamment dans les plastiques. Publié le 07/05/2025. Le 30 avril 2025, Suez et Carcassonne Agglo ont inauguré l’unité de méthanisation de la station d’épuration de Saint-Jean située à Carcassonne (Aude). L’unité produira 4 500 MWh de biométhane par an (équivalant à la consommation de 750 foyers) à partir de 60 000 tonnes de boue pour alimenter le réseau de gaz naturel. Intégrée dans le Pacte Vert de Carcassonne Agglo et le Plan Climat territorial, l’unité est aussi équipée de panneaux photovoltaïques produisant 10 000 kWh/an qui alimenteront le site en électricité verte. En réduisant de 30 % les boues à évacuer, cette nouvelle installation limite le trafic de camions, améliore la qualité de vie et stabilise les boues pour les rendre inertes via une unité de désodorisation. Une attention particulière a aussi été portée à l’intégration architecturale de l’installation dans son environnement. Publié le 07/05/2025. Observ’ER vient de publier son étude annuelle de suivi du marché 2024 des appareils de chauffage domestique au bois. Ce travail complète une première version diffusée il y a un mois (voir l’actualité du 27 mars 2025), qui ne portait que sur les seuls chiffres de vente. Cette analyse plus détaillée revient sur le marché très contrasté de 2024, où la dynamique des appareils indépendants à bûches (-35 % des ventes) a été totalement inverse à celle des appareils à granulés (+18 %). Pour les appareils à bûches, la baisse des ventes est perçue comme une régulation du marché après trois années post-Covid exceptionnellement dynamiques. En ce qui concerne les équipements à granulés, la sévère chute des ventes amorcée au deuxième semestre 2022 est désormais dépassée, et le secteur retrouve lentement son dynamisme. Ce rééquilibrage du marché a d’ailleurs eu un effet sur les importations, puisque les appareils à granulés sont davantage produits à l’étranger que les équipements à bûches. La part moyenne des importations dans l’ensemble des ventes est passée de 57 % en 2023 à 68 % en 2024. Concernant les types d’opérations, les appareils de chauffage au bois continuent de s’installer très majoritairement dans l’existant (à 91 %), et le remplacement d’anciens appareils bois par des modèles plus performants a représenté 37 % des opérations en 2024. L’étude se conclut par un suivi de l’évolution des prix de vente, où les indicateurs montrent des hausses beaucoup plus modérées que sur la période 2021-2023 : une augmentation moyenne de 4 % pour les équipements comme pour la pose, contre le double en 2023. L’étude est disponible en libre téléchargement sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables. Publié le 30/04/2025. Alors que le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) était attendu prochainement, sa publication a une nouvelle fois été repoussée « à la fin de l’été » par le Premier ministre. Le retard sera alors de deux ans par rapport au calendrier initialement prévu puisqu’il aurait dû être adopté par le Parlement à l’été 2023, comme le prévoyait la loi Énergie – Climat de 2019. Ce nouveau report est dû aux pressions de la droite et du Rassemblement National (RN), qui ont des réactions épidermiques sur le sujet des énergies renouvelables. Plus inquiétant encore, la nouvelle mouture de la PPE acte l’abandon progressif des objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables, au profit d’un objectif de développement des « énergies décarbonées ». Ainsi, le niveau cible fixé pour 2030 concernant la part des filières renouvelables dans le mix électrique est abaissé de 40 % à 33 %, alors que le seuil fixé par la directive européenne RED III est de 44 % pour l’ensemble des pays de l’UE. Par ailleurs, ce changement de fond s’accompagne d’un changement de forme : contrairement à ce qui avait été annoncé et défendu jusqu’à aujourd’hui par le gouvernement, la PPE sera finalement inscrite dans la loi, suivant la proposition de loi du sénateur LR Daniel Gremillet. Ces nouveaux revirements ont immédiatement entraîné des réactions du monde des énergies renouvelables, dénonçant un message désastreux envoyé aux entreprises du secteur de la transition énergétique. Les incertitudes se renforcent, avec des conséquences très directes, comme l’impossibilité, notamment, selon le Syndicat des énergies renouvelables, de lancer le prochain appel d’offres n° 10 sur l’éolien en mer, mettant ainsi en danger l’ensemble de la filière et son tissu industriel. Publié le 30/04/2025. L’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) a publié le 24 avril une note soulignant le rôle de ces équipements dans la sécurité énergétique du continent. Selon l’organisation, remplacer les chaudières fossiles de 7 % des foyers européens – soit 14 millions de logements – par des pompes à chaleur permettrait d’économiser 13 milliards de mètres cubes de gaz, soit l’équivalent des importations de gaz russe destiné au chauffage domestique et à l’eau chaude. Fin 2024, 26 millions d’unités étaient déjà en service, évitant ainsi la consommation de 24 milliards de mètres cubes de gaz. D’après la Commission européenne, une adoption massive de cette technologie, combinée à des rénovations énergétiques, pourrait permettre d’économiser 60 milliards d’euros sur les importations d’énergies fossiles. Pour atteindre l’objectif de 60 millions de pompes à chaleur d’ici 2030, le parc actuel devrait croître de plus de 130 %. Dans cette perspective, l’EHPA appelle les États membres à garantir un cadre réglementaire stable, en mettant notamment en œuvre les mesures du Pacte vert sans délai. Le futur système d’échange de quotas d’émission (ETS2) pourrait mobiliser jusqu’à 65 milliards d’euros via le Fonds social pour le climat, afin de soutenir le déploiement de technologies propres, dont les pompes à chaleur. Ce développement viendrait renforcer un secteur qui compte déjà 300 sites de production et plus de 416 000 emplois à travers l’Europe. Publié le 24/04/2025. Le gouvernement a présenté le 16 avril la mise à jour de la Stratégie nationale de l’hydrogène décarboné, avec des objectifs revus à la baisse pour cette filière. Le rythme de déploiement des grandes infrastructures de production et de transport d’hydrogène prennent en effet plus de temps que prévu à se déployer. En outre, pour certains usages, dans la mobilité notamment, d’autres voies de décarbonation progressent rapidement. Ainsi, alors que la première stratégie lancée en 2020 prévoyait 6,5 GW d’électrolyseurs en service en 2030, cette nouvelle version vise 4,5 GW en 2030 et 8 GW en 2035. Néanmoins, l’État annonce qu’il poursuivra l’effort de soutien à cette filière avec 4 milliards d’euros sur 15 ans, pour un mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné pour remplacer l’hydrogène d’origine fossile, dans l’industrie notamment. De même, de nouveaux appels à projets soutiendront les innovations technologiques, le déploiement de véhicules utilitaires à hydrogène ou encore la production de carburants de synthèse pour le transport aérien et maritime. Pour ces derniers, les premières productions à taille industrielle sont attendues d’ici 2030. Publié le 24/04/2025. Rennes Métropole, Engie Solutions et la Banque des Territoires ont lancé une société d’économie mixte à opération unique (Semop) pour piloter le développement du réseau de chaleur du sud de l’agglomération. D’une durée de 13 ans, le contrat de concession prévoit 156 millions d’euros d’investissements pour ajouter 32 km de réseaux aux 46 km existants. À terme, le réseau, alimenté exclusivement par des énergies renouvelables et de récupération (bois-énergie, biométhane, chaleur fatale), permettrait de chauffer 47 000 équivalents-logements et près de 100 bâtiments publics et privés supplémentaires (bureaux, groupes scolaires, établissements de santé, industriels). La production de chaleur augmentera de 110 GWh, pour passer à 328 GWh annuels, ce qui éviterait l’émission de 670 000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat. Deux chaufferies bois de 23 et 21 MW, à Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, viendront renforcer les capacités dès 2026 et 2028. Un système de stockage thermique de 3 000 m³ accompagnera cette montée en puissance. L’infrastructure sera dotée d’outils numériques pour optimiser la performance énergétique. La Semop est détenue à 46 % par Engie Solutions, 34 % par Rennes Métropole, 15 % par la Banque des Territoires et 5 % par les citoyens via une structure participative – une première en France pour un réseau de chaleur. Publié le 10/04/2025. Le 2 avril, Stellantis et Engie Solutions ont inauguré une nouvelle chaufferie biomasse sur le site industriel de « La Janais » à Rennes. Cette installation de 8 MW représente une étape majeure vers la décarbonation du site, permettant d’éviter chaque année l’émission de 6 650 tonnes de CO₂. Employant près de 2 000 salariés, le site est actuellement mobilisé pour le lancement de la nouvelle Citroën C5 Aircross. Le projet, soutenu par l’Ademe via l’appel à projets Biomasse chaleur pour l’industrie, l’agriculture et le tertiaire (BCIAT) de 2020, a reçu une subvention de 3,5 millions d’euros, sur un budget total de 13,5 millions. La chaufferie alimente un réseau de 2 kilomètres, comprenant dix points de livraison, dont un bâtiment de Rennes Métropole. La biomasse utilisée provient majoritairement de plaquettes forestières issues de zones situées à moins de 150 kilomètres du site. Engie Solutions assurera l’exploitation de la chaufferie pendant 15 ans. Publié le 10/04/2025. Le 4 avril et pour la dixième année consécutive, la filière des gaz renouvelables a présenté son Panorama des gaz renouvelables. Fin 2024, ces derniers couvraient 3,2 % de la consommation de gaz française, avec 731 installations en service. La production de biométhane a progressé de 27 % en 2024 pour s’établir à 11,6 TWh, avec toutefois une capacité de production atteignant 13,9 TWh/an. Alors que la France élabore sa stratégie énergétique pour la prochaine décennie, la filière des gaz renouvelables accueille favorablement l’objectif de 44 TWh PCS de biométhane injecté d’ici 2030. Toutefois, elle déplore le manque d’ambition pour 2035 (44 à 79 TWh), risquant de freiner les dynamiques actuelles. Pour assurer un développement durable, des mesures de soutien renforcées sont nécessaires, notamment sur le plan économique et réglementaire. Le ralentissement des raccordements en 2024 témoigne d’un besoin de visibilité à long terme. Les auteurs de ce Panorama estiment ainsi que « pour soutenir une croissance continue, la filière a besoin d’un équilibre entre : i) les dispositifs de soutien à la production, notamment pour les petites installations agricoles, ii) les dispositifs de décarbonation de la demande tels que les certificats de production de biogaz (CPB) pour les secteurs résidentiel et tertiaire et l’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants (IRICC) pour la mobilité, et iii) les soutiens à la décarbonation industrielle ». Le passage à l’échelle industrielle des nouvelles technologies de production de gaz renouvelables (pyrogazéification, gazéification hydrothermale, power-to-methane) est jugé urgent pour diversifier les sources d’énergie. Des dizaines de projets sont en attente de financement et de soutien politique. Par ailleurs, le bioCO₂ issu de la méthanisation est reconnu comme une ressource stratégique pour produire des e-carburants. L’hydrogène est également mis en avant pour la décarbonation de l’industrie lourde, avec de nombreux projets en cours. Enfin, la filière appelle l’État à instaurer une planification cohérente et ambitieuse, garantissant souveraineté énergétique, économie circulaire, emploi local, et valorisation des infrastructures existantes. Publié le 03/04/2025. Enosis, PME toulousaine spécialiste en méthanation biologique, inaugure Denobio, la première unité industrielle française de méthanation biologique, située en Hauts-de-France. Ce projet innovant transforme le CO₂ issu de la méthanisation agricole en biométhane injectable dans le réseau de gaz naturel exploité par GRDF. Après dix ans de recherche, Enosis industrialise ainsi un procédé basé sur des micro-organismes, développé avec des laboratoires français. La méthanation biologique associe CO₂ et hydrogène renouvelable, produit par électrolyse, pour augmenter de 50 % la production de méthane sans consommation supplémentaire de biomasse. Denobio est un démonstrateur industriel et une vitrine technologique, intégrée à l’unité de méthanisation d’Energia Thiérache. L’hydrogène est fourni par Lhyfe et le gaz produit sera injecté dans le réseau. Ce projet bénéficie du soutien de l’État via France 2030, de la Région Hauts-de-France et de GRDF. Publié le 03/04/2025. Quatorze forages descendant à 150 mètres de profondeur : c’est grâce à cette installation géothermique reliée à une pompe à chaleur de 130 kW que le futur groupe scolaire du Lac-Van Gogh de Miramas (Bouches-du-Rhône), qui ouvrira ses portes à la rentrée 2025, sera chauffé. L’équipement permettra également de rafraîchir l’été le bâtiment de 2 670 m². Les calories et frigories seront dispensées grâce à un plancher et un toit chauffant, assurant une utilisation optimale de l’installation qui devrait couvrir 100 % des besoins énergétiques du bâtiment l’été et 97 % l’hiver. Labellisé Bâtiment Durable Méditerranée de niveau Or, la nouvelle école présentera ainsi d’excellentes performances. « Les émissions de gaz à effet de serre dues au chauffage devraient être divisées par 17 en équivalent CO2 par rapport au groupe scolaire actuel chauffé au gaz naturel », souligne l’adjoint au maire Gérald Guillemont. Des panneaux photovoltaïques sont également installés sur le toit pour assurer une partie des besoins en électricité du groupe scolaire. Sur les 12 450 000 euros HT qu’a coûté la nouvelle école, 384 000 euros HT ont permis de financer l’installation de géothermie (forages, sondes, pompe à chaleur et équipements divers) qui devrait être soutenue par l’Ademe et la Région Sud à hauteur de 197 000 euros. Le coût annuel (fourniture d’énergie + maintenance + renouvellement) a lui été estimé à 8 700 euros contre 36 000 euros pour l’école actuelle. Le projet fait partie d’un programme plus large de sortie des énergies fossiles dans lequel s’est engagée la municipalité en 2020. Publié le 27/03/2025. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude annuelle de suivi du marché des appareils de chauffage domestique au bois et les chiffres ne sont pas bons. Avec un volume de 297 430 pièces en 2024 contre 422 065 un an auparavant, le secteur a enregistré une chute historique de son activité. Les ventes se sont contractées de 29,5 %, soit 124 635 appareils vendus en moins, un niveau jamais observé au cours des 13 dernières années. Si l’on observe plus en détail la dynamique des différents segments d’équipements, le point saillant est la lourde baisse des ventes d’appareils à bûches. Hormis les cuisinières à bois, qui constituent un marché de niche, aucun type d’appareil n’a été épargné : -42 % pour les poêles à bûches, -38 % pour les foyers fermés et inserts, ou -53,8 % pour les chaudières manuelles. Les reculs d’activité sur les segments des appareils à bûches ont été massifs, avec 134 370 pièces vendues en moins par rapport à 2023, qui avait été un très bon millésime. Seuls les poêles à granulés ont réussi à tirer leur épingle du jeu en progressant de 18,4 %, avec un marché estimé à 87 970 pièces. Ce segment se relève après une année 2023 catastrophique, au cours de laquelle ses ventes s’étaient rétractées de 63 %. Parmi les facteurs avancés pour expliquer ces mauvais résultats figure un contexte de crise économique qui n’incite pas les particuliers à investir, un hiver 2024 marqué par la douceur des températures, le net recul des dossiers MaPrimeRénov’ déposés au cours de la première partie de 2024, mais également les messages négatifs associant le chauffage au bois dans son ensemble aux pics d’émissions de particules. Pourtant, le chauffage au bois conserve tous ses avantages. Les granulés restent l’énergie la moins chère en centimes d’euro par kWh parmi les cinq principales utilisées par les particuliers en France, notamment vis-à-vis du gaz naturel. De plus, les industriels du secteur, accompagnés par le label Flamme Verte et la réglementation européenne Ecodesign, n’ont cessé de faire progresser les performances énergétiques et environnementales des équipements. Publié le 20/03/2025. Melun et Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, renforcent leur engagement en faveur de la transition énergétique avec l’extension de leur réseau de chaleur. En collaboration avec Dalkia, un nouveau puits géothermique sera foré en 2026 et complété par un système de pompes à chaleur. Ce réseau sera alimenté à 80 % par une énergie renouvelable, poursuivant ainsi l’initiative lancée dès 1969 à Melun. L’extension ajoutera 17 kilomètres de canalisations, portant le réseau à 43 kilomètres et intégrant 115 nouvelles sous-stations. Il produira 68 GWh de chaleur supplémentaire pour couvrir les besoins de 18 500 équivalents logements. L’investissement total pour ces travaux s’élève à 75 millions d’euros. Ce projet marque une avancée majeure pour la transition énergétique des deux villes. Publié le 20/03/2025. L’entreprise Normandie Hydroliennes a été sélectionnée comme lauréate du Fonds pour l’Innovation de l’Union européenne pour son projet hydrolien NH1. La société, basée à Colombelles (Calvados), va ainsi bénéficier d’un financement de 31,3 millions d’euros pour accélérer le développement et le déploiement de son système innovant dans le Raz Blanchard, passage en mer connaissant de forts courants, situé entre le cap de la Hague et l’île anglo-normande d’Aurigny. Ce financement soutiendra le déploiement d’une ferme pilote à l’échelle commerciale d’énergie hydrolienne. Cette dernière sera composée de quatre turbines à axe horizontal AR3000, de 3 MW chacune. Construites à Cherbourg, elles produiront 34 GWh par an d’énergie propre, durable et prédictible, soit l’équivalent de la consommation d’environ 15 000 personnes. La mise en service est prévue pour 2028. Le Fonds pour l’Innovation de la Commission européenne, doté de 4,8 milliards d’euros, est l’un des plus importants programmes de financement au monde pour la démonstration de technologies innovantes à faible teneur en carbone. Publié le 20/03/2025. Nous avons appris la triste nouvelle de la disparition subite, le 10 mars, de Hugues Defréville, à l’âge de 41 ans. Cofondateur de l’entreprise Newheat, spécialiste de la chaleur renouvelable et de la décarbonation de l’industrie, Hugues était également vice-président de l’association professionnelle Enerplan et directeur de l’association Solar Heat Europe. Nous avions ainsi régulièrement l’occasion de l’interviewer dans les pages du Journal des Énergies Renouvelables, pour lequel il savait toujours se rendre disponible. Nos pensées vont à sa famille, à son épouse et ses enfants, ainsi qu’à toute l’équipe de Newheat. Notre filière perd avec lui une personnalité solaire. Publié le 14/03/2025. À l’occasion du Salon de l’Agriculture, TotalEnergies a annoncé la mise en service de BioNorrois, sa deuxième plus grande unité de production de biogaz en France, située à Fontaine-le-Dun en Normandie. Cette installation injectera 153 GWh de biométhane par an dans le réseau de gaz, couvrant ainsi l’équivalent des besoins de 30 000 habitants. Le projet repose sur un partenariat avec le sucrier Cristal Union, qui fournira jusqu’à 80 % des matières premières sous forme de pulpes de betteraves issues de son site voisin. En valorisant 185 000 tonnes de matières organiques par an, BioNorrois produira également 150 000 tonnes de digestat, un fertilisant naturel, permettant de réduire l’usage des engrais chimiques de 5 500 tonnes par an. Plus de 130 agriculteurs et industriels locaux ont participé à la concertation pour adapter le projet aux besoins du territoire. Publié le 14/03/2025. Guyot Énergies et Idex investissent 70 millions d’euros dans une chaufferie industrielle bas carbone à Brest pour alimenter l’usine du groupe agro-alimentaire Bunge. Située sur le port de commerce, cette centrale utilisera des Combustibles Solides de Récupération (CSR) issus de déchets non recyclables collectés en Bretagne, réduisant ainsi l’enfouissement et contribuant à l’économie circulaire. L’unité de cogénération produira chaque année 85 GWh de chaleur et 20 GWh d’électricité. La chaleur couvrira une grande partie des besoins énergétiques de Bunge et pourra bénéficier à d’autres acteurs locaux, tandis que l’électricité sera injectée sur le réseau. Chaque année, 40 000 tonnes de CSR seront valorisées, conformément au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets breton, qui vise le « zéro enfouissement » d’ici 2030. Porté par Polder Guyot Énergies (51 % Idex, 49 % Guyot Énergies), le projet bénéficie d’un soutien de 14,5 millions d’euros de l’Ademe et d’un financement bancaire mené par Arkéa, Bpifrance et BPGO. Le chantier débutera cet été. Publié le 06/03/2025. Après 18 mois de travaux, l’unité de méthanisation Equibio Pays de Buch a été mise en service à Mios (Gironde) par CVE et Terra Énergies. Cette installation traitera jusqu’à 19 000 tonnes de biodéchets par an, principalement issus de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN). Le site produira l’équivalent de la consommation en gaz vert de 2 800 foyers. Lancé en 2013 pour valoriser le fumier équin du Bassin d’Arcachon, le projet a été repris en 2018 par CVE. L’installation, développée en partenariat avec la COBAN, reçoit des biodéchets issus de la restauration, des supermarchés, du fumier équin et des déchets agroalimentaires. CVE gère l’ensemble du processus, de la collecte au traitement et à la valorisation des déchets. L’unité produit du gaz renouvelable injecté sur le réseau GRDF (250 Nm3 CH4/h, soit 25 GWh/an), ainsi que du digestat utilisé comme engrais par onze agriculteurs locaux. Le projet représente un investissement de 20 millions d’euros, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, de l’Ademe et de l’État. En exploitation, il générera plus de 600 000 € annuels pour l’économie locale. Publié le 06/03/2025. 2024 aura définitivement été l’année du photovoltaïque en France. C’est le constat évident qui ressort des différents tableaux de bord établis par le service statistique du ministère de la Transition écologique, dont les derniers opus ont dévoilé les chiffres du quatrième trimestre 2024. Avec un parc total raccordé de 25 301 MW au 31 décembre dernier, la filière solaire dépasse pour la première fois celle de l’éolien (sites terrestres et en mer cumulés), qui totalise, quant à elle, 24 966 MW. Le dernier trimestre aura été particulièrement actif puisque près de 1,4 GW de nouvelles capacités photovoltaïques ont été raccordées durant cette période, soit un volume sensiblement plus élevé que celui du secteur éolien sur l’ensemble de l’année (1,2 GW). Le parc photovoltaïque français a progressé de 5 007 MW en 2024, dont un gros tiers (36 %) correspond à des installations comprises entre 100 et 500 kW. Côté production, la filière a généré 24,5 TWh d’électricité contre 22,4 TWh en 2023, ce qui a représenté 5,2 % de la consommation du pays l’an passé. Pour l’éolien, le bilan est loin d’être aussi brillant. La filière reste sur un rythme de progression annuelle compris entre 1 et 1,5 GW, une dynamique insuffisante pour rester dans la trajectoire de l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie, qui vise 33,2 GW à fin 2028. En revanche, l’éolien a produit davantage d’énergie que le solaire, avec 47 TWh (dont 4 TWh pour les parcs en mer), soit 10,5 % de la consommation électrique française de 2024. Toutefois, au-delà du satisfecit de ce bon bilan, ce qui monopolise aujourd’hui l’attention des acteurs du solaire, ce sont les réaménagements annoncés du tarif d’achat des installations de 100 à 500 kW, qui ont constitué le segment le plus dynamique en 2024. Publié le 27/02/2025. Selon des données préliminaires de l’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA), les ventes de pompes à chaleur ont chuté de 23 % en moyenne en 2024 par rapport à l’année précédente dans treize pays européens. L’échantillon des pays étudiés comporte l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni, qui représentent 85 % du marché européen. Parmi les marchés les plus touchés, la Belgique et l’Allemagne enregistrent des reculs respectifs de 52 % et 48 %. Seul le Royaume-Uni fait exception avec une hausse des ventes de 63 %, portée par des aides gouvernementales. Alors que 2,6 millions d’unités ont été écoulées en 2023, seules deux millions de pompes à chaleur ont été vendues en 2024, portant le parc total à environ 26 millions d’appareils dans les pays étudiés. Trois facteurs expliquent ce recul : l’instabilité des dispositifs de soutien public, un contexte économique défavorable marqué par la crise du pouvoir d’achat, et la baisse des prix du gaz. Face à cette situation, le secteur réduit sa production et supprime des emplois après avoir massivement investi ces dernières années. Au moins 4 000 postes ont déjà été supprimés, et plus de 6 000 sont affectés par le ralentissement du marché (baisse du temps de travail, chômage économique…). Publié le 27/02/2025. La Ville de Périgueux renforce son engagement pour la transition énergétique avec l’inauguration, le 19 février, de l’extension de son réseau de chaleur. Cette extension de 2 kilomètres permet d’alimenter 59 000 m² supplémentaires en chaleur renouvelable grâce au bois-énergie local. Porté par Engie Solutions, le réseau couvre désormais 7,3 kilomètres et dessert 58 bâtiments, dont le musée Vesunna, des bâtiments administratifs et le lycée Jay de Beaufort. Avec 82 % des besoins thermiques couverts par la biomasse, l’extension permet d’économiser 432 tonnes de CO₂ en plus par an, portant le total à 3 550 tonnes. Financé à hauteur de 3 millions d’euros, dont 970 000 euros par l’Ademe, ce projet contribue également à la filière sylvicole locale en valorisant 2 000 tonnes de bois supplémentaires chaque année. En plus de son impact environnemental, l’extension offre une stabilité tarifaire et réduit la facture énergétique des abonnés de 5 %. Publié le 20/02/2025. Dalkia, filiale du groupe EDF, et la plateforme Enerfip lancent une campagne de financement participatif pour le réseau de chaleur urbain de Remiremont (Vosges), alimenté par des énergies renouvelables. La levée de fonds qui vise un montant de 250 000 euros offre aux citoyens une opportunité d’investissement avec un rendement brut de 6,5 % par an, tout en contribuant à la transition énergétique locale. Une réunion d’information a eu lieu le 28 janvier au Centre Culturel de la ville. Ce réseau de chaleur écologique desservira plus de 60 bâtiments, dont des services publics, des écoles et des logements collectifs. Une chaufferie biomasse utilisant du bois-énergie local sera installée, permettant une réduction de 85 % des émissions de CO₂. La mise en service est prévue pour septembre 2025. Financé par l’Ademe, la Région Grand Est et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, ce projet sera d’abord ouvert aux habitants de Remiremont avant d’être élargi progressivement à d’autres territoires. Publié le 20/02/2025. Charwood Energy, spécialisé de la valorisation de la biomasse, a signé le 5 février son premier corporate PPA avec Verallia France, producteur d’emballages en verre, pour un approvisionnement en syngaz (gaz de synthèse) sur 21 ans. Ce contrat prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale de production de syngaz au sein de l’usine Verallia de Cognac. Ce gaz vert, issu de la pyrogazéification de biomasse, remplacera 20 % de la consommation d’énergie fossile d’un des fours du site, contribuant ainsi à la stratégie de décarbonation de Verallia. Avec une mise en service prévue au premier trimestre 2027, cette installation produira 30 GWh par an à partir de 8 000 tonnes de biomasse locale. Elle permettra d’économiser 6 000 tonnes de CO₂ par an, soit une réduction de 84,5 % par rapport au gaz naturel. Ce projet générera 5 emplois directs et 8 emplois induits. Financé par Charwood Energy et Eiffel Gaz Vert via W&nergy, il bénéficie d’une subvention de l’Ademe et de la région Nouvelle-Aquitaine. Publié le 13/02/2025. À l’occasion de son 20ème anniversaire, GRTgaz change de nom pour devenir NaTran. Avec son projet NaTran2030, l’entreprise vise la neutralité carbone d’ici 2050 et fixe des objectifs ambitieux à horizon 2030 : 50 % d’investissements verts, une multiplication par cinq des gaz renouvelables dans les réseaux, plus de 1000 kilomètres de nouvelles infrastructures pour l’hydrogène et le CO₂, une réduction de 40 % de son empreinte carbone et un renforcement des compétences internes. Le nom NaTran évoque le transport, la transformation énergétique et le respect de la nature. NaTran ambitionne de devenir un acteur de référence en Europe pour le transport et la logistique des gaz verts. Son développement repose sur l’ancrage territorial et la digitalisation pour innover et optimiser ses performances. Forte de ses 3 300 collaborateurs, l’entreprise ouvre un nouveau chapitre de son histoire au service de la décarbonation et de la souveraineté énergétique. Publié le 13/02/2025. L’Ademe a publié fin janvier plusieurs documents sur l’évolution du système électrique et des énergies renouvelables en France. Dans la mise à jour de son étude dédiée aux coûts des énergies renouvelables et de récupération, l’Ademe souligne que malgré la hausse des prix de l’énergie, les coûts des énergies renouvelables ont chuté sur la dernière décennie, rendant le photovoltaïque et l’éolien terrestre plus compétitifs que les centrales à gaz. Le coût du photovoltaïque oscille entre 70 et 91 €/MWh en 2022, tandis que l’éolien terrestre atteint 59 €/MWh, contre 172 €/MWh pour le gaz. Dans un autre document, un Avis dédié à l’autoconsommation photovoltaïque individuelle, l’Agence souligne les bénéfices de ce type d’opération, en particulier pour les secteurs à forte consommation diurne comme l’industrie, l’agriculture et le tertiaire. Pour le résidentiel, elle recommande d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire en décalant certains usages, tels que la charge des véhicules électriques et la production d’eau chaude sanitaire, vers les heures de forte production. Toutefois, du fait de leur impact environnemental, l’Ademe appelle à la prudence quant à la tentation d’installer des batteries stationnaires pour maximiser son autoconsommation. Enfin, selon son Avis sur la flexibilité et le stockage, le développement des énergies renouvelables, qui pourrait atteindre 200 GW d’ici 2050, n’implique pas une augmentation équivalente des capacités de stockage. Une multiplication par trois des moyens de stockage, soit environ 20 GW, suffirait, tandis que les centrales thermiques verraient leur rôle réduit. L’Ademe insiste sur l’importance de la flexibilité de la demande : adapter la consommation à la production permettrait ainsi de réduire les coûts et les impacts environnementaux associées à la transition énergétique. Publié le 13/02/2025. Dans le cadre de la discussion de la loi de programmation énergétique par les députés et sénateurs, l’association Énergies renouvelables pour tous dénonce un intense travail de lobby mené auprès des parlementaires sur le coût des énergies renouvelables comparé au nucléaire. Ce lobbying se baserait sur une note de 2022 du Cérémé, un autoproclamé cercle d’études sur l’énergie, appelée « Comparaison des coûts complets de l’électricité » qui assurait que « les énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien terrestre et en mer) ont des coûts de production plus élevés que le nucléaire « nouveau ». « Faux ! » réplique Énergies renouvelables pour tous à travers une réponse d’une vingtaine de pages rédigée par Frédéric Fortin, expert financier dans le domaine des infrastructures. La note du Cérémé est « truffée d’omissions et d’erreurs » assure-t-elle. Elle fait par exemple l’impasse sur les coûts cachés du nucléaire (traitement des déchets), sous-estime le coût du nucléaire pour surévaluer celui des énergies renouvelables, et ne maîtrise pas la méthodologie de calcul du LCOE, le coût actualisé de l’énergie. Ainsi alors que la Cour des comptes a estimé le LCOE du nouveau réacteur de Flamanville entre 122 €/MWh et 176 €/MWh, il est évalué à 103 €/MWh par le Cérémé, relève l’association, qui conclut : « Au-delà de la pollution générée dans le débat public, ce genre de prise de position conduit à justifier l’inaction, et ainsi à retarder la décarbonation et le développement d’un mix énergétique plus compétitif en France ». Publié le 06/02/2025. La nouvelle version de l’annuaire des formations aux énergies renouvelables édité par l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) est consultable en ligne grâce à un moteur de recherche. Cette nouvelle base de données permet de choisir la formation souhaitée selon plusieurs critères : région, type de formation, filière, niveau… Cet annuaire présente 204 formations ayant trait aux énergies renouvelables et à l’écoconstruction, allant de BAC+2 à Bac+5. Les professionnels en recherche de qualifications supplémentaires pourront consulter les formations continues de longue durée ou de courte durée ou les formations dispensées par des industriels et des bureaux d’études. Selon Stéphane Ducuing, qui a identifié les différentes formations : « La palette des formations incluant les énergies renouvelables dans le secteur de l’énergie s’est élargie à tous les échelons d’enseignement, du bac professionnel au master spécialisé en passant par les licences professionnelles ou plus récemment les BUT (Bachelor Universitaire Technologique). La période post-covid a fondamentalement modifié les formats d’enseignement et a permis de toucher un public plus vaste et plus diversifié. La mise à jour de cette année offre un focus complet sur les cursus et les débouchés de la filière, qui se révèlera tout aussi utile à l’étudiant faisant ses vœux sur Parcoursup qu’à l’ingénieur cherchant à se spécialiser ou l’installateur souhaitant renforcer ses compétences. » Publié le 06/02/2025. Engie Solutions et Wepa, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de papiers hygiéniques écologiques ont conclu un partenariat de 15 ans pour concevoir, exploiter et entretenir une chaufferie sur le site de Wepa à Bousbecque (Nord). Cette installation, soutenue par l’Ademe, couvrira 89 % des besoins en vapeur de l’usine, qui emploie plus de 400 personnes. Avec une puissance de 8 MW, elle produira 61 GWh de chaleur par an, réduisant ainsi la dépendance au gaz naturel. La biomasse utilisée proviendra d’un rayon de moins de 150 kilomètres. Opérationnelle en 2027, cette chaufferie renforcera l’indépendance énergétique de Wepa. Publié le 06/02/2025. Lhyfe annonce la construction de son premier site de production d’hydrogène vert dans les Hauts-de-France, à Croixrault (Somme). Situé stratégiquement au carrefour de l’Europe, ce site contribuera à la décarbonation de l’industrie et de la mobilité lourde, renforçant ainsi la souveraineté énergétique de la région, avance l’entreprise. Dès 2026, cette unité pourra produire jusqu’à 2 tonnes d’hydrogène vert par jour grâce à un électrolyseur alimenté par des énergies renouvelables. Cet hydrogène permettra aux industriels locaux de remplacer l’hydrogène gris et aux transports lourds de réduire leurs émissions de CO2. Ce projet s’inscrit dans la politique de réindustrialisation durable portée par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest et participe à l’essor économique local. Il complète le réseau de Lhyfe en France, déjà implanté dans le Grand-Ouest, le Sud-Ouest et l’Est. Les Hauts-de-France, région clé pour l’industrie (chimie, sidérurgie, métallurgie, verre) et la logistique, bénéficieront directement de cette production d’hydrogène vert. Ce site pourra également alimenter des stations pour camions, bus et autres véhicules lourds fonctionnant à l’hydrogène. Enfin, grâce à sa flexibilité, l’unité de Croixrault pourra stabiliser le réseau électrique régional en modulant sa consommation en fonction des besoins, assurant ainsi un soutien au réseau énergétique des Hauts-de-France. Publié le 30/01/25. Dans le cadre du plan Clean Industrial Deal actuellement préparé par la Commission européenne, l’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) révèle que les pompes à chaleur pourraient couvrir dès maintenant 37 % des besoins de chaleur industrielle. Elles éviteraient ainsi l’émission de 146 millions de tonnes de CO2, soit 24 % des émissions industrielles, et davantage que les émissions annuelles des Pays-Bas. « L’Europe a besoin d’une industrie compétitive et durable, et les pompes à chaleur de forte puissance en sont la clé, déclare Paul Kenny, directeur général de l’EHPA. Cette technologie fournit déjà une chaleur fiable, des économies et une énergie abordable dans les processus de fabrication, du papier aux pâtes alimentaires, et cela peut et doit s’accroître. Nous demandons instamment à la Commission européenne de placer les pompes à chaleur industrielles au cœur de ses prochains plans et politiques. » Ces dernières peuvent permettre de produire des températures jusqu’à 200 °C, précise l’association. Le Clean Industrial Deal doit être présenté par la Commission le 26 février 2025. Publié le 30/01/2025. Les villes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan lancent un réseau de chaleur décarboné, alimenté à 91 % par géothermie. Le 25 janvier, un contrat a été signé entre les maires des deux villes et Dalkia, opérateur du projet, en partenariat avec 2gré, filiale du groupe Arverne, et Île-de-France Énergies & Territoires. Les travaux débuteront en 2025 dans la ZAC du Bas Clichy et le centre de Livry-Gargan, avec un forage géothermique profond prévu pour 2026. D’ici 2031, le réseau atteindra 26 kilomètres et couvrira l’ensemble des quartiers des deux communes. Ce projet permettra de réduire les émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an. Avec ce nouveau réseau, les habitants bénéficieront d’une baisse de 50 % de leur facture énergétique, ce qui aidera 1 100 ménages à sortir de la précarité énergétique. Représentant un investissement total de 90 millions d’euros, porté par Dalkia et ses partenaires, ce projet reçoit le soutien de l’Ademe et de la Région Île-de-France. Publié le 30/01/2025. Le 21 janvier, le groupe Valorem et la Banque des Territoires ont annoncé le transfert d’un deuxième portefeuille de projets photovoltaïques et éoliens à leur plateforme commune d’investissement « Calypso », créée en 2023. Détenue à 51 % par Valorem et à 49 % par la Banque des Territoires, cette plateforme vise 500 MW de capacité de production d’énergies renouvelables d’ici 2027, soit plus de 1,1 TWh par an, équivalent à la consommation de 485 000 habitants. Le nouveau portefeuille comprend 12 centrales solaires et 8 parcs éoliens, portant la capacité totale de Calypso à 308 MW. Cette opération fait suite au refinancement d’une dette de 200 millions d’euros en octobre 2024. Ce partenariat renforce la transition énergétique en facilitant le financement et l’exploitation d’infrastructures renouvelables. Valorem apporte son expertise technique, tandis que la Banque des Territoires soutient le développement de ces projets. Publié le 24/01/2025. À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2025, les 21, 22 et 23 mars, des centrales hydroélectriques françaises ouvriront leurs portes au public. Ces journées visent à faire découvrir la petite hydroélectricité, une énergie locale, propre et durable, issue de la force des rivières. Les visiteurs pourront participer à des visites guidées, rencontrer des producteurs locaux engagés dans la transition énergétique et explorer un patrimoine industriel et naturel souvent méconnu. À ce jour, une quinzaine de centrales sont inscrites, avec d’autres ajouts prévus. Ces journées sensibilisent aux enjeux de la transition énergétique et de la gestion de l’eau, tout en mettant en valeur l’innovation technologique et le savoir-faire industriel. L’entrée est libre et gratuite, avec inscription préalable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.energiesdeleau.com. Publié le 24/01/2025. Le gouvernement a annoncé les résultats de l’appel d’offres « biométhane injecté », lancé en décembre 2023 pour les installations de biométhane de plus de 25 GWh/an, qui visait un volume de projet de 500 GWh/an. Un seul lauréat a été désigné, pour une production de 37 GWh/an. Face à cette très faible souscription, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire cet appel d’offres. Désormais, le soutien aux nouvelles installations de production de biométhane supérieures à 25 GWh/an reposera sur le mécanisme des certificats de production de biométhane (CPB), dont le cadre réglementaire a été finalisé en juillet 2024. Ce système impose aux fournisseurs d’intégrer une part de biométhane dans l’énergie distribuée à certaines catégories de consommateurs, avec une obligation applicable à partir de 2026. Un décret de juillet 2024 établit une trajectoire des volumes à atteindre pour 2026-2028. Parallèlement, le gouvernement engagera une concertation avec les acteurs de la filière pour définir les orientations post-2028, en cohérence avec la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Ce matin a eu lieu, dans les locaux parisiens de la FNCCR, la présentation du 15e baromètre des énergies renouvelables électriques en France, édité par Observ’ER (l’Observatoire des énergies renouvelables). Il met en lumière une année 2024 exceptionnelle, portée par le photovoltaïque. Avec une production record de 148 TWh (+9 TWh par rapport à 2023) et 6 GW de capacités supplémentaires raccordées, le parc total atteint désormais 78 GW. Cette croissance est principalement due au secteur solaire, qui a ajouté 4,5 GW grâce à l’essor des grandes centrales au sol et à l’autoconsommation, multipliant par quatre le rythme des raccordements par rapport aux années 2020. En revanche, l’éolien stagne, limité à 1,5 GW de nouvelles capacités annuelles, pénalisé par des contraintes réglementaires et administratives. L’éolien offshore reste incertain quant à sa capacité à respecter sa feuille de route. La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif ambitieux : atteindre 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030, contre 29,9 % en 2023. Bien que ces cibles soient à portée, elles nécessitent de maintenir, voire renforcer, les dynamiques actuelles tout en surveillant la croissance de la demande électrique. Ce baromètre offre une vue complète des performances des huit filières sur l’année écoulée. En téléchargement libre ICI. Publié le 16/01/2025. L’aéroport de Bordeaux annonce un projet de géothermie sur nappe qui sera opérationnel dès le premier semestre 2025. Ce projet intervient dans le cadre de la stratégie de décarbonation et d’efficacité énergétique de l’aéroport. Le système exploitera la chaleur des calcaires oligocènes, situés à 140 mètres de profondeur, pour chauffer et refroidir l’aéroport grâce à une boucle géothermale opérant entre 17°C et 22°C. Cette solution couvrira 40 % des besoins annuels en chaleur et 63 % en froid, complétée par les installations existantes de chaudières gaz et groupes frigorifiques. Les travaux, débutés en 2024, ont confirmé la viabilité technique des forages. La mise en service et les essais finaux sont prévus pour le début de 2025. Cette installation permettra de réduire annuellement 486 tonnes de CO₂ et 1 058 MWhep d’énergie primaire, soit l’équivalent de la consommation de 235 foyers. Publié le 16/01/2025. Le projet DEZiR, porté par Verso Energy en collaboration avec RTE, vise à capturer du CO2 biogénique (carbone contenu dans la biomasse d’origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation) et à produire du carburant d’aviation durable (e-SAF) dans la région de Rouen. Avec un investissement de 1,3 milliard d’euros, ce projet sera implanté à Alizay et Petit-Couronne et devrait être opérationnel en 2029. Le CO2, capté auprès de la chaudière biomasse d’Alizay, servira à produire 81 000 tonnes d’e-SAF par an, permettant d’éviter plus de 5 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans. En parallèle, RTE assurera le raccordement électrique du site. Ce projet créera jusqu’à 1 400 emplois pendant la construction et 250 emplois directs et indirects lors de son exploitation. La concertation préalable, organisée par la CNDP du 13 janvier au 15 mars 2025, permettra au public de s’informer et de contribuer via des réunions publiques, des rencontres de proximité et un site web dédié. Cette initiative s’inscrit dans les efforts de décarbonation du transport aérien, en alignement avec les objectifs climatiques de l’accord de Paris. Publié le 09/01/2025. Le 19 décembre, Brest métropole a inauguré le réseau de chaleur du Technopôle Brest-Iroise, un centre de recherche situé en périphérie de Brest en Bretagne. Après 10 mois de travaux, une chaufferie biomasse de 2,2 MW alimente désormais 1 500 équivalents-logements, avec une énergie renouvelable à 80 %, issue de 3 500 tonnes annuelles de plaquettes forestières locales. Sur 5 kilomètres avec 38 sous-stations, ce réseau dessert l’Ifremer, l’Université de Bretagne Occidentale, et l’école d’ingénieurs IMT Atlantique. Dotée de technologies innovantes comme des ballons de stockage thermique et un condenseur de fumées, la chaufferie optimise l’utilisation de la biomasse, réduisant les émissions de CO₂ de 2 500 tonnes par an. L’investissement total de 13,6 millions d’euros, cofinancé par Engie, Brest métropole et une subvention de l’Ademe de 4,8 millions d’euros, s’inscrit dans le plan climat de Brest métropole et a créé cinq emplois locaux. Le détail du projet est à lire dans notre numéro Le Journal des énergies renouvelables n° 269. Publié le 09/01/2025. Après cinq ans de travaux, le centre multifilière Run’Eva, situé à Saint-Pierre (île de La Réunion), a été inauguré le 18 décembre. Ce projet, répond à la saturation des capacités d’enfouissement des déchets sur l’île et s’inscrit dans les objectifs nationaux de transition énergétique. Déployé sur 7 hectares, le site regroupe 39 ouvrages, incluant des unités de tri des matières recyclables, de méthanisation des biodéchets et de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), avec une capacité de traitement de 145 000 tonnes de déchets par an. La turbine à vapeur installée produira 15 MW d’électricité, contribuant à l’autonomie énergétique de l’île et à la réduction de son empreinte carbone. Run’Eva a mobilisé jusqu’à 250 travailleurs et emploiera plusieurs dizaines de personnes à long terme. Publié le 20/12/2024. Le 6 décembre 2024, la ville de Toul (Meurthe-et-Moselle) a inauguré la chaufferie biomasse de son nouveau réseau de chaleur. Ce réseau de 12,5 kilomètres, alimenté par une chaufferie biomasse de 8,5 MW, fournira une énergie renouvelable et locale à 2 400 équivalents logements, ainsi qu’à une cinquantaine de bâtiments publics et privés, dont l’hôpital, des écoles et des résidences. Le projet, réalisé et exploité par Engie Solutions via la société Toul Énergie, permettra de maîtriser durablement les coûts énergétiques en les décorrélant des fluctuations des prix des énergies fossiles. Le réseau sera totalement opérationnel au printemps 2025 et pourra être étendu pour accueillir de nouveaux raccordements. Chaque année, 10 250 tonnes de bois-énergie provenant d’un rayon de 120 kilomètres autour de Toul alimenteront la chaufferie. Publié le 20/12/2024. Waga Energy va valoriser le biogaz produit par le site de stockage des déchets (30 000 tonnes par an) de l’Albié à Monflanquin (Lot-et-Garonne) en biométhane via une unité de méthanisation capable de produire 12 GWh de biométhane par an. Cette production, équivalente à la consommation annuelle de 3 000 foyers, sera injectée dans le réseau de gaz naturel local, alimentant particuliers et entreprises. Prévue pour fin 2025, cette unité réduira de 2 400 tonnes par an les émissions de CO₂. Outre l’alimentation en énergie propre du territoire, le biométhane pourra également desservir, sous forme de bio-GNV, des flottes de poids lourds via des stations Témob, soutenant la décarbonation de la mobilité lourde dans les agglomérations locales comme Villeneuve-sur-Lot et Agen. Publié le 12/12/2024. L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dédié à la gazéification hydrothermale suscite un vif intérêt, avec 24 projets identifiés en France. Cette technologie innovante vise à transformer les déchets industriels, urbains et agricoles en gaz renouvelable injectable dans les réseaux. Répartis sur 10 régions, ces projets pourraient valoriser annuellement 1,25 million de tonnes de déchets, contribuant à l’économie circulaire. En complément, des ressources telles que l’eau, l’azote et les minéraux sont récupérées, réduisant l’impact environnemental. Les projets visent une capacité d’injection de 2 TWh/an d’ici 2030, équivalente aux besoins de chauffage de 175 000 foyers. Cette solution intéresse particulièrement les industriels, notamment dans la chimie, pour réduire leur dépendance au gaz fossile. La gazéification hydrothermale apparaît comme une alternative aux méthodes traditionnelles telles que l’incinération, réduisant l’empreinte carbone de 80 % et les impacts environnementaux jusqu’à 100 %. Publié le 12/12/2024. Dans son dernier baromètre dédié aux énergies renouvelables dans les transports, EurObserv’ER estime que la consommation d’énergies renouvelables dans ce secteur au sein de l’Union européenne a atteint environ 20,9 Mtep en 2023, enregistrant une progression de 6,3 % par rapport à 2022. Partant de 9,6 % en 2022, la proportion des énergies renouvelables dans les transports devrait ainsi dépasser largement les 10 % en 2023. La consommation de biocarburants s’est établie à 18,5 Mtep, après une relative stabilité observée en 2021 (17,1 Mtep) et 2022 (17,4 Mtep). Parallèlement, la consommation d’électricité renouvelable, majoritairement utilisée dans les transports ferroviaires, a augmenté de 6,7 %, atteignant 2,4 Mtep (27,5 TWh) en 2023. Cette progression s’explique par le développement des véhicules électriques dans les transports routiers. Publié le 06/12/2024. Le 18 novembre, France Chaleur Urbaine a lancé un outil numérique pour aider les élus à identifier le potentiel de création de réseaux de chaleur dans leur commune. Cet outil permet de localiser les zones d’opportunité et les bâtiments pouvant être raccordés, en s’appuyant sur les modélisations réalisées par le Cerema. Les réseaux de chaleur, alimentés par des énergies renouvelables et de récupération comme la géothermie ou la biomasse, constituent une solution clé pour réduire les émissions de carbone des bâtiments. En moyenne en France, ils sont alimentés à hauteur de 66,5 % par ces énergies. La programmation énergétique nationale ambitionne de tripler la chaleur livrée par ces réseaux d’ici 2035, tout en portant le taux d’énergies renouvelables et de récupération à 80 %. En parallèle, un réseau de soutien aux collectivités, piloté par l’Association Amorce et ses partenaires, offre outils, ressources et retours d’expérience pour faciliter la création et le développement des réseaux. France Chaleur Urbaine accompagne également les collectivités pour optimiser l’extension des réseaux existants, grâce à des services gratuits et des campagnes de sensibilisation. Ces initiatives visent à accélérer la transition énergétique et à soutenir les élus dans leurs démarches pour une meilleure gestion des ressources locales. Publié le 06/12/2024. Pour Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé de bois, il était urgent de remettre quelques pendules à l’heure. Lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 5 décembre, l’association est revenue sur le thème majeur du lien entre chauffage au bois et qualité de l’air. C’est désormais l’un des marronniers de fin d’année, dès la montée en puissance des systèmes de chauffage dans le pays. L’augmentation des émissions de particules dans l’air sont trop souvent principalement associées à l’utilisation de combustibles bois. Chiffres à l’appui, Éric Vial, délégué général de Propellet, est venu rappeler les réalités d’un secteur qui n’a eu de cesse de progresser au cours des vingt dernières années. Grâce à la mise en place du label Flamme Verte et de la réglementation européenne Ecodesign, les appareils de chauffage à bûches ou à granulés ont grandement progressé dans leur efficacité énergétique et environnementale. Ainsi entre 2008 et 2022 les niveaux d’émissions de particules fines des appareils neufs mis sur le marché ont diminué de 250 à 40 mg par Nm3 pour les appareils à bûches et 20 mg par Nm3 pour les appareils à granulés en 2022. Associés à l’amélioration de la qualité des combustibles bois eux-mêmes (là aussi à travers la mise en place de labels), le secteur a vu sur la période 2000-2023 réduire de 38 % les volumes de combustibles bois consommés chaque année en France et ce, malgré une augmentation de 25 % du parc total. Il a également constaté une division par deux des émissions de particules fines PM2,5 (d’un diamètre inférieur à 2,5 microns) de l’ensemble du parc des appareils de chauffage bois français. Le message est donc clair, les nouveaux équipements mis chaque année sur le marché sont désormais très efficaces et améliorent nettement les performances du parc total. Cependant, il reste encore 3 millions d’appareils peu performants, environ 45 % du parc, et qui sont à l’origine de la très grande majorité des émissions de particules du secteur. Leur remplacement est l’un des axes prioritaires et pour y parvenir les professionnels demandent le maintien du niveau des aides du dispositif MaPrimeRénov’. L’arrêté paru hier au JO montre qu’ils n’ont pas été entendus puisque les aides à l’installation d’appareils bois ont été rabotées de 30 % environ. Publié le 29/11/2024. Le producteur d’électricité renouvelable, UNITe, va proposer des contrats de vente directe d’énergie aux entreprises et aux collectivités sous forme de PPA. Cette initiative vise à réduire sa dépendance aux mécanismes de soutien et à répondre à un marché énergétique en mutation. Sa filiale Green-Access aura pour mission de trouver les clients et d’assurer la contractualisation. Avec cette nouvelle offre, UNITe ambitionne de vendre un tiers de sa production directement aux consommateurs d’ici 2032. Les entreprises montrent un intérêt croissant pour les PPA, notamment pour stabiliser les coûts de leur énergie sur le long terme et pour faire face aux incertitudes autour du mécanisme Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), qui doit prendre fin en 2025. Ce dernier permet aux fournisseurs alternatifs d’électricité de s’approvisionner auprès du producteur historique (EDF) à un prix régulé et pour des volumes déterminés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Publié le 29/11/2024. Le 26 novembre, Enercoop, Ilek, Octopus Energy et Volterres ont annoncé la création du Collectif des Fournisseurs Verts. Ces quatre fournisseurs sont tous, par ailleurs, labellisés VertVolt. Ce label, lancé en 2021 par l’Ademe, repose sur l’achat conjoint de l’électricité renouvelable et de la garantie d’origine qui y est associée auprès du même producteur. Le collectif a pour ambition de renforcer la confiance des consommateurs grâce à une meilleure transparence et de soutenir ainsi, par la demande, la production d’énergie renouvelable. Dans cette optique, il formule trois propositions. Pour que les consommateurs puissent avoir une connaissance plus précise des offres vertes, il propose de donner une base légale au Label VertVolt, et de l’intégrer ainsi aux codes de l’énergie et de la consommation. Les comparateurs d’offres d’énergie pourraient également proposer des informations complémentaires aux prix affichés : origine de l’électricité, label ou encore qualité de service. Le collectif souhaite également que les contrats de gré à gré « intermédiés » – dit aussi utility PPA, lorsque les fournisseurs achètent en direct auprès des producteurs – soient couverts par le fonds de garantie de Bpifrance, afin que de plus petits acteurs puissent aussi bénéficier de prix stables à long terme. Enfin, le collectif rappelle son engagement en faveur des circuits courts de l’énergie et du partage de la valeur, en proposant des offres bonifiées aux consommateurs riverains des sites de production. Publié le 22/11/2024. Grand Besançon Métropole a signé avec Engie Solutions un contrat de concession de service public pour renforcer et étendre son réseau de chaleur. Cet accord, d’une durée de 12 ans, vise à alimenter plus de 23 000 logements équivalents avec une énergie décarbonée à 90 % renouvelable. Pour cela, le réseau sera étendu de 24 à 74 kilomètres pour raccorder à terme 500 bâtiments. Il sera alimenté en chaleur renouvelable grâce à l’optimisation du patrimoine existant, de la récupération des fumées des chaudières biomasses actuelles, de l’unité de valorisation énergétique voisine et de la mise en service d’une nouvelle chaufferie biomasse à l’horizon 2030. Ce système réduira les émissions de CO₂ de 35 000 tonnes par an. Le projet mobilisera un investissement de 122 millions d’euros, soutenu par l’Ademe via le Fonds Chaleur. Publié le 22/11/2024. Dans la famille de l’énergie solaire, la filière thermique n’est pas la plus médiatisée mais son actualité n’en reste pas moins riche. Dans l’une de ses dernières études, l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) revient sur l’activité de l’année 2023 et celle du premier semestre 2024 à travers une analyse centrée sur les applications individuelles et basée sur une dizaine d’entretiens menés avec des professionnels. La structuration du marché, les nouveaux acteurs, l’évolution des prix font partie des thèmes abordés pour mieux comprendre la dynamique actuelle de ce marché. Le rapport revient notamment sur l’avènement des installations solaires thermiques avec panneaux autostockeurs qui agite le secteur depuis quelques années. Introduits sur le marché en 2020, ces capteurs solaires intègrent un réservoir de fluide caloporteur de 150 litres où un échangeur de chaleur est immergé, dans lequel l’eau domestique circule et se réchauffe. Ces capteurs peuvent être installés en toiture ou en terrasse. Moins cher à l’investissement qu’un chauffe-eau solaire classique (2 000 € contre 4 700 €, sans la pose), les chauffe-eaux solaires avec panneaux autostockeurs ont redynamisé le marché en installant 29 420 m2 de surfaces en 2023, soit des volumes supérieurs aux CESI classiques en métropole (28 900 m2). Des performances aidées par l’aide MaPrimeRénov’ à laquelle ces installations pouvaient prétendre en 2023. Défenseurs et détracteurs de ces installations d’un nouveau type s’expriment. L’étude revient également sur les très belles performances des systèmes combinés en 2023 (+ 59 % avec 21 850 m2 vendus), un segment de marché qui connaît un renouveau depuis trois ans. Le rapport complet est disponible en libre téléchargement sur le site d’Observ’ER. Publié le 14/11/2024. Le 29 octobre, Veolia et le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (Siaap) ont inauguré une unité de production de biométhane issu de l’assainissement des eaux usées d’une grande partie du bassin de l’est et du sud-est parisien traitées par l’usine de Seine Valenton (94). Cette installation produira 45 GWh de biométhane par an qui seront injectés dans le réseau à compter de 2025. Une production suffisante pour alimenter en énergie plus de 10 000 foyers, tout en évitant l’émission de 9 000 tonnes de CO2 par an et pour un investissement de 18,5 millions d’euros. Publié le 14/11/2024. Le 12 novembre, la Ville de Châteauroux et Engie Solutions ont signé un contrat pour l’extension et l’exploitation d’un réseau de chauffage urbain renouvelable. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de transition énergétique de la ville, visant à desservir environ 11 000 logements et à alimenter le réseau à 94 % par des énergies renouvelables issues de la centrale géothermique Saint-Jean. À l’horizon 2027, le réseau s’étendra sur 34,9 kilomètres, permettant aux habitants d’accéder à une énergie stable et écologique, tout en réduisant de 10 780 tonnes les émissions annuelles de CO₂. La première phase inclut la rénovation de la centrale géothermique Saint-Jean et la sécurisation du réseau avec des chaudières gaz d’appoint. Le projet bénéficie d’un budget de 57 millions d’euros et pourra évoluer pour intégrer de nouvelles technologies. Une grande majorité des bâtiments raccordables seront de l’habitat collectif et des bâtiments publics (hôtel de ville, maisons de retraite, etc.). Publié le 07/11/2024. Le 6 novembre 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association Énergies Renouvelables pour Tous, représentée par le cabinet Huglo-Lepage, visant à obliger le gouvernement à respecter ses objectifs européens en matière de développement des énergies renouvelables. Ce rejet marque un recul par rapport à la jurisprudence « Grande-Synthe » de 2021, qui avait imposé à l’État d’intensifier ses actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, la France s’est exposée à des sanctions de la Commission européenne pour avoir raté l’objectif obligatoire. En effet, l’association souligne que la France reste en retard, avec un objectif de 23 % d’énergies renouvelables pour 2020 toujours non atteint en 2023. Ce recul interroge sur la portée réelle des engagements climatiques de la France et remet en question l’efficacité de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), qui vise à définir le mix énergétique futur, si le Conseil d’État ne la considère pas comme contraignante. Face à cette décision, Énergies Renouvelables pour Tous prévoit de saisir la Commission européenne pour renforcer le caractère opposable des engagements climatiques de l’État. Publié le 07/11/2024. Dans son dernier baromètre consacré aux pompes à chaleur, EurObserv’ER estime qu’environ 5,9 millions d’unités, toutes technologies confondues, ont été vendues dans l’Union européenne en 2023, soit une baisse modérée de 1,2 % par rapport aux presque 6 millions de PAC écoulées en 2022. Les PAC air-air réversibles dominent toujours le marché, représentant environ 4,3 millions d’unités vendues en 2023, avec des volumes comparables à ceux de l’année précédente. Le segment des PAC air-eau, après une année record en 2022, connaît quant à lui une contraction de 9,5 %, avec 1,3 million d’appareils écoulés en 2023. Ce recul s’explique par des baisses de ventes importantes sur certains marchés clés, dont l’Italie, la France et la Pologne, ainsi que par plusieurs facteurs tels que la chute des prix du gaz, l’inflation, le ralentissement de la construction neuve suite à la hausse des taux d’intérêt, et des politiques publiques moins incitatives. Les PAC géothermiques, en revanche, affichent une progression de 10,9 %, avec 136 914 unités vendues. Fin 2023, le parc de PAC installées dans l’UE est estimé à 54,2 millions d’appareils (52,2 millions de PAC aérothermiques et 2 millions de PAC géothermiques). Publié le 07/11/2024. Le 4 novembre, Agnès Pannier-Runacher a annoncé la mise en concertation publique de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette concertation, ouverte jusqu’au 15 décembre 2024, permet aux citoyens et acteurs institutionnels de contribuer à la définition de la politique énergétique et climatique du pays. La SNBC vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030 par rapport à 1990, tandis que la PPE ambitionne un passage à une consommation énergétique globale à 60 % décarbonée d’ici 2030. La transition énergétique repose sur des efforts de sobriété, l’électrification des transports, l’expansion des énergies renouvelables, et le développement du nucléaire. La concertation sur ces textes, supervisée par la Commission nationale du Débat public, inclut des consultations en ligne et des événements dédiés. Les objectifs de la stratégie s’inscrivent dans la trajectoire européenne du Pacte vert et du paquet « Fit for 55 ». De façon surprenante, la PPE n’affiche pas clairement la trajectoire de progression des énergies renouvelables devant permettre à la France de se conformer à la directive RED III (Renewable energy directive). Cette dernière vise l’objectif contraignant – validé par la France – d’atteindre au moins 42,5 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique global en 2030 et de s’efforcer de la porter collectivement à 45%. L’objectif de 42,5% impliquerait un taux de 44 % d’énergie renouvelable pour la France à cet horizon. Grenoble INP (Institut polytechnique de Grenoble), rattaché à l’Université Grenoble Alpes (UGA), a obtenu un financement de 3 millions d’euros dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Compétences et métiers d’avenir » pour son projet Bioraf. Ce projet vise à former des étudiants de niveau bac+5 et bac+8 aux procédés biotechnologiques pour les bioraffineries de biomasse végétale, en collaboration avec Clermont Auvergne INP et des entreprises partenaires comme Fibre Excellence et Bio-Valo. Coordonné par la professeure Christine Chirat, Bioraf met l’accent sur l’éco-conception et la valorisation des bioressources pour produire des biocarburants, des matériaux biosourcés et de l’énergie renouvelable. Les formations incluront des travaux pratiques sur les installations des entreprises partenaires et seront dispensées de manière collaborative entre les écoles. Le Groupe CMA CGM, entreprise de transport maritime en conteneurs et Suez ont signé un protocole d’accord pour intensifier la production de biométhane en Europe, visant à soutenir la transition bas-carbone dans le transport maritime. Cet accord ambitionne de produire jusqu’à 100 000 tonnes de biométhane par an d’ici 2030 à destination des navires CMA CGM. Un programme d’investissement commun de 100 millions d’euros et des projets de R&D permettront d’établir des sites de production en Europe et de développer des technologies innovantes pour la production de biocarburant. CMA CGM, engagé vers le Net Zero Carbone d’ici 2050, s’appuie sur ce partenariat pour renforcer son usage de carburants alternatifs et a d’ores et déjà investi dans une flotte de 131 navires bas-carbone à livrer d’ici 2028. SUEZ, fort de son expertise sur la valorisation énergétique des déchets a permis en 2023 d’éviter 6,4 millions de tonnes de CO2. Ce partenariat stratégique vise à accélérer la décarbonation du transport tout en consolidant les chaînes d’approvisionnement de carburants renouvelables. Publié le 24/10/2024. Solagro a publié une étude, basée sur le scénario Afterres2050, pour évaluer le potentiel de biomasse mobilisable en France métropolitaine d’ici 2050, tout en prenant en compte la production alimentaire, la lutte contre le changement climatique, et la réduction des impacts environnementaux. La publication analyse aussi les filières de valorisation énergétique de la biomasse, avec des applications possibles pour la production de chaleur, de méthane et de carburants liquides. La mobilisation de la biomasse pour l’énergie est un sujet sensible mais crucial dans la course à la neutralité carbone d’ici 2050, qui nécessite l’abandon des énergies fossiles. En France, bien que l’électricité soit un vecteur énergétique décarboné privilégié, elle ne couvrira que 50 % des besoins énergétiques finaux à cette échéance, contre 25 % aujourd’hui. Certains secteurs sont difficiles à électrifier, notamment ceux nécessitant de la chaleur haute température, les transports lourds longue distance, ou encore les transports maritimes et aériens. Dans ces cas, le recours aux bioénergies (biomasse solide, liquide ou gazeuse) devient indispensable. Publié le 24/10/2024. Lhyfe a posé la première pierre de son plus grand site de production d’hydrogène vert en France, situé à Le Cheylas en Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA). Cette unité de production, d’une capacité de 10 MW qui sera alimentée par de l’électricité d’origine renouvelable, produira dès 2025 jusqu’à quatre tonnes d’hydrogène vert par jour, doublant ainsi la capacité initialement prévue. Installé sur un ancien site de stockage de déchets de l’aciérie Ascométal, ce projet participera à la décarbonation de la mobilité et de l’industrie locale en remplaçant les produits pétroliers et l’hydrogène gris. L’hydrogène vert produit alimentera notamment les stations du réseau HYmpulsion, opérateur d’infrastructures d’avitaillement en hydrogène de la région AuRA, et les industries locales. Le projet bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de financements européens, incluant une subvention de 5,5 millions d’euros. Publié le 18/10/2024. Seul rendez-vous dédié à toutes les énergies renouvelables en France, le Forum EnerGaïa est le rendez-vous professionnel incontournable des acteurs et des solutions en faveur d’une économie décarbonée et plus durable. Territoires, villes et industries viennent y trouver des solutions innovantes, concrètes et transversales pour répondre à leurs enjeux de transition. Le Forum EnerGaïa se déroule les mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier et lance, pour la première fois, les Trophées de l’innovation : un événement pour mettre en lumière les innovations, nouveautés et avancées techniques des exposants en réponse aux grands enjeux de transition. Quatre prix seront décernés dans 4 catégories inédites et transversales :
Publié le 18/10/2024. Airbus a inauguré le 3 octobre une nouvelle chaufferie biomasse à Toulouse, en partenariat avec Engie et l’Ademe. Cette installation permettra de couvrir 86 % des besoins en chaleur des sites toulousains du constructeur aéronautique à partir d’énergies renouvelables, évitant ainsi l’émission de 26 000 tonnes de CO₂ par an. Cette chaufferie, d’une puissance de 20 MW, s’ajoute à une première installation de 14 MW en service depuis 2013, portant la capacité totale à 34 MW. Ces deux chaudières alimentent un réseau de chauffage de 15 kilomètres couvrant plus de 60 bâtiments sur 800 000 m². Le bois utilisé provient de sources locales dans un rayon de 120 kilomètres. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de décarbonation d’Airbus, visant à réduire son empreinte carbone à Toulouse, où se situent ses lignes d’assemblage et son siège social. Lauréat du Fonds Chaleur de l’Ademe, le projet a reçu une subvention de 9 millions d’euros. Publié le 18/10/2024. Après son suivi détaillé des chiffres de marché, Observ’ER vient de mettre en ligne son étude qualitative sur le marché des pompes à chaleur (PAC) individuelles, jusqu’à une puissance de 30 kW. Basé sur des entretiens approfondis avec des professionnels du secteur, le travail revient en détail sur les faits majeurs de 2023 et les premières orientations du marché en 2024. Les différents chapitres de l’étude passent notamment en revue l’évolution de la structuration des filières, le persistant écueil du manque d’installateurs – et de foreurs pour la partie géothermie – ainsi qu’un ressenti sur l’impact des dispositifs de soutien au marché. Parmi l’ensemble des thématiques abordées, une polarise tout particulièrement l’attention des acteurs : la nouvelle réglementation européenne F-Gaz qui régit l’utilisation des fluides frigorigènes dans les applications de réfrigération (dont font partie les pompes à chaleur). Les nouveaux textes, qui s’appliquent depuis mars 2024 aux 27 pays membres de l’Union européenne, ambitionnent une très nette accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre associées aux gaz fluorés contenus dans les pompes à chaleur d’ici à 2050 avec notamment une période critique de 2025 à fin 2030 qui va porter 80 % de l’ensemble des efforts à réaliser. Un immense défi pour l’industrie française et européenne qui a déjà anticipé techniquement ce virage avec l’introduction de nouveaux fluides moins nocifs comme le propane. Cependant les échéances arrivent très vite et le secteur va devoir procéder à des changements complets des gammes des produits diffusés sur le marché dans les cinq années à venir. Publié le 10/10/2024. La Commission européenne vient de publier les conditions générales de son deuxième round d’appel à projets pour la production d’hydrogène renouvelable (enchère IF24), via le Fonds d’innovation. Cette enchère, qui est un pilier essentiel de la Banque européenne d’hydrogène, apporte un soutien financier aux producteurs d’hydrogène classés comme carburants renouvelables d’origine non biologique. La procédure débutera le 3 décembre 2024 et accordera jusqu’à 1,2 milliard d’euros d’aide aux projets retenus. Les soumissionnaires retenus dans le cadre de l’enchère IF24 recevront une prime fixe en €/kg d’hydrogène renouvelable produit, sur une durée maximale de dix ans d’exploitation. Le soutien du Fonds d’innovation permettra de combler l’écart entre les coûts de production et le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour l’hydrogène renouvelable. En s’appuyant sur les enseignements de l’enchère pilote et facilitant une contribution du financement de l’UE aux objectifs du Net-Zero Industry Act (NZIA), un nouveau critère a été introduit : les projets seront évalués sur leur capacité à « assurer la sécurité de l’approvisionnement en biens essentiels et contribuer au leadership industriel et à la compétitivité de l’Europe ». La Commission veillera également à ce que des processus de production sûrs en Europe soient soutenus par des exigences appropriées en matière de sécurité et de cybersécurité. Publié le 10/10/2124. Dans son rapport Renewables 2024, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dresse un panorama encourageant pour le développement des énergies renouvelables électriques (photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse, etc.) dans le monde. L’AIE estime que près de 5 500 GW de nouvelles capacités seront installées à l’échelle mondiale d’ici 2030, soit presque trois fois la croissance observée entre 2017 et 2023. Le photovoltaïque devrait à lui seul croître de 4 210 GW d’ici la fin de la décennie, soit 80 % du total, un bouleversement du mix mondial. La Chine jouera un rôle clé, représentant 60 % des nouvelles installations. Les énergies renouvelables produiront près de la moitié de l’électricité mondiale d’ici 2030, avec une part du solaire et de l’éolien doublant pour atteindre 30 %. Portée par la croissance de l’électricité renouvelable, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale devrait passer à près de 20 % en 2030, contre 13 % en 2023. L’AIE souligne également la nécessité de construire et moderniser près de 25 millions de kilomètres de lignes électriques et d’atteindre 1 500 GW de capacité de stockage pour garantir la flexibilité des réseaux. Le rapport n’aborde qu’à la marge la chaleur renouvelable mais évoque les carburants renouvelables (biomasse solide, liquide, e-carburants, biogaz, hydrogène). Ces derniers devraient peu progresser, leur part dans la demande d’énergie mondiale devrait être de 5,5 % d’ici 2030. L’Agence rappelle que les projections de croissance du parc renouvelable mondial demeurent encore en deçà de l’objectif de la COP28 de tripler les capacités renouvelables d’ici 2030. Publié le 04/10/2024. Les travaux viennent officiellement de commencer pour la construction d’une nouvelle station multi-énergies sur l’aire de Dardilly (Rhône) le long de la route M6 (ex A6) et il s’agira de l’une des premières aires routières sans pétrole en France. Ce projet qui va être développé et exploité par GNVert et Engie Vianeo, deux marques d’Engie dédiées à la mobilité durable, s’inscrit dans la politique de transition énergétique portée par la Métropole de Lyon. La station distribuera du BioGNV à fort débit permettant d’avitailler tout type de véhicule : poids lourds, bennes à ordures ménagères, bus, véhicules légers. Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, d’une puissance de 300 kW à 500 kW avec dix points de charge, y sera également installée, accessible à tous les véhicules électriques. L’électricité fournie par les bornes de recharge sera garantie d’origine renouvelable. Publié le 04/10/2024. Waga Energy, en partenariat avec Veolia, a lancé une nouvelle unité de production de biométhane sur le site de valorisation des déchets de Granges en Saône-et-Loire, marquant ainsi leur sixième projet commun en six ans. Cette unité utilise la technologie Wagabox pour épurer le biogaz produit afin d’en faire du biométhane, qui est ensuite injecté dans le réseau de gaz naturel. Avec une capacité de traitement de 600 m³/h et une production annuelle de 25 GWh, elle peut alimenter plus de 3 000 foyers tout en réduisant les émissions de CO2 d’environ 3 300 tonnes par an. Le site de Granges, qui traite jusqu’à 130 000 tonnes de déchets par an, améliore son efficacité énergétique en remplaçant un ancien moteur de cogénération biogaz par cette nouvelle unité d’injection de biométhane. Publié le 27/09/2024. La Ville de Niort projette de développer un réseau de chaleur urbain décarboné, en visant un mix énergétique avec 80 % d’énergies renouvelables. Deux réseaux existent actuellement : celui des Brizeaux, fonctionnant au bois énergie, et celui du Clou-Bouchet, alimenté au gaz. Ce dernier, propriété de Deux-Sèvres Habitat, doit être repris par la Ville car il ne peut plus être maintenu sous sa forme actuelle. Une étude de faisabilité a été lancée pour racheter et convertir le réseau du Clou-Bouchet aux énergies renouvelables. Deux options sont envisagées : récupérer la chaleur industrielle de l’entreprise Thébault, spécialisée dans la fabrication de panneaux de contreplaqué, ou installer une chaudière biomasse. La transition vers les énergies renouvelables permettra de stabiliser et réduire les coûts pour les abonnés, qui bénéficieront d’une TVA réduite à 5,5 %. Ce projet s’inscrit dans les objectifs de Niort Durable 2030 et du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), avec une réduction potentielle de 3 500 tonnes de CO2 par an. Publié le 27/09/2024. Parmi l’ensemble des études récurrentes réalisées par l’Ademe, celle portant sur les marchés et emplois de la transition énergétique est l’une des plus attendues. Chaque année à la rentrée, ce travail vient passer au crible le développement trois grands secteurs concourant à l’évolution des modes de production et de consommation en France non pas d’un point de vue énergétique mais économique à travers des indicateurs d’investissement, d’activité économique générée et d’emplois directs associés. Ces secteurs sont : les énergies renouvelables et de récupération, les transports terrestres et le bâtiment résidentiel. Pour le domaine des énergies renouvelables et de récupération les résultats sont bons puisqu’ils mettent en avant des hausses significatives d’emplois directs (166 330, +16,8 % par rapport à 2021) ainsi que de l’activité économique (46,1 milliards d’euros, +19 % par rapport à 2021). Il faut cependant noter que dans le périmètre de l’étude figure l’ensemble des filières renouvelables développées commercialement en France à l’exception de l’éolien en mer et des autres énergies marines. Sur la période 2020-2022, les investissements réalisés sur bon nombre de filières ont connu un développement nettement plus important que ce qui avait pu être observé au cours de la décennie 2010. Ainsi pour les filières EnR&R hors bâtiment résidentiel, les investissements dans de nouvelles centrales ont progressé de 63 % entre 2020 et 2022. Mieux encore, les filières appliquées au résidentiel (essentiellement les appareils de chauffage renouvelable) ont augmenté de 85 % en deux ans. Sans surprise les deux filières renouvelables les plus dynamiques en 2022 ont été le photovoltaïque et les pompes à chaleur aérothermiques. La première affiche une activité de 9,7 milliards d’euros – un record pour la filière – et 18 300 ETP (équivalents temps plein). La seconde est avec 66 570 ETP la première filière en termes d’emplois de tous les secteurs renouvelables. Une ombre pointe cependant : l’ensemble des trois secteurs couverts dans l’étude affiche un déficit pour le commerce extérieur qui a atteint un niveau inédit de 18,5 milliards d’euros. Ce passif est essentiellement le résultat des importations de voitures électriques, le photovoltaïque pèse tout de même pour 2,3 milliards dans ce déficit. Publiée le 19/09/2024. Suez et le sucrier Tereos, annoncent la construction de la première chaufferie à Combustibles Solides de Récupération (CSR) des Hauts-de-France pour une mise en service prévue en 2027. Cette installation permettra de remplacer 40 % de la consommation de gaz fossile de la sucrerie-distillerie d’Origny-Sainte-Benoite (Aisne), en utilisant des déchets non recyclables comme source d’énergie. La chaufferie traitera les déchets non dangereux non recyclés (bois, papiers, cartons, plastiques, mousse…) principalement enfouis aujourd’hui. Le projet vise à réduire les émissions de CO2 de Tereos de 65 % d’ici 2032. Il créera 150 emplois pendant la construction et 50 postes permanents, tout en contribuant à la transition énergétique et à l’économie circulaire. Publiée le 19/09/2024. L’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG) et Enerplan, le syndicat professionnel de l’énergie solaire, ont signé une feuille de route visant à favoriser le couplage et le déploiement de solutions combinant solaire thermique et géothermie. La combinaison de ces deux énergies permet de réaliser du stockage intersaisonnier de chaleur solaire dans le sous-sol, afin de récupérer en période hivernale la chaleur estivale stockée. Cette feuille de route formalise la collaboration des deux entités sur ces sujets, qu’ils soient de nature technique, réglementaire ou de communication. L’objectif : éclairer les professionnels du secteur sur la pertinence de ces combinaisons. En 2023, les pouvoirs publics ont publié un Plan d’action pour le développement de la géothermie. Un plan équivalent pour la chaleur solaire est attendu pour 2025. Publié le 13/09/2024. La géothermie permet de chauffer des bâtiments mais elle est également pertinente pour assurer la climatisation et le rafraîchissement. C’est ce que montre l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG) dans une étude technico-économique qui compare les installations géothermiques à d’autres solutions de refroidissement dans cinq typologies de bâtiments : maisons, logements collectifs, bureaux, commerces et établissements de santé. « Dans tous les scénarios techniques envisagés, qu’il s’agisse des sondes géothermiques verticales et des solutions de géothermie sur nappe, ces analyses démontrent des économies intéressantes par rapport aux solutions classiques », affirme Xavier Moch, expert géothermie de surface à l’AFPG. Si les solutions de géothermie nécessitent un investissement important au départ, elles présentent en effet des coûts d’exploitation réduits. L’avantage est d’autant plus marqué que les prix de l’énergie et de l’électricité ont tendance à augmenter. L’étude montre qu’à Paris par exemple, 875 millions d’euros de bénéfices pourraient être tirés sur 50 ans si toute la ville était climatisée par géothermie. Cette énergie renouvelable présente également des avantages environnementaux et sanitaires puisqu’elle atténue l’effet d’îlot de chaleur urbaine. Elle contribue à une diminution du taux de mortalité pendant les périodes de températures élevées, ainsi qu’à une réduction de la morbidité et de la perte de productivité. Publié le 13/09/2024. Observ’ER (l’Observatoire des énergies renouvelables) vient de mettre en ligne son analyse du marché 2023 des applications solaires thermiques pour particuliers. Depuis une quinzaine d’années, la filière évolue avec une alternance de progressions et de reculs des chauffe-eaux solaires ou des installations combinées (eau chaude sanitaire plus chauffage) tout en restant sur des volumes de m2 de capteurs installés limités (moins de 100 000 m2 par an en métropole). En 2023, ce sont les systèmes solaires combinés (SSC) qui se sont tout particulièrement distingués avec un marché de près de 22 000 m2 et 59 % de mieux en un an. Les crises énergétiques et économiques récentes ont donné un nouveau souffle au solaire thermique. De plus en plus de particuliers ont recherché des solutions susceptibles de réduire leurs factures énergétiques, ce qui a profité au secteur et tout particulièrement aux SSC. Du côté des chauffe-eaux solaires individuels (CESI), le marché a progressé uniquement à la faveur du développement des capteurs auto-stockeurs. Introduite il y a moins de cinq ans, cette technologie associe un capteur solaire sous lequel est placé un réservoir d’eau, qui intègre un échangeur thermique contenant un fluide caloporteur. Moins cher et plus simple à installer, mais plus particulièrement destiné aux régions les plus ensoleillées, ce type d’équipements est rapidement monté en puissance en affichant un volume de 29 420 m2 en 2023, soit un meilleur niveau que celui des CESI traditionnels (28 900 m2). Le bilan du marché solaire thermique métropolitain en 2023 pourrait sembler positif s’il n’était confronté aux objectifs attendus de développement pour le secteur. La Stratégie française pour l’énergie et le climat (mise en consultation en novembre 2023) ambitionne 6 TWh de chaleur issue de solaire thermique pour 2030 en France métropolitaine, puis 10 TWh fin 2035. Les estimations pour 2023 font état de 1,58 TWh d’énergie générée, soit un niveau et une dynamique très loin de la trajectoire recherchée. Publié le 06/09/2024. Le 27 août, Grand Chambéry a inauguré cinq nouveaux bus bioGNV (gaz naturel pour véhicules), marquant une avancée significative dans la transition énergétique du réseau de transport public de l’agglomération. Ces véhicules, plus écologiques que les anciens bus diesel, font partie d’un investissement de 5,7 millions d’euros pour l’acquisition de 15 bus cette année, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, responsable de 30 % des émissions nationales. Les nouveaux bus offrent également un meilleur confort avec des équipements tels que la climatisation, le wifi, des espaces dédiés aux fauteuils roulants et poussettes, ainsi que des systèmes de sécurité avancés. Grand Chambéry s’est fixé l’objectif d’acquérir un total de 30 bus d’ici quelques années, renforçant ainsi l’offre de transport en commun et contribuant à la diminution de la dépendance à la voiture individuelle. Publié le 06/09/2024. La Ville de Créteil a annoncé le 28 août que les travaux de la nouvelle station de production et de distribution d’hydrogène renouvelable, ont commencé le 10 juin. Baptisée H2 Créteil, la station sera construite à côté de l’unité de valorisation énergétique Valo’Marne (UVE) appartenant à la société éponyme, filiale de Suez. À la fin des travaux, la station sera reliée à l’UVE et utilisera l’électricité produite par cogénération à partir de la combustion des déchets ménagers des 19 communes gérées par le Syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne, propriétaire de l’UVE. Cette nouvelle station produira 1 000 kg d’hydrogène par jour, générés par électrolyse de l’eau, grâce à la valorisation énergétique des déchets. Valo’Marne assure la majorité du financement de cette opération, estimé à 16,3 millions d’euros, pour laquelle 6,3 millions d’euros de subventions ont été obtenus : 1,7 million d’euros de l’Ademe, 1,1 million d’euros de la Région Île-de-France et 3,5 millions d’euros de fonds européens. La Caisse des dépôts complétera l’investissement par le biais de la Banque des territoires. Cette installation nécessitera douze mois de travaux avant sa mise en service à la mi-2025. Grâce à elle, environ 1 500 tonnes d’équivalent CO2 par an à l’échelle régionale devraient être évitées. Publié le 30/08/2024. Début août, la coentreprise Paprec Energies / Pizzorno Environnement a été choisie par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération (Var) pour la construction et l’exploitation du futur pôle de transition environnementale de l’agglomération dracénoise. Le contrat prendra la forme d’une délégation de service public (DSP) pour une durée de 25 ans. D’un investissement de 130 millions d’euros, le centre comprendra une unité de tri et pré-traitement des déchets, une unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés et un réseau de chaleur. L’usine séparera les matières encore valorisables des déchets ménagers pour les transformer en CSR (combustibles solides de récupération). Ce combustible alimentera une chaufferie fonctionnant en cogénération produisant ainsi de la chaleur et de l’électricité pour le futur réseau de chauffage urbain. En effet, ce dernier – de 13,8 kilomètres – fournira 4 MWh par an d’énergie et d’eau chaude. Ce projet vise à réduire considérablement l’enfouissement des déchets ménagers, décarboner le territoire en évitant l’émission de près de 4 000 tonnes de CO2 par an, et atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de la région Sud PACA. L’investissement total de 130 millions d’euros sera porté par une société d’économie mixte à opération unique (Semop). Le chiffre d’affaires est garanti par le traitement annuel de 48 000 tonnes de déchets au prix de 175 euros la tonne sur 25 ans. La mise en service est programmée pour le second semestre 2028. Publié le 30/08/2024. Le projet de fabrication d’hydrogène à partir de déchets, initié par l’entreprise espagnole Raven SR, a été désigné « Projet et investissement d’intérêt régional autonome » par le ministère régional d’Aragon en Espagne. Cette récompense permettra de réduire les délais administratifs du projet prévu à Saragosse. D’ailleurs, il a déjà été soutenu par la Commission européenne via une aide de 2,4 millions d’euros en 2022 pour le démarrage de son usine. Raven SR a également obtenu 1,4 million d’euros supplémentaires du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique d’Espagne. La technologie Raven SR se base sur un procédé de réduction chimique et thermique sans combustion qui convertit les déchets organiques et les gaz d’enfouissement en hydrogène et en carburants synthétiques grâce au procédé Fischer-Tropsch. D’après Raven SR « contrairement à d’autres technologies de production d’hydrogène, sa reformation vapeur/CO2 ne nécessite pas d’eau douce comme matière première et utilise moins de la moitié de l’énergie de l’électrolyse ». L’entreprise ambitionne de produire 75 kilogrammes d’hydrogène de qualité transport pour chaque tonne de déchets organiques, soit environ 5 250 kilogrammes d’hydrogène par jour pour un total annuel d’environ 1,8 million de kilogrammes. Le projet devrait être opérationnel en 2026. Publié le 25/07/2024. En collaboration avec l’Ademe, Observ’ER vient de mettre en ligne sur son site l’état des lieux du parc d’installations de méthanisation en service en France au 1er janvier 2024. Ce travail dresse le bilan de la filière suivant les différents types de sites ou de valorisation existants. Le document recense 1 724 installations opérationnelles dans le pays, un chiffre en progression de plus de 12 % en une année, pour un secteur qui est l’un des plus transverses en matière de production d’énergie finale puisque la méthanisation se valorise sous forme d’électricité, de chaleur, de biométhane (biogaz injecté dans le réseau national gazier) et de combustible pour véhicule avec le bioGNV. Parmi l’ensemble des données disponibles on retient notamment la progression du biométhane dont 9,1 TWh PCS (pouvoir calorifique supérieur) ont été injectés dans le réseau de gaz naturel en 2023, soit l’équivalent de la consommation de gaz de 1,8 million de personnes. L’état des lieux est également disponible sur le site SINOE, un outil dédié à l’observation et à l’analyse des déchets ménagers et assimilés. Publié le 25/07/2024. Le 25 juin, Séché Environnement a inauguré son unité de production de biométhane Wagabox à Sainte-Marie-Kerque dans le Pas-de-Calais. Cette installation innovante valorise les déchets enfouis sur un site de stockage pour produire du biométhane. La technologie développée par Waga Energy, permet de capter et traiter le gaz émis par les déchets, produisant ainsi du biométhane injecté directement dans le réseau de GRDF. Cela permet d’éviter l’émission de 5 800 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de la consommation de 5 500 foyers. L’unité de Sainte-Marie-Kerque, capable de traiter 800 m³/h de gaz brut pour produire jusqu’à 35 GWh de biométhane par an, pouvant notamment servir à la décarbonation des secteurs du transport et de l’industrie. Auparavant, sur ce site de Séché Environnement, le gaz était converti en électricité, mais la solution développée par Waga Energy augmente significativement la production d’énergie renouvelable. Publié le 18/07/2024. Le 12 juillet, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la parution d’un décret et d’un arrêté relatif au dispositif des certificats de production de biogaz. « Le dispositif de certificat de production de biogaz (CPB), créé par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution de certificats de production de biogaz. Les fournisseurs de gaz naturel pourront obtenir ces certificats en produisant eux-mêmes du biométhane, ou auprès de producteurs de biométhane », peut-on lire dans le communiqué. Les producteurs de biogaz disposeront ainsi d’un revenu associé à la commercialisation de ces certificats, ce qui n’était pas le cas avant. Celui-ci viendra s’ajouter à la vente physique de la molécule de biométhane. Les certificats garantiront au consommateur, lors de son achat auprès des fournisseurs, la part de biogaz financée dans le cadre de sa facturation. Avec la publication de ces textes, l’État ambitionne une production de CPB de 0,8 TWh en 2026, 3,1 TWh en 2027 et 6,5 TWh en 2028. En 2023, la production de la filière biogaz a atteint 9,1TW. Publié le 18/07/2024. La PME industrielle Elyse Energy a confirmé l’implantation de sa première plateforme industrialo-portuaire de production intégrée de e-méthanol et de e-kérosène, baptisée NeoCarb, à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Ce procédé consiste à gazéifier d’une part de la biomasse solide (déchets et résidus de bois principalement) et d’autre part à produire de l’hydrogène vert ou « bas carbone », afin d’obtenir des hydrocarbures de synthèse à partir des gaz produits, riches en molécules de carbone et d’hydrogène. La société a sécurisé une parcelle de 51,3 hectares dans le Grand Port Maritime de Marseille pour ce projet qui comprend deux phases : la production d’e-méthanol pour le transport maritime, puis dans un second temps la conversion de cet e-méthanol en e-kérosène pour le transport aérien. NeoCarb produira 100 000 tonnes de e-méthanol et 50 000 tonnes de e-kérosène par an, contribuant ainsi à la décarbonation des transports. Elyse Energy prévoit la mise en service de la première phase en 2030, créant environ 600 emplois et nécessitant un investissement initial d’un milliard d’euros. Lire aussi nos articles évoquant ce projet dans Le Journal des Énergies Renouvelablesn° 265 et le hors-série « Bois-énergie : réalités et enjeux » d’avril 2024 du Journal des énergies renouvelables. Publiée le 11/07/2024. Newheat, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et Engie Solutions annoncent leur participation à un programme européen de Recherche & Développement nommé Treasure. Celui-ci porte sur l’étude d’un système de stockage de chaleur en fosse (ou Pit Thermal Energy Storage – PTES) à grande échelle relié au réseau de chaleur urbain de l’agglomération de Pau. Il s’agit d’accumuler et de décharger la chaleur au sein d’une fosse contenant de l’eau ou une matière minérale (sable ou graviers) associée à un fluide caloporteur. Le surplus de chaleur renouvelable disponible en période estivale sera stocké afin de pouvoir alimenter l’extension du réseau de chaleur urbain de l’agglomération de Pau en période hivernale. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet européen Treasure, soutenu par l’Union Européenne à hauteur de 9,9 millions d’euros et a pour but de faire la démonstration de grands systèmes de stockage d’énergie thermique en fosse. L’étude du stockage palois est la seule initiative française retenue pour le projet. Plusieurs projets de ce type existent déjà, notamment au Danemark. L’Europe souhaite améliorer la connaissance de ces solutions et faciliter leur déploiement dans d’autres contextes territoriaux. S’appuyant sur 15 initiatives réparties dans 5 pays européens et portées par 24 partenaires, le consortium Treasure fournira au moins trois grands démonstrateurs opérationnels et contrôlés et quatre démonstrateurs supplémentaires à un stade de développement plus précoce d’ici décembre 2027. La première phase du projet français, qui implique des études techniques, économiques et environnementales détaillées, devrait durer 1 an. Cette première phase est sur le point de démarrer pour déterminer la faisabilité d’un démonstrateur. Publiée le 11/07/2024. Lidl annonce la mise en circulation de son premier véhicule à hydrogène vert. Le camion, en service depuis début 2024, assure les livraisons des supermarchés Lidl dans la région Nantaise. Ce poids lourd, équipé de deux piles à combustible totalisant 180 kW et offrant une autonomie de 400 kilomètres, se ravitaille à la station multi-énergies de La Roche-sur-Yon, inaugurée en décembre 2021. Il utilise de l’hydrogène vert 100 % renouvelable fourni par l’entreprise Lhyfe et peut transporter jusqu’à 18 palettes avec une charge utile de 26 tonnes. Le groupe Jacky Perrenot, spécialiste du transport routier de marchandises, a adopté ce camion. En collaboration avec Lidl, il renouvelle annuellement une partie de la flotte avec des véhicules utilisant des énergies alternatives, les premières livraisons entièrement électriques ayant débuté en 2021. Après l’inauguration en mars 2022 de la première plateforme logistique européenne alimentée à l’hydrogène vert à Carquefou, en Loire-Atlantique, Lidl poursuit ses efforts pour des modes de livraison écologiques. Publié le 04/07/2024. Mardi 26 juin s’est tenue la 11ème édition des États généraux de la chaleur solaire, le rendez-vous annuel des acteurs de la filière solaire thermique. Une occasion d’établir le bilan de la dynamique actuelle et les perspectives d’un secteur trop peu souvent mis en avant. En 2023, l’activité a progressé de 8 % avec 73 000 m2 installés en métropole. Dans le segment du résidentiel, on retiendra la spectaculaire croissance des solutions solaires combinées (+ 69 %, 23 200 m2 contre 13 750 en 2022). Toutefois, malgré ces résultats encourageants, le secteur n’est pas sur une dynamique qui correspond aux objectifs que lui a assignés le plan national bas carbone. En effet, la chaleur solaire est attendue à hauteur de 6 TWh de production d’énergie fin 2030 puis à 10 TWh fin 2035, contre 2,4 TWh aujourd’hui (métropole + Drom). Les efforts nécessaires demanderaient « une multiplication par trois de la capacité installée dans le résidentiel individuel, une multiplication par dix dans le collectif, le tertiaire et la petite industrie et dans les grandes installations, il faudrait passer de 50 000 m2 installés en huit ans à un million de mètres carrés annuels ! », annonce Claire Barais, référente nationale solaire thermique de l’Ademe. « On n’y arrivera pas si on ne change pas la donne. Il va falloir mettre de nouvelles choses sur la table », poursuit-elle. Pourtant la filière dispose d’un atout de taille : un outil industriel national. Selon Enerplan, « La France est un pays exportateur net de capteurs solaires thermiques, avec une industrie nationale dynamique, réalisant un chiffre d’affaires dépassant 1,5 milliard d’euros et générant plus de 3 000 emplois directs et indirects en métropole ». Pour inspirer la nouvelle donne souhaitée par l’Ademe, Enerplan a réalisé une étude listant 24 propositions de mesures de soutien avec en premier lieu un axe sur la communication. « Il faut faire connaître le solaire thermique et en faire une priorité nationale », estime Richard Loyen, délégué général d’Enerplan, qui demande un grand plan de promotion de la chaleur solaire. Car aujourd’hui, le solaire thermique souffre d’une méconnaissance, tant du côté du grand public que des donneurs d’ordres publics ou privés. Autre obstacle à lever, la filière thermique ne bénéficie pas des mêmes dérogations que le photovoltaïque dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols (loi zéro artificialisation nette, ZAN). Les projets thermiques sont considérés comme participant à l’artificialisation des sols, contrairement aux centrales photovoltaïques, une appréciation qui handicape grandement le développement des grandes installations dans l’industrie, comme la réalisation de 15 000 m2 mise en service en mars 2023 sur le site de Lactalis à Verdun, figure de proue nationale sur ce segment. Publié le 04/07/2024. Énergie renouvelable locale non délocalisable, la géothermie a tout son rôle à jouer dans la transition énergétique. Elle peut en effet produire du chaud pour l’hiver et du frais pour l’été. Associée à des travaux d’amélioration thermique du bâtiment, elle permet de fortement réduire les consommations d’énergie. Mais les solutions géothermiques représentent aujourd’hui seulement 1 % de la consommation de chaleur en France. Les collectivités, entre autres, ont du mal à s’approprier cette technologie et manquent de ressources pour mener à bien des projets. De la pédagogie est nécessaire pour faire monter en compétence les élus et agents. C’est pourquoi Actee, programme de rénovation énergétique des bâtiments publics, vient de publier un guide sur la géothermie à destination des collectivités. Baptisé « Coupler géothermie et efficacité énergétique dans les bâtiments publics », il détaille les différents types de technologies géothermiques existantes, que ce soit à l’échelle d’un seul bâtiment ou de plusieurs, rappelle les étapes nécessaires au lancement d’un projet et récapitule l’ensemble des ressources financières mobilisables. Avec un objectif clair : « stimuler les démarches de projet de géothermie en collectivité territoriale ».
Pour en savoir plus : https://programme-cee-actee.fr Publié le 27/06/2024. Le 25 juin, l’Institut Jean Jaurès a publié une note analysant les conséquences d’une victoire potentielle du Rassemblement National (RN) aux élections législatives sur le développement de l’industrie de la transition écologique en France. Les filières du solaire, de l’éolien, de la mobilité électrique et des pompes à chaleur pourraient créer 177 300 emplois d’ici 2035 (soit en moyenne 25 nouveaux postes par jour), selon les prévisions des professionnels de ces secteurs. Cependant, ces emplois risquent d’être détruits ou de ne jamais être créés si le RN accède à Matignon le 7 juillet prochain. L’hostilité du parti d’extrême droite vis-à-vis du déploiement des énergies renouvelables et de l’essor des véhicules électriques pourrait susciter l’inquiétude chez les industriels. Cette incertitude pourrait se traduire en délocalisations d’usines vers des pays plus porteurs et en fermetures de sites en fonctionnement ou dont l’implantation est prévue sur le territoire français. Le RN pourrait ainsi mettre en danger des filières contribuant à la réindustrialisation de l’économie. Rappelons par exemple, que malgré son retard dans l’éolien en mer, la France héberge des usines de fabrication d’éoliennes en mer General Electric, Siemens Gamesa ou Chantiers de l’Atlantique (sous-stations et fondations) à Saint-Nazaire, au Havre, à Cherbourg et à Brest. Publié le 27/06/2024. Après une première version publiée fin mai, Observ’ER vient de mettre en ligne son étude complète sur le marché 2023 des pompes à chaleur (PAC) individuelles (jusqu’à 30 kW). Nous savions que 2023 avait été une année contrastée avec une bonne dynamique pour les équipements air/air (+ 15 % avec 895 940 ventes contre 750 780 en 2022) et les pompes à chaleur géothermiques (3 890 ventes, + 19 %) alors que les équipements air/eau ont reculé de 14 % (351 970 contre 302 030 ventes en 2022). Avec la version complète du suivi de ce marché, le tableau de bord s’étoffe de plusieurs indicateurs décrivant la régionalisation des ventes, les types d’opérations (premier équipement ou remplacement) ou encore l’évaluation du chiffre d’affaires. Parmi la série d’indicateurs nouveaux figure notamment un suivi des fluides frigorifiques utilisés. Depuis 2015, la directive européenne F-Gaz 517/2014 a en effet mis en place un mécanisme visant à réduire l’utilisation des fluides les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans l’industrie en y intégrant les applications de réfrigération domestiques, dont font partie les pompes à chaleur. Les résultats sont au rendez-vous puisqu’en 2023 plus de 90 % des appareils vendus avaient abandonné le fluide R410A, largement utilisé par l’industrie jusqu’ici, par le fluide baptisé R32 ayant un pouvoir de réchauffement global (PRG) trois fois inférieur, soit respectivement 1 920 kg équivalent de CO2, contre 675 kg éqCO2. Autre aspect important du marché : l’évolution des prix moyens des équipements. Après deux années de fortes augmentations, les prix ont ralenti leur progression en 2023 avec une hausse moyenne de 5 %. Un chiffre certes non négligeable mais loin des +10 à 14 % enregistrés en 2022 sur les appareils aérothermiques. Publiée le 21/06/2024. La première pierre de la future chaufferie biomasse du site d’Airbus Atlantic de Nantes a été posée le 7 juin. Cette installation, soutenue financièrement par l’Ademe à hauteur de 3,24 millions d’euros, produira environ 70 % des besoins en chaleur du site et permettra d’éviter l’émission de 6 400 tonnes de CO₂ par an. Sur un site de 88 hectares, 2 500 salariés travaillent à la fabrication de composants essentiels pour les avions Airbus, comme les caissons centraux de voilure et les entrées d’air de réacteur. L’installation, conçue et réalisée par Engie Solutions, comprendra une chaufferie biomasse de 8 MW alimentant un réseau de chaleur de 2,5 kilomètres. Les deux chaudières bois, de 6 et 2 MW, seront approvisionnées par de la biomasse locale dans un rayon de 150 kilomètres. Airbus Atlantic a investi 14 millions d’euros dans ce projet. La mise en service industrielle de la chaufferie est prévue pour le premier trimestre 2026. Publiée le 21/06/2024. Le 13 juin dernier, le producteur d’hydrogène vert Lhyfe a livré 350 kg d’hydrogène vert au producteur de gaz naturel Géométhane, pour un test de stockage en cavité saline. Cet essai a été effectué sur le site de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence appartenant à l’entreprise Géométhane. Cette dernière stocke actuellement du gaz naturel dans des cavités salines. L’objectif était d’injecter de l’hydrogène dans ces mêmes cavités afin d’étudier le comportement de ce gaz. L’hydrogène restera dans ces puits en observation pendant plusieurs semaines, puis sera extrait et analysé. « Nous sommes fiers de contribuer à cette expérimentation qui montre l’étendue des possibilités qu’offre l’hydrogène non seulement en matière de décarbonation de la mobilité et de l’industrie, mais aussi en matière de stockage d’énergie, pan nécessaire de notre indépendance énergétique. Les sites de production d’hydrogène vert commençant à se multiplier sur les territoires, la question du stockage va devenir centrale. L’usage des cavités salines est une option sérieuse envisagée partout en Europe. Cette expérimentation va permettre d’obtenir un premier retour d’expérience sur le sujet ! », a déclaré Matthieu Guesné, fondateur et président directeur général de Lhyfe. Ce test est central pour la suite du grand projet porté par la communauté de communes Durance Luberon Verdon Agglomération et Géométhane, qui vise à accélérer la décarbonation du site industriel de Marseille-Fos-Sur-Mer, notamment grâce à l’hydrogène vert. Publié le 13 juin 2024. Le 29 mai 2024, l’entreprise autrichienne Wienerberger spécialisée dans la fabrication de briques, tuiles et bardages a inauguré une nouvelle solution de valorisation de la chaleur fatale dans son usine de Pontigny dans l’Yonne. Située près d’Auxerre, cette dernière est spécialisée dans la fabrication des tuiles de la marque Aléonard. Au sein de ce site, plus de 95 % de la production dépend de six fours industriels. Pour capter et valoriser la chaleur fatale qui s’en échappe, Wienerberger s’est associé à Eco-Tech Ceram, une société experte en efficacité énergétique. Cette dernière a installé un système innovant appelé Eco-Stock. Il permet notamment de capter et stocker la chaleur fatale, restituer une énergie décarbonée et contrôler la durée, la puissance, la température et le débit des flux d’énergie. Pour l’entreprise Autrichienne le système est déjà une réussite puisqu’il a permis une réduction de 15 % de la consommation énergétique de l’usine et une diminution des émissions de CO2 de 450 tonnes par an. L’intégralité de cette innovation technologique a été financée par ETC Invest avec le soutien de l’Ademe. Publié le 13 juin 2024. Pour préserver le climat et la santé des populations, l’Union européenne a décidé d’interdire le moteur thermique pour les voitures neuves en 2035. Depuis, la bataille fait rage. Au-delà des campagnes de désinformation qui polluent le débat, les questions sont nombreuses et légitimes. Est-elle réellement écologique ? Sera-t-elle abordable pour le plus grand nombre, ou réservée aux riches ? Pourra-t-on encore partir en vacances en famille ? Y aura-t-il des bornes et de l’électricité pour tout le monde ? Les constructeurs européens sont-ils menacés par les voitures électriques chinoises ? La voiture électrique va-t-elle provoquer des pénuries de métaux ? Et les poids lourds, pourra-t-on les électrifier aussi ? Toutes les réponses à ces questions sont dans le nouveau livre de Cédric Philibert paru le 21 mars dernier aux éditions Les Petits Matins. Cédric Philibert est membre du collège des personnes qualifiées d’Observ’ER, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et enseigne à Sciences Po-Paris. Pour commander cet ouvrage : ICI Publié le 6 juin 2024. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2023 des pompes à chaleur (PAC) individuelles, jusqu’à 30 kW. En 2023, le marché français des pompes à chaleur aérothermiques a progressé de 6 % passant de 1 102 750 à 1 167 970 unités écoulées. Cependant, derrière ce chiffre se cachent deux tendances opposées entre les segments de marché. Après une très bonne année 2022 (+ 39 %), les ventes de pompes à chaleur air/eau reculent de 14 % passant de 351 970 à 302 030 pièces écoulées. Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs. Sur le marché de la construction neuve, l’effondrement des mises en chantier observé depuis près de deux ans a des conséquences directes sur les ventes de pompes à chaleur. Un phénomène qui va se poursuivre en 2024. Sur le marché de la rénovation des bâtiments, la crise économique et la poursuite de l’inflation en 2023 ont conduit de nombreux ménages à différer leurs investissements de remplacement d’anciens équipements de chauffage. Enfin, le dispositif MaPrimeRénov’ a été moins efficace dans son ensemble. Ainsi, en 2023, le nombre de ménages aidés a reculé de 15 %, par rapport à 2022.Du côté des pompes à chaleur air/air, la dynamique est plus positive puisque les ventes progressent de 15 % (895 940 unités contre 750 780 en 2022). Ces équipements, qui ne sont pas éligibles au dispositif MaPrimeRénov’, ont vu leurs ventes augmenter à la fois sur le marché de la construction neuve et sur les logements anciens. Les fortes températures estivales ont porté en partie les ventes de PAC air/air, dont le mode rafraîchissement attire les consommateurs. En ce qui concerne les pompes à chaleur géothermiques, l’activité a progressé de 19 % en 2023 (3 890 ventes contre 3 260), soit le meilleur résultat enregistré depuis près de 10 ans. La tendance qui pousse de plus en plus de particuliers à se tourner vers les énergies renouvelables pour se prémunir des futures hausses des prix du gaz et de l’électricité a également profité à la géothermie. De plus, l’annonce du plan national en faveur de la géothermie de surface dévoilé début 2023 a sans doute profité au secteur. Toutefois, avec moins de 4 000 unités vendues, le segment reste un marché de niche. Retrouvez les principaux résultats commentés par Frédéric Tuillé, responsable des études au sein d’Observ’ER dans cette vidéo. Publié le 06/06/2024. Propellet, l’association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois, a présenté le bilan de la saison de chauffe 2023-2024 et les perspectives de développement du secteur, lors d’une conférence de presse le 5 juin. Après une baisse significative en 2023, les ventes des appareils de chauffage au granulé de bois amorcent leur reprise. Au premier trimestre 2024, les commandes de poêles à granulés ont augmenté de 36 % par rapport au premier trimestre 2023, ce qui rétablit l’équilibre entre les ventes de poêles à bûches et à granulés. Pour les chaudières, le rebond est attendu plus tard dans l’année, à partir du troisième trimestre. Du côté du combustible, la production de granulés a atteint un niveau record de 2,25 millions de tonnes en 2023, soutenue notamment par l’ouverture de trois nouvelles usines capables de produire 200 000 tonnes supplémentaires. La consommation est restée stable en 2023, à un niveau d’environ 2,5 millions de tonnes. Le climat doux qu’a connu cette saison de chauffe contribue aussi à la formation de stocks importants de granulés. Leur prix s’inscrit par conséquent dans une tendance baissière, après le pic observé en 2022, même s’ils n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la crise. Pour l’avenir, Propellet projette un parc de 3,2 millions de poêles et 400 000 chaudières installées à horizon 2030, contre 1,7 million de poêles et 170 000 chaudières en 2023. Enfin, l’association appelle à inscrire des objectifs clairs et de long terme dans la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie et à une stabilité des politiques de soutien de l’État pour la filière de chauffage au granulé. Publié le 30/05/2024 : Le 23 mai, le syndicat départemental de l’énergie du Tarn-et-Garonne (SDE 82) a signé avec l’Ademe, la mise en œuvre d’un contrat chaleur renouvelable territorial (CCRt) sur la période 2024-2026. Cela fait suite à la proposition du SDE 82, il y a quelques mois, de devenir l’opérateur des CCRt sur le département. Le syndicat assurera la gestion déléguée du Fonds Chaleur de l’Ademe durant trois ans. Conclu en présence de plusieurs représentants officiels, ce contrat a pour but de favoriser le développement des projets de chaleur renouvelable (biomasse, géothermie, solaire thermique, récupération de chaleur fatale) sur le territoire de Tarn-et-Garonne. En tant qu’autorité organisatrice du service public local de l’énergie du Tarn-et-Garonne, le SDE 82 va accompagner gratuitement les acteurs publics et privés du territoire durant la mise en place et l’exploitation du projet. Ce contrat ambitionne de développer 31 projets (12 biomasses, 12 géothermies, 5 solaires thermiques, 2 chaleurs fatales) pour un montant prévisionnel de 5,4 millions d’euros, dont 2,98 millions d’euros d’aides prévisionnelles de l’Ademe sur le territoire. Publié le 30/05/2024 : La société Carbon Impact, spécialisée dans les technologies de captage et stockage de carbone, et le cabinet de conseil spécialisé dans la transition climatique South Pole, appellent à investir dans le premier projet français de captage et stockage de carbone sur des unités de production de biométhane. Ce projet de Bioénergie avec Capture et Stockage de Carbone (BECSC) se situe près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Il a pour but de capturer le CO₂ libéré lors de l’épuration du biogaz formé après méthanisation de la biomasse apportée par les agriculteurs de trois coopératives agricoles à trois unités de méthanisation locales. Le dioxyde de carbone sera liquéfié sur place et transporté en Norvège pour être séquestré pendant des millénaires sous la mer du Nord, dans des sols aux qualités géologiques spécifiques. « Les trois coopératives agricoles sont prêtes à investir immédiatement dans ce projet inédit en France. Cependant, leur financement reste conditionné à l’engagement préalable des entreprises à acheter dès aujourd’hui des crédits carbone qui seront générés seulement à partir de 2026. L’enjeu est qu’elles s’engagent rapidement », a déclaré Karim Rahmani, cofondateur de Carbon Impact. Ce projet a pour ambition de séquestrer environ 10 000 tonnes de CO₂ par an à compter de 2026. L’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, Avere-France, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l’association professionnelle de l’énergie solaire Enerplan ont annoncé, le 16 mai dernier, la parution de l’étude intitulée « Mobilité électrique et énergies renouvelables : Destins croisés pour un avenir durable », élaborée en partenariat avec le cabinet de conseil Wavestone. Elle dresse un état des lieux des synergies entre l’essor de la mobilité électrique et la croissance de production d’énergie renouvelable (EnR), et photovoltaïque en particulier. L’étude formule huit recommandations aux pouvoirs publics afin de renforcer cette synergie. Ils préconisent notamment d’harmoniser les règles de déploiement des EnR et des infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE) et de développer des incitations financières pour l’installation des sites mixtes et les solutions de recharge innovantes. Elle incite aussi à réfléchir à une évolution des règles du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) et à pérenniser les objectifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (Tiruert) au-delà de 2030 pour favoriser le développement de la mobilité décarbonée. Les partenaires recommandent aussi de lancer des campagnes de communication publiques pour informer et promouvoir le déploiement des solutions couplées EnR/IRVE en informant mieux des contraintes réglementaires à venir. Enfin, ils souhaitent que les pouvoirs publics développent des expertises techniques pour la filière du couplage et préparent l’évolution des matériels. « L’électrification du secteur des transports est déjà engagée, et d’ici 2030 plus de 8,5 millions de véhicules électriques seront en circulation en France. Face à ces nouveaux défis, les énergies renouvelables représentent une solution incontournable pour accompagner l’électrification des usages », a déclaré le président du SER, Jules Nyssen. Eiffage Énergie Systèmes et la société Entech ont annoncé la création d’une coentreprise dédiée aux projets de stockage d’énergie sur batteries raccordées au réseau haute tension en France. Cette nouvelle entité se concentrera sur la conception, l’intégration des systèmes de stockage, la réalisation des sous-stations de raccordement et la sécurisation des batteries. Les projets visés concernent des unités de stockage par batteries régionales ou nationales, connectées au réseau haute tension. Les deux partenaires ont déjà avancé dans les études de plusieurs projets en France. Le marché cible pour cette coentreprise dépasse 1 milliard d’euros. Eiffage Énergie Systèmes et Entech visent à contribuer à un mix énergétique décarboné, soutenant la transition énergétique. Publié le 17/05/2024. Le producteur et fournisseur d’hydrogène vert Lhyfe et le producteur d’acier suisse Ugitech ont signé un accord pour la création d’une unité de production d’hydrogène vert sur le site d’Ugine, en Savoie afin de substituer le gaz naturel alimentant certains fours et brûleurs. Cette collaboration vise à décarboner une partie des activités industrielles d’Ugitech et à contribuer à la décarbonation de la mobilité locale, notamment en vue des JO d’hiver de 2030. Lhyfe prévoit d’installer une unité de production d’hydrogène vert d’une capacité pouvant aller jusqu’à 12 tonnes par jour sur le site, soit une capacité d’électrolyse de 30 MW maximum. Cet hydrogène servira principalement à l’usine d’Ugitech, alimentée par une canalisation, mais sera également fourni à des acteurs locaux de la mobilité et de l’industrie. Les deux entreprises entament désormais une phase d’étude de faisabilité pour ce projet, dont la mise en œuvre dépendra des autorisations nécessaires et des décisions d’investissement. Ce projet pourrait réduire les émissions de CO2 d’environ 16 000 tonnes par an. Publié le 17/05/2024. Observ’ER vient de publier son étude annuelle du marché 2023 des appareils de chauffage domestique au bois. Ce travail vient compléter une première version diffusée il y a un mois (voir actu du 29 mars 2024) mais qui ne portait que sur les seuls chiffres de vente. Cette analyse plus détaillée revient sur le marché très contrasté de 2023 où la dynamique des appareils à granulés (- 65 % des ventes) a été totalement inverse à celle des appareils à bûches (+ 28 %). Les poêles à bûches ont notamment enregistré trois années de forte croissance pour atteindre en 2023 un volume de ventes plus de deux fois supérieur à celui de 2020 (237 630 pièces contre 113 910). Ce phénomène a d’ailleurs eu un impact sur la part des importations du secteur dans son ensemble car les appareils à bûches sont davantage produits en France comparés aux équipements automatiques à granulés qui sont très largement importés (95 %). Ainsi la part moyenne des importations est passée de 43 % en 2022 à 34 % en 2023 pour l’ensemble des équipements. En revanche, les exportations des acteurs français ont reculé. Accaparés par un marché national très dynamique où les délais de livraison ont sensiblement augmenté, les industriels ont surtout cherché à répondre à la demande française de poêles, foyers fermés, inserts ou de chaudières à bûches plutôt que d’essayer de développer leurs parts à l’étranger. Les appareils de chauffage au bois dans leur ensemble continuent de s’installer très majoritairement dans l’existant (à 92 %) et le remplacement d’anciens appareils bois par de plus performants a représenté 49 % des ventes contre 43 % en 2022. L’étude se clôture sur un suivi de l’évolution des prix de vente où pour la troisième année consécutive, les indicateurs ont été très nettement orientés à la hausse. Une hausse de 8 % en moyenne pour les équipements et pour la partie pose a été observée, un taux de progression significatif mais qui a tout de même été inférieur à ceux de 2021 ou 2020. L’étude est disponible en libre téléchargement sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables. Frédéric Tuillé, responsable des études au sein d’Observ’ER, commente les principaux résultats de l’étude dans cette video. Publié le 2 mai 2024. Waga Energy, spécialisé dans la production de biométhane à partir de déchets, a inauguré le 11 avril, une unité de production sur le Pôle de Stockage-Énergie (PSE) de Veolia à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme. Cette unité, équipée de la technologie Wagabox, transforme le gaz émis naturellement par les déchets en biométhane, qui sera injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF, alimentant ainsi les foyers et les entreprises de la région. Le Pôle Stockage-Énergie, déjà capable de traiter 150 000 tonnes de déchets par an, utilisait jusqu’à présent le gaz pour produire de l’électricité via de la cogénération. L’unité vient renforcer ce dispositif en augmentant la production d’énergie renouvelable du site. Avec une capacité de traitement de 600 m3/h de gaz brut, elle peut produire jusqu’à 25 GWh de biométhane par an, alimentant environ 3 500 foyers et réduisant les émissions de plus de 4 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Publié le 2 mai 2024. L’association européenne de la chaleur solaire Solar Heat Europe et l’association européenne de l’industrie papetière Cepi ont mis en ligne une fiche d’information sur l’intégration de la chaleur solaire comme solution de décarbonation de l’industrie des pâtes à papier et papiers. Elle sert de guide d’information pour tous les industriels du secteur qui souhaiteraient installer des panneaux solaires thermiques. Elle rappelle en particulier les propriétés techniques et les coûts de la chaleur solaire appliquée à l’industrie. La fiche d’information a été lancée lors du Forum des solutions d’efficacité énergétique du Cepi qui s’est tenu à Bruxelles le 17 avril dernier. Ce dernier avait pour objectif de trouver des solutions pour réduire les émissions de carbone du secteur. Les industriels de la pâte et du papier se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici 2050. Pour en savoir plus sur la chaleur solaire dans les processus industriels, se référer au dossier du Journal des Énergies Renouvelables n° 267 (avril-mai-juin 2024). Publié le 26/04/2024. Lhyfe, annonce le lancement d’une marketplace dédiée à l’hydrogène vert sur sa plateforme digitale, Lhyfe Heroes. Cette place de marché vise à faciliter l’achat et la vente d’hydrogène vert en coordonnant les acteurs des secteurs de l’industrie et des transports. L’objectif est de rendre l’hydrogène vert accessible à un plus large public, en modernisant les processus traditionnels grâce à la digitalisation. La marketplace permet aux producteurs et aux consommateurs d’hydrogène vert de collaborer plus étroitement, favorisant ainsi un maillage territorial optimal, une multiplication des sources d’approvisionnement et une meilleure optimisation de la production. De plus, tous les produits disponibles sur la marketplace bénéficieront de la garantie verte de Lhyfe. Publié le 26/04/2024. Le solaire thermique peut avoir d’autres usages que la seule fourniture d’eau chaude sanitaire ou le chauffage de locaux. Le segment des applications pour la production de chaleur destinée à des usages industriels (SHIP en anglais pour Solar Heat for Industrial Processes) est en plein essor, selon une analyse récente du site solarthermalworld.org. Sur le plan technologique, les capteurs plans vitrés ne sont pas les principales options, car ils représentent seulement 12 % du marché mondial en 2023. Ce sont davantage les capteurs cylindro-paraboliques (38 % du marché) ou les tubes sous-vide (26 % des applications en 2023) qui sont utilisés afin d’obtenir des températures d’eau chaude ou de vapeur les plus élevées, jusqu’à 400 °C. L’an passé, les capacités nouvellement installées dans le monde ont triplé par rapport aux deux années précédentes. En 2023, 116 opérations ont été réalisées pour une puissance totale de 94 MW, contre seulement 31 MW l’année précédente. Cette croissance a essentiellement reposé sur deux pays. Les Pays-Bas ont dominé le marché mondial par le nombre de nouveaux projets (43 pour 6,8 MW), mais c’est surtout l’Espagne qui se distingue avec la plus grande capacité SHIP installée : 49,2 MW, soit plus de la moitié du marché mondial. En 2023, le classement des pays ayant été les plus actifs dans les réalisations de type SHIP place quatre pays de l’Union européenne parmi les cinq premiers. En effet, derrière l’Espagne arrivent la France, la Chine, les Pays-Bas et la Belgique. Avec 11,1 MW mis en service, la France fait ainsi bonne figure dans ce palmarès. Pour l’Hexagone, solarthermalworld.org relève les effets bénéfiques du Fonds chaleur de l’Ademe, qui a permis les principales réalisations en la matière ces dernières années avec notamment le méga projet du site de Lactalis à Verdun où 10,5 MW de puissance ont été mis en service en 2023. Le travail de solarthermalworld.org repose sur une enquête menée auprès de 70 entreprises fournisseurs de technologie ou développeurs de projets. Une carte mondiale des fournisseurs clés en main de réalisation SHIP sera prochainement mise à jour sur le site. Ponant, compagnie de croisière française et Farwind, start-up nantaise développant le concept de voiles rotors, annoncent un partenariat pour élaborer des solutions d’avitaillement en hydrogène vert et la décarbonation de l’industrie maritime. Le projet de voilier Swap2Zero (Sustainable, Wind Assisted Propulsion, Zero Emission Ready) de Ponant, vise à atteindre la neutralité carbone de ses futurs navires. Il intégrera des technologies de propulsion propres telles que des voiles d’un genre nouveau – voiles rigides ou voiles-rotor Farwind – et les piles à combustible à hydrogène liquide. Cette collaboration offre également de nouvelles perspectives à la technologie innovante de Farwind, axée sur la production en mer d’électricité à partir du vent, grâce à ses voiles-rotor, et sa conversion en hydrogène par électrolyse d’eau de mer. À l’horizon 2030, Ponant aspire à faire du projet Swap2Zero un modèle pour l’industrie maritime avec un développement à grande échelle en faveur de la transition énergétique dans le transport maritime. L’usine Lis, filiale du groupe Lesaffre, spécialiste de la levure et du séchage industriel et le groupe Idex ont inauguré une centrale de production de vapeur sur le site de Lis à Cérences dans la Manche. La centrale, opérationnelle depuis février 2024, a une capacité de production annuelle 11 000 tonnes de vapeur, soit 77 000 MWh, avec un taux élevé d’énergie renouvelable de 85 %, issues d’une chaufferie biomasse dédiée (le gaz étant conservé en appoint et secours). Le site est principalement alimenté par des ressources locales telles que des plaquettes forestières et du bois d’emballage en fin de vie. Le projet est aligné avec les objectifs français de décarbonation de l’industrie. Soutenu par l’Ademe à hauteur de 2,9 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire), le projet a fait l’objet d’un investissement complémentaire du Groupe d’Idex de près de 8 millions d’euros. Publié le 05/04/2024. GrandLyon Habitat vient d’achever la construction d’une nouvelle chaufferie bois, en parallèle de l’amélioration de la chaufferie gaz existante et la rénovation des sous-stations de distribution du chauffage, situées dans le quartier Saint-Rambert, à Lyon 9e. Ce nouveau réseau dessert 501 logements, dont 325 appartiennent à GrandLyon Habitat et 176 sont en copropriété. L’exploitant du site est Engie Solutions, qui a remporté un appel d’offres pour la gestion du site pour les 12 prochaines années. La chaufferie est alimentée avec des plaquettes de bois locales, couvre 70 % des besoins énergétiques du quartier. Ce choix permet de réduire l’empreinte carbone, avec une utilisation du gaz seulement en cas de grand froid ou de maintenance. Cette chaufferie bois à Saint-Rambert est la cinquième du genre pour GrandLyon Habitat, qui possède déjà des infrastructures similaires dans d’autres quartiers. Publié le 05/04/2024. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER), les gestionnaires de réseau RTE et Enedis, et l’agence Ore viennent de mettre en ligne leur rapport annuel « Panorama del’électricité renouvelable ». Cet ouvrage détaille l’état du parc électrique renouvelable en France ainsi que les volumes d’énergie qui ont été produits par les différentes filières. L’an passé, la capacité nationale électrique renouvelable a augmenté de 5,4 gigawatts (GW), soit légèrement plus qu’en 2022 (5 GW), pour atteindre un total de 70 GW installées. Le photovoltaïque s’est tout particulièrement illustré avec 3,1 GW de puissance supplémentaire, contre 2,8 GW en 2022, soit 57 % des nouvelles capacités. Toutefois, avec 19 GW le parc solaire rate son objectif de 20,1 GW à fin 2023, fixé par l’actuelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cela équivaut à un semestre de retard sur cet objectif. En revanche, l’éolien terrestre a connu un net ralentissement avec 1,2 GW raccordés en 2023, contre 1,3 et 1,7 GW au cours des deux années précédentes. Le parc compte, fin 2023, 21,8 GW raccordés contre un objectif PPE de 24,1 GW. Soit un écart de plus de 2 GW, ce qui correspond à près d’un an et demi de retard au rythme actuel. Pour les autres filières, le parc hydroélectrique (avec 25,6 GW raccordés) et les sites de bioénergies électriques (avec 2,2 GW) ont été relativement stables par rapport à 2022. Au total, les filières renouvelables ont couvert 30,9 % de la consommation d’électricité de la France continentale au cours de l’année 2023 avec 135,6 TWh produits. Ce chiffre est en nette progression par rapport à celui de 2022 (110,4 TWh) et cela grâce notamment à une année particulièrement bien ventée. L’éolien terrestre a établi un nouveau record avec 48,9 TWh d’électricité injectée dans le réseau à quoi se sont ajoutés 1,9 TWh d’éolien en mer du site de Saint-Nazaire. Publié le 28/03/2024. Le producteur d’hydrogène vert Lhyfe a reçu la confirmation, le 18 mars dernier, qu’il recevra une subvention de l’État français pouvant aller jusqu’à 149 millions d’euros. Elle servira à financer la construction d’une usine de production d’hydrogène vert près du Havre. D’une capacité d’électrolyse installée de 100 MW, ce projet a été sélectionné par l’État français et validé par la Commission européenne dans le cadre de PIIEC (Projets Importants d’Intérêt Européen Commun) sur l’hydrogène. Lhyfe entend produire jusqu’à 34 tonnes d’hydrogène vert par jour. Située près du site, l’usine Yara qui produit de l’engrais est intéressée par le projet de Lhyfe et le soutient afin de décarboner son processus industriel. Le site devrait voir le jour dès 2028. Publié le 28/03/2024. Jeudi 28 mars, l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) a rendu public son suivi du marché 2023 des appareils domestiques de chauffage au bois et les résultats sont pour le moins très contrastés suivant les types d’équipements. Si pour l’ensemble des segments (poêles, foyers fermés, inserts, chaudières et cuisinières) le marché enregistre un net recul de ses ventes (-17,9 % pour 420 205 pièces contre 511 950 en 2022) cette orientation a été très majoritairement le fait des appareils à granulés pour lesquels 2023 a été catastrophique. L’activité s’est effondrée pour tous segments avec une baisse moyenne de 64 % des ventes. Symbole de ce spectaculaire retournement : les poêles à granulés. Depuis 2018, ils constituaient le premier sous-segment du marché national en termes de ventes avec plus de 201 000 pièces en 2022 mais l’an passé seules 74 300 appareils ont été écoulés. Une chute de l’activité de 63 % et 127 500 ventes de moins en seulement 12 mois. Face au marasme des appareils automatiques, ceux à bûches enregistrent une année exceptionnelle avec une hausse moyenne de leurs ventes de 28 % tous segments confondus. Les courbes se croisent notamment sur le segment des poêles où plus de 237 000 appareils à bûches ont été vendus contre 186 160 un an auparavant. La cause principale de ce phénomène est la répercussion des effets de la crise des granulés de l’été 2022. Dans un climat de tensions énergétiques générales en Europe, de nombreux utilisateurs d’appareils automatiques s’étaient rués sur les combustibles à granulés alors disponibles, provoquant des pénuries et une hausse sensible des prix. Malgré un retour à la normale tout au long de l’année 2023, cet épisode a durablement marqué les esprits des consommateurs qui se sont détournés des appareils granulés. Pour la France, à cela s’est ajouté une révision des conditions du dispositif MaPrimeRénov’ dont l’aide pour l’achat d’un poêle à granulés a diminué de 500 € pour les ménages à profil modeste et très modeste. Publié le 21/03/2024. Le 14 mars 2024, 18 organisations européennes, composées d’associations industrielles et d’ONG ont publié un appel à l’action exhortant la Commission européenne et les États membres à donner la priorité à la décarbonisation du chauffage et du refroidissement dans le prochain mandat législatif. En effet, la Commission a publié début février une « Communication », présentant ses recommandations pour le prochain objectif climatique que l’Union européenne doit se donner à horizon 2040. Elle préconise une réduction des émissions de CO2 de 90 % comparé à 1990, contre au moins 55 % en 2030. Les organisations européennes se félicitent que la Commission identifie les secteurs du bâtiment et de l’industrie, comme ceux présentant le plus fort potentiel de réduction, car ils représentent respectivement 42 % et 25,6 % de la consommation finale d’énergie de l’UE. En revanche, elle déplore l’oubli dans cette communication du traitement de la production de chaleur et de froid, encore largement carbonée et qui représente 80 % de la consommation énergétique des bâtiments et 60 % des besoins énergétiques des industries. La coalition appelle à une action immédiate pour éliminer progressivement les combustibles fossiles dans le chauffage et la climatisation, en soutenant le financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et de récupération. « L’objectif de réduction de 90 % des gaz à effet de serre d’ici 2040 rend indispensable la décarbonation urgente du chauffage et du refroidissement », a déclaré Justin Wilkes, directeur général d’ECOS (Environmental Coalition on Standards). Publié le 21/03/2024. Séché Environnement, en partenariat avec Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane, annonce la mise en service d’une unité de production de biométhane sur un site de stockage de déchets d’Opale Environnement à Sainte-Marie-Kerque, dans le Pas-de-Calais. Cette installation, utilisant la technologie brevetée Wagabox, transforme le gaz de décharge émis par les déchets enfouis en biométhane. Ce dernier est directement injecté dans le réseau de gaz local pour approvisionner les ménages et les entreprises. Le site de Sainte-Marie-Kerque a une capacité de traitement de 800 m3/h et peut produire jusqu’à 35 GWh de biométhane par an, équivalent à la consommation de 5 500 foyers, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2 de 5 800 tonnes par an. Le 1er mars, le Conseil européen de l’énergie géothermique (Egec) a annoncé le lauréat du Prix européen de l’innovation géothermique Ruggero Bertani 2024. Ce prix récompense les entreprises qui ont apporté une contribution exceptionnelle au domaine de l’énergie géothermique sous la forme de produits innovants, de recherches scientifiques ou de lancement de projets. C’est l’allemand Vulcan Energie Ressourcen qui a été récompensé pour son usine d’optimisation de l’extraction du lithium (LEOP) à partir de la géothermie. Inaugurée en 2023 à Landau, en Allemagne, celle-ci permet la production à grande échelle de chlorure de lithium (LiCl) à partir de saumures géothermiques grâce à un processus d’absorption connu sous le nom d’extraction directe de lithium (DLE). La production annuelle locale de 40 tonnes d’hydroxyde de lithium permet la fabrication d’environ 850 batteries de voitures électriques par an. Au-delà de cette performance, ce qui rend le procédé particulièrement intéressant, ce sont ses avantages environnementaux par rapport aux méthodes de production traditionnelles et son empreinte annoncée comme climatiquement neutre. La coproduction d’énergie géothermique permet en outre de générer des revenus supplémentaires en fournissant de l’énergie renouvelable aux communes et à l’industrie locale. Horst Kreuter, directeur général de Vulcan Energie Ressourcen, a souligné l’importance de ce prix et s’est dit impatient d’utiliser le procédé « commercialement et à grande échelle ». GRTgaz a publié, le 27 février, son bilan gaz annuel de l’année 2023. La consommation de gaz a baissé de 11,4 % en 2023 et passe sous la barre des 400 TWh pour atteindre 381 TWh consommés. La capacité de production de gaz renouvelables a pour sa part atteint 11,8 TWh, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente. En effet, la dynamique de développement du biométhane se poursuit en France. 652 sites de méthanisation injectent dans les réseaux à fin 2023 (+ 138 sites par rapport à 2022). De plus, 14,8 TWh de projets de méthanisation sont en développement. Dans ces conditions, l’ambition nationale de 44 TWh de gaz renouvelables en 2030 pourra être atteinte, estime GRTgaz. « Il convient pour cela de mettre en place rapidement différents outils réglementaires dont le dispositif de Certificat de Production Biométhane, le lancement d’un premier Appel à Projet Pyrogazéification (production de gaz EnR à partir de déchets solides) et de garder une constance en matière de tarif d’achat », insiste le gestionnaire de réseau. GRTGaz a également à son actif sept projets de transport d’hydrogène, dont six ont été labellisés « projet d’intérêt commun » par la Commission Européenne. En outre, deux projets de transport de CO2 ont également été sélectionnés pour recevoir le même label. Apparue plus tardivement en France que chez son voisin allemand, la méthanisation agricole constitue aujourd’hui un enjeu sociétal, à la croisée de l’économie, du social et de l’environnement. Mobilisant une grande diversité d’acteurs, des agriculteurs aux collectivités locales, en passant par les énergéticiens, la méthanisation agricole suscite de nombreux débats et idées reçues véhiculées autant par les pro que les anti. L’ouvrage collectif Idées reçues sur la méthanisation agricole a un double objectif : offrir une mise au point informée sur le sujet et donner à penser les angles morts. Il montre aussi combien la méthanisation agricole ne se résume pas à une « énergie verte », mais questionne les évolutions des mondes ruraux dans leur globalité. Auteurs : Aude Dziebowski, Emmanuel Guillon et Philippe Hamman. Le Cavalier Bleu éditions. Pour en savoir plus lire Les Clés de la Transition Énergétique Le Synteau (Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau), en collaboration avec la Banque des Territoires, GRDF, Amorce, FNCCR, FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau), et ATEE Club Biogaz, publie un guide technique sur l’injection de biométhane provenant des boues de stations d’épuration urbaines (STEU), basé sur 10 ans d’expérience auprès de 35 maîtres d’ouvrage. Ce guide vise à accompagner les acteurs de la filière dans le développement et l’exploitation des projets, en abordant le cadre réglementaire, les choix de conception technique, la performance opérationnelle, les structures contractuelles, le financement, et les perspectives d’optimisation des sites. En janvier 2024, 47 stations de traitement des eaux usées injectent du biométhane dans le réseau de distribution de gaz, représentant cinq fois plus de sites qu’en 2018, avec une capacité installée de 565 GWh/an. La capacité de biométhane injecté pourrait doubler d’ici à 2030, atteignant 1 TWh supplémentaire grâce au potentiel mobilisable sur une centaine de stations d’épuration. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER), avec le soutien de l’Ademe, publie un « Questions-réponses sur les géothermies » pour informer le public sur cette énergie renouvelable. Capable de produire chaleur, froid, rafraîchissement et électricité, la géothermie présente des avantages, tels sa haute performance énergétique, sa disponibilité continue et son impact visuel nul en surface. Le document répond aux questions fréquemment posées sur la géothermie, offrant des explications pédagogiques et illustrées d’exemples concrets, afin de sensibiliser davantage le public à cette source d’énergie souvent méconnue. Equans et Valeco ont annoncé un partenariat visant à accélérer la décarbonation des moyens de transport et de l’industrie en Région Nouvelle-Aquitaine, en déployant une infrastructure de production d’hydrogène vert par électrolyse en Dordogne. Les futurs électrolyseurs seront alimentés en électricité par une centrale solaire, actuellement en construction par Valeco, dont la mise en service est attendue pour 2026. Equans prendra en charge la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure, tandis que Valeco, en tant qu’investisseur majoritaire, fournira l’électricité renouvelable nécessaire. Avec une puissance maximale de 5 MW, l’infrastructure alimentera un « filing center » (centre de chargement de camions citernes) pour exporter l’hydrogène vers des stations de ravitaillement et des industriels intéressés par la décarbonation. Le CHU Amiens-Picardie annonce la mise en place d’une thermofrigopompe en partenariat avec Idex. Ce nouveau dispositif vise à fournir de la chaleur et du froid pour une partie de ses besoins, représentant une surface de plus de 300 000 m² comprenant 1 705 lits et 32 blocs opératoires. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique, environnementale et économique de l’établissement. La thermofrigopompe choisie permet une production simultanée de chaud et de froid, répondant ainsi aux besoins spécifiques du CHU. Cette installation a permis des économies d’énergie substantielles, réduisant la consommation totale de gaz naturel de l’établissement de 25 %, soit une économie annuelle de 8 400 MWh, équivalant à la consommation de 700 foyers. Le projet a bénéficié d’un investissement total de 2 444 918 €, avec une subvention de l’Ademe de 989 633 €. Le 9 février, L’AFPG, le Cibe, la Fedene, le Ser et Uniclima, avec la participation de l’Ademe, ont publié la 7e édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération. Les conclusions de ce bilan sont mitigées. Malgré une augmentation de la production issue de sources d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R), la chaleur renouvelable ne représente que 27,2 % de notre consommation finale de chaleur en 2022. Pourtant, les différents usages de la chaleur représentent 45 % de notre consommation finale d’énergie et dépendent en majorité d’énergies fossiles importées, fortement émettrices de gaz à effet de serre et soumises à des variations de prix importantes. La France possède les atouts nécessaires à la décarbonation de la chaleur. En 2022, le bois-énergie, coproduit de la sylviculture durable destinée à produire du bois matériau, a fourni à lui seul 63 % de la chaleur renouvelable en France métropolitaine afin de chauffer 8,8 millions de logements et décarboner les procédés industriels. Les usages domestiques, liés à des équipements individuels (appareils de chauffage au bois, pompes à chaleur, chauffe-eaux solaires, …), représentent 65,2 % de la production de chaleur renouvelable en 2022. Le groupement à l’initiative de ce rapport attend des décisions politiques fortes « pour décarboner massivement la chaleur, notamment à travers des objectifs nationaux ambitieux et des moyens financiers et humains dimensionnés à la hauteur des enjeux de souveraineté énergétique, de neutralité carbone et de maîtrise de la facture énergétique des Français. » L’association « Énergies renouvelables pour tou·te·s » lance une campagne d’adhésion et publie 13 fiches pour contrer la désinformation sur les énergies renouvelables. Après un an d’existence et un recours contre l’État, l’association lance sa première campagne de financement sur Hello Asso. « Énergies renouvelables pour tou·te·s » s’engage en menant des actions juridiques et en publiant des tribunes dans la presse. Elle réalise des activités de vulgarisation et des analyses poussées sur les énergies renouvelables. L’association recherche également des candidats pour rejoindre l’association afin de se développer et d’accroître son impact. Les chantiers de géothermie sont de plus en plus nombreux, portés par la dynamique impulsée par le gouvernement. Pour faire face à la demande, l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG) et le Syndicat National des Entrepreneurs de Puits et de Forage d’Eau et de Géothermie (SFEG) travaillent ensemble depuis plusieurs années pour développer la formation des professionnels du forage. Si 600 assistants-foreurs en géothermie sur sondes et sur nappes supplémentaires sont nécessaires d’ici à 10 ans, selon les estimations de la filière, l’offre de formation est en effet insuffisante. Afin d’assurer son développement, le SFEG et l’AFPG ont obtenu de la part des Commissions paritaires nationales de l’Emploi conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics le certificat de qualification professionnel leur permettant d’habiliter des organismes proposant des formations d’assistants-foreurs. Ce certificat assurera l’application d’un référentiel commun et de bonnes pratiques. À l’occasion du salon Hyvolution, qui s’est tenu toute fin janvier à Paris, H2V, pionnier de la production massive d’hydrogène bas-carbone, et la Banque des Territoires ont annoncé un accord de partenariat pour les cinq prochaines années en vue d’accompagner le financement des projets de production d’hydrogène bas-carbone et d’e-carburants. Cet accord portera sur un investissement de 65 millions d’euros à horizon 2029. La Banque des Territoires interviendrait à minima à hauteur de 20 % du capital nécessaire aux sociétés de projets pour porter les actifs ainsi développés, H2V restant actionnaire majoritaire de ces actifs. Un premier projet de 200 MW concerné par ce partenariat devrait se concrétiser à Marseille-Fos. Ce projet a pour ambition de produire 28 000 tonnes d’hydrogène bas-carbone dédiées à la production annuelle de 140 000 tonnes d’e-méthanol pour avitailler entre autres la flotte de CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Cela permettrait d’éviter, l’émission de 240 000 tonnes de CO2 chaque année. L’accord de CMA CGM est toutefois attendu avant le lancement officiel du chantier. Pour préserver le climat et la santé des populations, l’Union européenne a décidé d’interdire le moteur thermique pour les voitures neuves en 2035. Depuis, la bataille fait rage. Au-delà des campagnes de désinformation qui polluent le débat, les questions sont nombreuses et légitimes. Est-elle réellement écolo ? Sera-t-elle abordable pour le plus grand nombre, ou réservée aux riches ? Pourra-t-on encore partir en vacances en famille ? Y aura-t-il des bornes et de l’électricité pour tout le monde ? Les constructeurs européens sont-ils menacés par les voitures électriques chinoises ? La voiture électrique va-t-elle provoquer des pénuries de métaux ? Et les poids lourds, pourra-t-on les électrifier aussi ? Toutes les réponses à ces questions sont dans le nouveau livre de Cédric Philibert à paraître le 21 mars prochain aux éditions Les Petits Matins. Cédric Philibert est membre du collège des personnes qualifiées d’Observ’ER, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et enseigne à Sciences Po-Paris. L’unité de stockage de déchets Gaïa, située à Cusset, dans l’Allier, devient producteur de biométhane grâce à la technologie Wagabox, inaugurée le 31 janvier par Vichy Communauté, Suez et Waga Energy. Première du genre en Auvergne-Rhône-Alpes, cette unité complète le dispositif existant depuis 2011, où l’énergie est produite par la fermentation des déchets, valorisant le biogaz par cogénération pour produire électricité et chaleur. Le dispositif Wagabox va plus loin car elle permet d’extraire le méthane contenu dans le biogaz pour produire du biométhane en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (gaz de décharge) grâce à une technologie d’épuration brevetée. Ce gaz renouvelable est injecté directement dans le réseau de distribution de gaz de ville de GRDF à Cusset pour répondre aux besoins en chauffage, cuisson et eau chaude sanitaire des habitants et entreprises. Chaque année, 17 GWh de biométhane seront injectés, alimentant l’équivalent de 1 700 foyers et évitant l’émission de 2 800 tonnes de CO2. Mercredi 7 février, Uniclima, le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, a tenu sa traditionnelle conférence de presse de début d’année destinée à dresser le bilan de l’année précédente. Hélas, pour les équipements du génie climatique, 2023 a été un mauvais millésime : une grande partie des segments de marché couverts par le syndicat ont enregistré des baisses d’activité significatives. Ainsi, pour les équipements individuels, les indicateurs affichent un recul de 14 % pour les pompes à chaleur air/eau, moins 23 % pour les chaudières gaz ou fioul et jusqu’à moins 60 % pour les chaudières biomasse. À chaque fois les causes sont similaires : un marché du neuf en berne depuis plusieurs années et surtout un net ralentissement du marché de la rénovation. Avec la crise économique, les particuliers ayant des équipements de chauffage en fin de vie (mais qui fonctionnent encore) ont différé leur remplacement. Ainsi, le Syndicat relève qu’en 2023, le nombre de logements aidés par le dispositif MaPrimeRénov’ a diminué de 15 % par rapport à l’année précédente. Dans ce panorama morose, les pompes à chaleur air/air arrivent toutefois à tirer leur épingle du jeu avec une progression de 13 % de leurs ventes par rapport à 2022 pour atteindre 910 420 unités. Aussi prisée dans le neuf que dans la rénovation, cette solution technique reste notamment portée par sa capacité à pouvoir climatiser les habitations lors des jours les plus chauds de l’été. Le solaire thermique (73 100 m2, soit + 8 %) ainsi que les pompes à chaleur géothermiques (3 517 unités, soit + 18 %) ont également progressé en 2023 mais leur activité porte sur des volumes nettement plus restreints. Pour 2024, les professionnels se disent globalement inquiets. L’inflation et la crise économique sont encore dans l’esprit des particuliers et le marché du neuf va, très probablement, rester en hibernation. Corsica Sole, producteur d’énergie solaire, annonce la construction de la première unité de production d’hydrogène renouvelable en Corse, nommée Folell’Hy. Le site convertira l’énergie solaire excédentaire en hydrogène renouvelable via un électrolyseur, le stockera et le distribuera après conditionnement dans des réservoirs transportables. Le projet, directement raccordé à la centrale solaire existante de Folelli de 12 MW, contribuera à l’autonomie énergétique de la Corse. Deux tonnes d’hydrogène par an seront disponibles pour des utilisations telles que la mobilité maritime lourde et les groupes électrogènes. Ce projet servira également de site expérimental pour lever des incertitudes liées à cette application, notamment en termes d’interactions avec le gestionnaire de réseau et d’utilisation de la ressource en eau. La mise en service est prévue pour le premier trimestre 2025. Le 24 janvier, l’entreprise française Charwood Energy spécialisée dans les solutions de valorisation énergétique de la biomasse, a inauguré un démonstrateur de gazéification. Situé à Colpo, en Bretagne, ce démonstrateur comprend un centre de recherche, de formation et un centre expérimental. Mis en service en novembre 2023, ce centre d’innovation est conçu pour générer de l’électricité grâce à un système de cogénération d’une capacité de 70 kWe. Ce démonstrateur réalisera une gamme d’essais d’enrichissement du syngas, le gaz issu du processus de gazéification. Cela comprend la préparation du combustible, l’analyse en ligne du syngas, l’enrichissement de l’oxydant et le post-traitement du syngas. L’approvisionnement en biomasse locale est assuré par LG Concept, filiale du groupe Charwood Energy. En quatrième de couverture du numéro 266 du Journal des énergies renouvelables qui a été expédié aux abonnés en date du 25 janvier 2024, une publicité titrée « Investir » propose des placements dans des « parkings équipés de bornes électriques ». Les auteurs de cette publicité ont usurpé le nom, l’adresse et les coordonnées RCS de l’entreprise SIM (Société d’investissement multimarques) filiale du Groupe AccorInvest, propriétaire exploitant hôtelier. Cette page de publicité renvoie sur une plateforme qui vous demande de laisser vos coordonnées. Ne les appelez pas, n’activez pas le QR code et ne laissez pas vos coordonnées. Cette publicité est une fraude caractérisée, et le Journal des énergies renouvelables met en garde ses lecteurs contre tout risque d’escroquerie à l’épargne, et a informé l’Autorité des marchés financiers (AMF) avoir publié cette publicité. L’AMF a publié le 30 janvier un communiqué de mise en garde sur ce type de fraude. Celle-ci recommande également, en cas de doute, de contacter le service d’accueil téléphonique des épargnants Épargne Info Service 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 (prix d’un appel local). NB : La publicité frauduleuse a été retirée de la version électronique du Journal des énergies renouvelables n° 266 que vous pouvez lire dans votre kiosque abonné. Le parlement européen souhaite une stratégie européenne sur l’énergie géothermique. A l’initiative de l’eurodéputés polonais Krasnodębski affilié au groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), une résolution a été votée la semaine dernière par la quasi-totalité de l’assemblée (96%). Elle inclut différentes demandes. Parmi celles-ci : une stratégie européenne pour l’énergie géothermique afin de réduire les charges administratives et de favoriser les investissements dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture ; une alliance industrielle afin d’accélérer les meilleures pratiques et la mise en œuvre effective de la législation ; un régime d’assurance harmonisé pour l’atténuation des risques financiers. L’assemblée européenne veut encourager les États membres à élaborer des stratégies nationales pour la géothermie et soutenir les régions en transition et les régions charbonnières dans leur transition vers la géothermie. Niels Fuglsang, député européen, a déclaré que la géothermie était une ressource « qui nous aide à nous libérer de notre dépendance à l’égard du gaz de Poutine » à l’image du projet Aarhus au Danemark qui alimente 36 000 foyers. Le producteur et fournisseur d’énergies renouvelables Enercoop a annoncé le 18 janvier devenir son propre responsable d’équilibre. La coopérative a fait basculer dans son propre périmètre tous ses consommateurs et l’essentiel de ses producteurs à la fin de l’année 2023. Elle assure officiellement les prévisions et l’équilibrage de l’ensemble de la consommation et de la production énergétique de son périmètre. C’est la première fois qu’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (statut d’Enercoop) gère ce type d’activité. “Être responsable d’équilibre, c’est se placer au cœur des enjeux du marché de l’énergie” explique Julie Archambeaud, directrice du pôle Énergie d’Enercoop Société Coopérative d’Intérêt Collectif (statut d’Enercoop) gère ce type d’activité. Elle ajoute, “Par ailleurs, devenir notre propre responsable d’équilibre nous permet une plus grande indépendance par rapport aux divers acteurs du marché de l’électricité.” Jeudi 25 janvier, Observ’ER, la FNCCR et l’Ademe ont présenté à la presse la 14e édition du baromètre des énergies renouvelables électriques en France, réalisé par Observ’ER avec le soutien de l’Ademe et de la FNCCR. Chaque nouvel opus du baromètre est l’occasion de revenir sur l’activité des différentes filières et de faire le point sur l’avancée du pays vis-à-vis de ses objectifs. Depuis 2021, la première filière électrique renouvelable en France en termes de nouvelles capacités raccordées est définitivement le photovoltaïque et 2023 a confirmé cela. Depuis trois ans, le secteur est parvenu à sensiblement rehausser son rythme de progression pour tourner autour de 3 GW de moyenne annuelle. Pour les professionnels du secteur, l’explication tient essentiellement au fait que le solaire est désormais clairement identifié comme la meilleure technologie pour se prémunir des hausses à venir de l’électricité sur le réseau. Une approche que particuliers, collectivités, PME ou grands groupes ont intégré dans leurs réflexions. Par ailleurs, l’autoconsommation poursuit son impressionnant développement avec 1,9 GW de puissance cumulée et plus de 370 000 installations en France. Côté éolien, rien de nouveau. La filière terrestre ne parvient pas à accélérer sa croissance et le segment en mer n’a pas raccordé de nouveau parc en 2023. Au total, si la progression de l’électricité renouvelable est plus vigoureuse depuis trois ans, la France n’en reste pas moins en retard sur ses objectifs. Avec une part de 28 % de la consommation électrique en 2022, le seuil visé à fin 2030 de 40 % (issu notamment de la loi Énergie et climat de 2019) pour les technologies renouvelables semble trop haut au vu de la dynamique actuelle. Selon une récente étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 2023 aura été une année record pour le développement des capacités mondiales de production d’électricité renouvelable dans le monde. 510 gigawatts (GW) supplémentaires ont été raccordés, un chiffre de 50 % supérieur à celui de 2022, soit la plus forte dynamique jamais observée au cours des trois dernières décennies. Sans surprise, la plus forte croissance a eu lieu en Chine qui a mis en service autant d’énergie solaire photovoltaïque en 2023 que ce qui avait été raccordé en photovoltaïque en 2022 sur la planète entière (Chine incluse). En matière d’éolien, la Chine a aussi fait très fort avec un bond de 66 %. L’augmentation de la capacité des énergies renouvelables en Europe, aux États-Unis et au Brésil a également atteint de nouveaux sommets. Selon l’AIE, compte tenu des politiques actuelles et des conditions du marché, la capacité mondiale d’énergie renouvelable devrait désormais atteindre 7 300 GW sur la période 2023-2028, ce qui représente une croissance de 2,5 fois du parc installé. Solaire et éolien seront plus que jamais les secteurs moteurs en représentant 95 % de cette expansion. Avec une telle trajectoire, les énergies renouvelables dépasseront le charbon pour devenir la première source mondiale de production d’électricité d’ici 2025. Toutefois, malgré ce développement sans précédent au cours des 12 derniers mois, le monde devra aller plus loin et tripler sa capacité électrique renouvelable d’ici 2030 pour que les pays respectent les engagements pris lors de la COP28. L’entreprise japonaise d’électronique, Epson, a réalisé une transition vers une consommation d’électricité 100 % renouvelable sur l’ensemble de ses sites mondiaux en décembre 2023. L’engagement public de l’entreprise en mars 2021 pour une électricité entièrement renouvelable sur tous ses sites a été concrétisé dès novembre 2021 au Japon, suivi par la réalisation mondiale en décembre 2023. Cette initiative fait partie intégrante de la « Vision Environnementale 2050 » d’Epson, qui vise à devenir une entreprise à bilan carbone négatif et à abandonner l’utilisation de ressources non-renouvelables. Cette transition devrait permettre au groupe de réduire ses émissions annuelles de CO2 d’environ 400 000 tonnes en couvrant une consommation électrique d’environ 876 GWh par an. Au-delà de l’approvisionnement en électricité renouvelable, Epson envisage de promouvoir l’adoption généralisée des énergies renouvelables en produisant davantage de sa propre énergie et en soutenant le développement de nouvelles sources d’énergie. La Métropole de Lyon vient d’approuver un projet de méthaniseur sur la station d’épuration de Pierre-Bénite et de Saint-Fons, située au sud de la ville. Le site produira du biométhane à partir des boues qui sont actuellement incinérées sans valorisation énergétique. La production sera utilisée localement et contribuera à réduire l’empreinte carbone de la Métropole de Lyon de 20 000 tonnes équivalent CO2. Une partie des sous-produits de la méthanisation sera compostée pour servir d’engrais aux agriculteurs et 11 GWh/an seront utilisés pour chauffer le nouveau réseau de chaleur urbain du Sud-Ouest Lyonnais. L’investissement de 80 millions d’euros sera rentabilisé en une dizaine d’années, avec un calendrier prévoyant le lancement de la consultation du marché en début de 2024, le début des travaux en 2026, et la production de biogaz attendue en 2028-2029. La Ville de Besançon annonce l’extension de son réseau de chaleur urbain qui est actuellement alimenté à 85 % par l’usine d’incinération et des chaufferies bois. En attendant le raccordement des bâtiments de la Ville de Besançon au réseau (prévu entre 2026 et 2030), des chaufferies biomasse mobiles, intégrées dans des conteneurs de type Algeco, vont être déployées sur plusieurs sites : l’Esplanade des Droits de l’Homme, l’École Jean Zay, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts (ISBA) et la Cuisine centrale. Elles seront positionnées à proximité des chaufferies gaz existantes sur ces sites. Ces mini-chaufferies comprennent un compartiment pour le stockage du bois et un autre pour la chaudière, assurant la production d’eau chaude reliée au circuit existant. La puissance des chaudières bois mobiles est dimensionnée pour couvrir 86 % des besoins de chauffage, avec une utilisation complémentaire des chaudières gaz lors des périodes les plus froides. Le coût global du projet s’élève à 1,2 million d’euros avec des économies prévues de 141 000 € sur la facture annuelle de chauffage en 2024. Cette initiative permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 349 tonnes équivalent CO2/an. À l’occasion de la mise en service de la centrale géothermique du quartier Pleyel à Saint-Denis (Île-de-France), Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a annoncé le 22 décembre dernier le lancement du grand plan géothermie national. Le document, attendu depuis plusieurs mois par la filière, reprend les axes déjà présentés en février 2023, qui concernaient le développement de la géothermie de surface (c’est-à-dire portée par les pompes à chaleur), pour y ajouter un ensemble de points couvrant toutes les technologies et les types de valorisation. Ce nouveau programme comporte 50 actions destinées à soutenir le déploiement de la géothermie pour répondre aux besoins de chaud et de froid renouvelable pour les bâtiments individuels et collectifs en métropole, en Outre-mer et à l’export. Parmi les axes prioritaires figure notamment le renforcement du réseau de foreurs qui doit impérativement monter en puissance pour accompagner le développement de la géothermie de surface. Un accent est également mis sur la pénétration de la géothermie dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Pour les particuliers, le plan annonce le relèvement de l’aide Coup de Pouce Chauffage dans le cas du remplacement d’une ancienne chaudière thermique par une pompe à chaleur géothermique. Pour le tertiaire, l’idée est de multiplier les contrats patrimoniaux de chaleur renouvelable au sein des opérations soutenues par le Fonds Chaleur. Un volet particulier porte sur l’Outre-mer où le potentiel électrogène de la géothermie profonde est important. Pour accélérer les projets dans ces territoires, le plan du gouvernement prévoit la création d’une instance stratégique de concertation, réunissant l’ensemble des parties prenantes (ministères, industriels, collectivités, agences et organismes publics) et la mise à jour de la couverture du risque financier associé aux campagnes d’exploration. La Ville de Port-de-Bouc, située dans les Bouches-du-Rhône, et Engie Solutions ont signé, le 20 décembre 2023, un accord pour le développement d’un projet de thalassothermie sur la commune de Port-de-Bouc. La thalassothermie consiste à récupérer l’énergie calorifique de la mer pour alimenter des bâtiments en chaleur et en froid. Le futur projet comprend divers volets visant à exploiter l’énergie marine pour améliorer la qualité de vie des habitants. Un réseau de chaleur, alimenté par thalassothermie, sera développé et desservira plus de 4 000 équivalents-logements en chauffage et eau chaude sanitaire ainsi que tous les bailleurs sociaux de la ville. Dans le prolongement de ce projet, et pour préserver au mieux les ressources en eau potable de la ville, un réseau d’eau brute sera créé pour l’arrosage des espaces verts. Par ailleurs, 19 bâtiments communaux seront équipés de centrales solaires photovoltaïques (toitures, ombrières simples et doubles) soit l’équivalent de la consommation en électricité de 878 foyers. Après avoir signé, en janvier 2023, un partenariat dans le cadre du projet « Alsace Géothermie Lithium », le groupe minier Eramet et Électricité de Strasbourg ont installé, pour une durée minimum de 6 mois, une unité pilote d’extraction directe de lithium sur la centrale géothermique de Rittershoffen, exploitée par l’énergéticien alsacien. Faisant suite à deux premiers pilotes déployés sur les centrales de Rittershoffen et Soultz-sous-Forêts, en 2020 et 2021, cette nouvelle unité vise à démontrer, en conditions réelles, l’efficacité du procédé d’extraction développé par Eramet et valider la durabilité de ses performances sur le long terme. Breveté, celui-ci a d’ores-et-déjà été mis en place à Centenario, en Argentine, pour exploiter l’un des plus grands gisements de lithium au monde. En Argentine, la production devrait d’ailleurs débuter au deuxième trimestre 2024 et atteindre 24 000 tonnes par an en 2025. En Alsace, les deux partenaires espèrent être en mesure, à l’horizon 2030, de produire 10 000 tonnes par an de carbonate de lithium issues des eaux géothermales. Ce projet de production française décarbonée, dont la décision finale d’investissement est attendue en 2026, répondrait ainsi aux besoins d’environ 250 000 batteries de véhicules électriques par an. Le 8 décembre, le maire de Créteil et Dalkia Île-de-France ont signé un avenant au contrat de chauffage urbain. Suite à la connexion des réseaux Nord et Sud de la ville début décembre, le réseau de chauffage urbain s’étend désormais sur plus de 50 kilomètres. Il répond aux besoins en chauffage et en eau chaude de 40 505 équivalents logements, incluant des immeubles d’habitat collectif, des équipements publics et privés, tels que les écoles, l’Université Paris-Est Créteil, les entreprises Essilor, Valeo et le CHU Henri Mondor. L’optimisation du rendement du réseau est rendue possible grâce au raccordement au puits de géothermie et à l’unité de valorisation Valo’Marne, fournissant une énergie calorifique issue de l’incinération des déchets ménagers. Le projet bénéficie d’un soutien financier de la Région Île-de-France et de l’Ademe. La nouvelle version du Guide des formations aux énergies renouvelables édité par l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) est disponible en ligne et interrogeable grâce à un moteur de recherche. Cette nouvelle base de données permet de choisir la formation souhaitée selon plusieurs critères : région, type de formation, filière, niveau… Ce guide se révélera utile aux étudiants devant renseigner leurs vœux dans Parcoursup : il présente 300 formations ayant trait aux énergies renouvelables et à l’écoconstruction, allant de BAC+2 à Bac+5. Les professionnels en recherche de qualifications supplémentaires pourront consulter les formations continues de longue durée ou de courte durée ou les formations dispensées par des industriels et des bureaux d’études. Le guide en version papier est par ailleurs toujours disponible ICI. Le fournisseur de chaleur renouvelable, Newheat, a inauguré le 8 décembre sa centrale solaire thermique, baptisée Lactosol et située à Verdun (55). Elle alimente l’un des sites du groupe Lactalis qui transforme le lactosérum liquide, coproduit issu de la fabrication du fromage, en poudre de lactosérum destinée à l’industrie agroalimentaire. Couvrant une superficie de 15 000 m², ce projet d’envergure vise à réduire de 2 000 tonnes par an les émissions de CO2 de la tour de séchage du site, soit environ 7 % des émissions totales. La tour de séchage, inaugurée en novembre 2021, était initialement alimentée par une chaudière à gaz. Lactalis poursuit ses efforts en matière d’efficacité énergétique en installant une chaudière biomasse d’ici à 2026, remplaçant près de 50 % du gaz consommé par une énergie renouvelable. Au cours de la dernière décennie, le mouvement des énergies citoyennes s’est développé en Occitanie. Au fil du temps, les initiatives visant à monter des projets d’énergies renouvelables gérés localement ont essaimé sur le territoire, ont bénéficié de l’appui la Région et de l’Ademe et se sont fédérées autour des réseaux Énergies Citoyennes Locales et Renouvelables (ECLR Occitanie) et Énergie Partagée. En 2023, le territoire d’Occitanie compte 200 projets citoyens de différentes tailles et déployés sur plusieurs technologies (petites toitures accueillant du photovoltaïque, parc de 6 éoliennes…). Au total, ces installations représentent 23 MW de puissance, et produisent 49 GWh par an. 7 millions d’euros d’épargne ont été investis dans ces projets coopératifs, portés par 130 collectivités actionnaires et 7 300 citoyens occitans sociétaires. Pour les années à venir, les initiatives d’énergie coopérative pourront de nouveau compter sur le soutien de la Région Occitanie et de l’Ademe. Ces derniers ont signé avec ECLR Occitanie une nouvelle convention, le 13 décembre 2023, lors du salon Energaïa. Désormais, au sein de la Menuiserie Meslin (Groupe Lorillard), à La Haye (Manche), les Compagnons menuisiers travaillent à une température stable. Un système géothermique a été inauguré en octobre dernier, après un an de travaux. Il assure le chauffage et la climatisation des 5 000 m² d’ateliers et de bureaux alors qu’auparavant seule une partie des bureaux était chauffée par une chaudière au fioul. Avoir une température régulière facilite également la production. Dans l’atelier, les variations de température et d’hygrométrie au gré des saisons et de la météo jouaient en effet sur la stabilité du bois et sur la durée de séchage des menuiseries et des colles cellulosiques. Le dispositif a nécessité un investissement de 450 000 € financé en partie par l’Ademe. Il comprend 23 sondes géothermiques installées dans des puits de forage à 100 mètres de profondeur et reliées à 4 pompes à chaleur de 50 kW. Les sondes ont été fournies par la société Elydan, spécialiste de la géothermie, qui propose également des systèmes de captage horizontaux et par corbeilles. Ces dernières sont depuis cet automne proposées avec des tubes spiralés qui réduisent, selon la société, jusqu’à 20 % la résistance thermique du fluide caloporteur et les pertes de charges par rapport à des tubes lisses standards, et assurent ainsi une meilleure restitution de la chaleur et du froid. Le dimensionnement de l’installation a, lui, été réalisé par le bureau hydrogéologie Études & Mesures Philippe Berlandier (EMPB). Le 4 décembre, EDF, via sa filiale Production Énergie Insulaire (PEI) a inauguré sa centrale électrique de Port-Est située sur l’île de La Réunion qui vient d’être convertie à la biomasse solide. Équipée de douze moteurs initialement alimentés au fioul, la centrale tourne désormais à la biomasse liquide issue d’huile de colza. Cette initiative vise à soutenir l’objectif de la Réunion d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, tout en réduisant chaque année les émissions de CO₂ de 500 000 tonnes. « La consommation en biomasse liquide sera de l’ordre de 120 000 tonnes, pour une production de plus de 500 GWh/an », précise l’étude d’impact du projet. Certifiée conforme aux normes de durabilité de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED 2), la biomasse liquide améliore la qualité de l’air en éliminant les émissions de soufre et en réduisant les émissions de poussière tout en garantissant une puissance électrique de 212 MW. La Commission européenne lance les premières enchères organisées par la banque européenne de l’hydrogène afin de soutenir la filière. Un montant initial de 800 millions d’euros est mis à disposition par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation. Ces enchères prennent la forme d’une prime fixe par kilo d’hydrogène produit, attribuée au producteur. Elles visent à combler l’écart entre les coûts de production et le prix que les consommateurs sont aujourd’hui disposés à payer. Ces enchères contribuent à l’objectif du plan REPowerEU consistant à produire 10 millions de tonnes d’hydrogène sur le marché intérieur d’ici à 2030. Dans le cadre des enchères pilotes, les producteurs d’hydrogène renouvelable pourront soumettre des offres en vue d’obtenir une aide de l’UE pour un certain volume de production d’hydrogène. Ces offres devront reposer sur une proposition de surprix par kilogramme d’hydrogène renouvelable produit, limité à 4,5 €/kg. La subvention accordée pour les projets sélectionnés s’ajoutera aux recettes des ventes d’hydrogène réalisées, pendant une durée maximale de 10 ans. Une fois les conventions de subvention des projets signées, les industriels ont cinq ans pour commencer à produire. Les promoteurs de projets ont jusqu’au 8 février 2024 pour soumettre leur demande. La Commission propose un nouveau mécanisme dit « Auctions-as-a-Service », pour les projets qui n’ont pas pu bénéficier de la prime et prévoit également de lancer un deuxième cycle d’enchères en 2024. Le 20 novembre, l’Ademe a publié un avis sur le bois énergie. L’institution confirme son soutien au développement de la filière. Le bois énergie est la première source d’énergies renouvelables en France, représentant 33 % de la consommation d’énergie. Aujourd’hui en France, 1 Français sur 4 se chauffe au bois. Cette énergie peut prendre différentes formes : cheminées, inserts, poêles et chaudières à bûches ou granulés. Dans les logements collectifs ou sur les sites industriels, ce sont des chaufferies, qui s’approvisionnent en bois issus de la forêt, en résidus de bois des scieries, en déchets de bois, en bois d’élagage de haies ou de bocage. L’Ademe rappelle que tout en accompagnant la croissance des besoins en énergie renouvelable, il est important de maintenir une priorité à des usages en tant que matériau pour venir en alternative à des produits non renouvelables tels que l’acier ou encore le béton. La chaleur produite à partir de bois génère des impacts environnementaux. La filière est consciente de ces limites et œuvre pour les limiter. L’Ademe a fait plusieurs recommandations sur l’origine du bois et les pratiques sylvicoles et aussi pour limiter les émissions polluantes du bois énergie. Le 21 novembre, Limoges Métropole et Engie Solutions ont annoncé le lancement de deux projets de réseau de chaleur pour alimenter plus largement la ville en chaleur durable. Le premier réseau desservira le centre-ville et permettra d’étendre et de verdir le réseau de chaleur existant de l’Hôtel de Ville. Les installations passeront de 740 mètres linéaires et 10 sous-stations à 23 kilomètres et 135 points de livraison pour distribuer 64 GWh à quelque 9 470 équivalents-logements. La nouvelle Chaufferie de l’Est sera, à terme, alimentée majoritairement par la Centrale Énergie Déchets de Limoges Métropole (CEDLM). Grâce à la récupération de la chaleur fatale, issue de l’incinération des déchets, le réseau sera alimenté à terme à 97 % d’énergies renouvelables et de récupération. Pour limiter au maximum les perturbations occasionnées aux riverains, les travaux s’étaleront entre 2023 et 2028 pour une mise en service lors de la saison de chauffe 2028-2029. Le second réseau de chaleur servira la Rive Gauche de la ville. Il va tirer parti de l’énergie fatale des eaux usées de Limoges Métropole. La métropole profite en effet des travaux de modernisation de la STEP (station d’épuration principale) pour installer un système de récupération de la chaleur des eaux de rejet. Trois pompes à chaleur valoriseront les calories récupérées pour alimenter le réseau de chaleur. En complément, une chaudière biomasse d’une puissance de 8,5 MW sera installée dans la centrale de production. Alimentée par de la biomasse d’origine locale, elle permettra au réseau d’atteindre près de 98 % d’énergie renouvelable. Avec 14,3 km de réseau et 40 GWh distribués à 51 points de livraison, ce réseau de chaleur permettra de distribuer environ 5 880 équivalents-logements. Le Journal des Énergies Renouvelables est partenaire média du Forum EnerGaïa 2023 et sera présent sur place. Venez nous rencontrer les 13 & 14 décembre sur notre stand G08 – Hall : B1. À cette occasion, nous mettons un numéro spécial en téléchargement gratuit ICI. UniGéo entre en action. La société, créée en février 2022 par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris, pour les énergies et les réseaux de Communication (Sipperec) et les villes des Lilas, de Pantin et du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), a démarré en septembre les travaux de forage pour l’installation, aux Lilas, de la centrale géothermique du réseau de chaleur intercommunal. Quatre puits (deux de production et deux de réinjection) doivent être creusés pour atteindre 1 600 mètres de profondeur et pouvoir exploiter les calories de la nappe du Dogger à environ 57 degrés. Pour cela, une foreuse de 40 mètres de haut a été installée en contrebas du Fort de Romainville des Lilas. Afin de réduire le bruit et la pollution liés à l’utilisation de groupes électrogènes, il s’agit d’une foreuse 100 % électrique. Les forages devraient être terminés début 2024. Commenceront alors les travaux de construction du réseau de chaleur, long de 28 km, qui devrait être mis en service progressivement en 2025 pour alimenter 20 000 équivalents logements. Le budget, pour l’ensemble des travaux, s’élève à plus de 80 millions d’euros. Environ un tiers seront payés grâce à des aides de l’Ademe et de la Région Île-de-France. Le 8 novembre, les équipes de Plaine Commune Énergie, filiale d’Engie Solutions, ont annoncé que le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis sera alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable issue de la biomasse via un réseau de chaleur. Une opération rendue possible par la mise en service en octobre dernier d’un point de livraison qui permet de fournir chauffage et eau chaude sanitaire aux utilisateurs du centre aquatique. Le réseau de chaleur dessert déjà plusieurs villes, dont Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, l’Île-Saint-Denis et Aubervilliers, alimentant 61 500 équivalents-logements sur 90 kilomètres. D’ici 2024, le centre aquatique sera également raccordé au data center Equinix, augmentant sa part d’énergie renouvelable à 75 %. La startup bordelaise Seaturns, en partenariat avec l’Ifremer, teste actuellement un prototype de production d’énergie houlomotrice sur le site d’essais en mer de l’Ifremer de Saint-Anne du Portzic près de Brest. Avec des dimensions de 3,6 mètres de long pour 1,5 mètre de diamètre, le prototype restera à l’essai pendant 10 mois. Le système utilise le mouvement des vagues pour faire osciller un cylindre, similaire à un pendule, générant de l’électricité via une turbine à air. Si les résultats sont concluants, des étapes supplémentaires, telles que la validation de prototypes à plus grande échelle, sont envisagées, avec pour objectif la commercialisation d’unités de production d’électricité très bas carbone à partir de 2025. Le prototype bénéficie du financement de l’État dans le cadre de France 2030 et de l’Union européenne dans le cadre du plan France Relance. Lundi 6 novembre, la chaufferie biomasse et le réseau de chaleur des Hauts d’Évian, située dans le quartier des Hauts à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), a été mise en service. Confiée à Syane’Chaleur, au bureau d’études Menthe et à Engie, la construction a nécessité 15 mois de travaux. La production de chaleur desservira de nouveaux projets immobiliers, des bâtiments municipaux : Ehpad, groupe scolaire, caserne de pompiers. Le réseau alimentera à terme en chauffage et en eau chaude sanitaire 600 à 900 logements. La chaufferie aura au final une puissance de 6 MW et permettra de produire 14 GWh/an de chaleur tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 2 300 tonnes d’équivalent CO2 par an, soit l’empreinte carbone de 1 000 habitants. Le site utilise comme combustible de la plaquette forestière, résultat du broyage des rémanents (petites branches). L’investissement s’élève à 5 millions d’euros, dont 300 000 euros financés par France Relance et 2 053 970 euros financés par le Fonds chaleur de l’Ademe. Gironde Energies et Engie Solutions ont inauguré une nouvelle station d’avitaillement BioGNC située à Beychac-et-Caillau, en Gironde. Cette station propose un carburant issu de la valorisation de déchets organiques, une alternative propre et renouvelable aux carburants traditionnels, avec une réduction significative des émissions de CO2, des particules fines et du bruit. Elle servira les poids lourds en transit, facilitera l’accès aux zones à faibles émissions, en plein essor dans de nombreuses métropoles et agglomérations, grâce à leur classification environnementale Crit’Air 1 et permettra également la recharge des véhicules électriques grâce à la présence d’un superchargeur de 120 kW. L’installation de Beychac-et-Caillau est dimensionnée pour répondre spécifiquement aux besoins du transport routier de marchandises et des opérateurs logistiques locaux. Elle peut également avitailler 7/7J et 24h/24 tous types de véhicules légers et poids lourds. Et de deux ! Le Conseil municipal de la ville de Fresnes (Val-de-Marne) a voté un projet de création d’une seconde unité de géothermie, près du parc des Aulnes, pour alimenter le réseau de chaleur urbain. La centrale sera construite par Sofrege (Société fresnoise de géothermie), filiale à 100 % du Groupe Coriance, qui exploite le réseau de chaleur depuis 2010 dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Un avenant au contrat d’exploitation a été signé en ce sens fin septembre. Cette seconde centrale s’ajoutera à la première située aux abords du centre commercial de la Cerisaie, qui comprend un doublet créé en 1986 et un troisième puits foré en 2014 (68 MW). Elle sera composée d’un doublet géothermique et de deux pompes à chaleur d’une puissance totale de 5 MW. Le réseau sera également étendu de plus de 4,7 km. Il fera ainsi, à l’issue des travaux, 18 km pour un total de 133 sous-stations et 112 GWh de chaleur distribuées par an. La nouvelle installation de géothermie devrait permettre de faire passer le taux de couverture en énergie renouvelable de 60 à 80 %. 17 500 tonnes de CO2 seront ainsi évitées par an, soit l’équivalent de 15 000 voitures en circulation. L’investissement prévu par Coriance s’élève à plus de 31 millions d’euros, avec un soutien financier de l’Ademe et de la région Île-de-France. Les travaux devraient débuter en 2025. Saint-Malo Agglomération, le syndicat d’énergie d’Ille-et-Vilaine et sa SEM Energ’iV, s’associent pour valoriser en biogaz les déchets de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Saint-Malo Agglomération. Pour cela, la construction d’une unité de méthanisation a débuté en octobre, qui doit entrer en service début 2025. Elle alimentera en gaz renouvelable des bus, des bennes à ordures ménagères, des transporteurs et des particuliers. En s’associant, les partenaires visent à réduire de plus de 80 % les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de l’Agglomération, à améliorer la qualité de l’air, à progresser vers l’indépendance énergétique et à améliorer le confort des usagers en ayant des véhicules plus silencieux. La méthanisation réduira de 40 % les quantités de boues de la station d’épuration. Le biogaz produit sera accessible au grand public et aux véhicules locaux grâce à une station d’avitaillement de bioGNV prévue en 2025. Le coût total de l’opération est estimé à 11,16 millions d’euros, financé en grande partie par Saint-Malo Agglomération et dans une moindre mesure par le département de l’Ille-et-Vilaine. Le 20 octobre, le Contrat chaleur renouvelable territorial de la Gironde a été renouvelé pour la période 2022-2025. L’objectif de ce dispositif est de fournir un accompagnement technique et financier aux maîtres d’ouvrage publics et privés du territoire girondin dans la mise en œuvre de leurs projets de chaleur renouvelable. Lors du premier contrat, de 2019 à 2021, 33 installations (géothermie, chaufferie biomasse par plaquettes ou granulés, solaire thermique, récupération de chaleur fatale, création ou extension de réseaux de chaleur) ont bénéficié de 8,2 millions d’euros d’aides à l’investissement accordées par l’Ademe, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine. Avec le prolongement de cette convention, les signataires du contrat affichent désormais une volonté de montée en puissance, avec un objectif de 42 installations réalisées d’ici à 2025. Une enveloppe de 6,15 millions d’euros du Fonds Chaleur a été déléguée au Département de la Gironde. L’exécution de ce nouveau contrat se fera avec l’appui d’un groupement de compétences permanent, pour offrir un accompagnement aux porteurs de projets. Le Grand Port Maritime de Bordeaux et CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, ont posé la première pierre de l’unité de méthanisation CVE Port de Bordeaux. Cette installation permettra de traiter les matières organiques de la zone industrialo-portuaire de Bassens et de la métropole bordelaise : matières organiques issues de l’activité industrielle du Port (40 %), des activités de l’industrie agroalimentaire (40 %) et des biodéchets de la restauration et des supermarchés (20 %). Opérationnelle en 2024, cette unité pourra traiter jusqu’à 25 000 tonnes de matières organiques par an, équivalant au gaspillage alimentaire annuel de l’ensemble des habitants de Bordeaux Métropole, elle produira du gaz vert pour environ 4 000 foyers. La situation du site réduira considérablement la distance parcourue par les déchets organiques pour leur traitement et valorisation, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone liée au transport. CVE prendra en charge l’ensemble de la filière de valorisation des biodéchets, y compris la collecte, le traitement, la production de gaz renouvelable et la fourniture d’engrais organique naturel qui bénéficiera à 22 agriculteurs. L’unité de méthanisation représente un investissement de 23,8 millions d’euros avec le soutien financier du Fonds Européen Feder et de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine. Le producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable Lhyfe a inauguré, le 4 octobre dernier, la première station d’hydrogène privée de Vendée sur un site du distributeur de carburants Brétéché. Située à Maché, dans la zone de Bel-Air sur l’axe Challans-La Roche-sur-Yon, la station pourra distribuer jusqu’à 800 kg d’hydrogène par jour. Elle est alimentée grâce à un partenariat avec Lhyfe, qui produit cet hydrogène vert et renouvelable à Bouin à partir d’électricité éolienne et d’eau de mer. Brétéché souhaite continuer le développement de systèmes d’hydrogène dans les six départements où elle est implantée, à proximité des futurs sites de Lhyfe qui veut accroître sa production en 2024. Sa capacité installée s’élève actuellement à 1 MW, soit 300 kg d’hydrogène vert potentiellement produit par jour. Mais l’entreprise vise la production d’une tonne quotidienne courant 2024, soit une capacité installée de 2,5 MW. Solar Heat Europe, l’association de l’industrie solaire thermique européenne, et l’EGEC (son homologue sur la géothermie) se sont rapprochés afin de promouvoir ensemble l’utilisation de leur filière respective dans le secteur des processus industriels. L’industrie est un grand consommateur de chaleur, qui compte pour 75 % de ses besoins énergétiques globaux avec souvent une utilisation de chaleur à basse ou moyenne température (jusqu’à 400°C). Les deux structures européennes appellent à un déploiement accéléré de leurs technologies qui sont des solutions très adaptées aux besoins industriels, notamment dans le domaine de la chimie, de l’alimentation ou du textile. Des soutiens financiers à travers des programmes européens sont demandés afin de multiplier des opérations de grande envergure. Solar Heat Europe rappelle que dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables adoptée le 9 octobre 2023, des objectifs contraignants sont désormais fixés pour le déploiement du chauffage et du refroidissement renouvelables, ainsi qu’un objectif indicatif pour la décarbonation du secteur industriel. Si l’on ajoute à cela les préoccupations concernant la sécurité énergétique et les engagements volontaires des principales entreprises européennes à décarboner, il est clair que l’industrie européenne a besoin d’options fiables et compétitives pour satisfaire ses besoins en chaleur. Le solaire thermique et la géothermie sont prêts à relever le défi. Le Conseil supérieur de l’énergie a approuvé un projet de décret sur les certificats de production de biogaz (CPB). Cela signifie que les fournisseurs de gaz auront l’obligation d’avoir une part de gaz renouvelable dans leur mix. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz, soit en achetant ces certificats auprès de producteurs de biométhane. Un signal fort pour les acteurs de la filière et une reconnaissance du rôle majeur de cette énergie renouvelable et locale. Ce mécanisme vise à encourager la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et à garantir une visibilité à moyen terme pour la filière. Les CPB ne nécessitent pas de financement public, ce qui encourage le développement du biométhane. Ce secteur contribue à la décarbonation tout en favorisant la production locale d’énergie. Des objectifs ambitieux sont fixés pour produire 70 TWh de gaz renouvelables en France d’ici 2030, soit 20 % de la consommation nationale et un volume équivalent à nos importations de gaz de Russie avant la guerre en Ukraine. Le 9 octobre 2023, la Commission européenne a annoncé l’adoption des deux derniers piliers du Fit for 55, le paquet de mesures visant à réduire les émissions de l’Union européenne de 55 % en 2030. Incluse dans ce paquet législatif et désormais entérinée, la directive RED III (Renewable Energy Directive) engage l’Union à atteindre des cibles énergétiques ambitieuses, mais surtout revues à la hausse et juridiquement contraignantes. À horizon 2030, les énergies renouvelables doivent atteindre obligatoirement une part d’au moins 42,5 % dans le mix européen, contre 32 % pour la directive en vigueur auparavant. La réduction des gaz à effet de serre visée par Fit for 55 sera aussi portée par des textes visant à décarboner le secteur des transports terrestre, maritime (FuelEU Maritime Regulation) et aérien (ReFuelEU Aviation Regulation), à améliorer l’efficacité énergétique (Energy Efficiency Directive) et par une révision du système d’échange de quotas d’émission de carbone. Les États Membres devront maintenant transcrire les nouvelles dispositions de Fit for 55 dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, et y détailler les mesures qu’ils ont prévues pour atteindre leurs nouveaux objectifs pour 2030. À quoi ressemblera l’écosystème entourant les énergies renouvelables le jour où elles seront très largement dominantes ? Cette question n’a pas encore été très précisément approfondie. C’est cette lacune à laquelle tente de répondre le livre de Denis Bonnelle, « Cinq défis techniques XXL inédits pour le climat ». À partir d’une certaine taille, des options qui n’étaient pas pertinentes, le deviennent : électrification du transport maritime sans passer par le détour des e-fuels, qui ont un très faible rendement énergétique, stockage intersaisonnier de chaleur et de froid, autoroutes urbaines en hauteur pour vélos et trottinettes électriques… Ce livre, édité à compte d’auteur, peut être obtenu directement à l’adresse suivante : denis.bonnelle@ipsl.fr. Une version en anglais est également disponible, dans les mêmes conditions. Denis Bonnelle est physicien (ancien professeur en maths spé et lycées techniques) et économiste (énarque), il est membre de notre association Observ’ER. Le groupe Idex a inauguré une chaufferie biomasse à Bussy-Saint-Georges le 26 septembre 2023, alimentant actuellement 2 300 logements. D’ici 2028, plus de 6 000 logements seront connectés, réduisant significativement l’empreinte carbone du territoire. Le projet est soutenu par la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG) et la ville de Bussy-Saint-Georges pour chauffer l’écoquartier du Sycomore. Idex prévoit d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans le réseau de 70 % à 80 % tout en étendant le réseau de 7 km à 12,4 km pour utiliser la chaleur fatale d’une unité de valorisation énergétique à Saint-Thibault-Des-Vignes. Le projet a reçu un soutien financier de la Région Île-de-France et de l’Ademe. Après son étude annuelle sur le détail des ventes 2022 des appareils de chauffage domestique au bois (voir actu du 27 avril 2023), Observ’ER revient sur le secteur avec, cette fois, une approche plus qualitative destinée à mieux comprendre les évènements qui ont rendu l’année 2022 si singulière. Basé des entretiens menés auprès de professionnels, le bureau d’études analyse les mouvements observés sur la structuration du marché, les crises rencontrées ou les évolutions de la réglementation. Ce travail présente notamment les conséquences du boom des ventes d’appareils de chauffage à bûches et les difficultés d’organisation que cela a engendré pour l’ensemble de la chaine d’activité. L’étude couvre également la crise des granulés. Les professionnels se sont exprimés sur cette période au cours de laquelle le combustible est devenu difficile à trouver et a atteint des prix multipliés par 2 ou 3. Les industriels reviennent sur la chute brutale de leurs ventes au second semestre 2022 et surtout sur l’inquiétante absence de reprise en 2023 alors que les conditions de marché sur le combustible sont redevenues normales. Autre sujet d’importance, la future évolution des normes d’Ecolabelling. La Commission européenne veut remettre à plat les méthodologies utilisées pour le calcul des étiquettes énergétiques de l’ensemble des produits à vecteur air. Une nouvelle approche qui favoriserait les pompes à chaleur et que les acteurs du secteurs bois dénoncent. Après quasiment une décennie de résultats décevants, le marché du solaire thermique individuel connaît enfin une croissance significative. En 2022, les ventes de chauffe-eaux solaires individuels (CESI) et de systèmes solaires combinés (SSC), produisant à la fois eau chaude sanitaire et chauffage) en métropole ont progressé de 22 % pour atteindre un total de 44 250 m2. Certes la progression est inférieure à celle de 2021 (+ 53 %) mais le secteur semble avoir définitivement rompu avec la période 2011 – 2019, durant laquelle l’activité avait été réduite d’un facteur six. Le solaire thermique séduit à nouveau les particuliers dans un contexte où les ménages sont désormais sensibilisés aux hausses futures annoncées du gaz et de l’électricité et où les systèmes à fioul sont appelés à disparaître du marché. Ce sont d’ailleurs les systèmes combinés qui enregistrent les meilleurs résultats avec un doublement des ventes (13 750 contre 6 400 un an auparavant). Toutefois, cette nouvelle dynamique arrive trop tard pour que la filière dans son ensemble (applications individuelles et collectives ou industrielles) atteigne les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Alors que le texte actuel prévoyait 1,75 TWh d’énergie finale produite en métropole à fin 2023, la filière n’en a généré que 1,28 TWh en 2022. Avec un rythme de progression de l’ordre de 0,01 à 0,02 TWh par an au cours des années passées, la messe est dite : le secteur va rater son objectif de fin d’année de 0,4 TWh. Le 22 septembre a eu lieu l’inauguration de l’unité de méthanisation Mélusine Énergie, située à Aillas en Gironde. Le fournisseur de gaz Gaz de Bordeaux se porte acquéreur de l’intégralité de la production de biogaz, qui sera transporté à travers le réseau de Téréga, gestionnaire de gaz implanté dans le Grand Sud-Ouest. L’unité, en fonctionnement depuis 2022, a la capacité de valoriser près de 30 500 tonnes d’intrants chaque année. L’agriculteur François Guillomon, propriétaire de l’installation, avait fait le choix de diversifier son activité en raison de la crise menaçant le secteur laitier européen. Il possède plus de 400 vaches dont les effluents d’élevage (fumier, lisier, paille, sciure…) sont collectés et directement revalorisés dans le méthaniseur. À cela s’ajoutent des cosubstrats, provenant de l’exploitation ou d’exploitations voisines. La production annuelle de l’unité s’élève à 22,5 GWh et fournit en énergie plus de 5 600 logements. « Faire le choix d’un achat à 100 % c’est soutenir l’essor de la filière du biogaz et celui de la filière agricole en les accompagnant dans l’évolution de leur activité principale », a expliqué Cyril Vincent, directeur général de Gaz de Bordeaux. Des analyses récentes réalisées par des chercheurs de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) ont montré que des puits géothermiques situés dans la vallée du Rhin supérieur permettraient d’extraire du lithium de manière fiable pendant plusieurs décennies sans que ces sources ne s’épuisent. Avec l’avènement de la voiture électrique et du stockage par batteries, l’Europe aura besoin de grandes quantités de lithium dans les années à venir. Mais jusqu’à présent, la part de l’Europe dans la production mondiale de lithium n’était que de 1 %. Pour cette raison, les chercheurs du KIT ont étudié les moyens d’extraire le lithium des sources géothermiques. « En théorie, les centrales géothermiques de la vallée du Rhin supérieur et du bassin nord de l’Allemagne pourraient couvrir entre 2 % et 12 % de la demande annuelle de lithium de l’Allemagne », explique Valentin Goldberg de l’Institut des géosciences appliquées (AGW) du KIT. Lors de l’utilisation de l’énergie géothermique, l’eau extraite est réinjectée dans le sol via un deuxième forage. « Nous savions déjà que les sources géothermiques pouvaient fournir une énergie renouvelable pendant des décennies. Notre étude révèle désormais qu’une seule centrale électrique géothermique dans la vallée du Rhin supérieur pourrait couvrir jusqu’à 3 % de la consommation annuelle allemande de lithium », déclare Thomas Kohl de AGW, professeur d’énergie géothermique et de technologie des réservoirs et directeur des activités de recherche correspondantes. Le 15 septembre, l’université de Caen Normandie a inauguré sa nouvelle chaufferie biomasse. Cette dernière s’inscrit dans la restauration complète du réseau de chaleur d’un de ses campus, le Campus 1, composé de 36 bâtiments représentant 135 000 m² à chauffer. Cela représente près de 47% du patrimoine bâti de l’université. D’un budget de 8,8 millions d’euros, le projet a été financé en totalité par France Relance. Cette transition s’inscrit dans la stratégie DDRS (développement durable des établissements d’enseignement supérieur) de l’université. Ce label récompense les établissements d’enseignement supérieur engagés dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale. Caen Normandie cherche donc à réduire son empreinte environnementale en rénovant son patrimoine tout en apportant un meilleur confort aux usagers. Ses principaux objectifs sont de cesser la production de chaleur à partir d’énergies fossiles, de garantir l’indépendance énergétique de l’établissement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le 7 septembre dernier, un partenariat pour l’installation d’une chaufferie biomasse a été conclu entre le groupe Even, via sa filiale laitière Laïta, et le groupe Guyot. Située sur le site Laïta de Créhen, dans les Côtes d’Armor, cette chaufferie d’une capacité de 9 MW, couvrira 70 % des besoins en vapeur du site. Elle alimentera les différents ateliers de transformation laitière, à partir de bois en fin de vie collecté et valorisé en combustible par Guyot environnement. Les travaux de construction débuteront au 1er semestre 2024 et l’unité devrait être mise en service courant 2025. Ce projet est lauréat de l’appel à projets BCIAT depuis 2018. Il coûte 16 millions d’euros et est financé par Guyot énergies qui bénéficie d’une subvention de l’Ademe à hauteur de 4,2 millions d’euros dans le cadre du plan France Relance et du fonds chaleur. Il se pourrait bien qu’en 2029-2030, les villes de Bois-d’Arcy, Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l’École, situées dans les Yvelines à l’ouest de Paris, disposent d’un réseau de chaleur commun alimenté par la géothermie. C’est en tout cas ce que ces communes à forte densité urbaine et aux besoins en chauffage importants espèrent. Pour mener à bien ce projet, un permis de recherche géothermique sur les trois territoires a été déposé en juin dernier par Engie Solutions. Les sondages permettront de mener des études minières sur les caractéristiques du sous-sol (débit, température…) et d’étudier les potentialités d’implantation et de valorisation d’une centrale géothermique qui, pour être rentable, devra être capable de fournir en énergie 12 000 équivalents logements. Si les résultats sont favorables, la deuxième phase du projet pourra commencer : la création d’une co-entreprise (SAS LTE), avec pour actionnaires Engie Solutions et les communes concernées, pour construire la centrale à Bois-d’Arcy, dans le quartier de la Croix-Bonnet, et l’exploiter pendant au moins 30 ans. Parallèlement, les collectivités lanceront un appel d’offres pour désigner l’opérateur chargé de concevoir, construire et exploiter le réseau de chaleur alimenté par la centrale. Le producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable Lhyfe et le producteur d’énergie solaire TSE ont formé un consortium pour créer un hub énergétique vert dans la Vienne. Le tribunal de commerce de Paris a en effet accepté le 30 août dernier le rachat par Lhyfe et TSE des actifs fonciers et immobiliers des deux sites des Fonderies du Poitou. Le site des Fonderies d’Ingrandes grand de 43 hectares sera repris par les deux entreprises et le Centre d’Enfouissement Technique d’Oyré s’étalant sur 35 hectares, par TSE. Les deux partenaires installeront notamment un parc photovoltaïque et une unité de production d’hydrogène vert. Le projet de rachat, en cours depuis plus d’un an et demi, a été soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération de Grand Châtellerault, la Préfecture de la Vienne et la Sous-Préfecture de Châtellerault. « Le projet consiste d’abord à démanteler les infrastructures existantes et à dépolluer le site pour le rendre conforme au processus d’industrialisation grâce aux Fonds verts (1) et ensuite à bâtir les fondations d’un véritable parc industriel écologique où les entreprises travailleront en synergie », explique Ghislain Robert, directeur commercial France de Lhyfe. À terme, entre 250 et 300 emplois devraient être créés. (1) Fonds versés par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Les projets doivent permettre au moins 30 % d’économies d’énergie par rapport à avant la rénovation. Le 28 août dernier, le site de production de nourriture animale Prodeva, a annoncé la mise en place de deux nouveaux foyers de biomasse bois. Située à Vatry dans la Marne, l’entreprise est une filiale du groupe agro-industriel Cristal Union spécialisé dans la production de sucre, alcool et bioéthanol. Ces deux installations permettront au site de s’affranchir de l’usage de lignite (charbon) pour la déshydratation de luzernes et de pulpes de betteraves. En passant au 100 % biomasse, elle supprime ses émissions de CO2 de 23 000 tonnes par an. La première ligne est opérationnelle depuis fin juin 2023 et la seconde depuis août. Prodeva a déjà entrepris des stratégies de décarbonation et d’optimisation énergétique en renouvelant leur matériel de plaine et en adoptant de nouveaux procédés techniques et organisationnels (préfanage, ramassage de nuit…). L’entreprise vise désormais l’autonomie totale en eau d’ici trois ans. La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023, met les collectivités au centre de la planification énergétique en leur permettant de définir des zones d’accélération afin de développer des énergies renouvelables. Le ministère de la Transition énergétique a publié, le 13 juillet dernier, un guide de planification des énergies renouvelables qui présente le principe des zones d’accélération. Il précise le calendrier et recense l’ensemble des outils afin de faciliter les démarches des élus. Des fiches synthétiques sur les différents types d’énergies renouvelables ont également été mises à disposition. « Connaisseurs de leurs territoires, les élus seront bien entendu accompagnés dans cet exercice de planification par les services de l’État : le guide et les fiches produites constituent un deuxième étage de cet accompagnement après le lancement du portail cartographique des énergies renouvelables en juin » a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. La Commission européenne a autorisé, lundi 24 juillet dernier, une nouvelle enveloppe de 195,6 millions d’euros pour le le fonds de garantie en faveur des opérations de géothermie profonde. Ce fonds doit couvrir des opérations de géothermie profonde d’une capacité d’environ 30 MW et est prolongé pour une durée de 10 ans. La Commission a autorisé une contribution de l’Ademe de maximum 140 millions d’euros, pour la constitution du fonds de garantie. Le reste, sous forme de cotisations faites par les porteurs de projets souhaitant bénéficier de la garantie, s’élèvera à 55,6 millions d’euros. Ces garanties couvriront le risque lié au degré élevé d’incertitude de la ressource géothermale profonde lors de forages. Le montant maximum d’indemnisation par projet s’élèvera à 17 millions d’euros et sera payé aux porteurs de projets en cas d’échec sur la qualité ou la quantité de la ressource géothermale. Le Panorama de l’électricité renouvelable de 2022, vient enfin de paraître. Publiée par le Syndicat des énergies renouvelables, l’agence ORE et les opérateurs de réseau Enedis et RTE, la publication établit que le raccordement des énergies renouvelables électriques a atteint son plus haut niveau en 2022, avec près de 5 GW installés. Les énergies renouvelables ont couvert 24,3 % de la consommation d’électricité de France métropolitaine en 2022, soit toujours largement moins que l’objectif que le pays s’était donné pour 2020 (27%). La loi énergie-climat ambitionne de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique en 2030. La puissance totale du parc électrique renouvelable s’élève, en fin d’année dernière, à 64,8 GW, en comptant l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire photovoltaïque et les bioénergies. Les filières solaires photovoltaïque et éolienne représentent 98,5 % de nouvelles capacités raccordées en 2022. Fin décembre, le parc photovoltaïque s’élevait à 15,8 GW, dont 2,7 GW raccordés dans l’année. La puissance éolienne raccordée s’est quant à elle élevée à 2,3 GW, grâce notamment à la mise en service du parc éolien en mer de Saint-Nazaire (480 MW), amenant la capacité éolienne cumulée à 21,1 GW. Première source d’électricité renouvelable en France, le parc hydraulique n’a pour sa part pas évolué, et se maintient à 25,7 GW. Le secteur a en revanche connu une baisse de production de 23 % par rapport à 2021, en raison des sécheresses de l’an dernier, menant à une baisse de 5,8 % de l’électricité renouvelable totale produite en 2022. La filière bioénergie électrique atteint une puissance installée de 2,2 GW, dont 20 MW raccordés en 2022. Le 12 juillet dernier, le producteur d’électricité Qair, le développeur d’hydroliennes Hydroquest et leur actionnaire CMN (Constructions Mécaniques de Normandie), ont annoncé le soutien du gouvernement français dans le développement de la ferme pilote hydrolienne Flowatt au Raz Blanchard, dans la Manche. Ce projet a été encouragé par France 2030 avec un investissement de l’État de 65 millions d’euros minimum et un tarif d’achat préférentiel (non communiqué) de l’électricité produite. Installé sur une surface de 0,28 km2, le parc compte sept hydroliennes HydroQuest de 2,5 MW chacune, soit une puissance totale de 17,5 MW. Grâce au soutien de l’État, la ferme devrait commencer à produire d’ici 2026. L’industrialisation de la filière devrait créer 6 000 emplois d’ici 2030, pour le début de la production commerciale. La France bénéficie des courants marins parmi les plus forts au monde avec un potentiel de projet d’hydroélectricité estimé entre 3 et 5 GW pour les sites déjà identifiés et à plus de 100 GW dans le monde. L’industrialisation de la filière pourrait créer 6 000 emplois d’ici 2030 en France, avec la mise en service du premier gigawatt, assurent les porteurs du projet Flowatt. Le 13 juillet dernier, Sylvain Waserman, a été nommé par le Conseil des ministres, président-directeur général de l’Ademe, et succède ainsi à Boris Ravignon. Cet énarque de 55 ans et ancien député du MoDem, a occupé le poste de vice-président de l’Assemblée nationale de 2017 à 2022. Après l’exercice de son mandat, il a créé son cabinet de conseil en transition écologique pour les entreprises, « Acting 4 A Sustainable World », qu’il a quitté en juillet 2023. Suite à cette nomination, Sylvain Waserman déclare : « l’objectif commun : atteindre la neutralité carbone et accompagner notre société vers un modèle plus sobre et plus durable ». Le dernier baromètre EurObserv’ER en date s’est penché sur la filière solaire thermique en Europe et les nouvelles sont plutôt bonnes. La crise énergétique et la surchauffe climatique de plus en plus prégnante a remis en scène la chaleur solaire thermique dans toutes ses composantes. Que ce soit sur le segment du résidentiel individuel ou du collectif, des réseaux de chaleur urbains ou des besoins de chaleur des entreprises, la filière évolue depuis deux ans dans un contexte beaucoup plus favorable avec la forte augmentation du prix de l’énergie et la volonté des pays de l’Union européenne de se sevrer des importations de gaz russe. Selon EurObserv’ER, la reprise du marché du solaire thermique amorcée en 2021 s’est confirmée en 2022 avec une croissance de 11,9 % de la puissance installée annuellement, soit 1 660,7 MWth de mieux. Cette puissance est équivalente à une superficie de capteurs de près de 2,4 millions de m2 ce qui amène le total des capteurs solaires thermiques européens à 58,8 millions de m2. L’Allemagne reste toujours le premier marché de l’Union avec 709 000 m2, devant la Grèce, l’Italie et la Pologne, quatre pays qui ont tous enregistré des croissances à deux chiffres en 2022. La dynamique du solaire thermique est également intéressante aux Pays-Bas. Le marché y est porté par le résidentiel mais également par le segment agricole et de la production sous serres (fleurs, légumes…) qui cherche des solutions pour réduire sa consommation importante de gaz. Le 6 juillet dernier, Teréga Solutions, filiale de l’entreprise de transport et de stockage de gaz Teréga, et Solagro, entreprise associative spécialisée dans le secteur de l’agro-écologie et de la méthanisation, ont conclu un accord pour le développement de projets de méthanisation auprès d’agriculteurs. L’objectif est de favoriser des installations de petite et moyenne taille et d’accompagner les agriculteurs qui souhaitent valoriser les résidus d’activité de leurs exploitations en produisant une énergie renouvelable. Teréga Solutions prendra en charge la prospection des territoires, l’animation et la coordination des projets. Solagro apportera son expertise technique pour la réalisation des études de faisabilité. Le 30 juin dernier, le producteur d’hydrogène vert Lhyfe a annoncé sa participation au projet d’hydrogène renouvelable Hy’Touraine situé dans la zone d’activité Isoparc à Sorigny en Centre-Val-de-Loire. L’ Le 21 juin dernier, le fabricant d’onduleurs intelligents SolarEdge a annoncé sa collaboration avec le fabricant européen de système de chauffage Vaillant, pour intégrer les pompes à chaleur à leur technologie SolarEdge Home. L’objectif est d’optimiser et d’automatiser la consommation d’énergie solaire des ménages. Leur système intelligent prend des décisions en se basant sur la production des panneaux photovoltaïques installés, les habitudes de consommation d’énergie, les tarifs de l’énergie et les préférences des propriétaires. Avec cette nouvelle installation, l’énergie photovoltaïque excédentaire pourra alimenter la pompe à chaleur Vaillant et permettra aux résidents d’optimiser leur consommation d’énergie. SolarEdge a également adopté le protocole EEBUS (système d’uniformisation de l’interface entre les consommateurs d’électricité, les producteurs, les entités gestionnaires et les moyens stockages) pour compléter ses ensembles de protocoles de communication réseau. Les magazines édités par Observ’ER : Le Journal des Énergies Renouvelables, Le Journal du Photovoltaïque et Le Journal de l’Éolien, auxquels vous êtes abonnés seront désormais consultables en ligne sur une liseuse, en français dans un premier temps et tout prochainement en anglais. Vous pourrez y accéder sur ordinateur, téléphone mobile ou tablette. Lundi 3 juillet, vous recevrez un email comportant un lien, qui vous permettra d’accéder à votre espace abonné (1 abonnement = 1 accès au kiosque). Lorsque vous cliquerez sur ce lien, une fenêtre apparaîtra avec votre adresse mail de connexion et un mot de passe provisoire, qu’il vous faudra modifier lors de la première connexion à votre espace. Pour les connexions ultérieures, vous pourrez vous connecter depuis les sites des magazines dans l’onglet : « Espace abonnés ». Vous devrez utiliser la même adresse email comme identifiant ainsi que votre nouveau mot de passe. Si vous n’avez pas reçu de mail le 3 juillet au soir, nous vous invitons à vérifier dans les Spam. L’espace abonnés vous donne accès aux archives 2021 et 2022 des magazines et vous permet d’interroger un moteur performant pour des recherches spécifiques. Cette évolution ne met naturellement pas fin à l’envoi de votre magazine en version papier, que vous recevrez toujours par la poste. L’accès à la consultation en ligne prend fin en même temps que l’abonnement. Nous espérons que cette évolution vous sera utile et nous vous remercions de votre confiance ! Le 26 juin dernier, la mairie de Calais et CALOREV, filiale de Coriance, une société spécialisée dans la gestion et l’exploitation de réseaux de chaleur et de froid, ont signé un contrat pour l’exploitation et l’extension du réseau de chaleur de la ville de Calais. Le doublement de celui-ci a pour objectif de favoriser la conversion énergétique du territoire. Il sera alimenté à 86 % par de l’énergie renouvelable et locale provenant de la biomasse. Ce réseau de chaleur permettra d’améliorer la qualité de l’air en évitant l’émission de 13 000 tonnes de CO2 chaque année. Les habitants bénéficieront d’un prix plus compétitif que le prix des énergies fossiles et moins fluctuant. Dès 2024, l’équivalent de 18 000 logements pourra bénéficier d’une chaleur renouvelable grâce à l’ajout de 14,3 kilomètres de réseau et 44 nouvelles sous-stations. La chaufferie biomasse existante sera en partie rénovée pour atteindre une puissance de 18 MW. Une nouvelle station sera mise en service en 2024. L’association d’experts des énergies renouvelables, « Énergies renouvelables pour tous.tes » a déposé un recours au Conseil d’État, le 21 juin dernier, pour que l’État accélère en matière d’énergies renouvelables et respecte les objectifs de 2030 fixés par l’Union européenne. La France est le seul pays de l’Union européenne à avoir manqué ses objectifs de 2020. Les énergies renouvelables ne représentaient que 19,3 % de la consommation brute d’énergies contre 23 % prévu. « Il y a un manque de volonté politique. Ça s’accélère dans le monde mais on a du retard en France », déclare l’association. Les experts proposent une dizaine de mesures d’accélération à mettre en place, mais pour cela les effectifs dédiés aux énergies renouvelables doivent d’abord être renforcés. À l’horizon 2030, l’UE souhaite que le renouvelable représente entre 42,5 % et 45 %, dans la consommation totale d’énergie, ce qui est très ambitieux comparé aux 20,7 % actuels et nécessitera la contribution de tous les secteurs ainsi que des efforts de sobriété énergétique. Le 13 juin dernier, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé la publication de mesures réglementaires pour renforcer le déploiement de la filière biogaz. Un décret et deux arrêtés ont été publiés afin de revaloriser le tarif d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz. L’objectif est de permettre une meilleure indexation sur les variations des prix de l’énergie. Cette revalorisation atteint environ 12 % par rapport à l’arrêté précédent et le tarif sera désormais indexé deux fois par an contre une seule fois pour l’ancien. La ministre a également décidé d’autoriser le cumul de l’obligation d’achat de biométhane à un tarif réglementé avec d’autres aides à l’investissement (par exemple de l’Ademe ou des régions). Ces aides devront être versées au cas par cas après analyse de la rentabilité de chaque projet. Ces mesures viennent renforcer une filière en plein essor dans le secteur des énergies renouvelables. « Notre capacité d’injection de biogaz dans les réseaux représente environ 2 % de notre consommation totale de gaz aujourd’hui » a déclaré la ministre de la Transition énergétique. Les professionnels du biométhane souhaitent que l’Etat fixe un objectif de 20 % en 2030. Le développeur de projets de production et de stockage d’énergie renouvelable Verso Energy et l’entreprise de services Equans France ont signé, le 14 juin dernier, un partenariat pour développer des projets hydrogène dans la mobilité lourde. Verso Energy se charge de la conception, du développement et du financement des infrastructures, tandis qu’Equans France aura à charge, la conception, la construction et la maintenance des centrales de production et des stations de distribution d’hydrogène. Les deux entreprises collaborent déjà dans le cadre des projets Alp’Hyne et H2Bycol, visant à la création de trois stations de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable, dans la Vallée de l’Arve (Haute-Savoie) et en Île-de-France. Le producteur d’électricité renouvelable UNITe a été désigné pour la construction d’une centrale hydroélectrique à Méolans-Revel, dans les Alpes-de-Haute-Provence. En 2022, l’entreprise a été sélectionnée par la commune suite à un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’un aménagement hydraulique de 700 kW sur le torrent de Rioclar. Fort de son ancrage local avec l’exploitation de trois centrales hydrauliques dans la même vallée, UNITe souhaite commencer les travaux à partir de 2025. Les études environnementales et techniques ont déjà commencé et la production annuelle est estimée à 2 300 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) de 1 000 habitants. La commune ne bénéficiera pas de l’électricité produite par l’entreprise mais recevra une redevance, qui sera versée par UNITe au titre de l’occupation de ses parcelles communales. Le 31 mai dernier, le constructeur automobile Stellantis N.V et l’entreprise australienne Vulcan, spécialisée dans l’extraction de lithium des saumures souterraines grâce à la géothermie, ont signé un accord de principe pour un projet de développement géothermique. L’objectif est de fournir au site de Stellantis, situé à Mulhouse, de la chaleur renouvelable tout en extrayant du lithium qui servira à la production de batteries électriques. « La géothermie est l’une des nombreuses solutions que nous explorons pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2038 », déclare Arnaud Deboeuf, directeur industriel de Stellantis. Dans le cadre du projet Zero Carbon LithiumTM, Vulcan a déposé une demande de licence exclusive pour l’exploration du lithium en Alsace, couvrant une zone supplémentaire de 480 km² dans le gisement de saumure de la Haute Vallée du Rhin. De nombreuses études doivent d’abord être menées mais ce projet pourrait contribuer à combler une part significative des besoins énergétiques annuels du site de Mulhouse dès 2026. L’association française négaWatt et une vingtaine de partenaires européens ont présenté le 5 mai dernier leur scénario pour l’Europe visant à proposer une trajectoire de transition énergétique vers la neutralité carbone et le tout renouvelable avant 2050. Baptisé Clever (A Collaborative Low Energy Vision for the European Region), ce projet se distingue d’autres exercices prospectifs à l’échelle européenne car il met la sobriété au premier plan. Dans les vingt prochaines années, l’Union européenne devra faire deux fois plus pour réduire ses émissions que ce qu’elle a réalisé ces trente dernières années. Le rapport estime qu’il est possible de baisser de 55 % la consommation finale de l’Union européenne en 2050, par rapport à 2019 et atteindre 80 % d’énergies renouvelables en 2040. En France, l’objectif est une baisse de 40 % en 30 ans. La sobriété participerait à cette baisse, à hauteur de 20 % à 30 %, le reste concerne l’efficacité. Grâce à cela, l’Union européenne serait capable de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % dès 2030, soit 10 points de plus que l’objectif qu’elle s’est donné (-55%). Selon les auteurs, ce scénario rendrait l’Europe complètement autonome sur le plan énergétique en 2050. Aucune importation d’énergie ne serait nécessaire à cet horizon, pas même celles d’hydrogène vert ou de carburants de synthèse. En collaboration avec l’Ademe, Observ’ER vient de mettre en ligne sur son site l’état des lieux du parc d’installations de méthanisation en service au 1er janvier 2023. Ce travail dresse le bilan de la filière suivant les différents types de sites ou de valorisation existants. L’état des lieux recense 1 494 installations opérationnelles dans le pays, dont 85 % sont issus de centrales à la ferme ou d’unités de co-digestions territoriales. Cette catégorie est la seule à réellement progresser en nombre d’installations (+ 17 % par rapport à 2021). Les autres – unités en stations d’épuration urbaine, en industrie ou sur des sites de traitement de déchets ménagers – n’évoluent que très peu. L’année 2022 a ainsi vu l’émergence de 186 nouvelles installations, un chiffre inférieur à celui de 2021 (200 unités). Sur le plan de la valorisation, le biogaz issu des méthaniseurs a permis la production de 2,5 TWh d’électricité, d’environ 1,9 TWh de chaleur, l’injection de 7 TWh de biométhane dans le réseau de gaz naturel et d’ 1 TWh de BioGNV pour alimenter des véhicules. En termes de dynamisme, la valorisation sous forme de biométhane injecté dans le réseau de gaz a le plus progressé (+ 63 % de valorisation). La région Grand Est reste de loin la première en termes de nombre d’installations de cogénération (197 unités) ainsi que de capacité électrique (59,4 MWe). C’est également la première région, légèrement devant les Hauts-de-France, pour l’injection de biométhane avec 100 unités pour une capacité de 19 454 Nm3/h (+ 37 % par rapport à 2021). Lundi 22 mai dernier, le Comité de suivi du programme européen de coopération transfrontalière (Interreg Rhin Supérieur) a annoncé le lancement d’un projet de réseau de chaleur franco-allemand passant sous le Rhin qui approvisionnera environ 7 000 foyers strasbourgeois à l’horizon 2027. La chaleur « fatale » d’une aciérie de Kehl en Allemagne, sera récupérée et réinjectée dans le réseau de chauffage urbain de Strasbourg. Le projet de cette canalisation de 4,5 kilomètres est chiffré à 25,5 millions d’euros et sera financé par l’Union européenne à hauteur de 2,1 millions d’euros. Le reste sera apporté par des collectivités locales françaises et allemandes, la Banque des territoires, l’Ademe et son homologue allemand Dena. Le tout sous la responsabilité de la société Calorie Kehl – Strasbourg. Le projet permettra d’éviter l’émission de 20 000 tonnes de CO2 par an. Le 23 mai dernier, dix-huit agriculteurs associés ont inauguré Sanamethan, une nouvelle unité de méthanisation innovante à Vraignes-en-Vermandois dans la Somme. La particularité du site tient à la capture du dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le biogaz, qui est transformé afin d’être vendu. Il serait le deuxième site de ce genre en France, selon les exploitants. Quatre à cinq mille tonnes de CO2 biogénique seront récupérées sous forme liquide chaque année. Il peut être valorisé pour le nettoyage industriel, dans l’industrie pharmaceutique ou la fabrication de boissons gazeuses. Les prix de marché du CO2 varient de 40 à 150 €/tCO2. Le biométhane est, lui, injecté dans le réseau GRTgaz. En fonctionnement depuis le début de l’année, le groupement d’agriculteurs a investi 12 millions d’euros dans la création du site. Composée de quatre digesteurs, qui ingurgitent près de 100 tonnes de matières organiques par jour, l’unité de méthanisation injecte 320 Nm³/h de biométhane dans le réseau de transport de GRTgaz. « La multiplication des digesteurs permet de répartir les risques. En cas de panne sur l’un d’eux, trois autres continuent de fonctionner et de produire du biogaz, ce qui nous permet aussi de faire des tests sur de nouvelles matières organiques que nous cherchons à valoriser », précise Pierre Chombart, responsable du site. D’autres projets comme l’hygiénisation (valorisation des sous-produits animaux et soupe de biodéchets) ou la méthanation (réaction de synthèse du méthane à partir d’hydrogène et de monoxyde de carbone) sont envisagés ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques sur une partie du site. Alors qu’une augmentation du prix du gaz est attendue avec la fin du bouclier tarifaire au 1er juillet 2023, le prix du granulé de bois est en baisse. Après des hausses exceptionnelles ces derniers mois, il retrouve un niveau de prix raisonnable ce printemps. Pour un usage en chauffage principal, d’après une enquête du CEEB (Centre d’étude de l’Économie du Bois), le prix du granulé de bois en sac était de 11,75 centimes d’euros par kWh PCI (pouvoir calorifique inférieur) en avril 2023, et celui du granulé en vrac de 11,62 c€/kWh, contre plus de 13 c€/kWh en octobre 2022. Cette baisse ne ramène toutefois pas les prix au niveau de ceux de 2021 (5 à 9 c€/kWh), avant la crise énergétique. Propellet, l’association du chauffage au granulé de bois, observe néanmoins que pour une maison de 90 m2, se chauffer avec un poêle à granulé est aussi économique qu’avec une pompe à chaleur et serait même près de deux fois moins cher sans le bouclier tarifaire. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude complète portant sur le marché 2022 des pompes à chaleur (PAC) individuelles, jusqu’à 30 kW. Sans surprise, les ventes de pompes à chaleur géothermiques sont restées stables en 2022 par rapport à 2021, avec 3 260 appareils vendus contre 3 220 en 2021. Il en a été de même pour les équipements aérothermiques, dont les ventes n’ont progressé que de 3 %. Ce chiffre masque cependant un contraste entre les segments de l’aérothermie puisqu’une forte croissance a été observée dans les pompes à chaleur air/eau (+ 35 % pour 341 750 unités vendues) alors que les ventes d’appareils air/air étaient en recul (- 7 % pour 750 780 unités vendues). Après une première version de cette étude publiée en avril et qui ne portait que sur les chiffres de marché, l’étude publiée aujourd’hui s’étoffe de plusieurs indicateurs décrivant la répartition régionale des ventes, les types d’opérations (premier équipement ou remplacement) ou une évaluation du chiffre d’affaires de la filière. Outre ces indicateurs nouveaux, un volet est dédié au suivi des prix moyens des installations. Avec des hausses moyennes allant de 7 à 14 % pour le matériel, et ce sur l’ensemble des secteurs (aérothermie et géothermie), l’année passée a enregistré les plus fortes croissances de prix observées ces dix dernières années. S’ajoutant aux hausses déjà observées en 2021, entre 2020 et 2022, l’augmentation moyenne des prix aura ainsi été de 15 à 20 %. Engie Solutions, le Grand Reims et la Ville de Reims ont inauguré une nouvelle chaufferie bois, située dans le quartier de la Croix-Rouge, à Reims et qui sera alimentée par du bois de récupération, appelé aussi « Bois B ». L’unité traite des déchets de bois issus d’emballages, d’ameublements ou encore de bois de démolition, provenant d’un rayon de 100 kilomètres autour de la chaufferie. Le site permettra d’alimenter en chaleur renouvelable 20 000 équivalents logements. Ce projet s’ajoute au réseau de chaleur rémois créé il y a 50 ans qui dessert Reims et ses alentours. Le projet a nécessité un investissement de 19,8 millions d’euros, dont 10 millions d’euros financés par l’Ademe dans le cadre du Fonds chaleur. La 21e édition du baromètre EurObserv’ER des énergies renouvelables en Europe vient d’être publiée dans sa version française. Le programme EurObserv’ER est financé par la Commission européenne avec l’association Observ’ER comme leader. La version française des baromètres est réalisée grâce à un partenariat financier avec l’Ademe. Chaque année, six baromètres thématiques dédiés à la progression de filières renouvelables sont réalisés avant qu’un baromètre bilan ne vienne proposer un panorama complet. Douze technologies sont passées au crible d’indicateurs portant sur les capacités installées, l’énergie produite, les coûts de production, les emplois, les chiffres d’affaires ou les investissements en R&D et ce pour chacun des États membres. En plus de données chiffrées, le baromètre EurObserv’ER propose des analyses sur les dynamiques européennes, notamment à l’aune des objectifs posés par la Commission. Sans surprise, l’édition 2022 revient sur le retard grandissant des pays de l’Union quant à l’objectif principal de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Avec un taux de 21,8 % fin 2021, l’UE27 reste encore loin des 42,5 % à 45 % visés à fin 2030. Sur le plan de l’emploi, les filières renouvelables représentent 1,5 million équivalents temps plein (directs et indirects) pour un chiffre d’affaires de près de 185 milliards d’euros. Des chiffres en progression de plus de 10 % par rapport à 2020. Autre enseignement notable, l’usage des énergies renouvelables ont permis d’éviter l’émission de 601 millions de tonnes de CO2 en Europe. Le baromètre bilan EurObserv’ER se conclut par un chapitre consacré aux échanges commerciaux entre l’UE27 et le reste du monde. Si l’Union européenne a exporté pour 22,1 milliards d’euros de biens et services relatifs à des filières renouvelables en 2021, la balance commerciale est négative car les importations ont été supérieures (26,6 milliards). L’ensemble des baromètres sont disponibles en libre téléchargement sur le site internet EurObserv’ER. Le 11 mai dernier, le groupe Idex a inauguré son projet de boucle d’eau baptisé « ali énergie », alimenté par le lac d’Annecy. Il servira à chauffer et refroidir les bâtiments du quartier des Trémus dont un hôtel et la future piscine municipale de la ville. Ce nouveau réseau couvrira 95 % des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire (13 GWh/an) du quartier via des pompes à chaleur (PAC), le complément étant assuré par des chaudières à gaz, qui prennent le relais lors des maintenances des PAC. Les besoins en climatisation seront assurés à 100 % par la boucle d’eau (500 MWh par an) grâce au principe de « free cooling », c’est-à-dire la circulation de l’eau fraîche sans mise en service des PAC. Un tel système consomme 15 fois moins d’électricité qu’une climatisation classique et permettra d’éviter, à terme, la production de 2 600 tonnes de CO2 par an. Le coût total des installations de pompage et de son réseau de raccordement souterrain ont été conçus, réalisés et financés par Idex, pour un investissement de 10 millions d’euros, subventionné à hauteur de 1,7 millions par l’Ademe. Le réseau sera exploité et entretenu par Idex pendant 25 ans. Le 4 mai dernier, la première station BioGNV des Mauges a été inaugurée dans la zone industrielle du Tranchet, à La Pommeraye, commune déléguée de Mauges-sur-Loire en Région Pays-de-la-Loire. La station sera alimentée par les unités de méthanisation du territoire et permettra l’avitaillement d’une trentaine de poids lourds par jour. Le temps d’avitaillement sera de 10 à 15 minutes et la station sera accessible 24h/24. Le coût total d’investissement de ce projet est de 1,3 million d’euros porté par la société Mauges BioGNV. La Région Pays-de-la-Loire subventionne la station à hauteur de 200 000 €. Le tarif moyen de vente du gaz est de 1,32 €/kg HT et 1,59 €/kg TTC. Aujourd’hui, 10 stations GNV/bioGNV sont en service dans la région et une quinzaine sont en projet, pour un objectif de 86 stations à horizon 2030. L’Ademe annonce que 520 millions d’euros ont été alloués au développement de la de production de chaleur renouvelable dans le cadre du Plan de résilience, mis en place à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise énergétique en résultant. Ces aides allouées dans le cadre du désormais célèbre Fonds Chaleur permettront la construction de plus de 900 nouvelles installations qui produiront 3,68 TWh de chaleur renouvelable et de récupération afin d’alimenter habitats collectifs, collectivités, et entreprises. Avec les projets financés par le Fonds de décarbonation de l’industrie, ce sont au total plus de 700 millions d’euros d’aides publiques qui ont été attribuées en 2022 à de telles installations, pour une production attendue de 6,3 TWh par an. Ces aides soutiennent les réseaux de distribution et les installations de production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération, afin d’alimenter habitats collectifs, collectivités et entreprises. Observ’ER vient de publier son étude annuelle du marché 2022 des appareils de chauffage domestique au bois. Ce travail vient compléter une première version diffusée il y a un mois (voir Actu du 30 mars 2023) mais qui ne portait que sur les seuls chiffres de vente. Cette analyse plus détaillée met une nouvelle fois en avant une très belle année pour les appareils de chauffage à bûches. Portées par une conjoncture marquée par des augmentations des prix de l’électricité et du gaz, les appareils à bûches (tous types confondus) ont progressé de 25 % en 2022 contre 17 % pour les appareils à granulés dans un marché total qui a augmenté de 21,4 %. Le segment des poêles à bûches symbolise cette dynamique avec un rebond de 30 % de ses ventes (187 500 contre 144 240 en 2021). Ce phénomène a d’ailleurs eu un impact sur la part des importations du marché dans son ensemble puisque les appareils à bûches sont davantage produits en France comparés aux équipements à granulés. Ainsi la part des importations a diminué pour la première fois en 5 ans. Bonne nouvelle également du côté des exportations françaises qui progressent, notamment grâce au segment des foyers fermés et inserts à bûches. Les appareils de chauffage au bois continuent de s’installer très majoritairement dans l’existant (à près de 93 %) et le remplacement d’anciens appareils bois par de nouveaux plus performants a représenté 43 % des ventes de l’an passé. L’étude se clôture sur un suivi de l’évolution des prix de vente et sans surprise les indicateurs ont été très nettement orientés à la hausse. Une hausse de 12 % en moyenne pour les équipements et 7 % pour la partie pose. Le renchérissement des prix des matières premières et de l’énergie ont été en partie répercutés par les industriels. Sur les deux dernières années, les prix hors taxe des équipements ont augmenté en moyenne de plus de 20 %. L’étude est disponible en libre téléchargement sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables. Dans le cadre de l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui doit être présentée par le gouvernement en juin prochain, les acteurs de la filière de la chaleur renouvelable ont remis le 21 avril dernier à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, une proposition de « Plan Marshall » pour la chaleur renouvelable. Ce plan doit permettre de porter sa part à 54 % de la consommation totale de chaleur en France dès 2030, contre 23 % actuellement. Parmi les solutions proposées, on peut citer l’évaluation obligatoire du potentiel de valorisation de chaleur fatale des installations industrielles et data centers supérieurs à 5 MW ; la relance et la simplification des appels d’offres concernant les combustibles solides de récupération (CSR) ; la définition d’une stratégie territoriale de chauffage dans tous les documents d’urbanisme (PLU) et d’habitat (PLH) ou encore l’accélération du déploiement de la géothermie et de la méthanisation. Cette ambition repose sur une série de propositions législatives et réglementaires, ainsi que sur une augmentation pluriannuelle du Fonds chaleur. Selon les acteurs de la filière, l’enveloppe du Fonds pour 2023 devrait être portée à 750 millions d’euros, soit largement plus que les 522 millions attribués l’an dernier. Le 15 avril dernier, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a inauguré l’unité de méthanisation, baptisée BiogazMer, située à Mer dans le Loir-et-Cher. Porté par un collectif de douze agriculteurs, ce projet a nécessité quatre ans d’études et de construction. Le biogaz produit est issu de la fermentation de déchets de silos, de céréales, de pulpes de betterave ou encore de cultures intermédiaires d’hiver. Le digestat, résidu de la fermentation des matières organiques, est utilisé comme fertilisant naturel par les exploitations associées, dont deux en agriculture biologique et permet ainsi de réduire la dépendance aux engrais minéraux. BiogazMer injecte plus de 23 GWh de gaz vert dans le réseau de distribution soit l’équivalent de la consommation gaz de plus de 5 500 logements. Avec ce projet, 32 sites de méthanisation produisent du gaz vert en Région Centre-Val de Loire. Le groupe Legendre, spécialiste français de la construction, de l’immobilier et de l’énergie, la startup bretonne Geps Techno, évoluant dans le domaine des énergies renouvelables en mer et l’Ifremer annoncent que leur démonstrateur baptisé Dikwe va bientôt passer à échelle réelle. Ce projet d’ouvrage de protection du littoral érigé en forme de digue intègre un dispositif de production d’électricité basé sur un système houlomoteur à volets oscillants. Après des tests en bassin concluants, un prototype à échelle un quart a été immergé, pendant plusieurs mois, pour des essais en rade de Brest, à Saint-Anne-de-Portzic (29). Cette nouvelle expérimentation s’est également montrée probante, selon l’entreprise, et a permis de valider la prochaine et dernière étape de développement : la construction du démonstrateur à taille réelle, d’une capacité de l’ordre du mégawatt, qui pourrait voir le jour à l’horizon 2024, en Bretagne. Le projet Dikwe est soutenu par l’Ademe et les régions Bretagne et Pays de la Loire. Le producteur français d’énergies renouvelables CVE et la société d’économie mixte, Sem’Soleil ont inauguré le 7 avril dernier une unité de méthanisation injectant du biométhane dans le réseau, située à Montbrison dans la Loire. Le site traitera chaque année jusqu’à 23 000 tonnes de déchets organiques issus de l’activité industrielle (pour 50 % du flux valorisé), des activités de la collectivité et des restes alimentaires (40 %), et de coproduits agricoles (10 %), dans un rayon de 60 km autour de l’unité. Le biométhane sera injecté dans le réseau local de gaz naturel et assurera la consommation en gaz de 3 500 foyers, soit l’équivalent de plus de 45 % de la consommation des habitants de la ville de Montbrison. Le digestat offrira un engrais naturel à une quarantaine d’exploitations agricoles partenaires. Représentant un investissement de 13 millions d’euros, le projet a reçu le soutien financier du Fonds européen Feder (1 075 000 €), de l’Ademe Auvergne-Rhône-Alpes (525 000 €) et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (261 000 €). Pour le territoire, les retombées économiques sont estimées à plus de 600 000 € par an réinjectés dans l’économie locale. À l’occasion de la présentation des résultats de son enquête annuelle « les Français et l’hydrogène », Teréga, l’un des deux gestionnaires du réseau de transport de gaz en France avec GRTgaz, a levé le voile sur le projet HySoW (Hydrogen South West). Il s’agit d’une infrastructure dédiée au transport d’hydrogène à l’échelle du Sud-Ouest, présentée comme stratégique face aux enjeux de souveraineté énergétique française et européenne, dont la mise en service devrait intervenir à horizon 2030. Réalisé en association avec la région Occitanie, le projet HySoW a pour ambition de connecter des pôles industriels de la partie sud-ouest du pays aux flux d’hydrogène produits localement (Bayonne, Lacq, Pau) mais aussi en provenance du sud de l’Europe (Espagne) ou de la Méditerranée. Il permettra également de renforcer la sécurité d’approvisionnement de l’ensemble du système énergétique d’Occitanie grâce à des infrastructures de stockage d’hydrogène et à un projet de H2-to-Power. Parmi les principaux clusters de consommation visés, HySoW servirait notamment les programmes de décarbonation ou de réindustrialisation des entreprises de Bordeaux (secteurs aéronautique, industriel et portuaire), Bayonne (portuaire) ou Pau (aéronautique). Le corridor HySoW sera composé d’environ 600 kilomètres de canalisations, dont 40 % pourront être convertis du gaz naturel vers l’hydrogène, permettant le transport de 16 TWh/an d’hydrogène décarboné à travers tout le Sud-Ouest. Le projet sera structuré autour d’installations majeures de stockage d’hydrogène en cavité saline en Nouvelle-Aquitaine d’une capacité de 500 GWh PCS en 2030, qui pourra être augmentée jusqu’à plus d’1 TWh PCS à horizon 2050. L’agglomération du Grand Chambéry, a décidé de modifier l’unité de méthanisation des boues d’épuration de son usine de dépollution des eaux usées. Plutôt que de produire de l’électricité et de la chaleur par cogénération, elle injecte désormais du biométhane dans le réseau de gaz grâce à l’unité de purification du biogaz mise en service à la mi-mars. Ce biométhane permet d’alimenter 1 000 foyers par an en chauffage, soit environ 2 500 habitants. L’unité de purification de biogaz fournira aussi en biométhane la station BioGNV (Gaz Naturel pour Véhicules) de Bissy, ouverte à tous, véhicules légers et poids lourds, où s’alimentent les camions de collecte BioGNV de la direction des déchets de Grand Chambéry. Cette réalisation représente pour Grand Chambéry un investissement total de plus de 3 millions d’euros HT subventionné à hauteur de 1,4 millions d’euros par l’Agence de l’eau dans le cadre du plan France relance. « Le retour sur investissement est estimé entre 3 et 4 ans, précise l’agglomération, et est deux fois supérieur au gain généré par la cogénération. » Le producteur d’hydrogène renouvelable, Haffner Energy et la startup Carbonloop, spécialisée dans la séquestration de CO2 annoncent la signature d’un contrat pour deux sites de production d’hydrogène vert à partir de la biomasse. Via sa technologie de gazéification de la biomasse baptisée Hynoca, Haffner Energy va produire de l’hydrogène et du biochar à partir de résidus de bois. Une unité de thermolyse va chauffer la biomasse qui se décomposera en un résidu solide (le biochar) et produira un gaz qui sera ensuite raffiné dans une unité de craquage à haute température pour devenir de l’hydrogène. Chaque site consommera 7 000 de résidus par an pour produire d’un côté 225 tonnes d’hydrogène et de l’autre 1 100 tonnes de biochar, séquestrant environ 2 400 tonnes de CO2. Carbonloop commercialisera l’hydrogène à Hyliko (Groupe Kouros) qui le distribuera dans son réseau de stations-service à destination des poids lourds. Grâce à ses propriétés de rétention d’eau et des fertilisants, le biochar produit sera commercialisé auprès de la filière agricole. Le premier site Carbonloop sera localisé à Villabé (Essonne), à proximité de la station de distribution d’Hyliko, le long de l’A6, au Sud de Paris. L’hydrogène produit à partir de résidus de biomasse alimentera les premiers camions de la région parisienne. La localisation du second site sera dévoilée dans le courant de l’année 2023 Dix fondateurs publics et privés (Ifremer, Centrale Nantes, ITE France Énergies Marines, EDF, RTE, TotalEnergies, Technip Energies, Valorem, Valeco, Énergie de la Lune) annoncent la création de la Fondation OPEN-C, le plus grand centre européen d’essais en mer entièrement dédié à l’éolien flottant et aux énergies marines renouvelables. Cette structure de recherche s’est donnée pour mission de coordonner, développer et piloter les essais en mer avec une dimension multi-technologique : éolien flottant, hydrolien, houlomoteur, hydrogène en mer et photovoltaïque flottant. L’entité qui regroupe un ensemble de cinq sites en mer dédiés aux tests des prototypes les plus innovants sur l’ensemble des façades maritimes de l’hexagone, permettra à plusieurs innovations de se développer dans les trois prochaines années. Ces innovations concernent les essais de cinq prototypes distincts d’éoliennes flottantes de seconde génération, la production d’hydrogène vert offshore ou encore les tests de systèmes photovoltaïques flottants. Observ’ER vient de publier son étude annuelle de suivi du marché 2022 des appareils de chauffage domestique au bois. Les ventes de l’année passée ont une nouvelle fois été bonnes avec plus de 90 000 pièces supplémentaires vendues par rapport au marché 2021, ce qui porte à 513 290 unités le marché 2022 (+21,4 %). Ce total est le deuxième meilleur résultat enregistré au cours des 11 dernières années. La conjoncture, marquée par une hausse des prix de l’électricité et du gaz, couplée aux aides publiques (MaPrimeRénov’ et Coup de Pouce Chauffage), a prolongé la très bonne dynamique de 2021. Cependant, l’activité de 2022 se distingue sur certains points. Le premier tient au fait que l’an passé, ce sont les appareils à bûches (tous types confondus) qui ont affiché les plus belles croissances (en chiffres relatifs et absolus). Il s’est vendu 52 430 appareils à bûches de plus qu’en 2021 contre 37 400 pour les équipements à granulés. Ainsi, le secteur des foyers fermés et inserts (très majoritairement à bûches) progresse de 13,2 % en affichant un total de ventes de 72 180. Autre dynamique à relever, celle des chaudières à bûches qui ont vu leurs ventes évoluer de +22,5 % (4 350 unités contre 3 550 en 2021). La performance est à souligner car depuis 2011, ce sous-segment n’avait connu qu’une seule année de progression de ses ventes. Sur l’ensemble des ventes de 2022, ce sont les appareils manuels à bûches qui ont représenté la majorité des ventes. La balance penche de peu (51,1 % pour les appareils manuels contre 48,9 % pour les appareils automatiques) mais la répartition était inverse en 2021. De leur côté, les appareils automatiques à granulés (tous types confondus) réalisent une année très contrastée. Après un très bon premier trimestre, les vives tensions sur la disponibilité des combustibles granulés, ainsi que sur leurs prix de vente, ont porté un net coup d’arrêt aux ventes qui progressent tout de même de 18 % en moyenne sur l’ensemble de l’année. L’étude est disponible en libre téléchargement sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables. Le 14 mars dernier, la commune de Limoux dans l’Aude a inauguré sa nouvelle chaufferie bois, construite sur le site d’une ancienne tuilerie. Sur trois kilomètres de réseau est raccordée toute une série de bâtiments publics, logements collectifs et individuels (l’USSAP-ASM, l’hôpital de Limoux, l’Ehpad Chénier, l’institut Saint-Joseph, le groupe scolaire Jean-Moulin, les HLM d’Alogea, le foyer des jeunes travailleurs, Aude Urgence Accueil…). Ce projet va aussi permettre la valorisation de la filière bois de la Haute Vallée de l’Aude qui approvisionnera la chaufferie avec quelque 2 000 tonnes par an. Le programme a mobilisé un budget de près de 5 millions d’euros pour lequel le Département a été sollicité, au titre de l’aide aux communes, à hauteur de 250 000 €. La Région Occitanie et l’Agence de la transition écologique (Ademe) ont également été partenaires du projet. Le 15 mars dernier, Teréga, l’INSA de Toulouse et le collecteur de biodéchets Cler Verts, ont inauguré une nouvelle plateforme de recherche et développement baptisée Solidia Biogaz, située sur la commune de Bélesta-en-Lauragais, en Haute-Garonne. Le site, dans sa configuration initiale, accueillait des projets de recherches centrés sur les procédés de méthanisation et la valorisation des déchets organiques. La nouvelle plateforme est dédiée à l’enrichissement et à la valorisation du biogaz en biométhane injecté. La R&D utilisera du biogaz brut issu de l’usine de biodéchets de Cler Verts et de l’hydrogène produit par électrolyse à des pressions allant jusqu’à 10 bars. La plateforme pourra accueillir simultanément jusqu’à six pilotes de taille semi-industrielle : trois emplacements sous une halle couverte et trois emplacements extérieurs. Elle est destinée à tous les acteurs de la filière biogaz : développeurs de technologie, PME, grands groupes, universités et laboratoires de recherche. L’objectif est de réaliser des études de phénomènes à grande échelle et d’accompagner les différents acteurs vers l’industrialisation. Le Valtom, syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme va faire appel à Waga Energy pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Puy-Long situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L’unité Wagabox, développée par Waga Energy traitera le gaz émis par les déchets enfouis mais aussi le biogaz d’une usine de méthanisation voisine exploitée par la société Vernéa. Il s’agit d’un projet de production de biométhane à partir d’une source de biogaz hybride. Le mélange de ces deux flux fournira du biogaz suffisant pour réaliser un projet d’injection de biométhane dans le réseau de GRDF. 15 GWh de biométhane par an seront fournis au réseau de distribution de gaz, soit l’équivalent de la consommation de plus de 2 000 foyers. Remplacer le gaz par la géothermie, c’est ce que s’apprête à faire le réseau de chaleur de la copropriété de Parly 2 qui comprend 7 500 logements sur 37 résidences au Chesnay-Rocquencourt dans les Yvelines. Construit il y a cinquante ans, il devrait ainsi éviter l’émission de 18 500 tonnes de CO2 par an. La centrale géothermique exploitera les calories de la nappe du Dogger grâce à un doublet géothermal descendant à plus de 1 500 mètres sous terre où l’eau est à 61 degrés, et permettra au réseau d’être alimenté à 75% par de l’énergie renouvelable. Elle sera construite et exploitée jusqu’en 2053 par Engie Solutions, déjà exploitant du réseau de chaleur, sur une parcelle mise à disposition pendant trente ans par le département. Les travaux de forage pour la mise en place du doublet géothermal devraient démarrer à la fin de l’année, la mise en service étant prévue pour octobre 2025. 71 000 MWh d’énergie seront alors livrés par an à la copropriété de Parly 2, mais aussi à la copropriété Nouvelle France, l’hôpital Mignot, plusieurs bâtiments communaux du Chesnay-Rocquencourt, deux groupes scolaires et le collège Charles Péguy, soit l’équivalent de 9 000 logements. Une société de production, baptisée « Géomy3 », a été créée pour l’occasion par Engie Solutions avec la copropriété pour actionnaire ainsi que la Ville du Chesnay-Rocquencourt et le Département des Yvelines. Le montant de l’opération s’élève à 30 millions d’euros. Une deuxième phase est à l’étude afin d’alimenter les communes voisines de Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Bougival et Noisy-le-Roi. Le développeur danois de projets d’hydrogène vert, Everfuel, et le gestionnaire français du fonds d’infrastructure d’hydrogène décarboné, Hy24, ont annoncé la création d’une filiale commune pour accélérer le développement de la production d’hydrogène par électrolyse dans les pays nordiques. La coentreprise combinera l’expertise d’Everfuel dans le développement de capacités de production d’hydrogène vert en Europe, et l’expérience industrielle et financière en gestion d’actifs d’Hy24 pour accélérer le développement de nouveaux projets au Danemark, Norvège, Suède, et la Finlande. La nouvelle société prévoit d’investir 200 millions d’euros en fonds propres pour le déploiement de ses projets avec pour objectif d’opérer jusqu’à 1 GW de production d’hydrogène dans ces pays. Une première opération a déjà été réalisée avec l’acquisition du projet HySynergy, un électrolyseur de 20 MW situé à Fredericia au Danemark. Prévu pour entrer en production au second trimestre 2023, ce site contribuera à réduire les émissions des procédés industriels de la raffinerie de Crossbridge Energy, adjacente à l’unité de production d’hydrogène vert, et offrira également de l’hydrogène vert pour la mobilité. La production d’électricité provenait au Danemark en 2021 déjà à 72 % des énergies renouvelables et de récupération, éolien avant tout (55 % en 2022), mais aussi de la biomasse, du solaire et de la valorisation des déchets. L’usine automobile Stellantis (ex-PSA) de Rennes-La Janais, annonce la signature d’un contrat de chaleur renouvelable avec Engie Solutions. Avec le soutien de l’Ademe pour 3,5 millions d’euros, Engie Solutions va investir dans la construction d’une chaufferie biomasse de 8 MW sur la zone d’activité de La Janais située sur la commune de Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes. Un réseau de trois kilomètres va être construit pour alimenter en chaleur le site, ce qui permettra d’effacer 45 % de la part de gaz dédié au chauffage de l’usine. D’autres bâtiments situés au sein de la zone d’activité pourront aussi bénéficier de cette chaleur renouvelable. Avec plus de 2 000 salariés, Stellantis Rennes est un acteur économique important du bassin rennais. En activité depuis 1961, le site assure chaque année la production des Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross thermiques et hybrides. Le groupe Coriance annonce la signature d’un contrat de délégation de service public avec la ville de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) pour la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur. La chaleur sera produite localement grâce à de la géothermie (62 %) et à la valorisation de la chaleur fatale issue de la station d’épuration de Bonneuil-en-France (35 %). Du biogaz sera utilisé en appoint (3 %). Les travaux de création du réseau de distribution de la chaleur débuteront en 2023 et fin 2024, les équipements permettant la récupération de chaleur sur les eaux usées de la station d’épuration seront mis en service. Au cours de l’année 2025, la centrale géothermale sera mise en service. Elle comprendra un doublet de géothermie associé à des pompes à chaleur et deux chaudières fonctionnant au biogaz, utilisées en appoint et secours. L’équivalent de 9 300 logements bénéficiera d’une chaleur produite à 100 % par des énergies renouvelables et le réseau rayonnera sur la majorité des quartiers. Des logements de résidences collectives, des bâtiments publics et certaines maisons individuelles seront raccordés. Annoncé lors de sa visite officielle en Polynésie française en juillet 2021 par Emmanuel Macron, le fonds de transition énergétique alloué à la Polynésie française et doté de 60 millions d’euros a été acté le 27 février dernier. Ce fonds vise à renforcer la souveraineté énergétique de la Polynésie française en favorisant le développement de production d’énergies renouvelables sur la totalité du territoire polynésien qui est majoritairement dépendant des énergies fossiles. Il s’adresse aux collectivités territoriales compétentes en la matière (Pays, communes, communautés de communes) et aux entreprises. Plusieurs types de projets pourront être soutenus : installation de production électrique 100 % énergies renouvelables, couvrant de nouveaux besoins ou intervenant en substitution d’installations de production ayant recours aux énergies fossiles ; installation de production hybride permettant de couvrir de nouveaux besoins ou en substitution partielle d’installations fossiles ; installation de production d’énergie renouvelable thermique et investissement d’infrastructures centralisées de réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et infrastructure de stockage pour fluidifier l’injection d’énergies renouvelables variables dans le réseau électrique. Après l’édition papier, le Guide des formations aux énergies renouvelables édité par l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) est désormais également disponible en ligne et interrogeable grâce à un moteur de recherche. Cette nouvelle base de données permet de choisir la formation souhaitée selon plusieurs critères : région, type de formation, filière, niveau… Ce guide se révélera utile aux étudiants devant renseigner leurs vœux dans Parcoursup : il présente 200 formations ayant trait aux énergies renouvelables et à l’écoconstruction, allant de BAC+2 à Bac+5. Les professionnels en recherche de qualifications supplémentaires pourront consulter les formations continues de longue durée ou de courte durée ou les formations dispensées par des industriels et des bureaux d’études. Le guide en version papier est par ailleurs toujours disponible ICI. Celcius Energy, filiale de SLB Nouvelles Énergies spécialisée dans la géothermie de surface, annonce avoir remporté l’appel d’offre de la ZAC Ferney Genève Innovation au côté de Augsburger Géothermie SA, d’Auvergne Forage, de Plantier, de Ménard et de Nabaffa. Il s’agit de la concession d’un projet urbain de la société publique locale (SPL) Terrinnov (détenue à 100 % par les collectivités locales de l’Ain) pour développer une zone d’aménagement de 65 hectares près de l’aéroport international de Genève. Celcius Energy et ses partenaires vont y construire un réseau géothermique de 5 km alimenté par 40 000 mètres linéaires de champs de sondes qui seront installées jusqu’à 230 mètres de profondeur. Ce projet serait ainsi « le plus important projet en termes de mètres linéaires en France », selon Celsius Energy. Une centrale de production et plusieurs sous-stations seront installées pour assurer la distribution de 20 GWh de chaud et 6 GWh de froid à la future ZAC. Le réseau reliera également l’accélérateur de particules du CERN, ce qui permettra de récupérer la chaleur fatale produite par l’installation de recherche et de la stocker dans le sous-sol grâce aux sondes géothermiques. Le chantier doit démarrer en juin prochain. À partir du 1er juillet 2023, tous les producteurs de biométhanes devront certifier leur site notamment afin d’assurer le respect des critères de durabilité. Cette nouvelle règle découle de la mise en application de la nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables dite RED II. Afin d’accompagner les agriculteurs dans les méandres de cette nouvelle démarche, l’association France Gaz Renouvelables a développé une plate-forme qui permet aux producteurs de biométhane de préparer la procédure et plus particulièrement l’audit préalable à la certification. Celle-ci implique un suivi strict des matières intégrées aux méthaniseurs, une analyse des process employés, et pour certains un calcul de la réduction des gaz à effet de serre induit par la production du biométhane ou d’électricité. Cette démarche concerne plus de 150 sites qu’ils soient en injection ou en cogénération. La plateforme permet aux producteurs de biogaz de préparer le travail d’audit, en réunissant tous les documents nécessaires et en anticipant les questions probables des futurs auditeurs. L’outil est gratuit et disponible sur le site methaniseur-red2. Énergie Partagée publie de nouveaux outils et recommandations pour aider le développement de projets citoyens et territoriaux de chaleur renouvelable dans trois filières : le bois-énergie, le solaire thermique et la méthanisation. Via trois publications, Énergie Partagée propose une série de recommandations et des retours d’expériences visant à accélérer la réplication de projets pilotes et à expérimenter des modèles citoyens pour des réseaux de chaleur de grande taille. Pour Arno Foulon, animateur national pour Énergie Partagée : « les collectivités et les citoyens ont besoin d’être accompagnés et outillés pour mettre sur pied des opérateurs énergétiques territoriaux qui produisent et distribuent localement de la chaleur à partir de ressources de proximité, formant de véritables circuits courts de l’énergie, du producteur au consommateur. » Une partie de ces publications a fait l’objet d’un financement européen dans le cadre du projet LIFE Let’sGO4Climate porté par la Région Centre-Val de Loire. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz GRTgaz a livré le 10 février son bilan sur la consommation nationale de gaz pour 2022. Cette dernière a baissé de 9,3 % par rapport à l’année précédente, grâce au climat doux, à la montée des prix et aux efforts de sobriété. Le biométhane a pour sa part confirmé la dynamique engagée avec 149 nouvelles unités de méthanisation raccordées au réseau. L’an dernier, 7 TWh de gaz renouvelable ont été produits, soit l’équivalent de 1,6 % de la consommation française de gaz. Une part faible mais qui a rapidement augmenté ces dernières années. La filière biométhane est ainsi en avance sur l’objectif de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui vise 6 TWh injectés fin 2023. Les projets en cours de développement représentent 16 TWh supplémentaires, ce qui ferait passer à court terme la part de biométhane dans le mix à environ 5 %. Toutefois, la filière pourrait connaître un trou d’air dans les années à venir. En effet, suite à la baisse des tarifs d’achat du biométhane de 2020, le nombre de nouveaux projets s’est effondré, passant de 344 en 2019 à 75 en 2021 et 77 en 2022. Selon GRTgaz, de nouveaux dispositifs de soutien devraient corriger le tir. Les acteurs français de la filière bois-énergie lancent une pétition intitulée « Préservons la gestion durable des forêts françaises en soutenant le bois-énergie » en faveur d’une politique européenne qui reconnaisse la réalité du rôle de la biomasse dans la décarbonation de l’économie. Dans le cadre de révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables, des propositions remettent en question le caractère renouvelable du bois énergie issu des forêts à travers un plafonnement du bois prélevé en forêt (biomasse ligneuse dite « primaire »). Les professionnels de la filière assurent au contraire défendre et promouvoir une gestion durable des forêts, préservant son rôle d’atténuation du changement climatique, tout en fournissant un matériau et une énergie renouvelables. Ils s’inquiètent des effets de la révision de la directive européenne. Selon eux, la production de bois-énergie intervient en bout de chaîne, valorisant les parties de l’arbre qui n’ont pas d’autres débouchés. Comme chaque année, le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques Uniclima a livré les chiffres de ventes 2022 des appareils de chauffage. Du côté des chaudières gaz et fioul, les résultats ont été mauvais puisque les ventes ont reculé de 29 % (508 000 unités), soit environ 200 000 chaudières en moins par rapport à 2021. La politique de remplacement de ces équipements par des appareils moins émetteurs de CO2 fait sentir ses effets. En revanche, pour les technologies renouvelables, l’année 2022 a été plutôt bonne malgré la crise économique. Avec 42 000 unités vendues, principalement en rénovation, les chaudières biomasse enregistrent une nouvelle progression (+ 24 %). Une dynamique qui aurait pu être plus forte si le marché n’avait pas été freiné au deuxième semestre par la hausse du prix des granulés. Le challenge en 2023 pour la filière va être de rassurer les consommateurs sur le prix et la disponibilité des granulés pour éviter les tensions de l’an passé. Le solaire thermique confirme ses bons résultats de 2021 en affichant cette fois 11 300 chauffe-eaux solaires individuels (CESI) en 2022 (+ 55 % en un an) et un triplement du marché des systèmes combinés (chauffage + eau chaude sanitaire) avec 1 500 unités vendues. Sur ce segment, les aides gouvernementales en rénovation ont bien joué leur rôle d’aide à l’investissement. Dans le domaine des pompes à chaleur (PAC), ce sont les équipements air/eau qui ont connu la plus forte augmentation avec des ventes en hausse de 30 % (346 313 unités vendues). Ici aussi les aides gouvernementales ont joué un rôle important, notamment en ouvrant ce marché aux ménages les plus modestes. A contrario, les PAC air/air ont vu leur activité reculer de 8 % mais elles restent l’équipement de chauffage individuel le plus diffusé avec 772 324 ventes. Enfin, aucun changement sur le segment des PAC géothermiques qui enregistre des ventes stables et toujours à un niveau confidentiel (2 915 appareils vendus). Le 2 février, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a présenté le plan d’action du Gouvernement pour accélérer le déploiement de la géothermie en France. Suite au rapport rédigé par le Haut-commissariat au Plan sur le sujet, ce plan d’action comporte six grands axes pour structurer la filière et renforcer l’offre de forages géothermiques ; pour développer l’offre de formation ; pour accompagner porteurs de projets et usagers ; pour sensibiliser les acteurs locaux aux avantages de la géothermie ; pour simplifier la réglementation et enfin pour améliorer notre connaissance du sous-sol. Ce plan a aussi pour ambition d’augmenter de 40 % le nombre de projets de géothermie profonde lancés d’ici 2030 et de doubler le nombre d’installations de pompes à chaleur géothermiques chez les particuliers d’ici à 2025. Pour inciter les Français à recourir à la géothermie, l’aide pour toute installation d’une pompe à chaleur géothermique en remplacement d’une vieille chaudière thermique sera portée à 5 000 euros dès mars 2023 quel que soit le niveau de revenu (contre 4 000 euros jusqu’alors pour les ménages les plus modestes et 2 500 euros pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs). « En cumulant ce « coup de pouce » aux autres dispositifs de soutien, jusqu’à 90 % du coût total de l’installation pourra être pris en charge par l’État pour les ménages les plus modestes », assure le ministère. La Ville de Dole et Engie Solutions ont annoncé le 27 janvier dernier la pose de la première pierre de la future chaufferie biomasse qui sera située avenue de Verdun, dans le quartier des Mesnils Pasteur à Dole, dans le Jura. Cette nouvelle unité sera reliée à la chaufferie actuelle qui continuera de fonctionner et accueillera également un dispositif de stockage thermique pour constituer et redistribuer de façon optimale la chaleur à un réseau urbain desservant l’équivalent de 10 000 habitants. Le bois valorisé sera issu d’un rayon de 100 kilomètres autour de Dole et la part d’énergie renouvelable du mix énergétique de la ville passera de 52 à plus de 90 %. L’unité de méthanisation Artois Uniterr, située sur la commune de Grincourt-lès-Pas dans le Pas-de-Calais et actuellement en cours de construction, est un projet porté par la volonté commune de 53 associés, dont 31 exploitants agricoles et deux collectivités territoriales. Dans le cadre de ce programme, une campagne de financement participatif a été mise en place via la plateforme Lendosphère. L’objectif de 550 000 € a été atteint en dix jours grâce à 118 prêteurs locaux qui ont investi entre 50 € et 20 000 € (montant maximum autorisé pour cette campagne). Les sommes investies par les habitants de la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois représentent 86 % du montant global levé, témoignant de la forte adhésion locale pour ce projet. La construction de l’unité a débuté en septembre 2022 pour une mise en service prévue à l’automne 2023. Le site pourra recevoir jusqu’à 98,4 tonnes de matières entrantes par jour (lisiers, fumiers, produits végétaux, déchets organiques). La production de gaz vert sera équivalente à la consommation de 1 850 à 2600 foyers. Le 12 janvier dernier, une unité de purification de biogaz a été mise en service sur le site de la station d’épuration de Grand Chambéry. Cette nouvelle entité permet de produire du biométhane à partir du gaz généré par le traitement des eaux usées avec une production annuelle estimée à 9 GWh. Ce biométhane sera en majorité vendu à GRDF et injecté dans le réseau de distribution de gaz de ville. Une partie du biométhane produit sera aussi distribuée à la station BioGNV de Bissy (quartier de Chambéry), ouverte à tous, véhicules légers et poids lourds. Ce système vient remplacer un dispositif de cogénération qui produisait de l’électricité. Mardi 24 janvier, l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) a dévoilé l’édition 2022 du « Baromètre des énergies renouvelables électriques en France », ouvrage réalisé avec le soutien de l’Ademe et de la FNCCR. L’étude retrace l’actualité de huit filières (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biomasse solide, biogaz, déchets renouvelables, géothermie et énergies marines) au cours des 12 mois passés et dresse le bilan du pays, et de ses régions, notamment au regard des objectifs affichés. Malgré une année 2022 qui aura vu le raccordement de plus de 4 gigawatts (GW) de puissance renouvelable supplémentaire, il est aujourd’hui quasiment acté que la France n’atteindra pas ses objectifs pour les deux filières phares que sont l’éolien et le photovoltaïque. Depuis 2018, leur rythme de croissance a pratiquement toujours été en deçà des trajectoires visées. Même si le photovoltaïque a bouclé l’année avec plus de 2 GW de puissance supplémentaire raccordée, ce sursaut est arrivé trop tardivement. En 2021, la part des énergies renouvelables était de 25 % de la consommation électrique du pays, quand l’objectif était de 27 % à fin 2020. Plusieurs professionnels interviewés dans le cadre du baromètre ont affiché leur scepticisme sur la capacité de la nouvelle loi sur l’accélération des renouvelables à inverser la tendance. Pour beaucoup, les complexités administratives et le sous-effectif des services instructeurs de l’État demeurent les principaux freins au développement des secteurs renouvelables. À cela s’ajoute une volonté changeante du gouvernement qui inquiète les acteurs, notamment ceux de l’éolien terrestre après les annonces faites en début d’année 2022 par le chef de l’État, consistant à étaler jusqu’à 2050 l’objectif fixé pour 2028 de puissance raccordée. Toutefois, les objectifs pour les différentes filières seront en dernier ressort établis par la représentation nationale, lors de l’élaboration de la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie. Ingredia, filiale laitière du groupe coopératif Prospérité Fermière, et Engie Solutions ont conclu un partenariat en 2021 pour la construction et l’exploitation sur 15 ans d’une nouvelle chaufferie biomasse sur le site historique d’Ingredia à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), qui produit des ingrédients laitiers (poudres de lait, protéines et additifs). Le 13 janvier dernier, la première pierre de la chaufferie d’un coût de 12,7 millions d’euros a été posée en présence des représentants d’Ingredia et d’Engie Solutions. Le site bénéficie de 43 % de subvention de l’Ademe dans le cadre du Plan France Relance. Prévue pour entrer en service fin 2023, la chaufferie d’une puissance de 17 MW produira de la chaleur à 85 % issue de biomasse renouvelable. Les trois quarts des 44 000 tonnes de biomasse nécessaires seront récoltées dans un rayon de 100 kilomètres autour du site. Le 12 janvier dernier, TotalEnergies a mis en service son unité de méthanisation baptisée BioBéarn, qui serait selon le groupe la plus grande à ce jour en service en France. Situé à Mourenx dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le site a une capacité de production de 160 GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 32 000 habitants. BioBéarn valorisera 220 000 tonnes de déchets organiques par an, provenant essentiellement d’activités agricoles et de l’industrie agro-alimentaire du territoire. Près de 200 000 tonnes par an de digestat, fertilisant naturel et hygiénisé, seront valorisées en épandage agricole sur des parcelles cultivées dans un rayon de 50 kilomètres autour de l’unité. Cette utilisation permettra une réduction de près de 5 000 tonnes d’engrais chimique. Les premiers mètres cubes de biométhane commencent à être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel géré par Téréga. Nos confrères des Échos ont publié jeudi 19 janvier, une tribune collective initiée par Jean-Yves Grandidier, président de Valorem, et signée par 54 acteurs des énergies renouvelables en France. L’objet de ce texte est de rappeler que suite à la flambée des prix de l’énergie ce sont bien les énergies renouvelables qui financent le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui sera prolongé en 2023. « Alors que sur les marchés, les prix de l’électricité ont explosé en un an, les énergies renouvelables ont continué de vendre au même prix, dégageant plus de 38,7 milliards d’euros reversés au budget de l’État sur la période 2022-2023. C’est la contribution des non-émetteurs de gaz à effet de serre pour financer le bouclier tarifaire. Les producteurs amortissent donc la crise énergétique pour la facture des particuliers à hauteur de 75 %, tout en proposant une électricité propre et très compétitive », indique le texte. Mais les signataires vont plus loin en affirmant que « Les industries fossiles, elles, contribuent de manière infime au financement du bouclier tarifaire, les profits étant réalisés hors de France. Pire, les aides de l’Etat sur les carburants sont, in fine, des subventions de ces industries polluantes qui nous enfoncent davantage dans la crise économique, écologique et sociale. » Source : Les Échos. Du 6 au 17 mars, l’Ademe propose l’Ademe’Tour, un circuit de visite d’une trentaine d’installations renouvelables bénéficiant de différentes technologies de production de chaleur renouvelable en région Centre-Val de Loire. Établissements scolaires, gymnases, mairies, salles de spectacles, hébergements touristiques, bâtiments industriels seront ouverts à la visite pour les professionnels, collectivités et associations. La jeune entreprise quimpéroise Entech, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et des solutions de stockage, a reçu une commande d’Engie Laborelec pour un système de stockage par batterie destiné au Centre européen des énergies marines (Emec) de l’Île d’Eday, située dans l’archipel des Orcades au nord de l’Écosse. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Forward2030, financé par le fond public européen Horizon 2020 et porté par un consortium dirigé par Orbital Power. Ce dernier, concepteur de turbines hydroliennes, souhaite coupler ces batteries lithium-ion de 1,2 MW, pour 1,5 MWh de capacité de stockage, avec son hydrolienne de 2 MW Orbital O2 afin de démontrer la viabilité technique et économique de cette association en vue d’un déploiement à plus grande échelle. « L’installation du système de stockage d’Entech nous permettra d’utiliser le site Emec des Orcades comme un laboratoire d’essai en environnement réel, ce qui va nous amener à approfondir d’autres éléments du projet et répondre à l’avenir aux besoins des projets commerciaux offshore à grande échelle », explique Fiona Buckley, chef de projet d’Engie Laborelec. Brest Métropole annonce l’extension sur son réseau de chaleur urbaine pour 2023 qui s’ajoute au réseau actuel, long de 55 kilomètres et alimenté à 90 % par l’incinérateur de déchets de la ville de Brest. Deux extensions sont prévues, dont une en centre-ville dans le secteur Algésiras/Clemenceau pour desservir en eau chaude sanitaire et chauffage des établissements publics comme le centre des Finances publiques, le groupe scolaire Simone Veil, la maison des syndicats et la CAF. La deuxième extension concerne le secteur Valy Hir/Emille Rousse, quartier ouest de la ville. Le réseau alimentera notamment la future résidence pour seniors Émile Rousse, qui est en cours de construction. Ces travaux doivent être menés début 2023, et s’achever en juin. En parallèle, le chantier du futur réseau de chaleur du Technopôle a lui-aussi démarré le 9 janvier, pour une durée estimée à plus de six mois. À l’automne, les grandes écoles et autres instituts de recherche tels que l’Ifremer seront ainsi reliés à ce réseau indépendant, alimenté par une nouvelle chaufferie biomasse Le 22 décembre dernier, le Conseil des ministres a nommé Boris Ravignon, président-directeur général de l’Ademe. Il succède ainsi à Arnaud Leroy. Diplômé de l’ENA en 2002, il débute sa carrière en tant qu’inspecteur des finances. Il rejoint en 2008 le cabinet du Président de la République où il est en charge du développement durable, des transports et de l’aménagement du territoire et participe au Grenelle de l’Environnement. Il est élu, en 2014, maire de Charleville-Mézières et devient également président d’Ardenne Métropole. Il a été réélu en 2020. En juillet 2021, il est élu Vice-Président de la Région Grand Est, chargé de l’économie, de la commande publique et des fonds européens, mandat dont il démissionnera début 2023 suite à sa nomination en tant que Président de l’Ademe. Teréga, gestionnaire du transport de gaz sur l’ensemble du Sud-Ouest de la France et la société de projet de méthanisation AgriEnergie annoncent la mise en service d’un nouveau poste d’injection de biométhane sur la commune d’Auros en Gironde. AgriEnergie, société créée en 2019, est le fruit de la volonté commune de neuf agriculteurs girondins de s’allier afin de diversifier leurs activités au-delà de leurs exploitations agricoles. De l’étude de faisabilité jusqu’au raccordement du méthaniseur à son réseau de transport, Teréga a accompagné AgriEnergie pour la mise en œuvre de l’unité de méthanisation construite sur un ancien site de Teréga à Auros. Le méthaniseur, d’un débit d’injection de 100 Nm3/h, a été raccordé au réseau à la fin du mois d’octobre 2022. Initialement conçu pour accueillir des effluents d’élevage, des résidus de culture ou encore des CIVE (cultures intermédiaires à valorisation énergétique), il va aussi prochainement valoriser les biodéchets alimentaires des collectivités locales (hôpitaux, cantines scolaires, restauration collective) et des restaurants du territoire. Depuis le 10 décembre dernier, à l’occasion du lancement de la saison de ski, l’ensemble des dameuses de la station de Val d’Isère sont passées au carburant HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – huile végétale hydrotraitée). Élaboré à partir de déchets de graisses et d’huiles végétales usagées (sans huile de palme), ce substitut au diesel réduit les émissions de CO2 de 90 % et celles de particules fines de 65 %. Par ailleurs, après des essais concluants menés l’hiver dernier à Val d’Isère et à Tignes, deux navettes du réseau de transport en commun gratuit de la station sont désormais électriques. Les bus non-électriques ont quant à eux adopté dès cet hiver le biocarburant de synthèse HVO, à l’image des dameuses. D’ici à 2025, la station ambitionne de passer à l’électrique l’ensemble de sa flotte, soit une quinzaine de bus. Ørsted a annoncé le 20 décembre la décision finale d’investissement pour son projet FlagshipONE, sa première installation de production d’e-méthanol située à Örnsköldsvik au nord de la Suède. Elle fait suite au rachat de 55 % des parts à son partenaire Liquid Wind AB, initiateur du projet. Le transport maritime longue distance est en effet l’un des plus compliqué à décarboner en raison de la densité énergétique contrainte de ses carburants. Le méthanol synthétique produit à partir d’hydrogène vert – issue de l’électrolyse de l’eau grâce à l’électricité renouvelable – et de carbone est aujourd’hui l’une des principales alternatives aux carburants fossiles pour décarboner le transport maritime, estime l’énergéticien danois. L’unité de production FlagshipONE devrait fournir dès 2025 près de 50 000 tonnes d’e-méthanol par an à l’industrie du transport maritime, qui représente aujourd’hui environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Sa construction débutera au printemps 2023 près de la centrale électrique à cogénération Hörneborgsverket à Örnsköldsvik, et dont le CO2 émis sera utilisé pour produire cet e-méthanol. Après trois ans de travaux de rénovation de son réseau de chaleur, le Marché International de Rungis (MIN) arrête définitivement sa consommation de fioul lourd pour sa production de chaleur, qui est désormais assurée à 99 % par la valorisation des déchets du MIN. Ces travaux de modernisation ont permis l’augmentation des performances du réseaux : passage des installations sur un régime basse température et installation de 4 kilomètres de conduits hautement isolés, optimisation de 98 sous-stations de distribution grâce à des équipements connectés, construction de deux sous-stations d’échange haute pression/basse pression et remplacement de 6 kilomètres de réseaux existants. Le réseau de chaleur du MIN de Rungis fournit l’ensemble des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire du site. SNCF Immobilier et CVE, producteur d’énergies renouvelables, ont signé une convention d’occupation temporaire de 30 ans pour un projet de centrale solaire au sol sur une ancienne gare de triage située à Nouvion-sur-Meuse, dans les Ardennes. La centrale sera construite sur un terrain déjà artificialisé par l’activité ferroviaire sur une surface de 13 hectares et composée de 30 105 panneaux pour une puissance estimée de 17,5 MW. Le site produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 8 000 habitants (soit 3 800 foyers) avec une mise en service prévue en 2026. Les travaux prévoient le démantèlement de 23 kilomètres de rails, le retraitement des traverses créosotées et l’implantation de 500 mètres linéaires de haies. Pour la SNCF, cette signature fait passer à 53 le nombre d’hectares de friches industrielles du groupe transformés en centrales photovoltaïques. Le 19 décembre, l’association SolarPower Europe a publié son rapport annuel du marché du photovoltaïque, qui révèle une croissance des installations de 47 % par rapport à l’an passé. En effet, sur l’année 2022 ce sont 41,4 GW qui ont été installés, contre 28,1 GW en 2021. D’après l’association, cela représenterait un gain de production électrique annuelle équivalente au gaz transporté par 102 méthaniers. Ainsi le parc total européen en service passe de 167,5 GW à 208,9 GW en 2022 (+ 25 %) L’Agence Internationale de l’Énergie (IEA) préconise d’installer au moins 60 GW en 2023 pour compenser la diminution des importations de gaz russe. Pour ce faire, « Nous avons besoin de plus d’électriciens et d’une réglementation stable du marché de l’électricité. Une Europe solaire ne peut reposer que sur des processus administratifs plus fluides, des connexions au réseau plus rapides et des chaînes d’approvisionnement résilientes », explique Dries Ackes, directeur des politiques de SolarPower Europe. L’association projette 53,6 GW de capacité installée dans l’Union européenne en 2023, 74,1 GW en 2025 et 85,2 GW en 2026. Le nouveau réseau de chaleur de la ville de Fourmies, située dans le Nord, a été mis en service le 8 décembre dernier. Les 1 500 mètres de réseaux enterrés sont raccordés à une chaudière biomasse de 850 kW alimentée par des plaquettes bocagères provenant de moins de 30 kilomètres aux alentours du site. Ce nouveau réseau distribuera du chauffage à 90 % renouvelable pour neuf bâtiments du centre-ville : la mairie, l’inspection académique, l’écomusée, le théâtre, le gymnase Piette, le Tiers-lieux, la perception, la mairie des associations et l’espace Mandela. Une installation qui permettra d’éviter 311 tonnes de CO2 par an. La commune a réalisé ce projet dans le cadre du contrat d’objectifs « énergies renouvelables » signé avec l’Ademe, en vue de développer la chaleur zéro carbone sur le territoire. Le 20 octobre, la France, l’Espagne et le Portugal ont annoncé leur décision d’accélérer le développement des interconnexions énergétiques reliant la péninsule ibérique à l’Europe centrale. C’est dans ce cadre qu’a été annoncée le 13 décembre la signature d’un protocole d’accord pour le projet H2Med par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz GRTgaz, Teréga, Enagàs (Espagne) et REN (Portugal). Il s’agit d’une interconnexion hydrogène reliant Barcelone à Marseille, en passant par l’Occitanie, devant entrer en service d’ici 2030 et capable de transporter jusqu’à 2 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable par an, soit 10 % de la consommation européenne prévue par le plan REPowerEU à l’horizon 2030. Le 15 décembre les quatre gestionnaires devaient soumettre H2Med comme candidat au Projet d’Intérêt Commun (EPCI) soutenu par la Commission Européenne, dans le cadre du nouveau règlement sur les réseaux transeuropéens d’énergie. Fort du succès des neuf précédentes éditions, l’Observatoire des énergies renouvelables publie son guide 2022-2023 consacré aux formations énergies renouvelables et à l’écoconstruction. Cet ouvrage de référence répertorie une sélection de 200 formations et propose un décryptage complet de celles-ci, filière par filière, pour bien choisir son orientation. Classés par niveau d’études, les 4 grands chapitres passent au crible les formations disponibles dans les filières généralistes : bac +2, bac +3, bac +5… Suivent les formations continues longue durée, puis continues de courte durée. Le dernier chapitre est consacré aux formations dispensées par les industriels ou des bureaux d’études. Chacune des formations du guide est présentée sous la forme d’une fiche détaillée : descriptif, coordonnées, public visé, dates, tarifs et métiers ciblés. Pour compléter le tout, des témoignages donnent un éclairage vivant aux différents cursus. Un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent se former aux énergies renouvelables ou donner une nouvelle impulsion à leur carrière. GéoMeudon est une Société par Action Simplifiée Loi Transition Energétique née officiellement le 28 octobre 2022. Détenue à 90 % par Engie Solutions et 10 % par Meudon-la-Forêt, elle a pour but de construire et exploiter pendant 28 ans une centrale géothermique destinée à alimenter le réseau de chaleur de la ville. D’une étendue de 8 km, celui-ci dessert 7 600 équivalent-logements auxquels il livre actuellement du gaz naturel via 80 points de livraison. Grâce à l’utilisation de la géothermie associée à une pompe à chaleur, le réseau ne devrait pas consommer plus que 17 % de gaz. 17 700 tonnes de CO2 devraient ainsi être évitées chaque année, soit l’équivalent de 9 800 véhicules thermiques en circulation. Concrètement, la centrale captera et réinjectera l’eau géothermale à environ 1 600 mètres de profondeur où la température atteint a priori 64 degrés. Les puits seront composés de deux drains, de façon à traverser deux fois la couche géologique et maximiser ainsi la récupération de chaleur. La puissance calorifique devrait ainsi atteindre 15,9 MW. La centrale sera construite en lieu et place de la chaufferie gaz actuelle qui sera détruite, accompagnée d’une nouvelle chaufferie gaz d’appoint. En parallèle, afin de délivrer de manière optimale la ressource géothermale, des travaux seront menés pour faire passer 2 km de réseau en basse température et changer les 80 points de livraison. Les premières phases de travaux devraient démarrer en 2023 pour une mise en service de la chaufferie gaz en 2024 et de la géothermie en 2026. Le montant total des investissements s’élève à 36,8 millions d’euros. Le spécialiste français du photovoltaïque et du stockage, Corsica Sole, a inauguré le 1er décembre dernier une centrale de stockage à Deux-Acren en Belgique. La centrale, rattachée au réseau de transport électrique européen est composée de batteries lithium-ion et peut stocker une quantité d’énergie de 100 MWh avec un niveau de puissance allant jusqu’à 50 MW. Raccordé au réseau public d’électricité, le site assure la stabilité de distribution de l’énergie avec plusieurs objectifs : réguler la fréquence du réseau, assurer un back-up lorsque les panneaux ne produisent pas, stocker l’énergie aux heures creuses de basse consommation pour la réinjecter aux heures de forte consommation. Ce projet a été réalisé sans subventions publiques avec pour partenaires, Tesla, Yuso et InnoVent. Thyssenkrupp rothe erde a équipé son usine de fabrication de couronnes d’orientation et de roulements en acier de Lippstadt, située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d’une unité pilote de pyrolyse de la biomasse. L’usine va ainsi consommer 2 500 tonnes par an de déchets de bois pour produire 5 300 MWh de chaleur, de quoi couvrir 80 % des besoins de chaleur du site. Cela correspond aux besoins annuels de 300 foyers. Le bois sera carbonisé à 700°C par pyrolyse, ce qui permettra de produire également environ 640 tonnes par an de biochar, un sous-produit riche en carbone pouvant notamment servir à amender les terres agricoles. De cette façon, le procédé sera en mesure de séquestrer 1 500 tonnes de CO2 par an. « Une tonne de biochar emprisonne environ 2,5 à 2,8 tonnes de CO2, selon sa teneur en carbone et son utilisation ultérieure. Le biochar est produit dans le cadre d’un processus sans combustion. Lorsqu’il est utilisé comme matériau de remplissage dans les matériaux de construction, le CO2 est stocké dans un puits de carbone permanent pendant des milliers d’années », explique Caspar von Ziegner, président directeur général de Novocarbo, start-up allemande spécialisée dans l’élimination directe du carbone (Carbon Dioxide Removal ou CDR) et négociant les certificats de carbone sur le marché européen. L’organisme de qualification Qualit’EnR aurait reçu plus de 500 réclamations entre janvier et mi-novembre 2022 portant principalement sur des entreprises se réclamant QualiPAC et Qualibois, et propose donc 10 conseils pratiques pour lutter contre les éco-délinquants. D’après l’organisme, les victimes d’arnaque sont généralement des personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées ou isolées), bénéficiant d’aides financières, ou propriétaires de maisons individuelles anciennes. Il est donc conseillé de vérifier, sur le site de France Rénov’ ou auprès de l’organisme de qualification dont elle se réclame, que l’entreprise effectuant les travaux est bien qualifiée RGE. Il est également recommandé de s’assurer que le document remis au client potentiel pour signature lors de la visite correspond à un devis et non à un bon de commande. Il est rappelé qu’il est nécessaure de comparer plusieurs propositions concurrentes avant de passer commande. Les travaux proposés, même pour une PAC, ne durent généralement pas moins de 1 à 3 jours, suivant les modèles. Enfin pendant le chantier, exiger de l’installateur la remise d’une étude thermique, une facture détaillée avec les différents équipements et la main-d’œuvre, et une proposition de contrat de maintenance. D’après Qualit’EnR il est possible d’identifier les entreprises éco-délinquantes car elles présentent certaines caractéristiques récurrentes : leurs discours se concentrent rapidement sur le chiffrage et la rentabilité, et elles proposent des crédits de façon quasi-systématique. Elles ne font pas d’évaluation technique de l’installation en place ou du bâti, se déplacent souvent avec une imprimante et invitent à signer directement sans possibilité de rétractation prétextant une « promotion à saisir ». Pour rappel, si vous êtes victime d’arnaques vous pouvez contacter Qualit’EnR avec le formulaire suivant https://www.qualit- Le 21 novembre, Charnwood Energy a annoncé la mise en service d’un réseau de chaleur urbain alimenté au bois énergie près de Toulouse. Cette entreprise est spécialisée dans les procédés énergétiques utilisant la biomasse, directement ou par gazéification. Ce réseau a été développé pour le compte de son client Engie Solution, qui exploitera les deux chaudières biomasses d’une puissance totale de 4,7 MW (et deux chaudières gaz de secours) ainsi que les trois kilomètres du réseau de chaleur, comprenant 24 sous stations, et qui desservira à terme 1 200 logements, et 23 300 m2 de surface commerciale et de bâtiments publics de la ZAC Guillaumet à Toulouse. Le groupe australien, Vulcan Energy, annonce le démarrage en France de son activité de production d’énergies renouvelables et de lithium décarboné. L’entreprise entend engager en Alsace des projets de géothermie profonde exploitant les ressources géothermales de la vallée du Rhin. Les saumures géothermales présentant une forte concentration en lithium (214 mg/l), elles permettent à la fois de produire de la chaleur renouvelable et du lithium destiné à l’industrie des batteries. Vulcan Energy a déposé dans le nord de l’Alsace une première demande d’octroi de permis exclusif de recherches (PER) de mines de lithium et autres substances connexes, intitulé « Les Cigognes ». Le groupe déposera prochainement d’autres demandes de permis exclusifs de recherche. Vulcan est en discussion avec des entreprises implantées dans la région pour développer en Alsace des projets combinés de géothermie et de lithium, permettant de soutenir les industriels et les municipalités dans leur approvisionnement en énergies renouvelables et la consommation le cas échéant d’un lithium décarboné. En Allemagne, l’entreprise a déjà obtenu le permis d’exploiter une dizaine de sites. Les 20 et 21 octobre dernier, le Conseil européen a appelé à accélérer les procédures d’octroi de permis pour le développement des énergies renouvelables, prévues par le plan REPowerEU. C’est pourquoi la Commission européenne a proposé le 9 novembre de mettre en œuvre un nouveau règlement temporaire d’urgence intitulé « Proposal for a Council Regulation laying down a framework to accelerate the deployment for renewable energy ». La récente détérioration de la situation des marchés et la volonté européenne de s’émanciper de l’énergie fossile russe ont conduit à proposer des mesures d’urgence supplémentaires, après celles déjà mises en place par REPowerEU. Concrètement, si ces mesures étaient adoptées, elles permettraient aux procédures d’octroi de permis pour les installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier d’une évaluation simplifiée pour les dérogations spécifiques en matière d’environnement, et clarifierait certaines règles relatives aux oiseaux et habitats naturels. La Commission propose également un délai maximal d’un mois pour les autorisations concernant le solaire, leur unité de stockage et leur raccordement au réseau, ainsi que l’exemption de certaines évaluations environnementales. Les projets de repowering seraient quant à eux simplifiés et accélérés en limitant les évaluations environnementales aux seuls effets potentiels résultant de la transformation des sites. Afin de soutenir le développement de contrats de long terme d’approvisionnement en électricité (power purchase agreement ou PPA), le gouvernement a présenté un nouveau fonds de garantie destiné aux industriels. Il vise à couvrir le risque de défaut des acheteurs et permettrait de sécuriser une partie du coût d’approvisionnement en électricité renouvelable. Le dispositif sera opéré par Bpifrance, la banque publique d’investissement dont la mission est de financer le développement des entreprises, et pourrait concerner des PPA à partir de 2023. La somme constituant le fonds n’est pas encore précisée, mais ce dernier sera dimensionné pour couvrir la consommation équivalente à une ville comme Bordeaux. Il devrait être en partie alimenté par les revenus excédentaires des contrats de complément de rémunération en période de prix de marché supérieur aux tarifs d’achat public. En complément de son travail sur les applications individuelles solaires thermiques, Observ’ER vient de mettre en ligne un second volet consacré aux installations collectives en France. Cette étude associe un suivi quantitatif des ventes du segment à un volet qualitatif, qui commente plus en détail l’actualité des 18 derniers mois. Si, globalement, l’orientation du marché français a été en nette progression en 2021, la bonne activité (33 120 m2, départements et régions d’Outre-mer compris) a surtout été le fait d’opérations de grande taille. En effet, trois réseaux de chaleur (Narbonne, Pons et Cadaujac) ont permis l’ajout d’un total de près de 5 700 m2 de capteurs solaires thermiques. Dans le secteur industriel, les résultats ont été encore plus impressionnants avec notamment la mise en service de la centrale solaire du site de la malterie franco-suisse à Issoudun (15 580 m2). Ces projets sont le plus souvent issus du dispositif d’appels à projets animé par l’Ademe, qui vise spécifiquement ce type de réalisations, et dont les lauréats bénéficient de subventions à l’investissement provenant du Fonds chaleur. Après plusieurs années de gestation, plus d’une quinzaine d’installations solaires thermiques de grande surface sur sites industriels ou réseaux de chaleur sont ainsi dernièrement entrées en service en France. La crise économique a jeté une lumière nouvelle sur les technologies solaires thermiques et plusieurs très grosses réalisations ont été mises en place, venant valider techniquement les solutions. Ce segment est désormais l’un des principaux relais de croissance identifiés par les professionnels de la filière. L’étude est en téléchargement libre sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables. Le dernier baromètre EurObserv’ER publié en octobre traite des énergies marines renouvelables dans l’Union européenne. Les énergies marémotrice, houlomotrice, hydrolienne, ou encore thermique des mers, bien que très peu développées à l’échelle industrielle, comptent de nombreux prototypes. Ces sources peuvent présenter plusieurs avantages pour le réseau électrique : leurs productions sont relativement stables dans l’année et sont aisément prédictibles. Surtout, leur potentiel est énorme. En 2021, l’Union européenne comptait 21 sites en activité, soit 249,2 MW installés. Leur production s’est élevée à 502,8 GWh, en grande majorité issue de l’usine marémotrice de La Rance en France qui reste aujourd’hui encore, et de loin, la principale installation d’énergie marine en Europe (240 MW). D’ici 2030, l’Europe souhaite atteindre 1 GW d’installations et 40 GW en 2050. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Commission soutient financièrement la quasi-totalité des projets pilotes à travers différents programmes, tels que Forward-2030 qui vise à accélérer le déploiement des projets marémoteurs. Pour Ocean Energy Europe, l’association regroupant les professionnels de la filière, ce sont près de 100 GW qui pourraient être installés en Europe à l’horizon 2050. Observ’ER vient de mettre en ligne deux études de suivi du marché des applications individuelles solaires thermiques en France. Une première analyse se penche sur les chiffres du marché 2021 et les résultats sont bons. Après plus d’une décennie de bilans décevants, le segment des applications individuelles a connu une croissance particulièrement importante l’an passé. Les ventes de chauffe-eau solaires individuels (CESI) et de systèmes solaires combinés (SSC) ont progressé de plus de 50 % en métropole pour s’établir à 34 550 m2, contre 22 530 en 2020. Dans les territoires d’outre-mer, l’activité enregistre certes un recul en 2021 (89 050 m2 contre 101 285 m2 en 2020) mais reste à un niveau largement supérieur à celui de la métropole. Portés par des subventions finançant une large part des équipements, les chauffe-eau solaires individuels équipent désormais une bonne partie des particuliers des départements et régions d’outre-mer (DROM). La seconde étude est qualitative. Elle se base sur une dizaine d’entretiens avec des professionnels du secteur. Pour les acteurs du marché, la crise énergétique, l’augmentation des prix de l’électricité ou du gaz et la volonté d’autonomie toujours plus affirmée de la part des consommateurs sont les moteurs de ce rebond. Leurs perspectives à moyen terme sont bonnes puisque l’activité au cours du premier semestre 2022 continue de progresser. Les entreprises saluent également le rôle de MaPrimeRénov’, qui a permis d’élargir le nombre de consommateurs concernés, car le dispositif propose des aides financières bonifiées pour les revenus les plus modestes. En revanche, les professionnels estiment que la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE2020, ne valorise pas correctement les solutions solaires, prolongeant ainsi un biais déjà dénoncé dans la précédente réglementation (RT2012). Les deux études sont librement disponibles en téléchargement sur le site d’Observ’ER. Dans sa mission d’observation des dynamiques des énergies renouvelables en Europe, EurObserv’ER propose une première estimation de la part de ces filières dans la consommation brute d’énergie finale pour chacun des États membres de l’Union européenne à fin 2021. Alors que l’UE à 27 avait affiché un ratio global de 22,09 % fin 2020, réalisant ainsi son objectif de 20 %, l’ensemble de l’Union aurait peu progressé en 2021. Les premières estimations avancent une part de 22,45 %, soit 0,36 point de mieux en un an. L’ensemble des filières renouvelables a fourni 15,2 Mtep d’énergie en plus l’an passé, passant de 209,6 à 224,8 Mtep, soit une croissance de 7,3 %. Toutefois, la consommation totale brute d’énergie finale (renouvelable et non renouvelable) de l’Union européenne aurait nettement augmenté, passant de 948,9 à 1 001,6 Mtep (+5,6 %). Ce phénomène s’explique essentiellement par l’effet de rattrapage de l’activité économique après une année 2020 marquée par un exceptionnel ralentissement mondial. La photo détaillée par pays permet de se rendre compte que des États membres auraient reculé en 2021, passant même pour certains en deçà de leur objectif fixé à fin 2020. C’est le cas du Luxembourg (passant de 11,7 % à 10,01 % pour un objectif 2020 à 11 %), de la Belgique (passant de 13 % à 11,4 % pour un objectif 2020 à 13 %) mais surtout de l’Irlande (passant de 16,16 % à 12,87 % pour un objectif 2020 à 16 %). Ces pays avaient utilisé en 2020 un mécanisme de flexibilité prévu par la directive énergies renouvelables permettant d’afficher dans leur bilan des Mtep produits dans un autre pays de l’Union avec lequel ils auraient passé un accord. Les données sur les transferts réalisés en 2021 n’étant pas encore publiques, EurObserv’ER ne les a pas intégrées dans sa simulation. La publication des premiers résultats officiels, probablement fin décembre, sera l’occasion de voir si ces pays ont reconduit ces transferts statistiques. Et la France dans tout cela ? Elle gagne à peine 0,2 point avec 19,3 % de part des énergies renouvelables dans son bilan total. Le pays, qui n’avait pas eu recours à des transferts l’an passé, n’a donc toujours pas atteint le seuil de 23 % fixé pour 2020 et affiche désormais une différence de 13,7 points à combler d’ici à 2030 pour atteindre le prochain objectif de 33 %. Le défi est gigantesque. D’une part, il implique une croissance deux fois plus importante des énergies renouvelables que celle constatée au cours de la dernière décennie. D’autre part, l’objectif national devrait, en toute logique, encore être rehaussé si l’Union européenne valide son programme RepowerEU qui vise une part de 45 % d’énergies renouvelables en 2030, contre 40 % pour l’instant. Après la biomasse, la géothermie. Le Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (Smirec) prévoit d’exploiter la nappe du Dogger qui se cache sous le Bassin parisien pour alimenter le réseau de chaleur de Saint-Denis, l’Île-Saint-Denis, Stains et Pierrefitte, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en complément des chaufferies bois existantes. Si celles-ci permettent d’atteindre actuellement un taux d’énergie renouvelable de 55 %, le délégataire prévoit en effet d’étendre le réseau de 9 km vers le centre-ville d’Aubervilliers et les nouveaux quartiers de Port chemin vert et du Fort, et souhaite garder un taux d’alimentation par les énergies renouvelables supérieur à 50 %. Deux forages seront creusés à l’est de la commune de Saint-Denis, à un peu plus de 1 600 mètres de profondeur. Le premier extraira de l’eau du Dogger à environ 57 °C, qui sera réinjectée après utilisation via le second forage. Des pompes à chaleur (18 MW) récupéreront de la chaleur sur l’eau des retours du réseau pour la transférer à l’eau de départ. L’eau sera ainsi réinjectée non pas à 45 °C mais à 33 °C en moyenne sur l’année. L’ensemble de l’installation devrait ainsi permettre de produire 50 GWh/an, pour des besoins estimés à Aubervilliers à 52,7 GWh/an en 2025, l’appoint se faisant au gaz. L’investissement total représente 31 millions d’euros dont 9,5 millions apportés par l’Ademe et la région Île-de-France. L’enquête publique est actuellement en cours, les travaux devant débuter en février 2023 pour une mise en service à l’été 2024. La Ville de Soissons (Hauts-de-France) a confié à Idex la délégation de service public de son réseau de chaleur pour une période de 20 ans. Le nouveau délégataire aura pour mission de poursuivre la mue du réseau vers 85 % d’énergies renouvelables (contre 46 % actuellement) et ainsi de permettre à l’équivalent des 2 550 logements raccordés de profiter d’une énergie vertueuse. Une nouvelle chaufferie biomasse sera réalisée et la consommation d’électricité totale du réseau sera alimentée à 100 % par des sources renouvelables. Par ailleurs, le réseau sera modernisé et étendu, passant de 9,9 km à 26 km. Soixante sous-stations supplémentaires seront créées afin de concrétiser ce projet qui s’adresse aussi bien aux logements individuels qu’à l’habitat social et collectif. Le projet pourra bénéficier du soutien financier de l’Ademe, via son Fonds chaleur, du mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie ainsi que d’un dispositif de financement participatif qui proposera des taux bonifiés pour les Soissonnais. Le Haut-Commissariat au Plan, organe de l’État chargé de la réflexion prospective, a publié un plan destiné à développer la géothermie de surface (jusqu’à 200 mètres de profondeur). Élaboré avec l’appui du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), il décline un plan d’action en quatre volets pour rendre effectif le déploiement de cette énergie sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le premier concerne la formation de professionnels du secteur avec un programme de sept ans pour 60 millions d’euros. Le second concerne l’offre de forage et d’équipement de chauffage des professionnels avec une montée en puissance sur sept ans pour pouvoir répondre à une future demande. Le troisième se concentre sur l’accessibilité au niveau des particuliers et des consommateurs tertiaires afin de réduire les coûts d’investissement et le risque financier grâce à des soutiens publics et ciblés. Enfin le quatrième volet propose de cartographier le territoire selon les zones les plus propices, notamment pour réduire les coûts et les risques des forages. La géothermie est aujourd’hui le moyen de chauffage renouvelable le moins développé en France. Elle présente pourtant un réel intérêt de par sa longévité et ses très faibles émissions de gaz à effet de serre, comme l’explique Observ’ER dans sa dernière étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles. Lors du salon Autocar Expo qui s’est tenu le 13 octobre dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, CRMT (Centre de Recherche en Machines Thermiques), le groupe isérois de transport Berthelet, l’Ademe et GRDF ont présenté un car scolaire diesel converti au biogaz. Les cars scolaires roulent en moyenne 20 000 kilomètres par an, sont contrôlés tous les six mois et sont donc en très bon état après plusieurs années d’utilisation. Ils n’ont pas besoin d’une grande autonomie (300 kilomètres) et n’utilisent pas ou peu les soutes à bagages qui peuvent donc accueillir les réservoirs de gaz. Ce car retrofité est le premier d’une série de 16 véhicules qui seront affectés à des lignes de transport scolaire autour de Crémieu, dans le Nord-Isère. La Région Réunion et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé le 5 octobre une convention pour le développement des énergies renouvelables. En plus de ces deux organismes étaient également présents les représentants de la SPL Horizon (Société publique locale pour la transition énergétique à la Réunion). D’après Marie-Pierre Nicollet, directrice de l’Agence Réunion de l’AFD, trois points principaux seront étudiés : l’élaboration d’un plan solaire, la prospective sur les gisements en biomasse, et les bases d’un futur plan hydrogène vert. La présidente de Région, Huguette Bello, a qualifié ce partenariat d’« historique ». Le président de la SPL Horizon, Jean-Pierre Chabriat, affirme croire « en l’autonomie énergétique de l’île », qui aujourd’hui reste malgré tout dépendante à plus 87 % des énergies fossiles. L’association pour la transition écologique dans les collectivités, Amorce, a présenté le 6 octobre son Plan d’urgence Sobriété en 10 actions dans le but d’aider les collectivités « à passer l’hiver ». Généralement, ces dernières allouent environ 5 % de leur budget de fonctionnement aux dépenses énergétiques (soit 57 € par habitant et par an) mais les factures risquent d’exploser en 2022 et 2023 suite aux hausses de prix de l’électricité, du gaz et des carburants liquides. C’est pourquoi Amorce, l’Autorité des marchés financiers et l’association Intercommunalités de France ont travaillé à ce plan d’urgence. Plus de 200 collectivités ont participé aux groupes de travail et proposé près de 800 actions. Les 10 principales sont présentées dans le rapport et sont applicables dès maintenant. Tout d’abord il est indispensable de bien connaître ses factures et l’origine de ses consommations afin de hiérarchiser les priorités. Pour aider les collectivités l’outil e-SHERPA est disponible gratuitement. Il s’agit d’un outil de simulation « permettant de dresser en quelques minutes un premier état des lieux des bâtiments les plus énergivores et d’identifier les typologies d’actions d’efficacité énergétique les plus adaptées en termes de coût-bénéfice », précise Amorce. Parmi les actions prioritaires, il y a bien évidemment celles concernant la régulation du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, mais des économies substantielles peuvent également être faites sur l’éclairage, les déplacements et l’usage d’appareils électriques de confort, explique le rapport. Le 28 septembre dernier, GRTgaz a annoncé le lancement du Biomethane Industrial Partnership (BIP) au niveau européen. Son objectif est d’encourager tous les acteurs intéressés à travailler ensemble à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de biométhane. Cela concerne les États membres mais aussi les entreprises, les académiques et la société civile. La commission européenne a en effet annoncé en mars 2022 un objectif de production de biométhane de 35 milliards de mètres cubes dans le cadre de son plan REPowerEU destiné à réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles – au gaz russe en particulier, à réduire la consommation d’énergie et à diversifier ses approvisionnements. La commissaire européenne de l’Énergie Kadri Simson a déclaré : « L’Europe dispose d’un grand potentiel pour la production de biométhane, une alternative verte au gaz naturel. Dans le contexte actuel de crise de l’approvisionnement énergétique, nous ne pouvons pas laisser ce potentiel se perdre. Le nouveau Partenariat industriel pour le biométhane est ouvert à toutes les parties prenantes et vise à surmonter les obstacles au développement, à partager les meilleures pratiques et à favoriser la collaboration pour renforcer rapidement la production et l’utilisation du biométhane. » Rappelons qu’aujourd’hui seuls 3 milliards de mètres cubes de biogaz sont produits en Europe, contre 400 milliards de m3 de gaz consommés. Selon une nouvelle étude du think-tank britannique Ember, la demande globale d’électricité a augmenté de 3 % au premier semestre 2022, soit 389 TWh supplémentaires consommés. Les énergies renouvelables ont pour leur part produit 416 TWh de plus, soit davantage que cette hausse. L’éolien et le solaire ont couvert plus des trois quarts (77 %) de l’augmentation et l’hydraulique a compensé le reste, ce qui a permis d’éviter un recours accru aux énergies fossiles. Le charbon a décliné de 1 % et le gaz de 0,05 %. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique mondial sont restées stables durant le premier semestre, mais demeurent toutefois à un niveau très élevé. Dans son ensemble, le parc photovoltaïque mondial a produit 619 TWh au premier semestre, ce qui a représenté 5 % de l’électricité mondiale consommée. L’éolien a couvert 8 % de la demande avec 1 102 TWh produits. Éolien et solaire ont par conséquent couvert 13 % de l’électricité mondiale en 2022, près de trois points de mieux qu’à fin 2021. Dans l’Union européenne, confrontée à une crise énergétique due à la guerre en Ukraine, la progression des énergies renouvelables a contenu la progression d’électricité d’origine fossile à 6 % (contre 16 % attendu) permettant ainsi une économie de 29 milliards sur sa facture énergétique. Angers Loire Métropole annonce que la chaufferie bois du quartier Montplaisir, actuellement en construction, sera opérationnelle au printemps 2023. Érigée en bordure de l’autoroute A11 et de la route de Briollay, la nouvelle installation permettra de chauffer près de 2 400 logements et des équipements de quartier : gymnase, piscine, relais-mairie, médiathèque, future direction de la voirie, écoles, collèges et lycée. À ce jour, 70 kilomètres de réseaux traversent le sous-sol de la ville pour délivrer la chaleur à 90 000 foyers, à la Roseraie, mais aussi à Belle-Beille où la chaufferie bois est en service depuis 2018. Le bois utilisé provient d’un rayon de 100 kilomètres maximum autour d’Angers et pour la moitié, d’un périmètre inférieur à 50 kilomètres de la ville. La construction de la nouvelle chaufferie recevra le soutien de l’Ademe pour 8,5 millions sur un total de 16 millions d’euros. L’établissement public territorial du Grand Paris, Paris Terres d’Envol, et la société Coriance, spécialisée dans les projets de réseau de chaleur, ont conclu vendredi 23 septembre un contrat de concession de service public pour la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur sur les communes de Dugny et du Bourget (Seine-Saint-Denis). Le projet consistera en un réseau de distribution de 20 km et une centrale de production de chaleur produite localement et à 90 % à partir d’énergies renouvelables. Il sera notamment connecté au Village des médias qui accueillera plus de 1 500 journalistes du monde entier lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Coriance prévoit un investissement de 56 millions d’euros pour ce projet qui fonctionnera dans un premier temps grâce au biogaz puis comprendra en 2025 deux forages géothermiques associés à des pompes à chaleur ainsi que quatre chaudières gaz de secours. Il devrait alimenter l’équivalent de 9 000 logements avec 85 GWh par an. Depuis le lundi 19 septembre, les 10 premiers bus bioGNV (gaz naturel véhicule), alimentés par le biométhane produit au centre local d’enfouissement des déchets, ont été mis en exploitation au sein de l’agglomération de Lorient (Morbihan). Cela constitue la première étape du programme de l’agglomération qui ambitionne une flotte nouvelle génération, totalement décarbonée, d’ici 2030. Au total, près de 5 millions d’euros ont été investis dans l’acquisition de 8 bus articulés de 18 mètres et de 2 bus standards de 12 mètres. En parallèle, l’agglomération a débuté des travaux d’aménagements sur ses deux dépôts afin de mettre en conformité les ateliers aux contraintes spécifiques des véhicules bioGNV et hydrogène. À terme, Lorient Agglomération souhaite remplacer ses 95 bus actuels par 76 véhicules bioGNV (48 standards, 18 articulés) et 19 à hydrogène d’ici à la fin de la décennie. Les premiers bus à hydrogène seront intégrés au réseau en 2023. Swiss Krono France, fabricant de panneaux de bois à Sully-sur-Loire (Loiret), a annoncé l’investissement de plus de 100 millions d’euros dans le projet Green Energy qui vise à réduire drastiquement les besoins en gaz de son site de production. L’action consistera à réduire de 35 000 tonnes de CO2 par an les émissions de son usine de Sully tout en augmentant sa capacité de production. Concrètement, le projet va s’articuler en trois phases. Tout d’abord deux nouveaux sécheurs basse température, puis une chaudière biomasse multi-combustibles d’une capacité de 63 MW et un condenseur de fumée viendront équiper le site. Ensuite, Swiss Krono France déploiera de nouveaux équipements industriels au service d’une productivité augmentée. Le projet Green Energy a été doublement lauréat du Plan de Relance national puisque 3,8 millions d’euros lui ont été octroyés dans le cadre du dispositif « Efficacité énergétique et décarbonation des procédés » et 11 millions d’euros grâce au dispositif « Biomasse chaleur pour l’industrie » géré par l’Ademe. Le programme devrait s’étaler jusqu’en 2024. En Bretagne, plusieurs communes se sont rassemblées afin de financer un nouveau projet d’agrandissement du réseau de gaz à partir du réseau existant situé à Ploërmel (Morbihan). Le projet est notamment porté par le syndicat départemental d’énergies du Morbihan, Morbihan énergies. Il prévoit la construction de 25,6 km de tuyauterie supplémentaire pour relier Ploërmel à la zone d’activités économique de Caradec à Guédon en passant par trois autres communes : Guillac, Josselin, La Croix-Helléan et Forges de Lanouée. D’après Morbihan énergies plusieurs industries souhaitent également bénéficier d’un raccordement. « Il s’agit de la coopérative Eureden pour son séchoir situé à Bel air sur la commune de La Croix-Helléan, de la société JPA pour son abattoir de porcs, de la société Mix Buffet pour son unité de production basée sur la zone de la Rochette à Josselin, ainsi que le groupe Smurfit Kappa pour son site industriel implanté sur la zone de Caradec à Guégon, précise le syndicat. » GRDF prendra à sa charge 53 % des travaux, soit environ 1,8 millions d’euros. Les 1,59 millions restant sont portés par les communes concernés et les partenaires privés. Ce nouveau réseau permettra notamment l’injection depuis des unités de production de biométhane dont le nombre croît très rapidement en Bretagne. En effet, il s’agit de la troisième région française en termes de nombre d’unités installées (45 d’après SINOE). Plus de 160 autres projets sont également à l’étude d’après GRDF, qui prévoit que 14 % du gaz consommé en Bretagne sera d’origine renouvelable d’ici 2025. Lhyfe a conclu un accord avec le fabricant américain Plug Power pour la livraison de dix électrolyseurs de type PEM (membrane d’échange de protons) de 5 MW chacun destinés à la production d’hydrogène vert. Ces 50 MW produiront jusqu’à 20 tonnes d’hydrogène par jour, précise Lhyfe. Ce type d’électrolyseur constitue le plus gros modèle disponible clés en main pouvant être installé en extérieur. Lhyfe les utilisera dès 2023 afin de produire de l’hydrogène à partir d’énergie éolienne et solaire destiné à un large éventail d’applications dans le secteur de la mobilité. Cette production pourra notamment alimenter des chariots élévateurs et des véhicules utilitaires, tels que le Renault Master. À moyen terme, cette importante commande d’électrolyseurs devrait permettre à Lhyfe de pouvoir intervenir sur de multiples sites à travers l’Europe autour d’une activité d’ingénierie la construction d’unités de production d’hydrogène. La Commission européenne a annoncé en août avoir autorisé le schéma proposé par l’Italie visant à soutenir la production de biométhane. En vigueur jusqu’au 30 juin 2026, le régime validé par la Commission soutiendra la production de biométhane injecté sur le réseau national de gaz à destination des secteurs du transport et du chauffage. Il s’agira concrètement de subventions pour un budget total de 1,7 milliard d’euros, dont le montant par projet pourra s’élever jusqu’à 40 % des coûts d’investissements éligibles. Le dispositif prévoit également des tarifs d’achat (en euros/MWh) du biométhane injecté, attribués par appels d’offres sur une durée de 15 ans d’exploitation pour un budget de 2,8 milliards d’euros. La vice-présidente exécutive chargée de la politique concurrentiel Margrethe Vestager a déclaré que ce régime « aidera l’Italie à atteindre ses objectifs de réduction des émissions, à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes et à améliorer sa sécurité d’approvisionnement en gaz, tout en limitant les éventuelles distorsions de concurrence. » Les 18 et 19 septembre prochains auront lieu les Journées Nationales du Biogaz, organisées par l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui compte 430 adhérents. Cet événement sera l’occasion de faire découvrir au grand public le métier d’agriculteur méthaniseur et les techniques de production de gaz vert issu de déchets agricoles. 22 unités de méthanisation réparties sur l’ensemble du territoire, ouvriront spécialement leurs portes pour l’occasion. L’injection dans le réseau de distribution de méthane de synthèse, issu d’un procédé de méthanation, s’est déroulée du 4 au 6 juillet à Sempigny dans les Hauts-de-France. Ce gaz vert est issu d’un démonstrateur conçu par la startup Energo. La méthanation est un processus entièrement industriel qui produit un méthane de synthèse à partir de la synthèse de dioxyde ou du monoxyde de carbone et d’hydrogène. Le gaz obtenu a les mêmes caractéristiques que le gaz d’origine fossile. Le procédé novateur testé par Energo, avec le soutien du Lab Crigen, utilise un plasma froid pour combiner CO2 et hydrogène à pression ambiante et à une température modérée, dans un réacteur très compact. Cela permet de réduire de 20 % les coûts de la méthanation, assure l’entreprise. « Nous sommes extrêmement fiers de cette double première industrielle ici à Sempigny. Première nationale concernant l’injection de gaz de synthèse dans le réseau, et première mondiale concernant l’industrialisation du plasma-catalyse », se réjouit Vincent Piepiora, président d’Energo. Sur un potentiel de production de gaz renouvelables en France estimé à 420 TWh à l’horizon 2050, 50 TWh pourraient être produits par méthanation. Néanmoins, les gaz de synthèse produits par méthanation ne bénéficient actuellement d’aucun droit à l’injection. Dans l’attente d’un cadre réglementaire favorable à l’essor de cette filière, Energo a obtenu, de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), une autorisation d’injection du gaz produit à titre expérimental. La faisabilité technique étant démontrée, la startup appelle désormais à la mise en place de mécanismes de soutien afin d’offrir aux porteurs de projets la visibilité nécessaire à l’industrialisation de la filière. Observ’ER vient de publier son étude qualitative 2022 sur le marché des pompes à chaleur (PAC) dans l’individuel. Cette étude bisannuelle complète son étude quantitative publiée en mai dernier. Le marché français des PAC aérothermiques est le second marché d’Europe. Les équipements air/eau ont particulièrement profité des dispositifs MaPrimeRénov’ et Coup de pouce Chauffage (+ 49 % en 2021). Les équipements air/air restent les équipements les plus vendus avec près de 760 000 unités, même si leur croissance est plus mesurée (+ 4 %). Ils ont trouvé leur place sur le marché du neuf. Malgré les problèmes concernant l’approvisionnement en matières premières et la baisse du cours des certificats d’économie d’énergie (CEE), qui aident au financement des installations de PAC, les professionnels restent optimistes pour 2022. Le problème principal est selon eux le manque de main-d’œuvre qualifiée pour suivre la demande. À moyen terme, ils identifient également un risque concernant l’évolution de la réglementation sur les fluides frigorigènes. En effet, à partir de 2024, la mise sur le marché d’équipements ayant un faible GWP (Global Warming Potential) devra s’accélérer. À partir de 2025, ceux ayant un GWP supérieur à 150 ne seront plus autorisés à la vente. Pourtant, ces derniers représentent aujourd’hui la grande majorité du marché, et certains constructeurs voient mal comment il sera possible de faire évoluer toutes les gammes à cette échéance. Sur le secteur de la géothermie, le contexte général reste inchangé bien que le marché soit en légère hausse (3 220 unités en 2021 contre 3 005 en 2020). Il est essentiellement porté par le remplacement d’anciennes PAC. Les professionnels appellent à davantage d’actions de soutien et à encourager la formation d’installateurs spécialisés en géothermie. Les crises sanitaires et énergétiques ont créé un choc sur les prix. Globalement, tous les équipements ont vu leur prix augmenter (entre 5 et 9 %) en 2021, et les acteurs craignent que la situation ne dure. Le groupe Séché Environnement, spécialiste de la gestion de déchets, s’associe avec Waga Energy, producteur de biométhane issu de déchets pour la création d’une unité de production dans le Pas-de-Calais. Ce projet d’injection de biométhane sera situé sur le site de stockage de déchets ménagers de Sainte-Marie-Kerque, exploité par Opale Environnement, filiale de Séché Environnement. Waga Energy va construire une unité d’épuration utilisant sa technologie Wagabox, permettant de transformer le gaz émis par fermentation naturelle des déchets (le biogaz) en biométhane. Le site injectera 20 GWh de biométhane par an dans le réseau, soit la consommation d’environ 3 000 foyers. La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et la start-up bretonne Sweetch Energy annoncent l’installation de la première centrale osmotique pilote de production d’électricité en France sur le site de l’écluse de Barcarin, à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). L’énergie osmotique permet de produire de l’électricité renouvelable grâce au mouvement créé par des masses d’eau de salinité différente, en l’occurrence l’eau du Rhône et l’eau de mer. La centrale pilote sera de petite taille et intégrée dans deux conteneurs, qui abriteront le générateur osmotique connecté au Rhône au moyen de tuyauteries et de pompes, afin d’acheminer l’eau douce et l’eau salée nécessaires à son fonctionnement. Une troisième canalisation permettra d’évacuer le mélange des eaux dans la zone du fleuve où l’eau douce et l’eau salée se rencontrent à l’aval de l’écluse. D’une puissance installée de plusieurs dizaines de kilowatts (kW) dans sa phase d’expérimentation, le démonstrateur devrait être mis en service fin 2023 sur le terrain et représentera un investissement de près de 3 millions d’euros sur la durée de test estimée à deux ans. À ce partenariat industriel s’ajoute un partenariat financier avec un investissement de 1,5 million d’euros par CNR pour accompagner le développement de Sweetch Energy. Le site de La Malle du cimentier Lafarge situé à Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône, va utiliser des résidus de biomasse comme combustible pour la fabrication de ses ciments. Il s’agit d’exploiter les fines de bois, qui sont des poussières ou de petites particules issues de la préparation de copeaux ou de broyats de bois. Il y a encore quelques années, entre 3 et 4 millions de tonnes de déchets de bois étaient enfouis par an sans valorisation. L’utilisation de fines de bois permettra d’abaisser la part de combustibles soufrés comme le coke de pétrole dans le processus de combustion pour la production de ciment, contribuant ainsi à réduire de 10 % supplémentaires les émissions de soufre. L’approvisionnement en fine de bois est régional : la cimenterie récupère les fines de bois principalement à Fuveau ou dans le Var, grâce à des connexions directes avec des centrales biomasse, comme la centrale de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Début juillet, le démonstrateur power-to-gas Jupiter 1 000 situé sur le complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a commencé à injecter dans le réseau de gaz de l’e-méthane produit par le procédé de méthanation. Ce procédé consiste à faire réagir de l’hydrogène renouvelable avec du CO2 issu du recyclage de fumées d’Asco Industries, l’usine sidérurgique voisine, pour obtenir un gaz de synthèse. L’hydrogène vert provient des deux électrolyseurs de McPhy – PEM (Proton exchange membrane) et alcalin – d’une capacité de 1 MW. L’installation affiche une capacité de production d’e-méthane de 25 nm3/heure. Le réacteur de méthanation, le « méthaneur », a quant à lui été construit par Khimod (groupe Alcen) avec l’appui du CEA. « Jupiter 1000 est la première expérience française à l’échelle du mégawatt. Et il est le premier projet à valoriser du CO2 de fumées industrielles, indique Sylvain Lemelletier, directeur de projet chez Rice, le centre de recherche et d’innovation de GRTgaz. Les campagnes d’essais, entamées en février 2020 avec une première injection d’hydrogène, se poursuivront jusqu’en 2023 sous la coordination du CEA. À cette date, Jupiter 1000 célèbrera les dix ans des premières réflexions qui ont abouti au montage du projet. » Avec 75 % des voix contre 25 %, Jules Nyssen, jusque-là délégué général de Régions de France, vient d’être élu à la présidence du Syndicat des énergies renouvelables (SER). Jules Nyssen succède ainsi à Jean-Louis Bal qui occupait la présidence depuis mars 2011 et dont le mandat se terminera officiellement le 24 octobre prochain. « Ma principale ambition consiste à mieux faire connaître le SER du grand public pour porter un discours positif sur les énergies renouvelables. Si, aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour développer les énergies renouvelables, la mise en œuvre sur le terrain est plus compliquée. Nous devons faire de la pédagogie pour montrer en quoi le développement des énergies renouvelables est indispensable et compatible avec les projets territoriaux. Il faut lever les inquiétudes parfois amplifiées par certains. Le SER devra mettre en valeur les projets exemplaires et démontrer leur valeur ajoutée sociale et territoriale », a déclaré le nouveau président dont le mandat est de trois ans. Mercredi dernier, Observ’ER (l’Observatoire des énergies renouvelables), acteur de référence dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique en France et en Europe a dévoilé son tout nouveau site Internet. Sont présentés les différents domaines d’activité d’Observ’ER, les magazines avec Le Journal des Énergies Renouvelables, Le Journal du Photovoltaïque et Le Journal de l’Éolien, les études et baromètres thématiques (en consultation libre), les actualités les plus marquantes des différentes filières en France, en Europe et à l’international ; les Clés de la transition énergétique, également en consultation libre, dédiées à la transition énergétique dans les territoires, en zones rurales et dans les entreprises. Des fiches consacrées aux différents secteurs des énergies renouvelables sont également en libre accès. Pour la visite c’est ICI. La start-up H2V, filiale du groupe industriel Samfi, qui investit, développe et construit des centrales de production d’hydrogène renouvelable, a annoncé le 10 juin dernier l’officialisation de son futur site de production sur le parc d’activités des Portes du Tarn près de Toulouse en Occitanie. En effet, les élus ont validé ce projet lors du Comité d’Engagement et de Suivi des Portes du Tarn le 8 juin, dans le cadre du développement du parc d’activités afin d’attirer des entreprises notamment spécialisées dans la Cleantech, c’est-à-dire des techniques et services industriels qui utilisent les ressources naturelles, l’énergie, l’eau, les matières premières dans une perspective d’amélioration importante de l’efficacité de la productivité. Le projet d’H2V pourrait entrer en service en 2028 mais son dimensionnement reste inconnu. En plus des entreprises implantées sur le parc, il pourrait notamment alimenter la mobilité lourde, ainsi que des aéroports proches comme celui de Toulouse Blagnac. La société de projet Emasol, filiale de Newheat, entreprise spécialisée dans le solaire thermique, a mis en service une centrale de 1 800 m2, soit 1,4 MW thermiques installés sur la ville de Pons, en Charente-Maritime. Il s’agit de la première centrale de ce type alimentant un réseau de chaleur équipée de trackers (systèmes mécaniques permettant d’orienter les panneaux face au soleil). Son objectif est de doper la productivité de la centrale et d’apporter de la flexibilité au réseau de chaleur urbain qu’elle alimente. Ce réseau de chaleur, initialement fourni en énergie par des chaudières gaz et biomasse, atteignait déjà un taux de chaleur renouvelable de 73 %. Avec cette nouvelle centrale Emasol, il devrait atteindre un taux supérieur à 90 %, en effaçant la quasi-totalité du gaz fossile utilisé sur la période estivale. Cette centrale solaire thermique est prévue pour une durée de 25 ans minimum. Lauréate de l’Appel à projet « Grandes Installations Solaires Thermiques » du Fond Chaleur de l’Ademe, elle bénéficie d’un soutien de 580 000 euros, ainsi que de 167 500 euros de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet Emasol s’inscrit dans un cadre plus large, celui du financement organisé en 2020 par Newheat de cinq centrales de production de chaleur solaire et de récupération en France, comprenant un financement bancaire de 13 millions d’euros. Divers acteurs de la transition énergétique sont également actionnaires minoritaires, ainsi que la ville de Pons (5 %) en contrepartie de la mise à disposition du terrain d’implantation de la centrale. Les journées de la géothermie 2022 ont été l’occasion de retrouvailles pour la filière. Organisé les 9 et 10 juin derniers à Aix-les-Bains (Savoie) par l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG), en partenariat avec l’Ademe et le BRGM, l’événement n’avait pas eu lieu depuis 2016. Les 300 participants ont pu assister à des conférences sur des thématiques aussi variées que le développement du marché, l’innovation, la recherche, l’économie, la compétitivité, l’emploi, l’acceptabilité de la filière… Témoignages de collectivités et retours d’expériences ont montré le caractère incontournable de cette technologie, qui permet de produire à la fois du chaud et du froid, dans un contexte urgent de réchauffement climatique et de crise énergétique. Ces journées ont également été l’occasion du renouvellement des instances de l’AFPG et de la réélection de Jean-Jacques Graff au poste de président pour un mandat de trois ans. Deux projets innovants ont en outre été récompensés par les adhérents : celui du girondin AbSolar dans la catégorie géothermie de surface, et celui de l’exploitant de la centrale géothermique de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), ES géothermie, pour la géothermie profonde. Le premier répond à la problématique de variabilité des énergies renouvelables par un système associant « stockage d’énergie souterrain intersaisonnier » et « énergie solaire thermique ». Le second a permis, au sein du projet de recherche et d’innovation européen EuGeli, de développer un procédé d’extraction du lithium des saumures géothermales. Enfin, Ann Robertson-Tait, présidente de WING International (Women In Geothermal), a annoncé la création d’une branche française. Rendez-vous dans trois ans pour la sixième édition. L’Ademe a publié le 22 juin l’état des lieux du parc d’installations de méthanisation en service au 1er janvier 2022 sur la plateforme Sinoe. Il s’agit d’un outil destiné à aux collectivités territoriales pour les aider à optimiser leur politique de gestion des déchets ménagers. Ce travail réalisé en partenariat avec Observ’ER dresse le bilan et donne les chiffres clés de la méthanisation en France. Ainsi au 1er janvier, la base de données Sinoe récence 1 308 installations opérationnelles, dont 759 en cogénération (+ 44 par rapport à 2020) pour 248 MWe, 371 en injection (+ 156 par rapport à 2020) pour 62 787 Nm3/h et 180 en chaleur seule (+ 6 par rapport à 2020). Cela illustre la volonté du gouvernement de prioriser l’injection qui devrait à terme devenir le principal débouché de la filière méthanisation. Le Grand Est est de loin la première région en termes de nombre d’installations de cogénération (189 unités) ainsi que de capacité (53,7 MWe). C’est également la première région, légèrement devant les Hauts-de-France, pour l’injection avec 73 unités pour une capacité de 13 534 Nm3/h. Au niveau national la majorité des installations sont des petites unités à la ferme, 623 unités en cogénération avec une puissance moyenne de 133 kWe et 248 unités en injection avec un capacité moyenne de 142 Nm3/h. Les installations dans l’industrie sont majoritairement en chaleur seule (85 unités sur 107), de même pour les sites en couverture de fosse (37 unités sur 41). D’après le Service des données et études statistiques (SDES), en 2021 la quantité de biogaz injectée sur le réseau est estimée à 4 337 GWh, dont 460 GWh commercialisés sous forme de BioGNV, respectant ainsi la trajectoire prévisionnel fixée par la Programmation pluriannuelle de l’énergie. La capacité maximale d’injection se situe quant à elle aux alentours de 6,4 à 6,6 TWh et devrait doubler d’ici 2024 grâce aux projets inscrits au registre des capacités d’après GRDF. Toujours d’après le gestionnaire de réseau de distribution, d’ici 2030, 20 % du gaz consommé en France pourrait être issu de procédés renouvelables. Le CEA et GRDF s’associent pour cinq ans dans le cadre du projet Gazhyvert 2 pour développer un démonstrateur de gazéification hydrothermale. Cette solution permet de produire un gaz 100 % renouvelable à partir de biomasses liquides telles que les boues de stations d’épuration. En opérant à haute température et pression élevée, cette technologie permet de convertir jusqu’à 90 % du carbone de la biomasse en biogaz et garantit également la récupération des sels minéraux (azote, phosphore, potassium…) utilisables comme nutriments et fertilisants durables. Le projet Gazhyvert 2 a pour objectif de définir les adaptations nécessaires pour une industrialisation de la gazéification hydrothermale à horizon 2025. Les 8e Assises Nationales des énergies marines renouvelables, organisées par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), se sont déroulées le 14 juin dernier au Havre. Elles ont été l’occasion de rappeler le Pacte Éolien en mer signé en mars entre l’État et la filière, qui implique d’attribuer 20 GW de projets en mer d’ici 2030. Un chiffre sept fois supérieur aux projets actuellement en phase de développement. Il a également été l’occasion de présenter les résultats du rapport 2022 de l’Observatoire des énergies de la mer (disponible en ligne). Plus de 2,6 milliards d’euros ont été investis dans les filières renouvelables marines en 2021, générant 1,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, dont 91 % pour l’éolien posé et 4% pour le flottant. Le nombre d’emplois recensés s’élève à 6 591, en croissance de 36 % par rapport à l’année précédente. Ils se situent à 77 % dans l’éolien posé, 17 % dans l’éolien flottant et 6 % dans les autres énergies marines (hydrolien, houlomoteur, etc.). Trois parcs éoliens en mer étaient en effet déjà en construction et cette montée en puissance se poursuit grâce au début des travaux du parc de Courseulles-sur-Mer (Calvados). L’usine de GE Renewable Energy à Cherbourg a fonctionné à pleine capacité sur l’année 2021 tandis que les premiers recrutements commençaient pour l’usine de Siemens Gamesa, inaugurée au printemps 2022. Les régions Normandie et Pays-de-la-Loire sont de loin les plus dynamiques avec respectivement 2 266 et 1 832 emplois. La filière vise l’objectif de 20 000 emplois en 2035. Pour cela, « il faut créer un peu plus de 1 000 emplois par an : la filière est sur cette trajectoire », assure l’Observatoire. Le 22 juin, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a lancé un appel à l’adoption de mesures d’urgence avant l’été afin de garantir la sécurité d’approvisionnement des Français. Face à l’arrêt de livraison de gaz russe et à l’indisponibilité d’une grande partie du parc nucléaire français, le SER rappelle que la consommation d’énergies renouvelables s’est accrue de 9,3 % en 2021, en valeur absolue, « preuve que ces filières jouent un rôle grandissant dans la capacité de notre pays à couvrir ses besoins énergétiques », estime le syndicat. L’accélération de leur déploiement est un enjeu climatique et doit se concrétiser d’ici 2025, estime le dernier rapport du GIEC. Or, le SER redoute un « trou » d’air pour ces filières au cours des trois années à venir si rien n’est fait rapidement. « Le contexte actuel de fortes hausses des coûts des matières premières et de remontée des taux d’intérêt fait en effet peser un risque important sur de très nombreux projets renouvelables : à titre d’exemple, plus de 2 GW de capacités solaires et plus de 5 TWh de capacités de production de biométhane sont aujourd’hui en péril du fait du contexte inflationniste », précise le SER. « Le SER a proposé une série de mesures, comme l’indexation des niveaux de soutien public ou la possibilité pour les futurs projets de vendre de l’énergie sur le marché avant l’activation de leur contrat. Nous nous tenons aux côtés des responsables politiques pour que ces mesures puissent être mises en œuvre le plus rapidement possible. La sécurité d’approvisionnement devient un enjeu majeur et implique, avant-même toute mesure de simplification qui pourrait être proposée dans une future loi d’accélération, de pouvoir sauver ces projets sur le très court terme », indique Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER). Le Livre blanc du SER (février 2022). Sur les 45 offres d’emploi proposées début 2022 par le développeur de projets renouvelables Boralex, 11 postes sont encore à pourvoir. Boralex est spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation d’énergies renouvelables, en particulier des projets éoliens et photovoltaïques. Les profils recherchés sont très divers, allant de développeur informatique à technicien de maintenance et d’exploitation éolien. Pour postuler, c’est ICI. Mercredi 15 juin, le réseau international des énergies renouvelables, REN21, a publié la 17e édition de son rapport annuel. Cette étude, sur laquelle ont travaillé plus de 650 experts, dresse un état des lieux de la situation mondiale des énergies renouvelables en 2021 et son constat d’ensemble est sévère. Malgré les promesses d’une « relance verte » lancées après deux ans de pandémie de Covid-19 et des chiffres records de nouvelles capacités installées, d’investissements ou de production d’énergie renouvelable, « La transition énergétique n’a pas eu lieu ». Les systèmes énergétiques d’une grande majorité des pays continuent d’être largement dominés par les énergies fossiles et ce, à des niveaux très proches de ce qui était observé il y a dix ans. Si en 2021, 351 milliards d’euros ont été investis dans les technologies vertes, le rebond de l’activité économique mondiale a entraîné une augmentation d’environ 4 % de la demande énergétique dont une grande partie a été satisfaite par des combustibles fossiles, conduisant à un relèvement de 6 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2). De trop nombreux États continuent de subventionner massivement des opérations liées au gaz, au pétrole ou au charbon. Autre travers pointé, le tropisme de l’énergie électrique. Le rapport note notamment que trop peu de pays ont mis en place de réelles politiques en faveur des technologies renouvelables pour répondre à des besoins de chaleur et de froid ou de transport. Cependant, même si REN21 parle d’un rendez-vous manqué, l’organisme appelle une nouvelle fois l’ensemble des États à profiter de la crise actuelle pour amorcer une vraie transition énergétique, qui éloigne définitivement les systèmes énergétiques mondiaux des énergies fossiles. L’hydrolienne D10 de 1 MW développée par la société bretonne Sabella produit à nouveau de l’électricité pour le réseau de l’île d’Ouessant (Bretagne). Après avoir été améliorée, l’éolienne a été remise à l’eau en avril dernier, puis a subi une série de tests et de réglages. L’injection d’électricité va graduellement augmenter au cours des prochaines semaines passant de 100 kW à la puissance maximale admise par le réseau de l’île. Les améliorations de l’hydrolienne ont notamment porté sur la modification de la connectique d’export de la turbine et le lissage de la production électrique à terre. « Cette innovation est une avancée majeure, étant donné que la production électrique d’une hydrolienne génère de brèves perturbations du signal induites par les mouvements naturels de la houle ou des turbulences de courant, particulièrement présents dans le passage du Fromveur », explique l’entreprise. Cette fonction de lissage « doit garantir à l’exploitant du réseau Enedis une qualité constante de l’électricité injectée sur le réseau de l’île de Ouessant, assure Fanch Le Bris, directeur général de Sabella. « Nous sommes très satisfaits de ce développement technologique avec des performances obtenues supérieures aux exigences de l’exploitant. Ce succès est de très bon augure pour nos futurs projets sur les zones non interconnectées qui nécessiteront la mise en œuvre de ce type de fonction qui permet de sécuriser ces réseaux souvent plus fragiles que les grands réseaux interconnectés. » À l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique, qui se sont tenues du 31 mai au 2 juin 2022 à Genève, Énergie Partagée et GRDF ont signé une convention de partenariat pour favoriser l’implication des acteurs locaux dans des projets de gaz renouvelables. Ce rapprochement consiste en un partage de connaissances entre GRDF et Énergie Partagée par des échanges de proximité. La mise en réseau de ces deux structures permettra de créer des synergies locales pour accroître le développement des projets de gaz renouvelables à gouvernance partagée. Les projets de gaz renouvelables, aujourd’hui principalement portés par des agriculteurs, bénéficient déjà d’un ancrage local. L’enjeu est de trouver le juste équilibre pour élargir leur gouvernance aux collectivités et aux citoyens. Les deux acteurs développeront également des actions de coopération dans le cadre du projet « Let’sGo4Climate », piloté par la région Centre-Val-de-Loire, qui vise le déploiement de communautés d’énergie renouvelable au sein de la région. Des réflexions communes seront aussi menées à l’échelle nationale pour identifier les obstacles au développement des projets de gaz renouvelables à gouvernance partagée et proposer des pistes de dispositifs de soutiens dédiés, qui n’existent pas aujourd’hui. Après une première version publiée fin avril dernier (voir Actu du 2 mai), Observ’ER vient de mettre en ligne son étude complète sur le marché 2021 des pompes à chaleur (PAC) individuelles (jusqu’à 30 kW). On savait déjà que 2021 avait été un excellent millésime pour les équipements aérothermiques, qui avait globalement progressé de plus de 12 % pour l’ensemble des technologies (air/eau et air/air), dépassant pour la première fois le seuil du million d’équipements vendus en une année. Avec cette version complète de l’étude, le tableau de bord s’étoffe de plusieurs indicateurs décrivant la régionalisation des ventes, les types d’opérations (premier équipement ou remplacement) ou une évaluation du chiffre d’affaires. Parmi la série d’indicateurs nouveaux, le volet dédié au suivi des prix moyens retient particulièrement l’attention. Avec des hausses moyennes allant de 6 à 8 % pour le matériel, et ce sur l’ensemble des secteurs (aérothermie et géothermie), l’année passée a enregistré les plus fortes croissances de prix observées au cours des 10 dernières années. À l’instar de nombreux autres secteurs d’activité, l’augmentation du prix des matières premières et des tensions apparues dans la chaîne d’approvisionnement expliquent ce phénomène. Les acteurs s’attendent d’ailleurs à ce que cette tendance se poursuive en 2022. Une étude qualitative, entièrement basée sur des entretiens menés auprès de professionnels de la filière, viendra compléter et mieux analyser les données quantitatives. Ce travail devrait être publié mi-juillet. Le producteur nantais d’hydrogène vert Lhyfe a annoncé le succès de son introduction en bourse, lui permettant de réaliser une augmentation de capital d’environ 110 millions d’euros. Ce montant pourrait être porté à 124 millions d’ici le 17 juin prochain, date qui marquera la fin de la période de stabilisation de l’opération boursière. Le produit net de l’augmentation de capital sera employé pour sa plus grande partie (50 %) à abonder en fonds propres les sociétés de projets de manière à atteindre une capacité installée de production totale de 200 MW d’ici 2026. Par ailleurs, 35 % de la nouvelle enveloppe sera dédiée au renforcement des équipes commerciales et d’ingénierie et 8 % seront alloués à la R&D, notamment pour le développement technologique de la production d’hydrogène vert en mer et pour l’optimisation des coûts de production. Lhyfe dispose actuellement d’un portefeuille de 93 projets, uniquement à partir d’unités terrestres, ce qui devrait lui permettre d’atteindre une capacité installée totale de 55 MW d’ici 2024. À l’horizon 2030, la société se fixe comme objectif de disposer d’une capacité installée totale de production d’hydrogène vert supérieure à 3 gigawatts (GW). L’Ademe a lancé un appel à projet « une ville, un réseau » qui consiste à accompagner financièrement et à fournir du conseil aux initiatives de réseaux de chaleur et de froid renouvelables portées par des Villes ou des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de moins de 50 000 habitants. L’appel à projet court du 5 mai au 14 octobre et est financé par le Fonds chaleur, qui a déjà permis de doubler le kilométrage de réseaux en France, passant de 3 450 km en 2009 à 6 200 km actuellement. La France a pour objectif de multiplier par cinq la quantité d’énergie renouvelable livrée par ces réseaux d’ici 2030 par rapport à 2012, soit 40 TWh contre 15 TWh aujourd’hui. Le bâtiment est le premier consommateur d’énergie en France, et le verdissement du chauffage est indispensable à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Concrètement « une ville, un réseau » est une solution clé en main qui comprend :- un accompagnement à hauteur de 90 % des études préalables, sous la forme d’une étude de faisabilité, d’un schéma directeur de réseau de chaleur ou encore d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Les plafonds et niveaux des aides aux forfaits pour les investissements eux-mêmes sont en cours de révision pour être renforcés.- des conseils, en mettant à disposition des cahiers des charges adaptés ainsi que des guides pratiques de l’association Amorce et de l’AFPG (Association Française des professionnels de la géothermie).Pour vérifier l’éligibilité, l’Ademe a mis à disposition un cahier des charges disponible ici. Le 6 mai, a été inaugurée l’installation de méthanisation Reims Méthagri’n qui revend 100 % de sa production au fournisseur Gaz de Bordeaux depuis début décembre 2021. Ayant la capacité de traiter près de 11 000 tonnes d’intrants par an, cette unité est capable de produire 12 GWh de gaz renouvelable. Le fournisseur, présent dans près de 50 % des communes de France raccordées au réseau de gaz, vise un volume de 500 GWh de gaz issu de la méthanisation à l’horizon 2024 grâce à 34 futures unités, dont 21 situées en Nouvelle-Aquitaine. Pour Cyril Vincent, directeur général de Gaz de Bordeaux « En achetant 100 % de la production de biogaz [de Méthagri’n, ndlr], nous pouvons servir et satisfaire nos clients particuliers et professionnels, dont l’intérêt pour cette énergie alternative est grandissant. » Le 12 mai dernier, le groupe Idex a mis en service une chaufferie bois située à Cattenom, dans le département de la Moselle. L’unité, d’une puissance de 2 MW, alimente le réseau de chaleur de la ville d’une longueur de 1,5 kilomètres et qui dessert 22 sous-stations. Au total, 23 bâtiments de la ville et de la Communauté de Communes, ainsi que le collège et quelques maisons individuelles seront alimentés en chaleur renouvelable. Ce nouveau réseau de chaleur permet d’éviter 400 tonnes de CO2 par an et la chaufferie est approvisionnée annuellement par 1 100 tonnes de bois (bois de scierie, bois déchet et plaquette forestière), issues de partenaires locaux présents dans un rayon de 90 km autour du site. La ville de Cattenom ne bénéficiant pas d’un accès à un réseau gaz, dû à la proximité d’une centrale nucléaire, une chaudière fioul de 800 kW assure l’appoint. Mardi 24 mai, Observ’ER a présenté à la presse le nouveau numéro de sa collection Observ’ER Perspectives, consacré à l’énergie citoyenne en France et en Allemagne. La publication a été réalisée avec le soutien de la fondation Heinrich Böll France. Les projets citoyens ont pour principale caractéristique d’être développés par des groupements de citoyens et/ou des collectivités qui participent directement au capital des opérations. Ils en possèdent donc des parts, ce qui leur octroie une place majoritaire ou significative dans la gouvernance des projets. À ne pas confondre avec les projets en financement participatif, qui font seulement appel à l’épargne privée sous la forme de prêts. De plus, les projets citoyens n’ont pas de finalité lucrative et orientent généralement une partie de leurs retombées financières en faveur d’actions de sensibilisation aux questions environnementales ou en faveur de l’économie sociale et solidaire. Porté par un écosystème très dynamique, notamment animé par l’association Énergie Partagée, l’énergie citoyenne en France a permis de faire émerger plus de 515 projets renouvelables dans lesquels plus de 35 500 citoyens et 800 collectivités se sont engagés pour plus de 96 millions d’euros investis. Au travers d’articles d’analyse, d’interviews d’acteurs ou de portraits de réalisations, ce numéro d’Observ’ER Perspectives dresse l’état des lieux de la dynamique actuelle de l’énergie citoyenne, ainsi que des enjeux futurs. Par ailleurs, deux articles sont consacrés à la situation allemande où, si, les projets citoyens ont une définition différente de celle utilisée en France, les réflexions sur le choix des meilleures mesures de soutien à mettre en place sont proches de celles menées en France. L’ouvrage est en libre téléchargement à partir de la page blog des sites de chacun des magazines édités par Observ’ER : Le Journal de l’Éolien, Le Journal du Photovoltaïque et Le Journal des Énergies Renouvelables. Consultation publique organisée du 5 au 26 mai suite à la publication d’un projet de décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants. Les énergies renouvelables produites à base de matière organique, comme les biocarburants et le biogaz, sont soumises à une législation limitant la part des cultures dites « principales » dans leur production. Le code de l’environnement limite cette part à 15% pour la méthanisation, et l’usage des biocarburants produits à partir de biomasse destinée à l’alimentation humaine ou animale est « limité à 7% de la consommation d’énergie du secteur des transports routier et ferroviaire ». Cependant aujourd’hui il subsiste un manque de clarté pour bien identifier et comptabiliser les cultures principales et intermédiaires. Les retours d’expériences montrent que les définitions actuelles peuvent conduire à des mauvaises interprétations et qu’elles sont insuffisantes pour limiter les risques de concurrence entre les cultures destinées à l’alimentation et celles destinées à la production d’énergie. Ce projet de décret propose d’amener de la clarification. Ainsi pour être considérée comme principale, une culture devrait remplir au moins une des 5 conditions définies dans le projet de décret. Lancées en 2018 par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et ses partenaires (l’Ademe, la FNCCR, le réseau Amorce, le CLER et le syndicat ELE), les « Journées Portes Ouvertes des énergies renouvelables », sont l’occasion de découvrir des installations habituellement fermées au public et de rencontrer les personnes qui travaillent sur ces sites. Cette année, l’évènement se déroulera les vendredi 24 et samedi 25 juin sur toute la France. Ainsi, en Ile-de-France, le public pourra découvrir le fonctionnement de la centrale géothermique de la ville de Fresnes. Dans les Hauts-de-France, c’est la plateforme technologique solaire de Lumiwatt, située à Loos-en-Gohelle, qui ouvrira ses portes. Dans l’Indre (Centre-Val de Loire), le réseau de chaleur bois de la commune de Luçay-le-Mâle présentera aux visiteurs son installation et son fonctionnement. L’ensemble des sites ouverts sont visibles sur le site internet dédié à l’opération. A noter qu’il est nécessaire de s’inscrire à l’avance pour les visites proposées, ces inscriptions pouvant se faire en ligne. Dans le cadre de la préparation d’une nouvelle stratégie pour l’énergie solaire (photovoltaïque, solaire thermique et solaire à concentration), la Commission européenne a lancé une consultation publique auprès de l’ensemble des acteurs de ces technologies. Solar Heat Europe, l’association européenne du solaire thermique, vient ainsi de publier sa feuille de route pour la filière, intitulée « Energising Europe with Solar Heat – A Solar Thermal Roadmap for Europe » (Donner de l’énergie à l’Europe avec la chaleur solaire – Une feuille de route du solaire thermique pour l’Europe). Son objectif est de mettre en évidence les avantages du solaire thermique, de fixer des objectifs pour le secteur, d’améliorer l’environnement commercial pour son industrie et de supprimer les obstacles à un développement plus large. Selon l’association, l’énergie solaire thermique aurait le potentiel pour atteindre une capacité de 140 GWth d’ici 2030 dans le segment des bâtiments (d’habitation ou tertiaires) et 140 autres GWth en intégration à des réseaux de chaleur. Toutefois, le secteur le plus prometteur serait celui de la chaleur industrielle pour lequel la feuille de route de Solar Heat Europe indique qu’une capacité de 280 GWth pourrait être mise en service, toujours à l’horizon 2030. Solar Heat Europe vise ainsi un total de 560 GWth en service en 2030. Par comparaison, la capacité en service en Europe ne cumulait que 37,7 GWh en 2020, selon le dernier baromètre EurObserv’ER. Atteindre une telle capacité installée en 2030 permettrait d’économiser 500 TWh d’énergie thermique par an et de réduire les émissions de CO2 de 106 millions de tonnes. « Le potentiel du solaire thermique a été sous-estimé, comme celui de tout le secteur de la chaleur renouvelable, estime Solar Heat Europe. Il est critique que ce secteur reçoive le même niveau de soutien politique qui a été offert au photovoltaïque et à l’éolien. » D’autant plus, insiste l’organisation, que les fabricants de capteurs sont localisés en Europe. La feuille de route de Solar Heat Europe est actuellement en ligne sur le site de l’association où les acteurs et partisans de la filière peuvent devenir signataires officiels du document et ainsi participer à sa promotion. Plusieurs actions de communication d’envergure sont annoncées au mois de juin prochain qui marqueront les 30 ans de l’association européenne. Engie a annoncé le 5 mai le lancement du label TED avec le Bureau Veritas, spécialiste de la certification. « TED » pour Transition Énergétique Durable, ce label vise à certifier une méthode qualifiée de « robuste et systémique » dans le développement des projets d’énergie renouvelable. Les projets éoliens et photovoltaïques sont les premiers concernés, mais le label devrait s’appliquer à d’autres projets renouvelables à l’avenir, en commençant par la méthanisation courant 2022. Le label porte sur neuf engagements d’Engie répartis sur trois thématiques clés : territoires, nature, climat. La plupart de ces engagements correspondent aux bonnes pratiques déjà mises en place par les développeurs de projets renouvelables, qui se voient ainsi systématisées chez l’énergéticien. L’aspect territoire est particulièrement mis en avant, car au cœur des préoccupations des citoyens, d’après Engie, qui s’engage à construire les projets avec les collectivités et à leur rendre des comptes. Ainsi, le groupe mènera la concertation autour des projets, via « un dispositif évolutif d’interactions avec les parties prenantes ». Il fournira également aux communes d’implantation des projets une évaluation des impacts positifs sur le territoire et sensibilisera ses salariés aux enjeux d’appropriation et d’intégration des projets dans les territoires. « Nous ne devons pas chercher l’acceptabilité des projets, estimait Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie lors de la conférence du 5 mai. Nous proposons une appropriation citoyenne et économique des projets. L’ensemble de ces engagements, qui va au-delà des exigences réglementaires en France, constituera à terme la référence pour le développement et l’exploitation des installations renouvelables d’Engie dans le monde ». Le producteur français d’hydrogène, H2V, annonce la création d’une gigafactory d’hydrogène renouvelable sur la commune de Thionville, en Moselle, en partenariat avec la plateforme logistique E-Log’In 4 et la Sodevam (Société de développement et d’aménagement de la Moselle). Le site sera situé sur une friche industrielle de 31 hectares et accueillera quatre unités de production de 100 MW. Il produira chaque année 56 000 tonnes d’hydrogène renouvelable par électrolyse de l’eau, grâce à de l’électricité verte, et permettra d’éviter 400 000 tonnes de CO2 par an. L’hydrogène produit sera destiné à l’avitaillement de véhicules lourds : bateaux, camions, véhicules utilitaires sur les espaces aéroportuaires et ferrés. H2V annonce un investissement de 500 millions d’euros et la création de 120 emplois directs et 100 emplois indirects. La mise en service de la première tranche est prévue en 2026. Le 26 avril a été publié au Journal Officiel le nouveau décret mettant en application le dispositif de certificats de production de biogaz (CPB), prévus par la loi Climat et résilience de 2021. Par ce nouveau dispositif, les fournisseurs qui souhaitent proposer des offres de gaz intégrant du biométhane devront restituer à l’État des CPB. Sur le modèle des garanties d’origine pour l’électricité verte, le producteur injectant du biométhane dans le réseau, obtient par la même occasion des certificats de production de biogaz. Ainsi, les fournisseurs de gaz peuvent les obtenir soit en produisant eux-mêmes du biométhane, soit en achetant les certificats à des producteurs. En complément des dispositifs de soutien actuels, le marché des CPB permettra d’impliquer davantage les fournisseurs dans le développement de la production de biométhane en France. Le gouvernement, après consultation avec les acteurs de la filière, a décidé de fixer la date d’entrée en vigueur de l’obligation au 1er juillet 2023. Seuls les fournisseurs commercialisant plus de 400 GWh de gaz par an seront concernés dans un premier temps, puis chaque année, ce seuil sera réduit de 100 GWh, pour concerner tous les fournisseurs au bout de 5 ans. Pour booster la production de gaz renouvelable, la Commission de régulation de l’énergie propose également, dans une délibération du 14 avril, de mettre en place des appels d’offres « réservés aux installations ne parvenant pas à se développer dans le cadre du dispositif de marché de CPB ». En région Occitanie, l’entreprise Seven poursuit l’extension de son réseau de stations BioGNC (Biogaz naturel comprimé). Moins de six mois après l’ouverture de la station d’Ayguesvives, en Haute-Garonne, l’opérateur vient d’inaugurer dans le Tarn celle de Saint-Sulpice. Soutenue par l’Ademe dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, cette nouvelle installation est le fruit de la coopération entre différents acteurs locaux, parmi lesquels figurent la région Occitanie, la communauté de Communes Tarn-Agout et la société publique locale d’Un Point à l’Autre. Le GNC est un gaz naturel utilisé comme carburant. Il s’agit d’une technologie mature et éprouvée puisqu’il est, depuis 2011, le premier carburant alternatif utilisé dans le monde. Le BioGNC, sa version renouvelable, provient du biométhane issu de la méthanisation des déchets organiques récoltés sur le territoire. Raccordée au réseau Teréga, opérateur de transport de gaz, la nouvelle station est dotée de quatre pistes d’avitaillement et offre un débit de 900 Nm3/h. Elle est accessible à tous types de véhicules GNC, du poids lourd à la voiture particulière. Un accord a d’ailleurs été signé pour que les quinze autocars du réseau régional de transport liO s’y ravitaillent. D’ici fin 2023, la station de Saint-Sulpice accueillera aussi une solution d’avitaillement pour les véhicules à hydrogène. Observ’ER vient de publier son étude annuelle de suivi du marché des pompes à chaleur (PAC) individuelles (jusqu’à 30 kW). Le marché des PAC aérothermiques a progressé de 12,4 % en 2021. Avec 1 011 410 unités vendues, il dépasse pour la première fois le seuil du million d’équipements installés en une année, hors chauffe-eau thermodynamiques. Par comparaison, l’ensemble des PAC géothermiques commercialisées l’an dernier ne totalisait que 3 220 appareils. Un résultat certes en hausse par rapport à 2020 (+7,2 %), mais qui reste en deçà du niveau d’avant la crise sanitaire (3 475 unités vendues en 2019). Ces équipements sont relativement chers à l’achat, notamment comparés à leurs équivalents aérothermiques, mais sont surtout mal connus du grand public. La mise en place de Coup de pouce chauffage, proposant une aide entre 2 500 et 4 000 euros, n’a pas permis au secteur de rebondir.En ce qui concerne l’aérothermie, les trois quarts du marché reviennent aux PAC air/air, qui progressent de 3,9 %. Les acteurs ont observé un recul des ventes en été, rappelant que, sur ce segment, les achats restent très dépendants des pics de chaleur. Toutefois, la progression de l’aérothermie est surtout due à la dynamique du marché des PAC air/eau qui croît de 48,6 %, avec 253 140 unités vendues. Les aides publiques comme Coup de pouce chauffage et MaPrimeRenov’, ainsi que le remplacement des équipements installés il y a une quinzaine d’années, ont porté l’activité en 2021.Enfin, les ventes de chauffe-eau thermodynamiques enregistrent également une très bonne année (+ 40 %) avec 153 300 unités écoulées et cela grâce notamment aux installations réalisées dans les logements neufs, dont les mises en chantier sont reparties à la hausse en 2021. Engie solutions annonce le développement futur d’un réseau de chaleur sur la commune de Sartrouville, via sa filiale Cristal Éco Chaleur. La ville a en effet approuvé le développement de ce réseau, en accord avec le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU), qui consistera en une extension de celui qui couvre déjà les communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles et Montesson (département des Yvelines). Ce réseau d’une longueur actuelle de 18 km fournit de l’eau chaude pour du chauffage collectif, et de l’eau chaude sanitaire à l’équivalent de 4 800 logements. Les travaux de l’extension de Sartrouville débuteront en septembre 2022 pour développer 2,7 km de canalisations supplémentaires, pour un raccordement des premiers consommateurs en avril 2023. Les 48 000 MWh thermiques distribués par ce réseau seront à 83 % issus de l’unité d’incinération des déchets (chaleur fatale) du SITRU, ce qui permet d’éviter 14 300 tonnes de CO2 par an. Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé, lance la première formation qualifiante d’installation et d’entretien de poêles à granulés. Cette initiative est venue de l’identification d’un point de tension sur la question du recrutement de professionnels qualifiés pour une filière qui a vu ses ventes très fortement progresser en 2021 (+ 41 % pour les poêles à granulés). Pour faire face à la forte croissance du secteur, Propellet estime un besoin de 370 installateurs supplémentaires en 2022, et de 960 en 2023. C’est dans ce contexte qu’un premier parcours de formation test a débuté le lundi 24 janvier 2022 avec huit adultes en recherche d’emploi. En partenariat avec le Pôle formation Isère, cette formation pilote a été financée par un Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED), dispositif de la Région Auvergne Rhône Alpes. À travers cette formation, Propellet s’engage à faire monter en compétences les professionnels déjà présents au sein de la filière mais également les chauffagistes souhaitant se former à ce mode de chauffage. Deux autres sessions de formation en alternance pour une dizaine de participants, sont d’ores et déjà prévues en 2022. L’objectif est de pérenniser cette formation et de la proposer à l’échelle nationale pour répondre au besoin important de recrutement et accompagner la croissance de la filière. Cette formation sera acceptée pour le référent technique dans le cadre de la qualication RGE Qualibois air. Le réseau de chaleur déployé par Engie Solutions dans la ville de Compiègne (Hauts-de-France) affiche désormais 65 % d’énergie renouvelable dans son mix grâce à la mise en service d’une chaufferie biomasse de 14 MW. La chaufferie est approvisionnée directement en palettes non réutilisables et en résidus de l’exploitation forestière. 80 % du bois consommé proviennent d’un rayon inférieur à 100 km. Au-delà de l’aspect énergétique et environnemental, la récupération et valorisation de cette ressource locale répond également à l’envolée des prix des énergies fossiles. Le choix d’une ressource locale stable, associé à un taux de TVA réduit (5,5 %) ouvert à tous les réseaux proposant au moins 50 % de chaleur verte, est un levier non négligeable pour stabiliser les prix pour les abonnés. Le réseau de chaleur de Compiègne sillonne la ville grâce à ses 16 km de canalisations qui fournissent chauffage et eau chaude sanitaire à 9 000 équivalents logements dont 6 000 foyers. Avec un mix énergétique majoritairement renouvelable, le réseau permettra d’éviter l’émission de 12 000 tonnes de CO2 par an. L’investissement nécessaire à cette opération s’est élevé à 11,2 millions d’euros et l’opération a reçu un soutien de l’Ademe à hauteur de 4,83 millions d’euros dans le cadre du Fonds Chaleur. L’opérateur et développeur spécialisé dans la production de biogaz, Evergaz, annonce la mise en service de l’unité de méthanisation de Prémery située dans la Nièvre (58) et d’ une capacité de 150 Nm3/h. Cette nouvelle unité utilise le procédé DualMetha, mis au point par Evergaz, qui est une méthanisation dite « immergée ». Elle combine la méthanisation en voie sèche discontinue avec la voie liquide continue dans le but de traiter tout type de matières sans aucune préparation. Un procédé plus économe car l’utilisation de tout type d’intrants implique une absence de préparation des matières et évite les stades de broyage, de séparation des indésirables et de dilution. La sortie des digestats par grappin évite aussi la présence d’une coûteuse presse à vis traditionnelle. DualMetha est un procédé français, lauréat d’un Programme d’Investissement d’Avenir de l’Ademe. Beau temps pour la société Geoven, filiale de Georhin, ex-Fonroche Géothermie, qui porte le projet de géothermie profonde sur le site de Vendenheim, en Alsace. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, jeudi 24 mars, les arrêtés pris par la préfecture du Bas-Rhin entre décembre 2020 et octobre 2021 ordonnant l’arrêt définitif des opérations de forage sur le site puis l’arrêt définitif des travaux par l’exploitant. Ces différents arrêtés avaient été pris en réaction à un séisme de magnitude 3,59 survenu à Strasbourg le 4 décembre 2020, après une série d’autres séismes ayant eu lieu depuis un an à proximité des forages. Le tribunal de Strasbourg a estimé que la préfecture ne pouvait pas légalement ordonner l’arrêt définitif de l’ensemble des travaux entrepris par la société. Il estime également que Fonroche Géothermie avait pris les mesures nécessaires dès la survenue du séisme du 4 décembre 2020, en arrêtant immédiatement les travaux. Placé en début d’année sous le régime de la procédure de sauvegarde en attendant le résultat des recours contre les arrêtés préfectoraux, Géorhin indique s’appliquer en priorité à mener à bien la gestion des réclamations liées aux séismes. La société attend également les résultats de l’expertise demandée par la préfecture du Bas-Rhin, qui devaient être rendus fin mars mais qui ont été repoussés. Celle-ci étudie, quant-à-elle, la possibilité de faire appel devant la cour administrative d’appel de Nancy. L’étude de l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) sur le suivi du marché français des appareils de chauffage domestique au bois vient d’être mise en ligne et les résultats sont très bons. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et un recul des ventes de 16 %, le marché retrouve le chemin de la croissance en 2021, avec + 34,4 % par rapport à 2020. Ces bons résultats ont principalement été portés par les segments des appareils automatiques à granulés, tels que les chaudières automatiques dont les ventes ont plus que doublé (+ 119,6 % pour 31 910 unités). Autre marché particulièrement dynamique, celui des poêles automatiques qui progresse de 43,2 % (174 020 unités). Sur l’ensemble des ventes en 2021, l’activité des appareils à granulés (tous types confondus) dépasse pour la première fois celle des appareils à bûches, avec respectivement 213 340 unités vendues contre 209 590. Pour sa part, le marché des foyers et inserts, avec 63 780 unités vendues, affiche certes une croissance par rapport à 2020, mais reste cependant sur la tendance décroissante des 10 dernières années. Les ventes de ce segment ont en effet été divisées par trois depuis 2011. Enfin, le marché des cuisinières se marginalise toujours davantage avec une baisse de 17,3 % en 2021. Il ne représente plus qu’un marché de niche, totalisant 2 710 unités vendues. Le Groupe d’experts intergouvernemental pour l’évolution du climat (GIEC) vient de publier son rapport sur l’« Atténuation du changement climatique ». Ce dernier préconise pour l’avenir l’élaboration d’un monde largement électrifié et « alimenté principalement par des énergies renouvelables ». Entre 2010 et 2019 les coûts de l’énergie solaire ont diminué de 85 % en moyenne, de 55 % pour l’éolien, de 85 %pour les batteries lithium-ion, et leur vitesse de développement a explosé. L’attrait économique de ces solutions fait que dans certaines régions elles sont même devenues moins coûteuses à mettre en œuvre que leurs alternatives fossiles. Malgré tout, le monde n’est pas sur la bonne voie, car les subventions aux énergies fossiles bloquent les transformations nécessaires qui permettraient d’éviter d’atteindre 3°C de réchauffement climatique d’ici 2100. À elles seules, les infrastructures fossiles existantes conduisent à un large dépassement du budget carbone restant pour contenir la hausse à 1,5°C. Pire, de nouvelles infrastructures sont malheureusement encore aujourd’hui financées. Bien que les investissements dans les énergies renouvelables aient considérablement augmenté, ils n’ont pas permis de réduire suffisamment ceux dans les énergies fossiles, notamment parce que, et c’est un point clé du rapport, les bénéfices pour la société liés aux émissions de CO2 évitées ne sont pas assez pris en compte. Pour Laurence Tubiana, directrice générale de la European Climate Foundation : « Les nouvelles infrastructures de gaz, de pétrole et de charbon ne se contenteront pas d’empirer les coups climatiques auxquels nous sommes déjà confrontés, mais elles alimenteront également l’effrayante spirale géopolitique des énergies fossiles, si souvent liées aux tensions, aux conflits et à la volatilité économique ». Le rapport rappelle également que les pays riches émettent toujours la grande majorité des gaz à effet de serre, au détriment de ceux qui en émettent le moins, et qui sont également les plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique. Engie BiOZ (filiale du groupe Engie) et CVE, producteur français d’énergies renouvelables ont inauguré le 17 mars dernier une unité de méthanisation, après huit ans de développement, et située à Saint-Antoine-de-Breuilh en Dordogne (Nouvelle-Aquitaine). Le site est alimenté en matières organiques issues des distilleries, des industries agroalimentaires, papetières et des filières agricoles de proximité dans un rayon de 60 kilomètres autour de l’unité. Le biométhane produit est directement injecté dans les réseaux de gaz naturel de Nouvelle-Aquitaine, soit l’équivalent de la consommation en gaz de 1 800 foyers. Avec un investissement de près de 10 millions d’euros, ce projet a reçu le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine (350 000 euros), de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine (950 000 euros) et du Fonds européen Feder (722 000 euros). L’association européenne du solaire thermique Solar Heat Europe vient de livrer ses estimations de marché pour les années 2021 et 2022. Après une année 2020 relativement mauvaise, l’association est plutôt optimiste. D’après elle, 2021 a marqué un retour en force pour la filière du solaire thermique qui devrait se confirmer en 2022. D’après l’enquête de Solar Heat Europe menée auprès de ses membres, la croissance observée pourrait être la plus forte depuis l’année 2008. La capacité totale installée en Europe devrait dépasser les 38 GW de capteurs solaires, soit 27 TWh de chaleur produite. La capacité de stockage thermique est estimée à plus de 187 GWh, plaçant cette technologie comme la première des énergies renouvelables en termes de stockage de chaleur. Les deux principaux marchés européens, à savoir l’Allemagne et la Grèce, ont cependant suivi des tendances assez différentes entre 2020 et 2021. En Allemagne, premier marché européen, les ventes ont connu une croissance de 26 % en 2020 et sont restées stables sur 2021, à 450 MW. La Grèce, quant à elle, a vu ses ventes diminuer de 15,7 % en 2020, puis rebondir de 18 % en 2021, pour atteindre 251 MW. La production de panneaux grecs a connu une augmentation de 27 %, s’expliquant par une forte hausse des exportations, qui absorbent désormais 65 % de la production totale. La croissance est appelée à se poursuivre en 2022 estime l’association. Le 17 mars le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et les quatre gestionnaires de réseaux de gaz français ont annoncé la publication de la 7e édition du Panorama des gaz renouvelables en France, dressant l’état des lieux du biométhane injecté dans le réseau de gaz. Avec 151 nouveaux projets mis en service en 2021, soit une croissance de 71 % par rapport à l’année précédente, la France dispose d’une capacité de production de 6,4 TWh/an. L’an dernier, 4,3 TWh de biométhane ont été injectés dans le réseau, soit près de 1 % de la consommation de gaz naturel française. L’objectif officiel à 2023 pour cette filière (6 TWh) est ainsi d’ores et déjà dépassé. Ceux pour 2028, entre 14 et 22 TWh représentant de 7 % à 10 % de la consommation de gaz, pourraient, pour leur part, être atteints très rapidement. En effet, plus de 1 000 projets sont actuellement à diverses étapes de développement et l’équivalent de 19 TWh de capacité de production se trouve en file d’attente, soit un total de plus de 25 TWh avec les unités déjà raccordées. La dynamique de la méthanisation ne cesse de s’accélérer, mais des freins subsistent pour l’injection. La guerre en Ukraine remet pourtant au cœur de l’actualité la dépendance de l’Europe et de la France aux gaz fossiles, notamment à la Russie, ce qui montre plus que jamais l’importance de développer les gaz renouvelables. Or, d’après Jean-Louis Bal, président du SER : « Si l’État fait accélérer l’instruction des dossiers en file d’attente par ses services et garantit un dispositif de soutien stable, on connaîtra une forte accélération du nombre de nouveaux projets. Dans ces conditions, les gaz renouvelables pourraient représenter 20 % de notre consommation de gaz en 2030. » Ce dernier appelle donc à des mesures ambitieuses comme le raccourcissement des délais d’obtention des autorisations administratives et l’allongement de la durée réglementaire autorisée pour les mises en service. D’après le SER les nouvelles filières comme la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale nécessitent également des mécanismes de soutien personnalisés pour émerger. Le Suédois Vattenfall a inauguré aux Pays-Bas, le 22 mars dernier, sa première centrale hybride baptisée « Energypark Haringvliet » combinant éolien et solaire couplée à des batteries. Situé à 20 kilomètres de Rotterdam, le site est composé de six éoliennes, 115 000 panneaux photovoltaïques et de douze conteneurs de batteries pour une production annuelle estimée à 140 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 40 000 foyers hollandais. Le couplage de l’éolien, du solaire et des batteries avec une même connexion au réseau permet de lisser la production d’électricité tout au long de l’année. La mutualisation des câbles de raccordement à la sous-station permet aussi de réduire les coûts de maintenance et l’impact sur l’environnement. Lancés en octobre 2020, les travaux de l’unité biomasse de Montigny-lès-Metz (Moselle) viennent de s’achever avec son inauguration le 10 mars dernier par l’exploitant UEM et les élus de la ville. Construite sur un terrain cédé par l’armée, l’unité, alimenté à 70 % pour du bois issu d’un rayon de moins de 100 kilomètres de la ville, permettra d’éviter le rejet de 3 000 tonnes de CO2 par an. À ce jour, deux kilomètres de réseaux de chauffage urbains sont déjà en service et desservent les casernes Raffenel-Delarue et Colin, ainsi que les logements sociaux de l’OPHMM, d’ICF et de Moselis. D’ici quelques mois, onze bâtiments communaux, situés sur le tracé du réseau, seront raccordés. Dans le cadre de son schéma de transition énergétique et écologique, Clermont Auvergne Métropole annonce l’extension de la station d’épuration des Trois Rivières, située à Clermont-Ferrand. Les travaux ont pour objectif d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées et pluviales avec la construction des six bassins de stockage-restitution pour une meilleure qualité de l’eau (conforme aux normes européennes) lors des rejets dans la rivière Artière après épuration. La deuxième tranche des travaux comprendra la construction d’un méthaniseur pour la production de biogaz. Le coût global de ce projet de 55 millions d’euros sera financé par Clermont Auvergne Métropole avec l’aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’Ademe et la Région Auvergne Rhône Alpes. Financés pour 35 millions d’euros par la Métropole, un peu plus de 20 millions pour l’Agence de l’eau, et la Région. Fin des travaux prévue en 2024. Filière encore confidentielle, la gazéification hydrothermale est une technologie permettant de valoriser des déchets organiques humides, tels que les boues de stations d’épuration ou boues de curage et dragage (canaux, ports et canaux), afin de produire du gaz renouvelable (biométhane) injecté dans le réseau. Un groupe de travail dédié à cette nouvelle filière, piloté par le transporteur de gaz GRTGaz, estime qu’il existe un gisement potentiel de 400 millions de tonnes annuelles de déchets biomasses humides qui, par ce procédé, pourrait permettre de produire plus de 50 TWh de gaz à l’horizon 2050, équivalent à 15 % de la consommation de gaz de la France à cette date. Le groupe de travail national rassemble une quarantaine d’acteurs dont l’objectif est d’accompagner la structuration de la filière. Il participe à la définition d’un cadre national d’ici 2024, devant faciliter le déploiement effectif de la gazéification hydrothermale en France. Dans la cadre de sa politique de transition énergétique, Tours Métropole Val de Loire a confié en 2019 à Tours Métropole Énergies Durables, filiale d’Engie Solutions, la création de son nouveau réseau de chaleur à travers une délégation de service public de 23 ans. Ce contrat prévoit le déploiement de 17 km de canalisations. Dès 2024, l’équivalent de 10 000 logements et près de 30 bâtiments publics bénéficieront de chauffage et d’eau chaude sanitaire produits à 74 % à partir de biomasse. Après la mise en place d’une première chaudière biomasse en 2020, une seconde vient d’être inaugurée, toujours alimentée exclusivement par des plaquettes de bois issues de forêts locales situées dans un rayon maximal de 100 kilomètres, avec la création de 5 emplois. À ce jour, plusieurs bâtiments emblématiques de Tours bénéficient déjà de ce réseau de chaleur : Mame et les Beaux-Arts, l’Hôpital Bretonneau et Clocheville, ou encore les logements de Tours Habitat et de Ligéris. ilek, fournisseur français d’énergie verte (électricité et gaz) pour particuliers et petites entreprises, vient de clôturer avec succès sa première campagne de financement participatif pour le développement d’un projet de méthaniseur dans le Maine-et-Loire. En partenariat avec Enerfip, une plateforme de financement participatif dédiée aux projets d’énergie renouvelable, une somme de 500 000 euros a été levée en 5 jours grâce à la participation de 200 clients. Cette unité de méthanisation, baptisée Cop’Vert, est située dans une exploitation d’élevage de vaches laitières. Sa construction a débuté en janvier 2021 pour une mise en service prévue au premier trimestre 2022. À terme, plus de 10 870 tonnes de matières organiques seront traitées chaque année par l’installation, qui produira environ 10,6 GWh de biométhane par an. Cela représente l’équivalent de la consommation de gaz annuelle de près de 915 foyers. Avec cette action, ilek cherche à élargir son champ d’action en permettant à ses clients de placer une partie de leur épargne pour financer des projets d’énergie verte. Pour l’année en cours, l’objectif est de lever 5 millions d’euros pour financer une dizaine de projets sur toute la France, et jusqu’à 30 millions d’ici à 2025. La prochaine opération portera sur un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui lance un projet de trois parcs photovoltaïques dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Var et du Vaucluse. L’objectif sera de lever 395 000 euros pour ces parcs qui, une fois en service, vendront leur énergie à ilek et permettront d’alimenter environ 4 220 personnes en électricité 100 % renouvelable. Propellet France, l’association nationale du chauffage au granulé de bois, a publié en ce début d’année une note de huit pages, afin d’expliquer l’augmentation du prix du chauffage à granulés. En effet, le prix du granulé au départ d’usine est passé de 220 € la tonne en janvier 2021 à 350 €/tonne en janvier 2022. Cette augmentation serait due à une « surchauffe conjoncturelle », estime l’association. Les ventes d’appareils à granulés ont plus que doublé entre 2020 et 2021, grâce aux aides nationales et aux politiques de sorties des chaudières au fioul et au gaz. D’autre part le marché européen sort d’une période de quasi surproduction de granulés, conduisant à une suroffre et des prix très bas provenant de l’étranger jusqu’au printemps 2021. Mais la crise de l’énergie que nous vivons a fortement impacté les usages des granulés, qui ont été davantage utilisés dans plusieurs pays pour produire de l’électricité, et pour devenir une source de chauffage principal. La hausse des prix a pu affoler certains consommateurs qui ont décidé d’en stocker plus que nécessaire, produisant l’effet « papier toilette » observé lors du premier confinement provoqué par la pandémie de Covid-19. Globalement, Propellet cherche à rassurer les consommateurs qui pourraient voir dans cette situation exceptionnelle une tendance de fond. Bien que les prix ne devraient pas retrouver leur niveau de 2020, cette énergie reste toujours très économique par rapport au gaz (50 % plus cher) et à l’électricité (trois fois plus chère), rappelle l’association. HyDeal España engage sa phase opérationnelle et entend débuter la production d’hydrogène vert à partir d’électricité photovoltaïque dès 2025. Issue de l’initiative HyDeal Ambition, HyDeal España est une joint venture créé en novembre dernier par l’entreprise spécialisée dans la production d’hydrogène DH2 Energy, le groupe sidérurgique ArcelorMittal, le transporteur de gaz espagnol Enagás et le conglomérat de l’industrie chimique Grupo Fertiberia. Le projet consiste en une plateforme de production d’hydrogène située dans le nord de l’Espagne, qui affichera une capacité photovoltaïque totale d’ici 2030 de 9,5 GW pour 7,4 GW d’électrolyseurs. L’hydrogène sera livré à un complexe industriel situé dans la région des Asturies, au nord du pays. La taille du projet devrait lui permettre d’atteindre des coûts de production d’hydrogène vert « compétitif ». De futurs clients comme ArcelorMittal ou Grupo Fertiberia ont rejoint le projet afin de décarboner leurs procédés industriels, grands consommateurs d’hydrogène gris. À terme, l’hydrogène de HyDeal España devrait remplacer l’équivalent de 5 % des importations de gaz fossile de l’Espagne, et réduire de 4 % les émissions de CO2 du pays. Le Syndicat des énergies renouvelables, RTE, Enedis et l’agence ORE ont publié le 17 février la 29e édition du Panorama de l’électricité renouvelable. Il détaille la production et le parc installé, par technologie et par région, au 31 décembre 2021. Près de 4 GW (3 951 MW) ont été installés durant l’année, dont 2 687 MW pour le photovoltaïque et 1 202 MW pour l’éolien. Le parc total de production d’électricité renouvelable, toutes filières confondues, s’établit désormais à 59 781 MW, et a produit 117,5 TWh d’électricité sur les 12 mois précédents. Cela correspond à 24,9 % de la consommation d’électricité française sur la même période. L’hydroélectricité reste de loin la première source mais stagne avec une production annuelle de 58,4 TWh, soit 49,7 % du total produit par les sources renouvelables, et représente un parc de 25 718 MW. Seconde technologie, l’éolien a produit 36,8 TWh sur la période, en baisse de 7,2 % par rapport à l’année précédente, qui avait été exceptionnellement ventée. Le parc éolien installé s’élève à 18 783 MW au 31 décembre. Enfin sur la troisième marche, le solaire photovoltaïque a quant à lui connu sa meilleure année en termes d’installation et passe de 10 380 MW en 2020 à 13 067 MW. Sa production sur la période s’élève à 14,3 TWh, en hausse de 12,6 %. Nouveauté 2022, ce panorama compare les installations en service et en projet dans chaque région aux objectifs définis dans les schémas de planification régionaux (SRADDET). La Ville de Lyon annonce que l’école Simone Signoret, située dans le 8e arrondissement, est désormais chauffée à 25 % par du biogaz provenant, via des garanties d’origine, de l’unité de méthanisation Chand’énergies, située dans l’Ain. Ce site, mis en service en novembre 2020 par deux agriculteurs, traite des déchets agricoles locaux et plus particulièrement des effluents d’élevage pour une valorisation de 10 000 tonnes de matières organiques par an, soit du chauffage pour 2 400 équivalents-logements. Les élèves sont aussi associés à ce projet avec la mise en place, depuis le début de l’année, d’un projet éducatif baptisé « Défi class’énergie », piloté par l’Agence locale de l’énergie, ayant pour mission de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. L’utilisation du biogaz n’est pas nouvelle pour la ville de Lyon qui chauffe déjà une quarantaine de bâtiments municipaux, tels que l’Hôtel de Ville, 5 mairies d’arrondissement, 4 piscines d’hiver, 9 écoles et 9 crèches, ainsi qu’un établissement culturel ou sportif par arrondissement (Maison de la Danse, musée des Beaux-arts, patinoire Charlemagne, etc.). Le 10 février dernier, le Syndicat des énergies renouvelables a présenté le second volet de son Livre blanc, qui contient notamment 10 mesures indispensables à mettre en œuvre dans le prochain quinquennat. Pour son président Jean-Louis Bal, « La France doit dès à présent passer à la vitesse supérieure en matière de renouvelables. […] les candidats doivent se saisir des outils déjà existants et être en capacité d’en faire émerger de nouveaux ». Le SER estime par exemple indispensable de créer un « Fonds social pour le climat » pour protéger les plus vulnérables ou de mettre en place des formations professionnalisantes pour décrocher un emploi compatible avec la transition énergétique. Il demande également un programme industriel pour renforcer la souveraineté dans les technologies stratégiques, à l’instar des renouvelables, tout en programmant une sortie des énergies fossiles dans les secteurs qui en sont encore trop dépendants. Tout ceci ne pourra se faire sans un « programme national d’information » sur les énergies renouvelables pour un débat éclairé. 50 mesures sectorielles ont également été élaborées afin de guider les différents secteurs des politiques publiques. Produire du lithium localement et avec une faible empreinte environnementale : c’est l’un des enjeux du développement croissant des véhicules électriques en Europe. Grâce au projet de recherche et d’innovation européen EuGeli (European Geothermal Lithium Brines), une piste sérieuse se dessine. Achevé en décembre dernier après trois ans de travail et financé par l’Institut Européen d’Innovation et de technologie, celui-ci a permis de développer un procédé d’extraction du lithium des saumures géothermales situées à la frontière franco-allemande. Concrètement, des colonnes sont remplies d’un matériau adsorbant qui capte de façon sélective le lithium dans les saumures. Ces colonnes peuvent être installées sur la branche de réinjection d’un puits de géothermie existant, ce qui offre l’avantage de pouvoir exploiter sur un même site le métal et la chaleur géothermique. Un fois adsorbé, le lithium est récupéré en faisant passer de l’eau légèrement saline dans les colonnes. Une solution concentrée en lithium est obtenue, qui doit être purifiée avant la précipitation du carbonate de lithium de qualité batterie. Dans le cadre du projet, mené par huit partenaires français, allemands et belges sous la coupe du groupe français Eramet, deux pilotes d’extraction ont été réalisés avec succès sur un puits de géothermie en Alsace. Prochaine étape : trouver un modèle économique pour rendre possible une exploitation du procédé à l’échelle industrielle, avec en ligne de mire la réduction d’importation de lithium d’Amérique Latine, d’Australie et de Chine. Le 28 mars prochain, La Poste mettra en circulation un timbre à l’effigie du four solaire d’Odeillo, situé sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via dans le département des Pyrénées-Orientales. On doit le four solaire d’Odeillo à Félix Trombe qui, en 1946, dirige le laboratoire du CNRS des terres rares à Meudon. Il parvient à concentrer la lumière du soleil à l’aide d’un miroir pour obtenir de hautes températures en milieu confiné avec pour objectif de fondre des minerais de terres rares et d’extraire des matériaux purs afin d’étudier leurs propriétés. En 1947, le laboratoire est transféré à Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales et devient une unité de recherche dédiée à l’énergie solaire. C’est en 1963 qu’est construit le four solaire d’Odeillo sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, à dix kilomètres de Mont-Louis. Plus grand que l’arc de triomphe, il mesure 54 mètres de haut, 48 mètres de large et possède 63 miroirs pour une puissance de 1 000 kW. Aujourd’hui, le four solaire d’Odeillo est un laboratoire du CNRS, le laboratoire Promes (Procédés, Matériaux, Énergie Solaire), une infrastructure de recherche nationale et européenne, spécialisée dans l’étude des matériaux en conditions extrêmes (industrie, domaine spatial, centrales solaires…), et dans la conversion, le stockage et le transport de l’énergie. À l’issue d’un webinaire qui s’est déroulé le 27 janvier, l’association négaWatt a présenté un certain nombre de propositions afin d’abreuver le débat pour la présidentielle 2022 : « Les mesures structurantes à engager lors du prochain quinquennat ». Celles-ci se basent sur son scénario publié fin 2021 afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Parmi les mesures proposées, l’association appelle les candidats à engager un grand programme de rénovation performante des bâtiments. En 2030, la France devrait ainsi viser environ 3 millions de maisons individuelles, 1,3 millions de logements sociaux et 640 000 logements en copropriété rénovés au niveau Bâtiment basse consommation (BBC-rénovation) ou équivalent. Pour cela, les trois mesures clés proposées sont une loi de programmation de la rénovation performante, un plan de formation des artisans et un accompagnement assorti de financements simplifiés des projets de rénovation. L’association invite également à réorienter la stratégie industrielle de la France vers les industries comme celle de l’éolien offshore, de la méthanisation, du photovoltaïque et des batteries, industries essentielles à la décarbonation des transports, secteur le plus en retard. Dans l’optique d’un scénario sans nucléaire, négaWatt appelle non seulement à planifier l’arrêt progressif d’exploitation des 56 réacteurs existants, mais également à ne pas démarrer l’EPR de Flamanville ni lancer la construction d’aucun autre réacteur de nouvelle génération. NégaWatt proposera également des webinaires thématiques tout au long de l’année 2022 pour détailler ces mesures. Le développeur breton d’hydroliennes sous-marines, Sabella et l’Écossais Nova Innovation, spécialiste en énergies marines annoncent l’obtention d’une concession de 12 MW d’hydrolien au large de l’île de Holy Island, à Anglesey au Pays de Galles pour une superficie de 0,65 km2. Les hydroliennes des deux constructeurs seront immergées et posées sur fonds marins pour une puissance de 6 MW chacune – de quoi alimenter jusqu’à 10 000 foyers par an, selon le groupe Sabella. Ce partenariat franco-écossais s’intègre au projet gallois baptisé « Morlais », qui couvre une superficie de 35 km2 en mer avec un potentiel de 240 MW et pour objectif l’alimentation du réseau électrique d’Anglesey. Les turbines devraient être mises à l’eau en 2023 ou 2024. Observ’ER vient de publier la douzième édition de son baromètre des énergies renouvelables électriques en France. L’ouvrage présente en détail, et par région, l’actualité des huit filières principales de production d’énergie renouvelable électrique sur les 12 derniers mois afin d’éclairer les territoires sur leur trajectoire en matière de transition énergétique. Si au niveau régional, les filières poursuivent leur développement avec une part croissante de projets portés par les collectivités, le retard du pays sur ces filières est de plus en plus flagrant. En effet, la France n’a pas respecté son engagement d’atteindre 27 % de part de renouvelable dans sa consommation totale électrique en 2020. Cette part n’était que de 24,7 % fin 2020. Le prochain objectif du pays est 40 % d’électricité renouvelable en 2030, ce qui ne pourra pas non plus être atteint sans un changement de politique. Certes, le photovoltaïque a connu une très bonne année 2021, avec entre 3 et 3,5 GW de nouvelles capacités raccordées. Mais le solaire va devoir conserver ce même rythme annuel sans faillir durant les sept années à venir, pour espérer revenir dans la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Un pari difficile car la croissance actuelle du photovoltaïque est basée à plus de 70 % sur des grandes centrales au sol, soit des projets qui se heurtent de plus en plus à des limites foncières et d’acceptabilité. Quant à l’éolien terrestre, son rythme de croissance reste désespérément lent. La filière progresse en moyenne d’un seul GW par an alors qu’elle devrait en faire au moins le double. Résultat, l’éolien commence lui aussi à sortir de sa trajectoire et à cumuler du retard. Ainsi, à fin 2028, ce sont entre 15 et 20 GW qui risquent de manquer au pays pour ces deux filières par rapport à ce qui est prévu par la PPE. L’entreprise Hype, plateforme de mobilité hydrogène, vient d’annoncer deux partenariats. Le premier a été conclu avec le producteur français d’énergies renouvelables Akuo. Le projet est de constituer sur la période 2022–2024 le premier écosystème de mobilité hydrogène pour le territoire francilien, notamment en combinant leurs projets Last Mile et H24byHyp. À terme, l’objectif est de permettre le déploiement en Île-de-France d’au moins 20 stations hydrogène de grande capacité (1 tonne/jour) et 6 stations de plus petite taille à l’horizon 2024. Cette étape est importante dans le programme de Hype qui vise à développer une flotte de 10 000 taxis hydrogène mais également d’utilitaires, de bus ou de camions bennes à ordures ménagères. Le second partenariat concerne Ecolotrans, spécialiste de la logistique urbaine écologique. Hype va faciliter l’intégration de la solution hydrogène au sein de la flotte d’Ecolotrans et l’accompagnera dans le déploiement d’une offre de services d’écomobilité dédiée aux professionnels de la logistique du dernier kilomètre appelée Ecolorent. Le 1er janvier 2022, Isabelle Guichard a été nommée Directrice Générale du Pôle de compétitivité DERBI, en remplacement de Gilles Charier. Avant de rejoindre DERBI, elle occupait le poste de Déléguée aux Affaires Européennes pour le Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. La FNCCR et Efficacity lancent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour aider les collectivités à développer ou à optimiser leurs réseaux de chaleur et de froid. Efficacity, institut de recherche dédié à la transition énergétique et écologique des villes, ainsi que le Centre Scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ont développé l’outil PowerDIS pour simuler, à l’échelle d’un quartier, tous les flux énergétiques. Ainsi il permet aux collectivités d’évaluer et de comparer un grand nombre de solutions techniques envisageables pour leurs réseaux. Dans le cadre de cet AMI, l’accompagnement est financé à 50 % par Efficacity. Il vise à étudier la possibilité de généraliser cet outil auprès des collectivités ou de l’aménageur en charge du réseau de chaleur, afin d’accélérer la transition énergétique des villes pour l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 mars 2022. Le groupe H2V, producteur et développeur français d’hydrogène renouvelable, et le port de Marseille Fos annoncent la construction d’un site de production d’hydrogène renouvelable dans la zone du Caban à Fos-sur-Mer. Le projet a pour objectif la décarbonation de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer en substituant la consommation d’hydrogène d’origine fossile par celle d’hydrogène vert et sera déployé sur une surface de 36 hectares. L’usine de production sera composée de six unités d’électrolyse de 100 MW chacune, soit 600 MW pour une production annuelle d’hydrogène estimée à 84 000 tonnes par an. L’hydrogène sera produit par électrolyse de l’eau grâce à de l’électricité d’origine renouvelable, via l’achat de garanties d’origine. Cette opération de 750 millions d’euros permettra la création de 165 emplois directs et 100 emplois indirects avec pour objectif d’éviter le rejet de 750 000 tonnes de CO2 par an. La mise en service des six tranches de 100 MW sera échelonnée entre 2026 et 2031. H2V a déjà lancé deux autres projets similaires ces dernières années. Son projet d’usine d’électrolyse de 200 MW dans la zone industrielle de Port-Jérôme (Seine-Maritime) a été racheté en octobre dernier par Air Liquide et rebaptisé Air Liquide Normand’Hy. Il devrait entrer en service en 2025. Le projet H2V59 vise pour sa part à créer une usine de production d’hydrogène vert, également de 200 à 300 MW, sur le Grand Port Maritime de Dunkerque (Nord). Sa mise en service pourrait aussi intervenir d’ici 2025. Depuis le 1er janvier dernier, Séverine Jouanneau Si Larbi, est Déléguée Générale de Tenerrdis, pôle de compétitivité dédié à la transition énergétique basé à Grenoble. Elle succède à Elisabeth Logeais. Séverine Jouanneau Si Larbi travaillait précédemment au CEA-Liten, centre de recherche européen dédié à la transition énergétique. Le solaire thermique reprend du poil de la bête en Autriche. Après 12 ans de baisse du chiffre d’affaires du secteur, la dégringolade a cessé en 2021. Lors du second semestre, les surfaces raccordées ont enregistré un bond, notamment grâce aux projets de grande taille comme celui de Friesach comptant 5 740 m2 de capteurs. Début 2022, on ne recense pas moins de 13 projets d’envergure en phase d’étude dans le cadre du programme de soutien national autrichien. Ces projets représenteraient une surface de capteurs de 303 107 m², c’est-à-dire 212 MW. Ce chiffre impressionnant correspondrait à quatre fois le chiffre installé en 2020 (53 MW). GreenOneTech, leader du secteur en Europe et basé en Autriche, a vu son chiffre d’affaires augmenter en 2021 de plus de 80 % par rapport à l’année précédente, d’après son directeur Robert Kanduth. Ce rebond du solaire thermique est tout de même conditionné à une forte volonté politique, à l’image du Fonds pour le climat et l’énergie qui a vu son budget croître de 45 millions d’euros en mai 2021. En octobre 3,5 millions d’euros ont ainsi été alloués à quatre projets à l’issue d’appels à candidatures. Trois études de faisabilité, dont le potentiel pourrait représenter 54 580 m², ont également obtenu 206 350 euros de financement. La prochaine session d’appels à candidatures aura lieu courant avril 2022. Le ministre allemand de l’Économie et de la Protection du climat, Robert Habeck, a présenté mardi 11 janvier un rapport sur l’avancement de son pays en matière de transition énergétique. Globalement, le bilan n’est pas bon et le ministre a pointé le retard dans l’effort de réduction des émissions de CO2. Alors que le pays devait les avoir abaissé de 40 % en 2020 par rapport à 1990, la baisse n’est que de 38 % fin 2021. Pourtant l’ambition de l’Allemagne est de baisser ses émissions de 65 % d’ici 2030 avant d’atteindre la neutralité carbone en 2045. Robert Habeck a ainsi annoncé une série de mesures destinées à corriger rapidement le tir. La nouvelle coalition au pouvoir entend notamment porter la part des énergies renouvelables à 80 % dans sa consommation d’électricité d’ici à 2030. Parmi les actions les plus significatives figure la révision d’ici au printemps de la loi sur les énergies renouvelables (loi EEG). Outre une augmentation des volumes d’appel d’offres, la nouvelle mouture de la loi entérinera le principe selon lequel l’expansion des énergies renouvelables sert un intérêt général primordial et participe à la sécurité du pays. Pour développer l’éolien terrestre, chaque Land devra consacrer 2 % de sa surface à l’éolien. Fin 2020, seul 0,8 % du territoire était ouvert à la construction de parcs, dont 0,5 % effectivement disponible. Les servitudes liées aux radars météorologiques militaires seront revues afin de libérer des terrains pour l’éolien. Pour sa part, le photovoltaïque sera rendu obligatoire sur toute nouvelle construction. En termes de capacité en service en 2030, le gouvernement vise 200 GW pour le photovoltaïque (54 GW fin 2020), 100 GW pour l’éolien terrestre (55 GW fin 2020) et 30 GW pour l’éolien en mer (7,8 GW fin 2020). Cela suppose d’installer jusqu’à 15 GW d’éolien et 20 GW de solaire par an, d’ici la fin de la décennie. Le pays veut aller vite car l’ensemble des mesures annoncées devraient être opérationnelles à la fin de l’année 2022. Teréga, opérateur du réseau de transport de gaz du sud ouest de la France, devient mécène du projet « Biogaz » initié par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique (AFDET). Ce mécénat a pour but de sensibiliser les élèves et apprentis de la 6ème au BTS aux énergies renouvelables et à la filière biogaz en particulier. Pendant deux ans, Teréga va mettre à la disposition des enseignants des ressources pédagogiques, qui seront disponibles sur la plateforme pédagogique ETINCEL. Les contenus du projet « Biogaz » se feront en collaboration avec les équipes pédagogiques du Campus des métiers et des qualifications Transition Énergétique rattaché au lycée des métiers de l’habitat, des énergies et de l’automobile Sixte-Vignon, situé dans les Hautes-Pyrénées. Reyssouze Energie Services, filiale d’Engie Solutions, annonce l’achèvement de l’extension du réseau de chaleur de Bourg-en-Bresse (Ain) et le lancement des travaux d’une chaufferie biomasse. Le réseau actuel, de huit kilomètres et raccordé à 3 500 équivalents logements (principalement des logements sociaux), vient de s’étendre avec un kilomètre supplémentaire. Cette extension, raccordée à 500 équivalents logements, sera en activité lors de la mise en service de la chaufferie biomasse en 2022. Cette nouvelle chaufferie sera alimentée en plaquettes forestières provenant d’un rayon maximal de 100 kilomètres et permettra la création de douze postes dans la filière bois locale. Engie Solutions annonce 6 300 tonnes de CO2 évitées par an et 35 GWh de chaleur livré chaque année. Vélizy-Villacoublay (Yvelines) a inauguré début décembre une centrale géothermique pour alimenter son réseau de chaleur (appoint et secours gaz). Cela n’a pas été une mince affaire. Si l’aquifère du Dogger, principal aquifère géothermique exploité en région parisienne, est chaud et productif en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne, il l’est moins ailleurs et notamment dans les Yvelines. Pour pouvoir l’exploiter à Vélizy-Villacoublay, il a fallu adapter à la géothermie la technique de forage multidrain utilisée pour les forages pétroliers. « Il s’agit d’une première en Europe. Cette technologie nous permet de compenser le déficit de débit naturel dans cette partie du Dogger de façon à atteindre 360 m3/h, soit 80 % de plus qu’avec un doublet de forage classique, et de rentabiliser l’opération », explique Thomas Guéant, ingénieur géosciences en charge du projet chez Engie Solutions. Ce dernier exploite ce réseau via la société Veligeo, détenue à 80 % par Engie Solutions et à 20 % par la collectivité. L’eau prélevée à 1 600 mètres de profondeur, à 65 °C, permet ainsi de développer une puissance calorifique de plus de 16 MWth et une production de 110 GWh, soit de quoi couvrir 66 % des besoins des abonnés (12 000 équivalents logements). Alimenté auparavant au gaz et par deux unités de cogénération, le réseau (19 km) a subi une série de travaux pour atteindre des niveaux de température et pression acceptables pour l’utilisation de la géothermie. D’un montant total de 25 millions d’euros, le projet est soutenu à hauteur de 3 millions d’euros par la Région Île-de-France et près de 6 millions par l’Ademe. Le gestionnaire de réseau de gaz Teréga et la société d’économie mixte EnR64, fondée en 2019 à par le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques, ont annoncé la création de la société Stirvia pour développer un réseau de stations publiques GNV et BioGNV dans les Pyrénées-Atlantiques. Cet évènement est la suite logique de la convention signée début 2020 destinée à étudier le potentiel sur ce territoire. Stirvia doit favoriser la création progressive d’un maillage de stations-services. Une première station va être construite à Pau, tandis que des études sont menées sur le choix d’implantation d’autres stations dans le département. Elles seront avant tout destinées aux professionnels du transport routier, principaux usagers de GNV, mais pourraient s’ouvrir à terme à d’autres clientèles. Teréga et EnR64 n’ont cependant pas détaillé les futures offres de BioGNV. Le fournisseur d’équipement de data centers Interxion, a mis en service la solution de refroidissement River Cooling sur ses data centers Interxion MRS2 et MRS3, à Marseille. Conçu en partenariat avec Dalkia Smart building et EDF, River Cooling consiste en le détournement d’eau souterraine de l’ancienne installation industrielle « La Galerie de la Mer » afin d’alimenter 27 échangeurs thermiques pour refroidir les data centers Interxion. Avec plus de trois kilomètres de réseaux enterrés, un investissement de 15 millions d’euros et 2 ans et demi de travaux, ce système devrait permettre d’économiser près de 18 400 MWh par an pour le refroidissement des équipements informatiques. L’entreprise espère ainsi atteindre un indicateur d’efficacité énergétique (PUE) de 1,2, c’est-à-dire le ratio entre la consommation d’énergie de tous les équipements informatiques et liés directement à leur bon fonctionnement (onduleur, climatisation, etc) et la consommation des équipements informatiques en tant que tels (réseau, serveur, etc). En effet, avec River cooling, Interxion ne dépendra plus de groupes froids électriques, très énergivores. A l’avenir, l’entreprise envisage de connecter son réseau à celui de chauffage urbain d’Euroméditerranée pour couvrir les besoins de bureaux et de logement. La maison mère de Interxion, Digital Realty, s’est engagée à réduire de 68 % ses émissions directes et de 24 % ses émissions indirectes d’ici 2030. Après avoir fait plusieurs séries d’annonces ces dernières semaines autour de mesures destinées à stimuler le développement des énergies renouvelables (voir l’actu du 7 octobre sur l’éolien et du 4 novembre pour le solaire), la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili se tourne désormais vers l’ensemble du tissu industriel et productif du pays. Invitée vendredi 3 décembre à la Convention des entreprises pour le climat à Nantes, la ministre a exhorté les entreprises de toutes tailles à prendre au plus vite le virage de la transition écologique. Aussi pour les aider dans leurs décisions stratégiques et leurs investissements, Barbara Pompili a annoncé le lancement de « Mission Transition Écologique », un site internet regroupant l’ensemble des aides et dispositifs existant dans le domaine de la transition écologique des entreprises. Alors qu’une très nette majorité des dirigeants de PME et ETI françaises ont conscience de l’urgence climatique, les aides publiques écologiques restent encore trop méconnues et il est souvent jugé difficile de trouver le bon accompagnement, compte tenu de la multiplicité des opérateurs qui les proposent. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a renforcé ses dispositifs de communication à destination des entreprises, notamment via ce nouveau site qui dispose d’un moteur de recherche réunissant près de 500 dispositifs publics d’accompagnement et de financement (ADEME, BPI, Régions, Départements, Agences dédiées, etc.). L’outil permettra également une mise en relation directe avec un conseiller expert de la transition écologique afin de guider les entrepreneurs. La plateforme est accessible à l’adresse suivante : https://mission- Dans leur vieux hangar transformé en bureau commun, à Monts en Indre et Loire, les deux cabinets de conseil spécialisés en hydrogéologie, Hygéo et Hydrogéologues conseil, ont décidé de faire la preuve par l’exemple. C’est donc une installation de géothermie basse température qui y assurera le chauffage. « Il existe deux technologies : la géothermie sur nappe et la géothermie sur sondes verticales. La première nécessite d’avoir de l’eau souterraine exploitable à l’aplomb du site, c’est-à-dire pas trop en profondeur, ce qui n’est pas notre cas. La seconde est possible partout et est souvent privilégiée pour les petits projets », explique Hélène Galia, directrice d’Hydrogéologues conseil. Les deux sociétés ont ainsi opté pour la seconde option. Deux forages ont été effectués en octobre et descendent à 70 m de profondeur. Dans chacun d’eux, une sonde (2 tubes en U) sera installée, dans laquelle de l’eau circulera en circuit fermé. Elle se réchauffera l’hiver au contact du sous-sol qui garde une température constante de 12/13 degrés toute l’année, puis alimentera des émetteurs basse-température à l’aide d’une pompe à chaleur (de marque française Lemasson). Celle-ci relèvera la température pour assurer le chauffage des 100 m² de surface (puissance de 8,45 kW, Cop de 4,6). L’été, l’installation permettra, à l’inverse, de rafraîchir les locaux. L’ensemble a coûté 62 000 euros dont 65 % couverts par des aides de l’Ademe et du Feder. Les travaux devraient être terminés en janvier. Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région mulhousienne et Suez ont inauguré le 24 novembre l’unité de méthanisation de Sausheim située en Alsace dans le département du Haut-Rhin. Le site traitera les boues d’épuration de 490 000 équivalent-habitants de l’agglomération mulhousienne et produira 2 000 000 Nm3 de biométhane épuré par an. Ce biométhane servira à alimenter en carburant vert les bus de l’agglomération. Grâce à un procédé mis au point par Suez qui permet de récupérer le phosphore sur les digestats liquides, le site produira aussi des granules de 1 à 3 millimètres qui seront utilisés à des fins agricoles pour fertiliser les sols. Après l’association Negawatt, l’Ademe dévoile 4 scénarios prospectifs pour que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. Le scénario S1 « Génération frugale » propose des changements de société profonds, avec une redéfinition des indicateurs de bien-être pour tendre vers une véritable frugalité, en se basant sur des solutions maîtrisées et éprouvées, et la généralisation des techniques low-tech. À l’inverse, le scénario S4 « Pari réparateur » propose peu de changements de mode de vie par rapport à aujourd’hui, mais parie sur une croissance économique soutenue et des révolutions technologiques, notamment sur la capture et le stockage de CO2, le stockage d’énergie et l’efficacité énergétique. Si le scénario S1 se heurte à des risques de clivages politiques forts au sein de la société, le S4, lui, se heurte au réalisme technologique et aux limites physiques. Les scénarios S2 « Coopérations territoriales » et S3 « Technologies vertes » se présentent ainsi comme des voies médianes, mais exigent également de profondes transformations. Pour ces 4 scénarios l’Ademe prend comme hypothèse une part de 70 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique, avec une forte électrification des usages comme le proposent déjà les scénarios de RTE (« Futurs énergétiques 2050 ») et Negawatt. Quels que soient les choix de société, l’Ademe appelle à organiser un débat structurant sur 5 problématiques : la sobriété, les puits de carbone, les régimes alimentaires, le bâtiment, et le modèle industriel. Le 22 novembre s’est déroulée une conférence de presse à Monteux au cours de laquelle les représentants de la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat (Vaucluse) et l’entreprise Hynoé ont présenté le projet de station d’hydrogène vert, qui devrait s’installer à Sorgue, l’une des cinq communes de l’intercommunalité. Il est prévu qu’elle fournisse jusqu’à 400 kg d’hydrogène vert par jour d’ici 2024, afin d’alimenter des poids lourds, bus, bennes à ordures et chariots-élévateur. L’hydrogène doit être produit par des électrolyseurs alimentés par de l’électricité photovoltaïque, provenant d’installations construites sur le territoire des Sorgues du Comtat. Les élus mettent en avant la diminution de la pollution atmosphérique comme les particules fines, mais également une réduction de la pollution sonore. La jeune société Hynoé, basée à Marseille qui compte 70 salariés pour un chiffres d’affaires de 15 millions d’euros, affirme vouloir investir 4 millions d’euros dans ce projet de station d’hydrogène vert. Initiés en 2020, les travaux de construction de la chaufferie biomasse de Compiègne avancent à grand pas avec une mise en service prévue pour début 2022. Pour la rénovation de son réseau de chaleur, la Ville de Compiègne a mandaté Engie Solutions qui est chargé de construire une chaufferie biomasse d’une puissance de 14 MW alimentée par des bois de récupération issus de l’entretien des forêts ainsi que du bois de palettes (caisses, cagettes…) provenant d’un rayon inférieur à 100 kilomètres. À la mise en service, le réseau sera alimenté à 65 % par de la chaleur renouvelable issue de la biomasse. Le réseau de chaleur de Compiègne alimente 66 sous-stations, fournit chauffage et eau chaude sanitaire à 9 000 équivalents logements, dont 6 000 foyers sur un total de 16 kilomètres de réseau. Ce projet bénéficie du soutien de l’Ademe dans le cadre du Fonds Chaleur. Le 15 novembre dernier, a été inaugurée l’unité de méthanisation de Ginestous-Garonne située à Toulouse. Construit sur le site de la station d’épuration de Ginestou, le méthaniseur est alimenté par les boues des eaux usées de la métropole toulousaine et le biogaz produit sera épuré et injecté sous forme de biométhane dans le réseau de GRDF. La production attendue est de 52 GWh annuels en augmentation progressive pour atteindre 61 GWh dans 15 ans. La mise en service de l’unité de méthanisation va par ailleurs permettre la fermeture de la plateforme de compostage des boues à l’origine de fortes nuisances olfactives et dénoncées depuis plusieurs années par les riverains. Près de 34 millions d’euros ont été investis dans ce projet, financé à 67% par Toulouse métropole, avec le soutien de la Région, de l’Ademe et de GRDF. Le Syndicat National du Chauffage Urbain (SNCU) a présenté le 9 novembre son enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid pour 2020. Il ressort que le chauffage par les 833 réseaux de chaleur du territoire a livré 25,4 TWh net sur l’année 2020 (contre 25,6 TWh en 2019) pour une production brute de 30,4 TWh, soit 5,65 millions de tonnes de CO2 évitées. Le taux d’énergie renouvelable et de récupération utilisé dans les réseaux de chaleur augmente peu (+1,1 %) et atteint 60,5 %, dont la majorité (28,3 %) provient d’unités de valorisation énergétique des déchets, et de biomasse (21,2 %). Avec un contenu carbone de 129 g/kWh en analyse de cycle de vie, l’Ademe estime le coût de la tonne équivalent CO2 évitée par les réseaux de chaleur à 37 €, soit un prix inférieur à ceux pour l’éolien, le photovoltaïque ou les pompes à chaleur. Les 33 réseaux de froid, puisant l’eau dans les rivières, en mer ou dans les nappes géothermiques, ont quant à eux livré 0,81 TWh en 2020 (contre 0,96 TWh en 2019) avec un contenu moyen de 11 gCO2 / kWh. La présidente du SNCU pointe les besoins de soutenir le développement de tels réseaux par des subventions ciblées ainsi que la sensibilisation des élus. L’Île-de-France est toujours de loin la première région en termes de réseaux de chaleur (115) et de froid (9), mais aussi celle avec un des plus forts taux d’énergie fossile (46 %). Au niveau national, le gaz représente plus d’un tiers de l’énergie utilisée, malgré des objectifs d’utilisation de la part de la biomasse, de la géothermie et des déchets dans le mix énergétique national devant encore tripler à l’horizon 2030. La filiale d’EDF, SHEMA, vient d’annoncer le début des travaux de la nouvelle centrale hydrolélectrique de Vichy (Allier) qui fait partie des sites retenus par le ministère de la Transition écologique, dans le cadre d’un appel d’offre lancé en 2016. Le site, constitué de deux turbines sera construit sur la rivière Allier en aval du pont barrage avec l’intégration d’une nouvelle passe à poissons dans le cadre de la préservation de la faune piscicole. Selon la filiale d’EDF, la centrale, d’une puissance de 3,5 MW, produira de l’électricité pour la consommation de 7 600 personnes soit environ 30 % de la population de Vichy. La fin des travaux de l’ouvrage est prévue pour 2023. Précurseur au niveau européen, le quartier bas carbone Atlantech, situé dans l’agglomération rochelaise, est un site pilote dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’écoconstruction, du développement durable et de la mobilité douce. Parmi les différentes technologies développées, vient d’être inauguré un démonstrateur d’autoconsommation collective relié à un électrolyseur qui produit de l’hydrogène pour stocker le surplus d’électricité et alimenter des offres de mobilités décarbonées. Il s’agit d’une ombrière de parking équipée de 304 kW photovoltaïques, qui alimente à 100 % en autoconsommation quatre points de livraison : le bâtiment du pôle d’innovation Lab’In Tech ainsi que des bornes de recharge d’éclairage public et de véhicules électriques. Le système est relié à un électrolyseur de 138 kW, qui produira 3 tonnes d’hydrogène par an. L’objectif est d’explorer l’ensemble de la chaîne de valeur de la boucle énergétique et de comprendre comment le solaire et l’hydrogène peuvent s’associer et s’optimiser. Aujourd’hui stocké dans des bonbonnes, l’hydrogène sera disponible à la pompe dans les mois qui viennent pour des véhicules du site équipés : voiture, vélos, vélos cargo, etc. Ce premier démonstrateur a pour vocation d’être déployé sur l’ensemble du site Atlantech à travers une boucle à l’échelle de tout le quartier. Certains bâtiments étant parfois excédentaires en énergie et d’autres déficitaires, le mix des usages : bureaux, habitations, enseignement, services assurera un équilibre et optimisera la répartition de l’autoconsommation sur le site. Ainsi, la production photovoltaïque des habitations pourra alimenter les besoins des bureaux plus importants en semaine et l’inverse le week-end lorsque les habitants sont chez eux. Depuis quelques semaines, Bolloré Energy, filiale du groupe Bolloré, commercialise un carburant 100 % biodiesel (B100), baptisé Koolza 100. Ce carburant alternatif est produit uniquement à partir de colza cultivé et transformé en France. Bolloré Energy vient ainsi concurrencer d’autres groupes déjà sur le marché comme Oleo100, filiale du groupe Avril, ou encore Altens avec cependant toujours l’épineux débat de l’utilisation de terres agricoles pour des besoins non alimentaires. Réservé à une clientèle de professionnels (transporteurs, industrie ferroviaire, etc.), le Koolza 100 est compatible avec la plupart des camions disponibles. « Ce nouveau produit constitue une alternative écologique au diesel fossile avec une autonomie équivalente. Il permet notamment de réduire les émissions de CO2 de 60 % et les émissions de particules fines de 80 % », annonce Bolloré Energy ajoutant « contrairement au produit fossile, il n’est pas classé comme un produit dangereux ou nocif pour l’environnement ». Dès 2022, plus de 30 % des livraisons du B100 par ses fournisseurs seront également effectués par des camions utilisant ce nouveau carburant avec l’objectif d’atteindre 100 % en 2023. Le Koolza 100 peut également trouver des débouchés dans le transport ferroviaire puisque Bolloré Energy le teste sur des trains entre Paris et Granville (Manche). Les quinze trains de cette ligne ont une motorisation bi-mode. La voie n’est en effet électrifiée que jusqu’à Dreux (Eure-et-Loir), obligeant ensuite à recourir au moteur diesel. Les Établissements Roussel, Haffner Energy et le groupe Thevenin & Ducrot annoncent le lancement du projet de production d’hydrogène à partir de biomasse, comprenant également une station multi énergie, un ensemble de véhicules lourds à hydrogène, et des tube-trailer (conteneurs spéciaux pour le stockage et le transport d’hydrogène). Ce projet se base sur la technologie HYNOCA,développée par Haffner Energy, qui exploitera de la biomasse locale (issue d’exploitation agricole, forestière et viticole) collectée et traitée par les Établissements Roussel, entreprise familiale spécialisée dans le bois énergie. Forte du dépôt de 14 familles de brevets, HYNOCA permettrait de produire et de distribuer localement, à partir d’un combustible très accessible, de l’hydrogène sans dépendance à l’électricité. La distribution aux clients s’effectuera grâce à une nouvelle station multi-énergie de Thevenin & Ducrot (copropriétaire de la marque AVIA). Cette station d’une capacité de 720 kg d’hydrogène vert par jour sera construite à Montmarault, dans l’Allier, pour une mise en service prévue en 2023. Il s’agit du premier projet du plan de Thevenin & Ducrot consistant à déployer une filière hydrogène sur aire de service et qui devrait être suivi d’un second de taille équivalente à Chamboeuf, en Côte-d’Or. Hors achat des véhicules, l’investissement total pour ces deux projets s’élève à près de 30 millions d’euros. Le projet est également cofinancé par Jean-Paul Fargheon, un tiers-investisseur privé désireux de participer à la création de la filière hydrogène. Lundi 25 octobre, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, a présenté les principaux résultats de son rapport « Futurs énergétiques 2050 » et c’est peu dire qu’ils étaient attendus. Lancé en 2019 à la demande du gouvernement, cet exercice prospectif dresse trois trajectoires d’évolution de la consommation électrique. Une trajectoire dite « de référence » mènerait la consommation nationale à 645 TWh en 2050, soit une augmentation de 35 % par rapport à aujourd’hui, une trajectoire « sobriété » placerait la consommation à 555 TWh/an et une troisième alternative, baptisée « réindustrialisation profonde », se solderait par une consommation de 755 TWh/an. Les 6 scénarios de production électrique présentés lundi s’inscrivent dans la trajectoire de référence, les scénarios correspondant aux autres trajectoires devant être publiés d’ici mars prochain. Ils s’intègrent tous dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) adoptée en 2020. Chacun de ces scénarios permet ainsi non seulement de garantir la sécurité d’approvisionnement à tout moment, mais aussi d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Deux familles de scénarios ont été développées. D’une part, les trois options « N » (N1, N2 et N03) prévoient le déploiement de nouveaux réacteurs nucléaires (de huit à quatorze selon les scénarios), ainsi que le prolongement jusqu’à soixante ans d’une partie du parc actuel (pour l’option N03). L’énergie nucléaire fournirait alors entre 25 % et 50 % de l’électricité produite en France, associée cependant à une part importante de renouvelables car ces technologies pèseraient entre 50 % et 75 % dans ces scénarios « avec nucléaire ». L’autre famille est celle des options « M » qui décrivent un mix basé à 100 % sur les énergies renouvelables en 2050 (M0) ou 2060 (M1 et M23), avec des variantes dans leur mode de développement. Ainsi dans le scénario médian (M1), le photovoltaïque atteindrait 214 GW de capacité raccordée, dont 35 GW dans le secteur résidentiel. Cela reviendrait à équiper une maison sur deux en panneaux photovoltaïques en autoconsommation partielle. L’éolien terrestre se situerait à 59 GW, soit 3,5 fois plus qu’aujourd’hui, auquel devraient s’ajouter 45 GW d’éolien en mer (contre 0 GW aujourd’hui). Suivant les trois scénarios « M », en 2050, le solaire occuperait de 0,1 à 0,3 % du territoire et la France compterait de 14 000 à 35 000 éoliennes, contre environ 8 500 à l’heure actuelle. Enfin, pour chaque option, qui désigne donc un système électrique global en 2050, est estimé son coût complet à l’horizon 2060. Les résultats vont de 59 milliards d’euros par an (scénario N03 avec 50 % de nucléaire en 2050) à 80 milliards d’euros par an (scénario M1, avec 100 % d’énergies renouvelables en 2060). Selon RTE, cette différence de coût se justifie essentiellement par la restructuration du réseau électrique nécessaire au développement massif des énergies renouvelables et par les dispositifs de flexibilité destinés à pallier les variations de la production renouvelable. Mais en cas de dérive des délais et des coûts de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, comme l’expérimente actuellement l’industrie nucléaire avec les EPR de première génération, le bilan économique serait équivalent pour les deux scénarios. Les nouveaux réacteurs nucléaires envisagés, EPR2 et les petits réacteurs modulaires (SMR), n’existent encore que sur le papier en France.Pour Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, cet exercice doit contribuer à un débat « le plus éclairé et le plus documenté possible » mais il avance également qu’il y a désormais « urgence à choisir une orientation ». « Nous sommes dans une course contre la montre pour répondre à la crise climatique. Tous les scénarios nécessitent des investissements considérables sur lesquels il est temps de prendre une option ». Air Liquide a annoncé le 20 octobre le rachat de la société H2V Normandy à H2V Product, en portant sa participation à 100 %, contre 40 % auparavant. Rebaptisée Air Liquide Normand’Hy, la société porte un projet d’installation d’électrolyseurs situés dans la zone industrielle de Port-Jérôme (Seine-Maritime) devant entrer en service en 2025. Avec ses 200 MW de capacité, il fournira jusqu’à 28 000 tonnes d’hydrogène vert par an pour des applications industrielles et de mobilité lourde, et évitera ainsi 250 000 tonnes de CO2. La technologie d’électrolyseur retenue est celle des membranes échangeuses de protons (PEM). Ce projet est notamment qualifié pour le deuxième tour de l’appel à projets European Union Emissions Trading System (EU ETS) Innovation Fund 2020, et a été notifié par les autorités françaises à la Commission européenne dans le cadre de l’appel à Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) concernant l’hydrogène. D’ici 2030, Air Liquide prévoit de porter sa capacité de production d’hydrogène par électrolyse à 3 GW. Avant une publication officielle mardi 26 octobre, l’association d’experts indépendants NégaWatt vient de dévoiler les premiers éléments de son nouveau scénario à 2050. Plus qu’un simple exercice de projection énergétique, Negawatt propose à travers son travail un véritable projet de société qui couvre de nombreux aspects (énergie, économie, santé…). L’un de ses messages forts étant « Pas de transition écologique sans transition sociétale ». À partir d’une ligne de conduite basée sur deux objectifs, la neutralité carbone en France en 2050 (émissions « importées » incluses) et la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen d’ici à 2030, le scénario négaWatt conclut à la possibilité d’un mix énergétique reposant à 100 % sur des énergies renouvelables. Afin d’y parvenir, la première des conditions est une sobriété de la demande en divisant par deux la consommation d’énergie finale du pays en 2050 par rapport à aujourd’hui. Cela doit passer par une accélération de la rénovation énergétique des bâtiments et sur une évolution plus rapide des modes de mobilité. Côté production d’électricité, le scénario prévoit un parc reposant principalement sur l’éolien (pour 300 TWh de production annuelle en 2050), le photovoltaïque (160 TWh) et le biogaz (140 TWh). Il ne serait alors plus nécessaire de conserver un parc nucléaire. Aucun des 56 réacteurs actuellement en activité ne serait prolongé au-delà d’une durée de fonctionnement de cinquante ans, certains seraient arrêtés dès quarante ans et aucun nouveau réacteur ne serait mis en service. En complément du volet énergétique, le nouveau scénario propose deux autres volets analytiques : négaMat et Afterres 2050. Le premier porte sur l’évolution de la consommation des matériaux et des matières premières, le second est consacré à la transition agroalimentaire. Au-delà de la seule question du bilan énergétique français, une telle transition conduirait à éviter plus de 10 000 décès par an entre 2035 et 2050 liés à la pollution et permettrait de créer jusqu’à 300 000 emplois dans le secteur de la rénovation des bâtiments et 135 000 dans celui des énergies renouvelables. Le CEA avait déjà approuvé l’idée de l’entreprise de travaux publics Eurovia, selon laquelle la chaleur estivale du bitume peut être valorisée énergétiquement, grâce au dispositif Power-Road. La chaleur est collectée grâce à un échangeur thermique, constitué de tubes dans lesquels circule un fluide caloporteur, disposé à l’horizontale et positionné sous la couche de roulement, n’entravant ainsi pas les autres usages de la route. Sur le salon lyonnais Pollutec, mercredi 13 octobre, la filiale de Vinci a présenté les résultats d’une seconde étude, réalisée quant à elle par le BRGM, et qui prouve que sa technologie Power Road peut utiliser le sous-sol comme solution de stockage intersaisonnier. « Pour rester dans une géothermie de minime importance, avec un cadre réglementaire simplifié, nous nous sommes appuyés sur un champ de sonde. En circuit fermé », rapporte Antoine Voirand, spécialiste de la géothermie et du stockage d’énergie au BRGM. L’énergie collectée sous le bitume peut en effet être envoyée et stockée dans le sous-sol grâce à des sondes géothermiques. Antoine Voirand a modélisé un bâtiment ayant besoin à la fois de chauffage et de rafraîchissement, avec une pompe à chaleur géothermique alimentée par ces sondes chauffées par l’énergie emmagasinée grâce à Power Road. Le coût global d’un tel système pourrait d’après ses calculs diminuer de 10 à 35 % sur vingt-cinq ans celui d’une installation sans stockage intersaisonnier. Notamment parce que le besoin de sondes dans le sol est moindre. De même que la consommation de gaz pour l’appoint. « Les technologies sont matures, ce sont des solutions de géothermie et des pompes à chaleur, souligne Sandrine Vergne, responsable du développement de cette offre chez Eurovia. L’innovation, c’est le captage de l’énergie solaire thermique de la chaussée. » D’ores et déjà testée en conditions réelles pour chauffer des bâtiments ou déneiger des routes, cette solution pourra, selon l’entreprise, être déployée sur quelques dizaines de mètres carrés dans un lotissement, comme sur des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés. Le fournisseur de chaleur renouvelable, Newheat, inaugure ce jeudi 21 octobre la centrale solaire thermique, Narbosol, qui alimentera le réseau de chaleur de la ville de Narbonne (Aude) avec une puissance de 2,8 MW et la réduction de 500 tonnes de CO2 par an. Avec 3 232 m2 de capteurs solaires, la centrale alimentera en chauffage et eau-chaude sanitaire plus de 900 logements, 7 écoles (4 élémentaires et 3 maternelles), 1 collège et d’autres bâtiments publics. Déjà équipée d’une chaudière biomasse, la ville de Narbonne poursuit sa transition énergétique, en passant de 64 % à plus de 70 % d’énergie issues des énergies renouvelables. Le projet Narbosol, financé et développé par Newheat est lauréat de l’Appel à Projet « Grandes Installations Solaires Thermiques » du Fonds Chaleur de l’Ademe, il est également soutenu par la Région Occitanie à hauteur de 100 000 € dans le cadre de son plan de soutien au développement des énergies renouvelables. Vendredi 22 octobre à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) sera inaugurée la première station de recharge d’un futur réseau national de bornes ultra-rapides. L’évènement se fera en présence de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des Transports et de Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergies pour le Monde. Développé par le groupe NW, ce nouveau modèle de stations est innovant puisqu’il associe un système de stockage d’énergie basé sur des batteries (reposant sur la technologie JBox) à une borne de recharge ultra-rapide, baptisée IECharge. Sa puissance de charge maximale est de 320 kW, soit 16 fois plus rapide que celle des points de charge habituels. La partie batterie permet d’équilibrer le réseau électrique en se chargeant lorsque la production est trop importante tout en réinjectant l’électricité lorsque la consommation atteint un pic. Cette station d’un nouveau genre est la première d’un réseau qui devrait à terme représenter 600 unités dans les 24 prochains mois en France tout en proposant un prix de la charge 40 % inférieur à celui des autres stations ultra-rapides. Ce projet, qui est une étape dans la transition énergétique des transports (cf baromètre EurObserv’ER), a été retenu par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard qui a labellisé plus de 1 000 solutions identifiées comme propres, rentables et ayant un impact positif sur l’environnement et la qualité de vie. Portée par sept agriculteurs associés, l’unité de méthanisation de Green Gas Viry (Haute Savoie) sera inaugurée le 22 octobre prochain. Ce projet a été totalement imaginé et monté par un collectif d’agriculteurs qui en assurera l’exploitation au travers d’un contrat de 15 ans pour l’injection de biométhane sur le réseau GRDF. L’opération s’inscrit dans la politique énergétique des collectivités du Genevois français et a reçu le soutien de la Communauté de communes du Genevois, du Pôle métropolitain et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le méthaniseur produira du biogaz uniquement à partir de matière végétale (fumier de bovin et lisier pour 86 %) issue d’une collecte circonscrite dans un rayon de 10 km autour de l’unité. La production annuelle sera de 4 500 MWh, soit l’équivalent des besoins annuels de 900 foyers. Le digestat, sous-produit de la méthanisation, sera ensuite utilisé en tant que fertilisant naturel pour les champs alentour. La chaufferie biomasse de Blagnac située à six kilomètres de Toulouse a été inaugurée le 6 octobre dernier. Construite par Veolia, le site alimente le réseau de chaleur d’une partie de la ville, dont l’aéroport, les logements collectifs du quartier des Cèdres, le collège Guillaumet et la piscine des Ramiers. Les plaquettes forestières utilisées sont issues de forêts certifiées, situées à moins de 100 kilomètres de Blagnac. Cette nouvelle chaufferie s’inscrit dans un projet de rénovation du réseau de chaleur de la ville, initié, en 2017, par Toulouse Métropole et baptisé Blagnac Énergies Vertes. Le réseau de chaleur de Blagnac, créé en 1976 est alimenté par le puits géothermique du Ritouret grâce à une nappe se situant à 1 500 mètres de profondeur avec une eau à 58°C. Le réseau s’étale sur 4 km avec 37 postes de livraison. Avec la mise en service de la chaudière biomasse, la part des énergies renouvelables de l’ensemble du réseau de chaleur de la ville est désormais de 74 %. Un an après la pose de la première pierre, le producteur nantais d’hydrogène renouvelable, Lhyfe, a inauguré le jeudi 30 septembre son unité de production située sur le port du Bec à Bouin dans le département de la Vendée. L’électricité produite par les huit éoliennes situées à proximité du site alimente désormais un électrolyseur qui délivre aujourd’hui 300 kg d’hydrogène vert par jour pour passer à une tonne dans les mois à venir. La production alimentera quatre stations-services situées dans l’Ouest de la France dont celle de La Roche-sur-Yon qui sera opérationnelle dans les prochains jours. Une cinquantaine de véhicules lourds, bus, bennes à ordures ménagères pourront rouler à l’hydrogène renouvelable dans les départements de la Loire-Atlantique, de la Sarthe, de la Vendée d’abord, puis dans d’autres départements, notamment via le projet Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO). La société d’investissement Meridiam, Hydrogène de France (HdF) et la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) viennent d’annoncer le lancement du chantier de la centrale électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) sur la commune de Mana. A partir de source solaire, cette centrale couplée à du stockage hydrogène et à des batteries fournira de l’électricité sans interruption pour l’équivalent de 10 000 foyers (50 GWh par an), pour un coût inférieur aux autres centrales du territoire fonctionnant au diesel. De jour (de 8h à 20h) le complexe disposera de 10 MW de capacité, et de 3 MW la nuit. Sa capacité de stockage s’élèvera à 128 MWh et elle permettra d’éviter 39 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an. Représentant un investissement total de 170 millions d’euros, ce projet débutera le 30 septembre pour une mise en service prévue en avril 2024. Pendant les 25 années de son fonctionnement CEOG devrait générer un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros auprès d’entreprises locales. Le projet se situe sur une parcelle de 140 hectares louée par l’Office national des forêts, incluant 62 hectares de forêt humide que les porteurs de projet s’engagent à préserver et protéger. La malterie Boortmalt d’Issoudun, la société d’investissement Kyotherm, spécialisée dans la production de chaleur renouvelable, et l’Ademe annoncent la mise en service de centrale solaire thermique de la malterie d’Issoudun située dans l’Indre, en région Centre-Val de Loire. D’une surface de 14 252 m2, la centrale produira 8,5 GWh de chaleur par an, soit 10 % des besoins du site et évitera le rejet de 2 100 tonnes de CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles de 1 050 véhicules thermiques. Le mix énergétique de la malterie d’Issoudun est désormais composé de 50 % de gaz, 15 % de cogénération, 25 % de biomasse et 10 % de solaire thermique. Le projet a été développé et financé par Kyotherm, pour un montant de 6 millions d’euros et a été subventionné à hauteur de 3 millions d’euros par l’Ademe. Dans le but d’accompagner les régions dans le développement de leur politique de méthanisation, le Cler-Réseau pour la transition énergétique vient de mettre en ligne un guide intitulé « Les clés d’une méthanisation durable ». Réalisé en partenariat avec GRDF et Solagro, acteur historique de l’agro-écologie, ce document pratique s’adresse aux élus, aux techniciens des Conseils régionaux ainsi qu’à tous les acteurs et partenaires de la filière. Le guide contient sept fiches thématiques comprenant des analyses et des pistes d’actions tout en interrogeant le secteur sur ses nouveaux enjeux comme l’appropriation locale des projets, l’amélioration des pratiques, le soutien à l’innovation ou encore la formation aux métiers de la méthanisation. Disponible en libre téléchargement sur le site de l’association, cet ouvrage est le premier opus d’une nouvelle collection baptisée « Les Régions en action » et qui devrait s’étoffer dans les mois à venir. La communauté urbaine du Grand Reims vient d’annoncer un partenariat avec Engie Solutions (filiale du groupe Engie) afin de l’accompagner dans sa stratégie de performance environnementale. L’objectif fixé est d’atteindre une part de 90 % d’énergies renouvelables et de récupération d’ici 2022 dans le mix énergétique du réseau urbain de chaud et froid de la communauté urbaine. Pour ce faire, le projet ambitionne de remplacer définitivement l’utilisation du charbon dans le réseau par de la biomasse à hauteur de 35 %. L’économie circulaire est favorisée par l’utilisation de bois issu de la région, provenant de déchetteries, de démolitions ou de récupération d’industries et de commerces. Cette transition énergétique porterait de 17 000 à 22 000 l’équivalents-logements qui seront alimentés par le réseau urbain à partir d’énergie thermique verte. Créée en 2017, la communauté urbaine du Grand Reims rassemble 300 000 habitants répartis sur 143 communes. CVE et Île-de-France Énergies ont inauguré le 16 septembre dernier, l’unité de méthanisation Equimeth, située sur la commune de Moret-Loing-et-Orvanne en Seine-et-Marne. En service après 12 mois de travaux, cette unité traitera les biodéchets issus de la restauration, de l’agroalimentaire et de l’agriculture émis dans un rayon de 60 kilomètres autour du site. 25 000 tonnes de biodéchets seront valorisées par an et 250 Nm3 de biométhane injectés par heure dans le réseau de GRDF, soit l’équivalent de la consommation en gaz de 4 000 foyers. Le biométhane produit alimentera les communes de Moret-Loing-et-Orvanne, Saint-Mammès, Thomery, Champagne-sur-Seine, Avon et Fontainebleau, à hauteur de 15 % de la consommation en gaz des habitants. Ce projet de 12 millions d’euros a reçu le soutien financier de la Région Île-de-France, de l’Ademe et du Fonds européen FESI-FEDER. Les Services industriels de Genève (SIG) ont lancé, lundi 13 septembre, une vaste campagne de prospection géothermique. Leur ambition : localiser précisément une ressource qui pourrait couvrir 20 % des besoins de chaleur du canton d’ici 2035. Les mesures dureront six semaines et s’étendront sur 12 000 parcelles des deux côtés de la frontière : sur la communauté de communes du Genevois, l’agglomération d’Annemasse et le Pays de Gex en ce qui concerne la France. Elles privilégieront les zones suffisamment denses pour justifier le forage de puits pour alimenter les réseaux de chaleur. Cette campagne cherche d’abord des poches d’eau dont la température et le débit peuvent être suffisamment élevés dans les couches géologiques du Jurassique et du Crétacé. Elle identifiera aussi d’éventuelles fragilités qui pourraient provoquer des risques sismiques. Pour effectuer ses mesures, les SIG s’appuient sur des camions dits « vibreurs » ou « à chute de poids ». Tous les vingt à cinquante mètres, ils captent des données qui permettront d’établir une cartographie du sous-sol en trois dimensions (en complément d’autres informations récoltées entre 2014 et 2020). À noter que dans un pays où la géothermie n’a pas toujours eu bonne presse, l’établissement autonome de droit public et la collectivité ont multiplié les communications en direction des riverains, à la fois pour expliquer la manière dont les mesures seront effectuées, et pour justifier la nécessité de s’appuyer sur l’énergie locale et renouvelable qu’est la géothermie, en complément d’autres ressources comme le bois et l’énergie captée dans le lac Léman. Les SIG se donnent cinq ans pour déployer leurs premiers réseaux géothermiques. Le chauffage urbain produit à partir d’énergies renouvelables, est « une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploitée » en France, déplore la Cour des comptes dans un rapport publié le 7 septembre. En 2015, la loi a fixé comme objectif pour la France de multiplier par cinq entre 2012 et 2030 la quantité de chaleur et de froid renouvelables, et vise à cet horizon une production de chaleur renouvelable représentant 3,4 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep). Or, la consommation de chaleur renouvelable par les réseaux est passée de 0,68 à 1,21 Mtep entre 2012 et 2019, une croissance annuelle de 10 % insuffisante. Le rapport analyse la manière dont les pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, mettent en œuvre l’objectif national de développement des réseaux de chaleur dans un contexte de politiques d’économie d’énergie. En raison du poids des investissements nécessaires, 80 % des réseaux de chaleur font l’objet d’une délégation de service public (DSP). Or la Cour relève plusieurs cas de contrôles « lacunaires » de la part des collectivités. Le rapport appelle aussi à plus de transparence sur les données économiques, notamment le prix de vente de la chaleur de la part des exploitants de réseau, qui les rendent peu accessibles. Enfin, le soutien public au chauffage urbain pourrait être renforcé. Le taux réduit de TVA (5,5 %) sur les réseaux alimentés par des énergies renouvelables, l’un des principaux leviers pour leur développement, représente une dépense fiscale somme toute assez légère de 67 millions d’euros par an. « Si elle peut présenter un risque d’incompatibilité avec la réglementation européenne, cette mesure est cependant efficace et incitative pour le développement des énergies renouvelables » conclut la Cour. Un nouvel accord entre Engie et Google vient de se conclure en vue d’une décarbonation de l’activité du groupe américain en Allemagne. Dans ce partenariat, Engie élaborera et négociera un portefeuille énergétique afin de fournir à son client une électricité renouvelable issue d’énergie solaire ou éolienne pour alimenter ses centres de données et plateformes cloud. Au total, Engie fournira à Google 140 MW d’électricité renouvelable pendant 3 ans. L’énergéticien s’appuiera soit sur la construction de nouveaux parcs, soit sur des actifs déjà existants. Il proposera également une offre de services de gestion de l’énergie, notamment en matière de fourniture résiduelle, d’équilibrage ou de gestion de réseau. Cet accord s’intègre dans le programme « Carbon-Free Energy » que Google s’est fixé à l’horizon 2030. Pour y arriver, le groupe américain entend déjà décarboner 80 % de ses opérations allemandes d’ici 2022. Ce partenariat entre les deux groupes n’est cependant pas une première. En 2019, Google et Engie avaient signé un premier contrat d’achat d’électricité en Belgique pour cinq ans, prévoyant la fourniture d’énergie renouvelable à partir d’un projet éolien offshore. L’énergéticien français a également remporté un contrat similaire aux Pays-Bas. Le géant de l’ameublement et de la décoration vient d’annoncer la mise sur le marché de son offre d’électricité verte en Suède. Cette offre est le fruit d’un partenariat avec le fabricant de modules photovoltaïques, Svea Solar, qui équipe déjà les kits solaires vendus par le groupe aux particuliers. L’électricité proposée proviendra exclusivement de parcs solaires ou éoliens basés en Suède et l’offre sera vendue sous forme d’un abonnement mensuel fixe, auquel s’ajoutera un prix variable en fonction de la consommation. Avec cette initiative, le Suédois poursuit sa transition énergétique en indiquant qu’actuellement la consommation énergétique de ses 456 magasins répartis dans le monde, bureaux, entrepôts et usines est couverte à 51 % par des sources renouvelables. Le 19 juillet le gouvernement éthiopien a annoncé le succès d’une opération de remplissage du réservoir du Grand Barrage de la renaissance. Ce barrage d’une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes était en phase de construction depuis l’année 2011, et est enfin prêt à entrer en service. Cette première phase de remplissage a permis de stocker 4,9 milliards de m3, et la seconde augmentera ce volume de 13,5 milliards de m3 supplémentaires. Les deux premières turbines du projet devraient atteindre une capacité de 750 MW, augmentant ainsi de 20 % la puissance installée du pays. À terme, il représentera une puissance de plus de 5 GW. Situé sur la partie du Nil qui traverse l’Éthiopie, ce projet est source de tension avec l’Égypte et le Soudan, en aval, depuis de nombreuses années. En effet, l’Égypte revendique un droit sur le Nil basé sur deux traités de 1929 et 1959, mais l’Éthiopie n’en étant pas partie prenante affirme ne pas être tenue par leurs dispositions. Le Soudan, quant à lui, semble plus ouvert à la négociation et serait prêt à acheter à l’Éthiopie une part de l’électricité produite. L’hydrolienne géante de 2 MW, « O2 », développée par l’entreprise écossaise Orbital Marine Power vient de démarrer sa production d’électricité à destination du réseau des Orcades, un archipel situé au nord de l’Écosse. Ancrée sur le site de Fall of Warness du European Marine Energy Centre (EMEC), cette hydrolienne de 74 mètres de long à forme d’avion flottant et pesant 680 tonnes est composée de deux énormes hélices bipales immergées, d’un diamètre de 10 mètres chacune fixées au bout de bras articulés de 18 mètres. La durée d’exploitation sera de 15 ans et, selon le constructeur, cette hydrolienne pourra fournir de l’électricité pour environ 2 000 foyers par an. Le projet O2 a été financé grâce au programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre du projet FloTEC et par le Fonds européen de développement régional à travers le programme Interreg North West Europe dans le cadre du projet ITEG. Très attendue et scrutée, le texte de la loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été voté par l’Assemblée Nationale et le Sénat le 20 juillet. Suite à la saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés, elle a ensuite été partiellement censurée le 13 août. Il s’agit de quatorze points retoqués pour leur absence de lien avec l’article auquel ils sont rattachés. Censé agir sur tous les secteurs de la société française, ce texte apporte notamment de la nouveauté pour celui des énergies renouvelables, en particulier via les articles 82 à 102 du chapitre « Favoriser les énergies renouvelables ». Deux d’entre eux font partie de ceux censurés : le 84, qui définissait le cadre dans lequel le porteur d’un projet éolien devait mettre en œuvre des mesures de compensation en cas de gêne occasionnée par des installations éoliennes pour le Ministère de la Défense, et le 102 stipulant la possibilité d’autorisation en zone de friche pour les panneaux photovoltaïques après autorisation de la Commission Départementale de la nature, de paysages et des sites (CDNPS). Comme d’autres mesures emblématiques du texte, notons l’article 83 qui ajoute à la PPE des objectifs régionaux qui devront être pris en compte dans l’élaboration des SRADDET. Traduisant le concept de « communauté énergétique » de la Commission européenne, il inclut également des dispositions pour donner le droit aux citoyens, collectivités et entreprises de développer, produire, stocker, consommer et revendre leur énergie renouvelable produite localement. Le service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (SDES) vient de publier son nouvel opus sur les chiffres clés des énergies renouvelables. Celles-ci représentent à fin 2020 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie en France, soit près de 2 points de plus qu’en 2019 mais aussi près de 4 points de moins que l’objectif pour 2020 fixé par la directive 2009/28 et transcrit dans la législation nationale. L’accroissement rapide de cette part entre 2019 et 2020 est à interpréter avec prudence étant donné qu’il est avant tout dû à la baisse de la consommation énergétique dans l’industrie et surtout dans les transports, en lien avec les confinements en début et fin d’année et la limitation des déplacements. La contribution des énergies renouvelables en valeur absolue a toutefois augmenté de 4 TWh d’énergie primaire (passant de 318 à 322 TWh entre 2019 et 2020). Les secteurs de l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydraulique et du biogaz sont ceux qui ont connu les croissances les plus importantes (non corrigées des variations saisonnières). Le vendredi 23 juillet à 8h30 du matin, la société GéoRueil et son partenaire Engie Solutions ont annoncé le lancement des opérations de forage sur la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ces travaux concernent deux puits de géothermie à 1 500 mètres de profondeur, qui permettront de capter une eau à 62 degrés et fournir de la chaleur au futur réseau urbain de la ville. Les travaux de forage, volontairement débutés en été afin de réduire les nuisances auprès des riverains, se dérouleront jusqu’à mi-octobre et seront suivis par la construction du bâtiment de l’unité géothermique, pour une mise en service prévue à l’été 2022. Cette opération permettra d’éviter l’émission de 21 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 11 600 véhicules en circulation pour un investissement total de 71 millions d’euros. Le projet de géothermie et la construction du réseau de chaleur bénéficient du soutien de l’Ademe et de la Région Île-de-France à hauteur de 25,4 millions d’euros, dont 19,82 millions venant de l’Ademe et 5,5 millions de la Région Île-de-France Le 20 juillet, le fabricant de batterie lithium-ion LG Energy Solutions (LGES) annonçait avoir conclu un accord avec le fournisseur allemand de lithium Vulcan Energy Resources. À compter de 2025, ce dernier livrera 5 000 tonnes d’hydroxyde de lithium à LGES et 10 000 tonnes par an dès l’année suivante. Vulcan indique pour sa part qu’en 2025, ses cinq unités de production pourront livrer 40 000 tonnes par an d’équivalent de carbonate de lithium (tonnes LCE). De quoi produire un million de voitures électriques par an. L’entreprise extraira le lithium de gisements salins (saumure) souterrains situés dans la haute vallée du Rhin, en Allemagne, en recourant à la géothermie. Les forages géothermiques permettront d’extraire la saumure à haute température (165 °C), pour produire à la fois de l’électricité et de la chaleur renouvelables, et du lithium par un procédé d’extraction directe, avant de la réinjecter dans le sous-sol. Cinq unités géothermiques sont prévues. Les deux premières d’une capacité de 8 MW et 14 MW, et les trois suivantes de 17 MW chacune. Selon Vulcan, son procédé de production n’émet aucune tonne de CO2, contre 5 tonnes de CO2 par tonne d’hydroxyde de lithium pour le procédé de production par évaporation et 15 tonnes de CO2 pour l’extraction minière de lithium. La consommation d’eau ne serait que de 80 m3 par tonne produite pour son procédé, contre respectivement 469 m3 et 170 m3 pour les deux autres manières d’obtenir le lithium. Observ’ER (l’Observatoire des énergies renouvelables) vient de publier une étude qualitative sur le marché français des appareils de chauffage domestique au bois. Basé sur une dizaine d’entretiens auprès de professionnels du secteur, ce travail analyse leur ressenti face aux évolutions récentes de leur filière sur les 18 derniers mois. Ce volet complète celui sur les ventes et les prix mis en ligne en mars dernier (voir Actu du 16 mars). Évidemment il a été grandement question de la pandémie Covid et malgré des chiffres de marché en baisse, la grande majorité des personnes interrogées ont le sentiment d’avoir tiré leur épingle du jeu lors de cette année très particulière. La gestion des stocks a été difficile mais les entreprises ont su adapter leur mode d’organisation et surtout de communication avec leurs clients. D’ailleurs, bon nombre avancent que les aménagements réalisés en 2020 face aux contraintes de la crise sanitaire ont été ensuite conservés car ils amènent de la flexibilité. En revanche, le canal des ventes par internet reste à un niveau très faible (1 % des ventes) et la grande majorité des fabricants interrogés disent ne pas envisager de développer leurs ventes par ce biais. L’achat d’un appareil bois reste très souvent associé aux conseils d’un professionnel. Cependant, il est possible qu’avec la prolongation de la crise Covid en 2021, les habitudes évoluent et que ce segment prenne plus d’ampleur à moyen terme. Par ailleurs, le secteur est serein face à la mise en place de la future réglementation environnementale du bâtiment neuf (la RE2020) car le marché du neuf représente moins de 15 % des ventes. Enfin sur l’évolution des prix de vente, si 2020 a été très calme, des augmentations sensibles ont été observées depuis début 2021, notamment du fait de l’approvisionnement en matières premières. Les prix pourraient connaître plusieurs augmentations sur l’ensemble de l’année. La Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juillet dernier un règlement établissant « le cadre requis pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre ». L’objectif de neutralité climatique ainsi adopté confirme que les émissions nettes de gaz à effet de serre doivent être ramenées à 0 d’ici à 2050 au plus tard, avec même l’ambition d’atteindre des émissions négatives par la suite. Un objectif intermédiaire est fixé pour 2030 qui entérine l’accord des leaders européens l’an dernier : l’Union devra avoir réduit ses émissions nettes d’au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990. La contribution des puits de carbone est plafonnée de façon à garantir une transformation durable des secteurs à l’origine des émissions.Ce règlement est contraignant dans toutes ses dispositions, directement applicable dans l’ordre juridique des États membres et s’impose à tous les sujets de droit : particuliers, personnes morales, Etats, institutions. En vue d’atteindre cet objectif de 55% de réduction des émissions, la Commission européenne doit dévoiler demain 14 juillet un paquet législatif colossal intitulé « Fit for 55 » et portant sur le transport, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le marché du carbone… Malgré la promesse faite par le Président de la République qui s’engageait à fermer toutes les centrales électriques à charbon sur le territoire afin de lutter contre le changement climatique, l’exploitation de celle de Cordemais (Loire-Atlantique) de 1200 MW devrait être prolongée au-delà de 2022. Dans un communiqué du 8 juillet, EDF, propriétaire de la centrale a annoncé l’arrêt de son projet Ecocombust, qui consistait à adapter la centrale de Cordemais au combustible bois déchet, et à produire sur site des granulés. L’énergéticien invoque une problématique économique car le prix final de l’électricité produite ne serait pas assez attractif pour ses clients, notamment dans un cadre d’envolée récente des prix des matières premières. EDF renonce également du fait du retrait de son principal partenaire industriel, Suez, qui aurait retardé la mise en service à 2024. Les employés et syndicats, ainsi que plusieurs élus ayant soutenu le projet, regrettent cette décision qui est vécue comme un échec majeur dans le cadre de la transition énergétique. Géré par l’Ademe, SINOE est un outil d’analyse principalement destiné aux collectivités territoriales afin de les aider à optimiser leur politique de gestion des déchets ménagers et à améliorer leur service. SINOE dispose notamment d’une base de données consolidée qui repose sur un historique unique de plus de 10 ans d’information sur la gestion des déchets ménagers et assimilés en France. Pour accompagner la filière, SINOE a mis en ligne un document présentant en détail un état des lieux du parc des installations de méthanisation en France, réalisé en partenariat avec Observ’ER. Il est présenté suivant les différents types d’unités (à la ferme, centralisées, à partir de déchets ménagers, de stations d’épuration et de déchets industriels) avec des indicateurs de puissance installée, d’énergie produite et des cartographies illustrant le déploiement des sites sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cet état des lieux se base sur la dernière mise à jour de l’outil SINOE qui présente un panorama au 1er janvier 2021. A cette date la France comptait 1 018 installations opérationnelles dont la majorité (660 sites, soit 65 %) sont des unités à la ferme. Au niveau des types de valorisation, c’est la cogénération qui prédomine (production concomitante d’électricité et de chaleur) avec 63 % des cas devant l’injection de biométhane dans les réseaux gaz (19 %) et la production de chaleur seule (18 %). Dernière ligne droite pour les organisateurs japonais des Jeux olympiques 2021. La France anticipe et prépare l’échéance 2024. Parmi les installations en construction, une centrale géothermique d’une puissance de 2,8 MW qui alimentera en chaud et en froid le futur village des athlètes. Ainsi que la tour et la zone d’activité dite Pleyel (dans la commune de Saint-Denis). Le tout via une extension du réseau de chaleur du Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (Smirec), le deuxième réseau de chauffage urbain d’Île-de-France. Cette nouvelle infrastructure utilisera une énergie à 68 % renouvelable. « Trois puits de production de 115 m3/h ont été forés. Ils récupèrent une eau à 14 degrés dans le Lutétien, à 60 mètres de profondeur », témoigne Elodie Delemazure, cheffe de projets chez Engie Solutions, le délégataire de service public du réseau. Les deux derniers des sept puits de réinjection seront opérationnels à la fin du mois. De même que le puits de secours. Pas de mauvaise surprise à ce stade. Même s’il faut attendre que les travaux soient terminés pour tester tous les puits en même temps. Et savoir avec certitude que les débits restent ceux qui ont été imaginés au départ. (Quand ce n’est pas le cas, il est parfois nécessaire de délaisser la géothermie de surface et de trouver un plan B : une chaufferie biomasse ou un forage jusqu’au Dogger par exemple… avec une équation économique qui impose de raccorder un nombre plus conséquent de bâtiments). Les puits terminés, viendra le temps de la construction de la centrale, des raccordements et la mise en service, le tout devant s’étaler sur 2022-23. Cent-vingt sous-stations parsèmeront alors les dix kilomètres de réseau. Des thermofrigopompes élèveront la température en hiver (65 degrés au départ, 45° à l’arrivée) et l’abaisseront en période estivale (5° au départ. 12° à l’arrivée). Ces températures ne correspondent pas aux autres branches du réseau du Smirec créées pour certaines en 1950 et qui transportent pour l’une de l’eau chaude, pour l’autre de la vapeur. Elles sont en revanche parfaitement adaptées aux technologies de diffusion de calories plus contemporaines. En l’occurrence aux besoins des 600 000 m 2 de planchers chauffants créés en même temps que l’extension de réseau. Mardi 22 juin, à l’occasion des septièmes assises nationales des énergies marines renouvelables (EMR), l’Observatoire des énergies de la mer a présenté les principales conclusions de son rapport 2021 sur le secteur. Avec la mise en chantier en 2019 du parc éolien de Saint-Nazaire et de ceux de Fécamp et Saint-Brieuc en 2020, le secteur change d’échelle et entre de plain pied dans la construction d’une filière industrielle française. Plusieurs chiffres attestent en effet d’un réel décollage du secteur comme notamment le bond spectaculaire des investissements réalisés en 2020. Avec la construction des parcs cités plus haut, les sommes investies l’an passées ont atteint 1,5 milliard d’euros, soit 40 % des 3,6 milliards investis en France depuis 2007. L’an passé, le chiffre d’affaires du secteur a été estimé à 833 millions d’euros et pour la première fois, la majorité de l’activité des prestataires et fournisseurs de la chaîne de valeur a été réalisée grâce au marché domestique (71 %). Enfin côté emplois, après avoir dépassé le seuil des 3 000 emplois en 2019, les créations de postes se sont accélérées pour s’établir à 4 859 emplois en équivalent temps plein, soit une hausse annuelle de 59 %. Au niveau des territoires, une région sort du lot : les Pays de la Loire qui concentrent 53 % du chiffre d’affaires des prestataires et fournisseurs nationaux ainsi que 33 % des emplois du secteur. L’agence perpignanaise ArchiConcept vient d’être désignée pour la réalisation du futur campus dédié aux énergies renouvelables qui sera situé dans la zone Tecnosud de Perpignan (Occitanie). A la rentrée 2023, le site accueillera l’école d’ingénieur Sup’EnR, qui forme des étudiants au génie énergétique et aux énergies renouvelables (diplôme d’ingénieur, licence et master). L’objectif est de regrouper sur un seul campus, des plateformes de recherche, des conférences, des colloques et d’associer ces formations au pôle de compétitivité DERBI qui a pour mission de développer, au niveau régional, national et international, l’innovation, la recherche, la formation, le transfert de technologie, le développement et la création d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables appliquées au bâtiment et à l’industrie. Le futur bâtiment de 4 000 m2 (Bepos) sera équipé de panneaux solaires en toiture et d’ombrières de parking. Une pompe à chaleur géothermique par sondes verticales couvrira les besoins du site en chaleur et rafraîchissement. Le groupe franco-belge spécialisé dans les systèmes de stockage d’énergie John Cockerill annonce vouloir implanter une gigafactory d’équipements de production d’hydrogène bas carbone sur son site d’Aspach-Michelbach dans le Haut-Rhin. Le site serait doté d’ici 2022 d’une annexe lui permettant de produire jusqu’à 200 MW d’électrolyseurs annuellement. John Cockerill souhaite également commercialiser d’autres solutions permettant la production et le stockage d’hydrogène vert, basé sur le savoir-faire français et européen. En effet, l’entreprise prévoit la création de 400 emplois en Europe dont 250 emplois directs en France. Allié à d’autres sites européens, comme celui de Seraing en Belgique, le site envisage de progressivement augmenter sa capacité de production jusqu’à 1 GW à l’horizon 2030. L’entreprise McPhy spécialisée dans les électrolyseurs et stations de recharge hydrogène annonce elle aussi vouloir développer des capacités de production. Situé à Grenoble, ce nouveau site industriel devrait multiplier par sept les capacités actuelles de production de station de McPhy (soit près de 150 stations annuellement), en créant plus de 100 emplois directs. Il rassemblera dès 2022 les équipes, actuellement à La Motte-Fanjas et à Grenoble, sur ce site de 4 000 m². Ce changement d’échelle et de site pourrait permettre de fortement diminuer les coûts de production et les délais de livraison d’après McPhy. Ces stations seront destinées à la recharge de tous types de véhicule. L’entreprise spécialisée dans l’énergie houlomotrice Seabased va installer une centrale de 10 MW en Bretagne. La région, qui soutient ce projet via Bretagne Ocean Power, souhaite montrer que la Bretagne est une région avant-gardiste en ce qui concerne ce type de technologie marine. Bretagne Ocean Power a été créé dans ce but, et coordonne l’action de tous les acteurs économiques impliqués dans le développement des énergies marines en Bretagne. Pour ses systèmes électroniques Seabased a déjà travaillé avec l’entreprise bretonne ENAG, spécialisée dans les systèmes de conversion d’énergie en milieu hostile. Fort de ces divers partenariats, Seabased développe une centrale houlomotrice pilote de 2 MW dans la baie d’Audierne qui évoluera jusqu’à une puissance de 10 MW. Il s’agit d’un système de bouées à la surface de l’océan qui soulèvent l’arbre d’un générateur linéaire grâce au mouvement des vagues. Ce générateur constitué d’aimants, appelé Wave Energy Converter (WEC), est posé sur le fond marin. L’électricité produite par de nombreux systèmes bouée-générateurs est ensuite transportée sur le fond marin jusqu’à une sous-station avant de rejoindre le réseau électrique. Mardi 15 juin se sont déroulés les 8e États généraux de la chaleur solaire, un évènement co-organisé par Enerplan et Atlansun. Les échanges ont rassemblé un large panel d’industriels ou d’institutions engagés dans cette technologie. Ils ont été l’occasion de faire le bilan d’un secteur trop souvent oublié et parent pauvre de la transition énergétique du pays. Outre l’orientation positive du marché en 2020 et pour les premiers mois de 2021, les États généraux ont été l’occasion de rappeler la pertinence des réalisations solaires thermiques, qui constituent des solutions à des applications très variées. Il a ainsi été question de la dynamique des chauffe-eaux solaires individuels et des systèmes solaires combinés qui, après une année 2020 encourageante, connaissent une très forte progression en 2021. Dans le neuf, le positionnement du solaire thermique dans la prochaine RE2020 semble intéressant même si tous les détails de la prochaine réglementation ne sont pas encore connus. Autre sujet débattu, la place de la chaleur solaire dans les opérations du Fonds chaleur. Si les contrats d’objectifs territoriaux ou patrimoniaux ont permis ces dernières années de faire émerger plusieurs projets intéressants, il reste du chemin à parcourir pour que cette technologie puisse faire mieux que la cinquantaine de réalisations aidées en 2020 pour environ 4 % du budget total du dispositif. La concurrence avec le gaz fossile mais également avec les autres technologies renouvelables sont des obstacles difficiles pour un secteur souvent mal connu des acteurs du bâtiment. Pour l’avenir, les demandes des professionnels au gouvernement portent sur trois axes : le maintien des aides actuelles (notamment MaPrimeRénov qui semble donner de l’air au secteur depuis début 2020), la simplification des démarches administratives et enfin davantage de communication et d’information. Les chiffres 2020 du marché solaire thermique pour les applications individuelles viennent d’être publiés par Observ’ER. Dans son étude annuelle, l’observatoire évalue à 22 530 m2 les surfaces de capteurs solaires thermiques vendues en 2020 en Métropole pour des applications de chauffe-eaux solaires individuels ou de systèmes solaires combinés (eau chaude sanitaire plus chauffage). Ce chiffre marque une croissance de 8 % par rapport à 2019. Si le secteur reste à un niveau d’activité très bas comparé à ce qu’il était il y a une dizaine d’années (près de 130 000 m2 en 2011), les industriels ont tout de même le sentiment qu’une nouvelle dynamique peut s’enclencher. Les efforts faits sur les prix, qui sont restés très stables au cours des dernières années alors que celui des énergies fossiles a augmenté, commencent à porter leurs fruits. Dans le même temps, le développement des qualifications RGE (reconnu garant de l’environnement), acquises par les installateurs, a joué pleinement son rôle de tiers de confiance auprès des particuliers. Enfin, la mise en place en 2020 du dispositif gouvernemental MaPrimeRénov’, qui propose des aides réellement incitatives, a également participé aux bons résultats de 2020. Du côté des territoires d’Outre-mer, le marché présente un visage beaucoup plus dynamique avec 90 545 m2 recensés l’an passé. Dans ces régions, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a mis particulièrement l’accent sur la précarité énergétique en multipliant par trois la valeur des CEE provenant d’opérations réalisées chez des ménages en situation de précarité énergétique par rapport aux CEE hexagonaux. Le chauffe-eau solaire individuel est souvent l’équipement choisi dans le cadre de ce dispositif. Le concepteur et fabricant français d’hydroliennes marines HydroQuest vient d’annoncer un partenariat avec Qair Marine, pour développer une centrale hydrolienne constituée de sept machines de 2,5 MW chacune, soit 17,5 MW. Leur association se matérialise par la création de la société́ « FloWatt, les hydroliennes du Raz Blanchard », dont l’ambition est de permettre un déploiement à l’échelle commerciale de l’énergie hydrolienne en mer d’ici à 2030. Situé sur la concession du Raz Blanchard, cédée par EDF Renouvelables et localisée à la pointe nord-ouest de la presqu’île du Cotentin, le futur site va s’appuyer notamment sur les retours d’expérience du projet OceanQuest, l’hydrolienne marine immergée depuis 2019 à Paimpol-Bréhat. Pour ce nouveau projet, HydroQuest a conçu une nouvelle turbine à double axe vertical plus légère, dont la puissance nominale passera de 1 MW à 2,5 MW. La mise en service de FloWatt est prévue pour 2025, sous réserve du soutien du programme d’Investissement d’Avenir, opéré́ par l’Ademe, avec un démarrage de la construction des hydroliennes à partir de 2023. La ferme pilote sera exploitée sur une durée de 20 ans et produira 40 millions de kWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 20 000 habitants. L’ensemble de la gestion du projet sera effectué en France, de la fabrication des machines à leur maintenance en passant par les travaux de raccordement électriques. Le 2 juin, le Conseil Européen de l’Énergie Géothermique (EGEC) a publié son rapport annuel : European Geothermal Market Report 2020. D’après ce dernier, 2020 a marqué une fin tourmentée de la décennie, mais également un regain d’intérêt pour l’énergie géothermique. En effet fin 2020, l’Europe au sens large, incluant jusqu’à la Turquie, comptait 3,5 GW de production électrique issus de géothermie, répartis en 139 centrales. La Turquie, premier pays avec 1 688 MW installés, est le seul à avoir entamé un nouveau projet en 2020. Le nombre de réseaux de chaleur et de froid urbains alimentés par la géothermie s’élève quant à lui au nombre de 350, avec plus de 232 nouveaux projets en cours, malgré les impacts de la crise sanitaire. À l’image de l’Islande qui exploite 2 632 MW de géothermie profonde, de nombreux pays ont dévoilé leur volonté de développer fortement cette énergie, afin de décarboner leurs besoins de chaleur et de froid. Avec plus de 2,1 millions d’équipement en fonctionnement, l’EGEC souligne que le marché des pompes à chaleur géothermiques, bien qu’il soit en croissance, reste très localisé dans certains pays, notamment scandinaves. Afin de soutenir la filière, l’EGEC appelle les pouvoirs publics à la soutenir via des subventions à l’achat et aux forages, à mettre en place des prix pour le carbone plus incitatif, à financer la recherche, et à simplifier les démarches administratives pour l’autorisation des projets. Lhyfe, entreprise nantaise spécialisée dans l’hydrogène renouvelable, a été choisie pour faire partie du nouveau parc industriel danois « GreenLab », l’une des premières zones d’essai énergétique officielles et réglementaires en Europe. Lhyfe et ses partenaires y installeront un site équipé de 24 MW d’électrolyse pour une production d’environ 8 tonnes d’hydrogène renouvelable par jour. Cet hydrogène alimentera une production de méthanol utilisé pour la mobilité́ et les industriels du site, ainsi que pour la mobilité des usagers des alentours. La première phase du projet, qui comprend environ 12 MW, devrait être installée fin 2022. Le Français fait également partie du consortium du projet GreenHyScale, qui prépare un accord de subvention auprès de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) en réponse à l’appel de financement Green Deal de l’Union Européenne. GreenHyScale consiste en un projet de démonstration d’un électrolyseur d’une puissance minimale de 100 MW, utilisant la nouvelle génération d’électrolyseur alcalin multi-MW fournie par le Danois Green Hydrogen Systems. L’unité, dont la mise en service est prévue courant 2024, fournira environ 30 tonnes d’hydrogène renouvelable par jour. Le montant de la subvention s’élève à 30 millions d’euros. La mairie de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) annonce que les travaux de la centrale hydroélectrique qui turbinera les eaux du torrent de Miage débuteront après l’été 2021. La construction se déroulera en trois temps : la prise d’eau sur le torrent de Miage, une conduite forcée et un bâtiment usine qui sera fondu dans un environnement boisé à flanc de montagne pour une meilleure réduction de l’impact visuel. Pour l’acheminement des matériaux, la commune a opté pour un transport par câble téléphérique appelé « blondin », une solution technique respectueuse de l’environnement, qui évite des rotations d’engins motorisés. Un bail de 60 ans a été signé entre la commune et la SARL CH Miage (filiale du groupe Quadran) qui sera en charge de la construction et de l’exploitation de la centrale dont la puissance est estimée à 3 190 kW. La mise en service est annoncée pour 2023. Le géant de la construction China Gezhouba Group Corporation (CGGC) se voit confier la construction du futur barrage de Chollet par les gouvernements camerounais et congolais. Ce projet vise à construire une centrale électrique de 600 MW sur la rivière Dja, aussi appelée rivière Ngoko, marquant la frontière entre le Cameroun et la République du Congo. Avec 108 mètres de hauteur, le barrage créera une chute de 85 m pour produire de l’électricité à destination du Cameroun et du Congo, mais ces derniers envisagent également d’en fournir à leurs voisins du Gabon et de la République centrafricaine. Ce projet de 700 millions de dollars (600 M€), notamment soutenu par la Banque africaine de développement (BAD), sera mené en trois étapes, à savoir études, construction puis mise en service par la CGGC, mais pour l’heure aucun planning ni potentiel exploitant n’a été dévoilé. Dijon Métropole a annoncé le mercredi 19 mai le démarrage de la construction de sa première station de production d’hydrogène renouvelable qui sera située au nord de la ville. Ce site s’intègre au projet Smart Energhy, une coentreprise créée par Dijon Métropole et Rougeot Energie, et sera capable de produire jusqu’à 440 kilos d’hydrogène afin d’alimenter d’ici 2030, 44 bennes à ordures ménagères et 180 bus. L’électrolyseur sera alimenté par une électricité d’origine renouvelable issue de la combustion de déchets et d’une centrale solaire de 12 hectares pour une mise en service début 2022. Un projet de 100 millions d’euros au total, dont 20 % pour la construction des stations de production d’hydrogène et 80 % pour le renouvellement des bennes et des bus à hydrogène. Les investisseurs sont l’Ademe, la Région Bourgogne Franche Comté et l’Europe. Un second site de production, également situé au nord de Dijon, aura une capacité initiale de 880 kg/jour avec une mise en service prévue en 2023. Selon l’AFP, la société Morbihan Hydro Énergies, détenue à 51% par le fabricant d’hydroliennes Sabella, vient d’annoncer un projet d’immersion de deux hyroliennes dans le golfe du Morbihan. Ce projet est en phase d’instruction et fera l’objet d’une enquête publique dès cet été. Les deux hydroliennes de 14 mètres de haut et de 3,5 mètres de diamètres pour une puissance de 250 kW chacune seront fournies par Sabella et immergées à 20 mètres de profondeur dans le courant de la Jument, le plus fort du golfe du Morbihan. Le projet, d’un coût total de 8,5 millions d’euros est financé à hauteur de 65 % par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du projet Interreg Tiger qui promeut les énergies marines renouvelables. Le lancement opérationnel est programmé pour le second semestre 2022. La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et Paris et Métropole aménagement (P&Ma) annoncent la signature d’une convention pour la réalisation des travaux d’alimentation en chaleur renouvelable du nouvel écoquartier Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris. Les 59 000 m² de bâtiments neufs ou réhabilités seront chauffés via une boucle d’eau chaude qui valorise l’énergie calorifique de l’eau non potable de la ville de Paris. L’eau non potable de Paris, puisée dans la Seine et dans le canal de l’Ourcq possède son propre réseau et sert principalement au nettoyage des rues, au bon fonctionnement des égouts ou à l’arrosage des espaces verts. Cette nouvelle boucle à basse température de 450 mètres de long connectera tous les bâtiments à qui elle fournira une eau à 65°C, température parfaitement adaptée à leur haute performance énergétique. La boucle sera aussi connectée au réseau principal de la CPCU via deux échangeurs vapeur-eau en cas de besoin. Le projet est financé par P&Ma et CPCU, les adaptations nécessaires du réseau d’eau non potable par Eau de Paris, soit un investissement d’1,7 million d’euros. L’AIE a publié un rapport pour alerter sur la demande croissante de certains matériaux nécessaires aux développements de technologies renouvelables et de l’électrification des usages comme la voiture électrique. En effet dans « The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions » l’agence fournit un travail prospectif afin d’identifier les besoins en matériaux suivants différents scénarios de développement des technologies vertes. Ainsi elle propose plusieurs mesures pour contrer un certain nombre de risques identifiés, comme le fait que certains minéraux restent aujourd’hui exclusivement produits par un petit nombre de pays. Elle invite donc les gouvernements à investir dans des chaînes d’approvisionnement variées pour réduire les dépendances vis à vis de certains pays en situation de quasi-monopole. Il faut également promouvoir les nouvelles technologies à tous niveaux de la chaîne de valeur, afin de garantir une utilisation optimale des matériaux, d’un point de vue économique et environnemental. Le recyclage devra jouer un rôle majeur afin de réduire les besoins en matériaux bruts, grâce à des méthodes de collectes innovantes, et à des efforts de R&D sur les nouvelles technologies de valorisation des matériaux usagés. Les décideurs devraient également mettre en place un cadre propice à la transparence du marché, leur permettant, en cas de perturbations comme c’est le cas durant la crise sanitaire actuelle, de réguler rapidement et efficacement les chaînes d’approvisionnement. Enfin, l’AIE insiste sur le besoin de renforcer les normes environnementales et sociales relatives à l’extraction, la transformation et le transport des matériaux critiques de façon à maximiser les avantages environnementaux de la transition énergétique et à encourager le développement de nouveaux acteurs. La consultation publique pour le projet de décret bioénergies lancée le 27 avril dernier se poursuivra jusqu’au 18 mai. Il s’agit de transposer au niveau national le volet durabilité des bioénergies de la directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Pour rappel, une première directive (RED I) adoptée en 2009 avait conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et biocombustibles. En 2018, RED II soumettait aux mêmes exigences les filières de production de chaleur, gaz ou électricité à partir de combustibles issus de biomasse. Ainsi l’ordonnance de mars 2021 (n° 2021-235) vise à transposer RED II au niveau national, en soumettant toutes les installations de bioénergies (au-dessus d’un seuil de puissance) aux exigences de durabilité et de réduction de GES, ainsi que d’efficacité énergétique au niveau de la production électrique. Ces installations devront notamment respecter un certain nombre de critères pour pouvoir compter sur de futures aides publiques, ce qui devra être certifié par des organismes de contrôle indépendant. La transposition sanctuarise également des terres de riche biodiversité ou présentant un important stockage de carbone. Le fabricant de roulements mécaniques suédois SKF a annoncé le 28 avril l’installation d’une nouvelle turbine marémotrice au sein du Centre Européen pour l’énergie marine (EMEC), basé dans les Îles Orcades, en Écosse. Développé par l’entreprise écossaise Orbital Marine Power, avec l’aide des technologies de SKF, ce projet consiste en une unité de 2 MW électriques : l’Orbital O2. Comme l’énergie du soleil et du vent, celle de la Lune peut être exploitée via les forces qu’elle exerce sur les marées, pour actionner un alternateur, et donc produire du courant électrique. L’Orbital O2 mesure 72 mètres de long et possède 2 rotors bipales de 20 mètres de diamètre chacun, entraînés par les courants marins. Le potentiel de cette technologie est « colossal », selon SKF. La Commission européenne prévoit 40 GW d’énergies marines en service d’ici 2050, incluant l’énergie marémotrice, hydrolienne, houlomotrice, le photovoltaïque flottant et la production de carburants à partir d’algues. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole annonce l’extension de son réseau de chaleur renouvelable et missionne la société de distribution de chaleur de Mont-Gaillard (SDCMG), filiale d’Engie Solutions pour la réalisation des travaux. Construit en 1972, le réseau est composé de 97 sous-stations et 16 kilomètres de canalisations. Il alimente aujourd’hui en chaleur et eau chaude sanitaire plus de 6 000 équivalents logements (bailleurs, bureaux, bâtiments publics, etc.) situés dans les quartiers de Mont Gaillard, du Grand Hameau de Montcalm Capuchet et de Mare Rouge. En 2013, le réseau a été rénové avec l’acquisition d’une chaudière biomasse de 12 MW qui a permis d’offrir des tarifs plus compétitifs aux clients et d’avoir une couverture à 60 % issue d’énergies locales et renouvelables. Le nouveau projet prévoit 5 kilomètres de réseau additionnels, soit 2 500 équivalents logements supplémentaires, dont 15 000 m² de bâtiments tertiaires des quartiers Points Cardinaux et Bléville. Les travaux débuteront dès juillet 2021 pour une mise en service en février 2022. Malgré le poids des chiffres, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) tire un bilan en demi-teinte du Fonds Chaleur pour 2020. Le fonds a pourtant engagé 350 millions d’euros l’an passé au travers de plus de 600 projets aidés et annonce un portefeuille de 477 M€ en 2021. Si l’intérêt de cet outil, unique en Europe dans sa forme et son envergure, n’est plus à démontrer, la Fédération tient à nuancer ces résultats notamment sur la question du développement de nouveaux réseaux de chaleur. En la matière, les projets concernent principalement en des extensions de réseaux existants et non des créations. Le verdissement et l’extension des réseaux existants, s’ils sont des leviers essentiels, ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de développement de la filière, qui exige de créer de nouveaux réseaux. Ainsi, seuls 60 % de l’objectif de 2020 (par rapport à la trajectoire de la loi de programmation) a été atteint. La FNCCR regrette qu’il n’y ait pas eu une montée en puissance des objectifs Grenelle. Alors qu’il faudrait créer 8 TWh d’installations en chaleur renouvelable par an, la dynamique actuelle oscille entre 3 et 3,5 TWh/an. Les réseaux de chaleur étant en quasi-totalité publics, il appartient donc aux collectivités d’investir. Après une année 2020 marquée par des élections municipales, 2021 va être une année pleine pour les élus qui vont pouvoir plus aisément penser leurs futurs projets autour des énergies renouvelables thermiques et des réseaux de chaleur. Ces derniers apportent aux territoires des moyens de maîtriser le coût des factures pour les abonnés. Ainsi, la FNCCR compte renforcer son action dans ce domaine en direction des élus, avec notamment un nouveau cycle de formation et un guide, qui leur seront dédiés. Le 14 avril, le ministère de la Transition écologique a dévoilé son plan d’action pour le chauffage au bois domestique et le soumet à la consultation du public. Son objectif est de réduire de 50 % les émissions de polluants, la pollution atmosphérique étant responsable de 40 000 morts par an rien qu’en France d’après Santé Publique France. En 2018, le chauffage domestique au bois était responsable de 43 % des émissions de PM 2,5 et plus de 50 % de celles de PM 1,0 cancérigènes du fait d’un parc comprenant de nombreux appareils anciens. Afin de réduire l’impact sanitaire, les appareils utilisés doivent respecter un certain nombre de critères, être correctement dimensionnés et entretenus, utiliser du combustible sec, et privilégier les techniques d’allumage par le haut. Ce plan d’action vise à atteindre l’objectif de la loi Climat et Résilience de baisse de 50 % des émissions de particules fines, votée par les députés le 13 avril. Il s’organise autour de six axes prioritaires : sensibiliser le grand public en rendant obligatoire sur le nouveau diagnostic de performance énergétique l’affichage de la vétusté de l’appareil ; renforcer les politiques d’accompagnement pour le renouvellement des vieux appareils au bois ; faire évoluer les normes sur les nouveaux appareils ; créer un label pour favoriser l’utilisation de combustibles de haute qualité ; communiquer sur l’impact sanitaire de la combustion du bois, mais également encadrer l’utilisation du chauffage au bois dans les zones les plus touchées par la pollution atmosphérique. Rappelons que la France a été condamnée par la justice européenne pour manquement aux obligations issues de la directive sur la qualité de l’air. Avec le plan d’action pour la mobilité propre, celui sur le chauffage au bois devrait contribuer à améliorer la situation. Le 14 avril, le géant allemand de l’énergie Uniper a annoncé la création d’un hub hydrogène à Wilhelmshaven, en Basse-Saxe, en lieu et place du terminal de gaz naturel liquéfié (LNG) envisagé jusque-là. Une étude de marché avait en effet montré en octobre 2020 que les perspectives de long terme pour l’usage du LNG en Allemagne ne permettaient pas de rentabiliser ce terminal. Dénommé Green Wilhelmshaven, le nouveau projet est en cours d’étude de faisabilité, et prévoit la construction d’un terminal d’importation d’ammoniac (NH3) équipé d’un craqueur d’ammoniac pour produire du dihydrogène (H2). Cet ammoniac vert sera produit à partir de sources renouvelables. Le hub comprendra également un électrolyseur de 410 MW. À eux deux, ils devraient pouvoir fournir 295 000 tonnes d’hydrogène annuellement, soit 10 % de la demande allemande estimée en 2030, grâce à un futur réseau de gaz dédié. Le futur hub devrait être livré après 2025. Cet hydrogène est essentiel pour les objectifs de neutralité carbone de l’Allemagne. En effet, s’ils sont issus de sources d’énergies bas-carbone, les procédés de power-to-gas pourraient permettre de réduire sensiblement l’impact carbone de l’industrie, acier et chimie ciment notamment, et des transports longue distance (aérien, maritime, etc.). Dans la fabrication de l’acier, cet hydrogène servira par exemple à la réduction du minerai de fer en remplacement partiel du charbon aujourd’hui majoritairement utilisé, et extrêmement polluant. Le groupe Total annonce le démarrage de la production de biocarburants aériens dans ses bioraffineries de La Mède (Bouches-du-Rhône) et d’Oudalle (Seine-Maritime). Ces biocarburants sont élaborés uniquement à partir de déchets et résidus issus de graisses animales et d’huiles de cuisson usagées sans recours aux huiles végétales. Avec la création de cette nouvelle production dédiée, le pétrolier répond à la forte demande du secteur aéronautique qui recherche des alternatives au kérosène fossile afin de réduire son empreinte carbone. L’objectif est aussi une mise aux normes avec la législation française qui prévoit un mandat d’incorporation de 1 % de biocarburants aériens dès 2022, puis un objectif de 2 % à horizon 2025 et de 5 % à horizon 2030. Les aéroports français pourront disposer de ce biocarburant dès la fin avril 2021. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2020 des pompes à chaleur (PAC) dans le secteur du résidentiel (jusqu’à 30 kW). Pour les équipements aérothermiques, l’activité a été bonne puisque les ventes ont progressé de 10 % en un an (900 700 unités contre 815 400 en 2019). Avec 729 680 unités écoulées, le segment des PAC air/air est le premier sur le marché des systèmes de chauffage central individuel en France, loin devant les chaudières gaz ou fioul à condensation (510 000 ventes à elles deux). Cette croissance a surtout été portée par le marché de la rénovation car la construction de maisons neuves a été en retrait l’an passé. De leur côté, les pompes à chaleur air/eau font une année étale par rapport à 2019 (170 390 unités) alors que pour les chauffe-eau thermodynamiques c’est un recul des ventes qui a été enregistré en 2020 (109 500 unités contre 118 380 en 2019). Ce tassement est le premier depuis l’introduction de ce type d’appareils sur le marché français il y a une dizaine d’années. Enfin, pour les pompes à chaleur géothermiques, l’activité a été en baisse de 13,5 % pour s’établir à 3 005 appareils écoulés. Si les ventes se sont stabilisées depuis 2016 entre 3 000 et 3 500 unités annuelles, le secteur reste à un niveau faible qui le cantonne à un marché de niche. Lors de la 11ème session de l’Assemblée générale de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les délégataires d’Arabie Saoudite ont annoncé leur volonté de couvrir 50 % de leurs besoins en électricité à l’aide d’énergies renouvelables d’ici à 2030, le reste étant fourni par le gaz. C’est une révolution pour un pays où en 2019 le gaz représentait 65 % du mix électrique, le reste étant couvert par le pétrole. Ce projet est un immense défi dans un royaume où beaucoup reste à faire en termes d’infrastructure et d’organisation des filières renouvelables, de localisation des technologies, de réglementation ou de développement des ressources humaines. L’un des piliers de cette révolution verte devra être l’étroite collaboration entre institutions universitaires et scientifiques afin d’identifier les meilleures politiques de promotion des renouvelables. Le pays entend également réduire ses émissions de CO2 et prévoit de mettre en œuvre des projets sur les technologies d’hydrocarbures propres pour éliminer plus de 130 millions de tonnes de CO2 (MtCO2), toujours à l’horizon 2030, contre 582 MtCO2 émises en 2019. Les émissions de carbone liées au secteur énergétique de l’Arabie saoudite ont bondi de 5 % par an entre 1990 et 2015, puis sont restées stables avant de diminuer en 2018. Le pays compte les émissions par habitant parmi les plus élevées au monde, atteignant 17 tCO2 par habitant en 2019 (trois fois plus qu’un français), en faisant le 7ème émetteur mondial par habitant. L’agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) a publié son rapport annuel Renewable Capacity Statistics 2021 ce début avril, concernant la progression des énergies renouvelables destinées à la production d’électricité dans le monde. La principale information à retenir est le record d’installation en 2020 malgré la pandémie de la covid-19. En effet plus de 260 GW de capacité renouvelable ont été installés, soit près de 50 % de plus que le précédent record de 2019, pour atteindre 2,8 TW au total. Ainsi parmi les nouvelles centrales électriques installées en 2020, les renouvelables représentent plus de 80 % des capacités, dont 91 % rien que pour le photovoltaïque (127 GW) et l’éolien (111 GW) majoritairement en Chine et aux États-Unis. L’hydroélectricité croît de 12 GW en Chine et de 2,5 GW en Turquie. La capacité de production à partir de bioénergie augmente quant à elle de seulement 2,5 GW, et la géothermie de moins de 200 MW. La capacité d’électricité renouvelable hors réseaux a augmenté de 365 MW en 2020 pour atteindre 10,6 GW. La part des renouvelables dans la capacité électrique mondiale monte ainsi à 36,6 %, notamment grâce au démantèlement de centrales fossiles. Ces chiffres montrent une certaine résilience du marché des énergies renouvelables électriques au niveau mondial. La part des énergies renouvelables dans les capacités électriques mondiales s’établissait déjà à 34,6 % en 2019, selon l’Agence internationale de l’énergie En créant la société GéoRueil avec Engie solutions, Rueil-Malmaison veut montrer que la géothermie profonde n’est pas réservée à l’est parisien. Les travaux de forage de la coentreprise démarreront au printemps pour capter d’ici la fin de l’année une ressource de 61 degrés localisée à une profondeur de 1500 mètres (au Dogger). Objectif : une mise en service à l’été 2022 d’une centrale de 11,3 MW qui alimentera durant 28 ans un réseau de chauffage urbain de 11 000 équivalents-logement. « Dans un premier temps, nous avions la volonté de nous appuyer sur une part conséquente d’énergies renouvelables pour notre nouvel écoquartier, rapporte Monique Bouteille, maire adjointe en charge de l’urbanisme de la commune des Hauts-de-Seine. Un travail avec l’Ademe nous a montré que le potentiel géothermique nous permettait d’aller bien au-delà de ses 2 400 logements. » Plutôt que de déléguer la construction et l’exploitation de l’installation et comme le permet désormais la loi de Transition énergétique de 2015, Rueil-Malmaison a pris 11,5 % des participations de GéoRueil. Suffisamment pour avoir un regard sur son activité et participer aux choix. Pas trop car « la gestion fine d’un réseau de chaleur est complexe et l’investissement global trop conséquent », poursuit l’élue. Le seul forage coûtera 18,5 millions d’euros. La note du réseau s’élèvera quant à elle à 65 M€. La société de services énergétiques Idex, annonce la mise en service de la chaufferie biomasse du réseau de chaleur de Givors, au sud de Lyon. Depuis 1970, la chaufferie des Vernes de Givors produit de l’énergie sous forme d’eau chaude à partir de gaz et de fioul. En 2017, la Métropole de Lyon missionne Idex afin de faire évoluer son bouquet énergétique qui va passer à 55 % au biogaz et 45 % au gaz. En 2021, la transition du réseau de chauffage de la commune s’accélère et passe de 3 à 9 kilomètres avec l’installation d’une chaudière bois et d’un récupérateur de chaleur des fumées couplé à une pompe à chaleur (PAC). Le mix énergétique de la commune est désormais le suivant : 65 % chaudière bois + 14 % fumées bois et PAC + 21 % gaz naturel, soit du chauffage pour 2 700 équivalents logements et une baisse de la facture de près de 14 % par rapport à l’année dernière pour les consommateurs. Coût total de l’investissement, 11 millions d’euros, dont 3,5 millions d’euros subventionnés par l’Ademe. À la suite d’un premier appel à projets lancé en 2020, qui a sélectionné 5 projets de production d’hydrogène renouvelable, la Région Bretagne a lancé un second appel à projet le 1er mars dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 2021. Il s’agira de 4 à 5 nouvelles boucles d’hydrogène renouvelable, qui comprendront une phase d’études préalables, dotée d’un budget régional de 200 000 €, puis de 3 millions d’euros pour la phase de réalisation. La Région incite les investisseurs à mettre l’équivalent d’1 % du coût total dans des actions de préservation de la biodiversité. Les profils des cinq premiers projets sélectionnés en 2020 sont divers. Porté par le Syndicat départemental d’énergie du Finistère, Molène stockage H2, consiste à stocker l’énergie électrique photovoltaïque sous forme d’hydrogène par électrolyse de l’eau afin de décarboner le réseau insulaire de l’Île de Molène. Brest potentiel H2 est quant à lui un projet qui vise à évaluer le potentiel technico-économique du port et de l’unité de traitement des déchets de Brest. Situé à Briec, Ecosystème H2 vise à valoriser l’électricité produite par l’incinérateur des déchets du pays de Quimper pour produire de l’hydrogène par électrolyse. Hydrogène Morbihan consiste à développer un réseau de distribution autour de Vannes avec des stations de recharge pour véhicule en s’appuyant sur le site d’électrolyse renouvelable HyGO Vannes, prévu pour 2021. Un autre Ecosystème H2, cette fois situé près de la Roche aux Fées, cherche à étudier la possibilité de création d’un réseau d’hydrogène vert pour alimenter un train, une flotte d’utilitaires et de poids lourds ainsi que de l’injection sur le réseau de gaz. À l’occasion de ses 10 ans, l’équipementier et prestataire de services pour les marchés de l’énergie Altawest s’est engagé auprès de la Fondation Énergiespour le Monde, en particulier en contribuant au soutien de son projet BOREALE. Le projet BOREALE a pour objectif de procéder à l’électrification de sept localités rurales du sud de Madagascar grâce à des technologies de production d’énergie renouvelable. L’installation de centrales photovoltaïques d’une puissance de 7 à 12 kWc dans les régions d’Androy et d’Anosy permettra à 900 abonnés d’avoir un accès fiable et durable à l’électricité. Grâce à la production d’électricité verte, environ 6 000 bénéficiaires directs, et 20 000 bénéficiaires indirects, pourront accéder à davantage de confort domestique et à des conditions sanitaires améliorées, ainsi que développer de nouvelles activités. Altawest est venu accompagner le projet BOREALE à hauteur de 20 000 euros et le geste est d’autant plus altruiste que ce sont les employés de l’entreprise qui ont préféré remplacer le cadeau que l’entreprise faisait à chacun par un don à une ONG. L’étude de l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) intitulée Suivi du marché français des appareils de chauffage domestique au bois a été mise en ligne mercredi 24 mars et les résultats pour le marché 2020 ne sont pas bons. Dans son ensemble, le marché a enregistré un volume de 314 865 unités vendues soit 61 775 pièces de moins qu’en 2019. Segment phare, les ventes de poêles sont passées de 282 640 unités en 2019 à 237 550 (- 16 %). Pour les foyers et inserts, l’activité a chuté de 71 010 à 56 240 pièces (- 20,8 %) et pour les cuisinières, segment de niche, les ventes ont été en retrait de près de 25 % (4 340 en 2019 contre 3 275 en 2020). Évidemment, la crise sanitaire et économique a pesé lourdement dans ces mauvais résultats. Mais le marché était en perte de vitesse depuis plusieurs années. Autre phénomène très handicapant, l’extrême douceur de l’hiver 2019-2020 classé premier des hivers les plus chauds depuis un siècle. Principale illustration des difficultés du marché en 2020, les poêles automatiques à granulés enregistrent le plus gros recul de leur histoire avec près de 19 % de ventes en moins par rapport à 2019. Le coup est rude pour ce segment qui représente à lui seul 41 % des ventes d’appareils indépendants de chauffage au bois (poêles, foyers fermés, inserts et cuisinières). Dans ce constat sombre, seules les chaudières automatiques arrivent à tirer leur épingle du jeu avec une légère hausse de 2,4 % de leur activité (14 800 unités contre 14 460 en 2019). La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et Espaces Ferroviaires, filiale du groupe SNCF en charge de la réhabilitation d’anciens sites ferroviaires, signent une convention pour la mise en place d’un réseau de chaleur qui alimentera le futur écoquartier Hébert, entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers, dans le 18e arrondissement. Situé sur des terrains délaissés par la SNCF, ce programme prévoit la construction de 800 logements, 400 000 m2 de bureaux, 10 000 m² de locaux dédiés aux commerces, une crèche de 800 m2 et un square de 4 000 m2. Via un réseau de 450 mètres de long, la CPCU fournira chauffage et eau chaude, issus à 53,5 % de la valorisation de déchets (incinération) de ses centres de traitements situés en Île-de-France. Les travaux d’aménagement doivent débuter en 2022 pour une livraison en 2024. Six mois après la mise en place du plan gouvernemental « France Relance » en faveur de la décarbonation de l’industrie, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a présenté les 17 premiers lauréats du dispositif chaleur biomasse. Ces projets, qui représentent 130 millions d’euros d’investissements, permettront de réduire les émissions industrielles de gaz à effet de serre à hauteur de 332 000 tonnes de CO2 par an. Ces opérations bénéficieront d’une aide à l’investissement de 44 millions d’euros et d’un soutien au fonctionnement de 83 millions d’euros. Parmi les lauréats, on peut citer l’entreprise Kronenbourg, dans le Grand Est, avec son projet de mise en place d’un brûleur biomasse sur la chaudière gaz existante. La nouvelle installation effacera complètement le gaz du site grâce à un mix composé à 90 % de granulés de bois locaux et 10 % de biogaz issu du traitement des effluents du site. Depuis décembre 2020, le plan « France Relance » a permis de soutenir 49 projets pour la décarbonation de l’industrie française (que ce soit en chaleur biomasse ou en efficacité énergétique), soit 596 millions d’euros d’investissements. Fort de ce succès, le gouvernement a annoncé reconduire l’appel à projets concernant la production de chaleur biomasse, notamment ceux de conversion de chaudières existantes qui utilisent des combustibles fossiles vers des chaudières biomasse. De nouveaux lauréats seront annoncés en avril. L’association de promotion de l’énergie éolienne World Wind Energy Association (WWEA) a publié les résultats d’une enquête concernant les communautés énergétiques en Allemagne et au Japon. Issue d’une collaboration entre la WWEA, l’association régionale pour les énergies renouvelables en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LEE NRW) et la Japan Community Power Association, cette étude de deux ans visait à mettre en lumière la répartition des genres au sein des 50 communautés d’énergies sondées. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la proportion de femmes parmi les actionnaires est de 29 %, possédant 27 % des parts. Au Japon, ce pourcentage est également sous la barre des 30 %. Dans la moitié des structures japonaises, ce chiffre est inférieur à 10 %. Dans les deux pays, il semble que la proportion de femmes augmente avec la taille des communautés, et en Allemagne cette proportion est plus importante pour le photovoltaïque que pour les projets purement éoliens. Les femmes semblent également sous représentées au sein des directions, notamment au Japon où la moitié des structures n’ont aucune femme à des postes de management. La seconde partie de l’enquête montre que les profils types des membres des communautés d’énergie sont des hommes blancs retraités avec un capital social et culturel élevé. Au contraire, les personnes issues de l’immigration ou ayant des faibles revenus sont sous-représentées. Un groupe d’experts de la communauté SOCOL piloté par Philippe Papillon (du bureau d’études En Butinant l’Énergie) vient de réaliser un nouveau guide technique consacré à la production de chaleur solaire pour les piscines collectives. Ces équipements sont généralement ceux qui pèsent le plus lourd dans le budget “énergie” des collectivités en représentant en moyenne un peu plus de 10 % de leurs consommations énergétiques, ce qui correspond à 60 kWh/an (l’équivalent d’une quarantaine de douches) et près de 5 € par habitant. Or, le Fonds chaleur n’inclut pas les opérations solaires thermiques appliquées à ce secteur alors que la technologie constitue une solution performante et adaptée pour tous les besoins des différents types de piscines. Ce guide technique s’intéresse à plusieurs typologies de piscines (plein air à utilisation estivale, couverte « 4 saisons », bain nordique), à leurs besoins thermiques (ECS, bassins) et aux différentes technologies solaires adaptées aux différents usages (capteurs, systèmes). Comme c’est la tradition dans les ouvrages SOCOL, des schémas sont proposés pour chaque cas de figure, accompagnés d’éléments de dimensionnement et de points de vigilance. Le guide est en libre téléchargement sur le site de la communauté. Un groupe d’experts de la communauté SOCOL piloté par Philippe Papillon (du bureau d’études En Butinant l’Énergie) vient de réaliser un nouveau guide technique consacré à la production de chaleur solaire pour les piscines collectives. Ces équipements sont généralement ceux qui pèsent le plus lourd dans le budget “énergie” des collectivités en représentant en moyenne un peu plus de 10 % de leurs consommations énergétiques, ce qui correspond à 60 kWh/an (l’équivalent d’une quarantaine de douches) et près de 5 € par habitant. Or, le Fonds chaleur n’inclut pas les opérations solaires thermiques appliquées à ce secteur alors que la technologie constitue une solution performante et adaptée pour tous les besoins des différents types de piscines. Ce guide technique s’intéresse à plusieurs typologies de piscines (plein air à utilisation estivale, couverte « 4 saisons », bain nordique), à leurs besoins thermiques (ECS, bassins) et aux différentes technologies solaires adaptées aux différents usages (capteurs, systèmes). Comme c’est la tradition dans les ouvrages SOCOL, des schémas sont proposés pour chaque cas de figure, accompagnés d’éléments de dimensionnement et de points de vigilance. Le guide est en libre téléchargement sur le site de la communauté. Le 25 février dernier a été inaugurée la centrale solaire thermique SIG SolarCAD II située à Le Lignon sur le site des services industriels de Genève (SIG), un établissement public du canton de Genève (Suisse), chargé de la distribution de l’eau potable, du gaz, de l’électricité et de la chaleur urbaine sur l’ensemble du canton. D’une surface de 800 m2, la centrale produira de la chaleur qui sera injectée dans le réseau du canton de Genève auquel 60 000 ménages sont rattachés. L’installation fournira aussi l’équivalent de près de 70 % des besoins en eau chaude sanitaire du site des SIG au Lignon, qui accueillent 1 200 collaborateurs. Les panneaux, équipés de capteurs sous-vide fabriqués par la société genevoise TVP Solar, permettraient de produire davantage d’énergie en hiver que des panneaux classiques et à une température plus élevée, y compris par mauvais temps. Un tiers de la production de chaleur serait réalisé sur les 6 mois les plus frais de l’année. SolarCAD II est la deuxième centrale solaire thermique réalisée sur le site du Lignon. Elle succède à SolarCAD implantée de 1985 à 2000. Cette première installation avait déjà démontré la faisabilité technique de la production solaire reliée au réseau de chaleur. Le Groupe Legendre s’associe avec Geps techno et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) pour un projet de digue littorale productrice d’électricité. Spécialisée dans la construction et l’énergie, l’entreprise bretonne s’appuie sur sa filiale de recherche & développement Ingénova pour ce projet innovant. Prénommé Dikwe, ce projet entamé il y a deux ans consiste en un ouvrage de protection intégrant un système houlomoteur à volets oscillants dont la première phase de test réalisé à Brest dans le laboratoire de l’Ifremer s’est révélé concluante. Lauréat du Blue Challenge 2020 organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, il est soutenu par l’Ademe ainsi que les Régions Bretagne et Pays de la Loire. L’objectif est d’associer protection du littoral et production d’électricité tout en contrôlant son impact sur l’environnement. La prochaine étape, fin 2021, vise à des essais en mer d’un prototype à échelle réduite, qui, si les résultats sont probants, permettra d’entamer la construction de l’ouvrage réel prévu à l’horizon 2024. L’ordonnance définissant le cadre de soutien et de la traçabilité de l’hydrogène vert a été publiée au Journal Officiel le 18 février, au lendemain de sa présentation au Conseil des ministres. Prise en application de la loi Énergie-Climat de 2019, l’ordonnance censée définir les règles pour l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable et bas-carbone (nucléaire, et fossile avec capture de carbone) a fait l’objet d’une consultation publique début 2021. Pour s’inscrire dans la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, elle propose différents régimes suivant les types de production d’hydrogène, notamment basés sur leur impact carbone. Pour ce faire, un organisme indépendant sera chargé de gérer le système de garanties d’origines et de traçabilité, à l’instar du modèle pour les garanties d’origines de l’électricité. L’ordonnance définit également les conditions de mise en place d’un mécanisme de soutien public pour les filières de production par électrolyse issue d’électricité renouvelable et bas-carbone. Elle détaille également des dispositions relatives à l’injection sur les réseaux de distribution ou de transport de gaz naturel, dont les gestionnaires devront assurer la continuité de service et la sécurité du réseau. Un système de garanties d’origine pour le gaz injecté sur le réseau de gaz naturel est proposée, auquel sera également éligible l’hydrogène vert. Le Conseil d’État complètera ces annonces avec un décret, puis publiera un second décret pour son application. La semaine précédente, 30 industriels européens de l’énergie avait lancé le programme « HyDeal Ambition », visant à installer 95 GW de solaire et de 67 GW d’électrolyseurs en Europe à l’horizon 2030, pour atteindre un coût compétitif de l’hydrogène de 1,5 €/kg. Le Conseil d’État a annulé l’article 1er du décret du 3 août 2019 relatif au durcissement de la notion d’obstacle à la continuité écologique pour les systèmes de production hydroélectrique. Ce décret interdisait tout ouvrage de plus de 50 cm de hauteur sur un cours d’eau classé sur la liste* des cours d’eau en très bon état écologique, jouant un rôle de réservoir biologique. Il interdisait également ceux dont la prise d’eau ne restituait à l’aval que le débit minimum biologique une majeure partie de l’année, et prohibait toute remise en état de barrage ne faisant actuellement pas obstacle à la continuité écologique. Ce décret avait été attaqué par le cabinet Cassini Avocats pour le compte de France Hydro Électricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins (FFAM), de la Fédération des Moulins de France (FDMF), de l’Association des Riverains de France (ARF) et d’Hydrauxois. Ces organisations considéraient en effet que le texte condamnait une majeure partie du potentiel de développement de l’hydroélectricité. Le Conseil d’État a finalement invalidé certains points avancés par le gouvernement. Il statue notamment que la limite de 50 cm de hauteur ne peut être retenue, que le débit minimum est précisément défini pour garantir la vie, la circulation et la reproduction de la faune halieutique. Cette décision est sans recours et d’application immédiate, ainsi les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’Environnement ne font plus effet, les décisions administratives fondées sur celui-ci sont illégales. Il est ainsi à nouveau possible de déposer une demande d’autorisation environnementale pour les ouvrages sur les cours d’eau classés dans la liste en question, dans le respect de la continuité écologique appréciée au cas par cas. * Liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement : https://www.legifrance.gouv. La ville de Châlons-en-Champagne (Marne), Engie Solutions et la Société Champenoise d’Énergie (SCE) signent un contrat pour la construction d’un réseau de chaleur de récupération, dont les travaux débuteront dès cet été. Issue à 70 % de l’incinération de déchets ménagers non-recyclables de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de La Veule (située à 10 kilomètres de Châlon-en-Champagne), la chaleur produite alimentera 10 000 équivalents logements soit une réduction des émissions de CO2 de 17 000 tonnes par an pour le territoire châlonnais. Long de 32 kilomètres, ce nouveau réseau disposera de 131 sous-stations interconnectées et approvisionnera ses premiers clients fin 2022. Les nouveaux abonnés auront également la possibilité de compléter le mix énergétique du réseau par 30 % de biométhane agricole d’origine locale pour du chauffage 100 % renouvelable. Le 13 février se sont réunis des riverains ainsi que des élus afin de manifester contre l’installation d’une unité de méthanisation à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique) porté par le Danois Nature Energy et la coopérative d’Herbauges. Ce projet prévoit entre autres de traiter 548 000 tonnes d’effluents d’élevages et 132 000 tonnes de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) par an avec l’engagement des 230 exploitations agricoles. Situé le long de la Départementale 65, il permettrait l’injection sur le réseau de gaz de Machecoul de 26 millions de Nm3 de biométhane par an. Cependant, des inquiétudes ont émergé de la part des riverains qui dénoncent notamment « 85 rotations de véhicules par jour » pour transporter les matières valorisables jusqu’à l’usine. La coordination rurale des Pays de la Loire (CRPL) alerte également sur le risque que certains exploitants abandonnent les cultures alimentaires pour se spécialiser dans les cultures énergétiques pour alimenter les méthaniseurs, bien que seules des cultures intermédiaires soient évoquées. En outre, la réglementation française interdit d’introduire plus de 15 % de cultures principales (cultures énergétiques remplaçant une culture alimentaire), en moyenne annuelle, dans un méthaniseur. Toutefois, aucun projet de cette envergure n’a jamais été développé en France, c’est pourquoi le maire de Corcoué-sur-Logne, avec d’autres élus et la Confédération paysanne ont demandé un moratoire sur la méthanisation ainsi qu’un débat public pour identifier les risques sur le foncier, la concurrence avec les cultures alimentaires, ainsi que les risques environnementaux. Pour des projets de cette taille, les études d’impact sont de toute façon obligatoires. La ville de Châlons-en-Champagne (Marne), Engie Solutions et la Société Champenoise d’Énergie (SCE) signent un contrat pour la construction d’un réseau de chaleur de récupération, dont les travaux débuteront dès cet été. Issue à 70 % de l’incinération de déchets ménagers non-recyclables de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de La Veule (située à 10 kilomètres de Châlon-en-Champagne), la chaleur produite alimentera 10 000 équivalents logements soit une réduction des émissions de CO2 de 17 000 tonnes par an pour le territoire châlonnais. Long de 32 kilomètres, ce nouveau réseau disposera de 131 sous-stations interconnectées et approvisionnera ses premiers clients fin 2022. Les nouveaux abonnés auront également la possibilité de compléter le mix énergétique du réseau par 30 % de biométhane agricole d’origine locale pour du chauffage 100 % renouvelable. Le 13 février se sont réunis des riverains ainsi que des élus afin de manifester contre l’installation d’une unité de méthanisation à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique) porté par le Danois Nature Energy et la coopérative d’Herbauges. Ce projet prévoit entre autres de traiter 548 000 tonnes d’effluents d’élevages et 132 000 tonnes de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) par an avec l’engagement des 230 exploitations agricoles. Situé le long de la Départementale 65, il permettrait l’injection sur le réseau de gaz de Machecoul de 26 millions de Nm3 de biométhane par an. Cependant, des inquiétudes ont émergé de la part des riverains qui dénoncent notamment « 85 rotations de véhicules par jour » pour transporter les matières valorisables jusqu’à l’usine. La coordination rurale des Pays de la Loire (CRPL) alerte également sur le risque que certains exploitants abandonnent les cultures alimentaires pour se spécialiser dans les cultures énergétiques pour alimenter les méthaniseurs, bien que seules des cultures intermédiaires soient évoquées. En outre, la réglementation française interdit d’introduire plus de 15 % de cultures principales (cultures énergétiques remplaçant une culture alimentaire), en moyenne annuelle, dans un méthaniseur. Toutefois, aucun projet de cette envergure n’a jamais été développé en France, c’est pourquoi le maire de Corcoué-sur-Logne, avec d’autres élus et la Confédération paysanne ont demandé un moratoire sur la méthanisation ainsi qu’un débat public pour identifier les risques sur le foncier, la concurrence avec les cultures alimentaires, ainsi que les risques environnementaux. Pour des projets de cette taille, les études d’impact sont de toute façon obligatoires. Le 9 février, Solar Heat Europe a annoncé la sortie du nouvel outil en ligne du projet pour la Planification de la rénovation des systèmes de chauffage (HARP), pour aider les consommateurs dans la rénovation de leur système de chauffage. L’HARP est un projet mis en œuvre en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal et financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme Horizon 2020. Il vise à encourager les consommateurs à remplacer leur ancien système de chauffage énergivore. En effet, d’après l’HARP, parmi les 126 millions de chauffages centraux que compte l’UE, plus de 60 % ont un score inférieur ou égal à C sur l’échelle de l’étiquette énergie, alors que leurs propriétaires n’en sont pas toujours conscients. Ce nouvel outil fournira aux usagers une réponse personnalisée grâce à son simulateur en ligne, un panorama des solutions existantes avec leurs bénéfices propres, un guide pour trouver des professionnels compétents pour déposer leur ancien système et installer le nouveau, ainsi que le panel des aides financières disponibles. Il permettra donc d’accompagner les propriétaires de systèmes inefficaces tout au long de leur projet de remplacement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la chaleur domestique. Le Français Air Liquide et l’Allemand Siemens Energy ont signé un protocole d’accord afin d’unir leurs expertises dans la technologie de l’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM). Leur objectif est triple : la création de projets à grande échelle avec leurs clients dans la filière hydrogène, la fabrication d’électrolyseurs en Europe, et la recherche et le développement pour la prochaine génération d’électrolyseurs. Ils souhaitent demander des financements dans le cadre du Green New Deal et du programme Projet Important d’Intérêt Européen Commun (IPCEI), ainsi qu’à la France et l’Allemagne pour rapidement démarrer ces activités. Air Liquide est actuellement engagé dans le projet H2V Normandie, qui vise à construire une usine d’électrolyse de 200 MW, alimentée par de l’électricité verte, dans la zone industrielle de Port-Jérôme, sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville entre Le Havre et Rouen. Les deux partenaires ont déjà identifié d’autres opportunités en France, en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays européens, dans le but de créer un écosystème autour de ces technologies, et en particulier de l’électrolyse. Le 27 janvier se sont réunis acteurs politiques et de la recherche du territoire franco-valdo-genevois dans le cadre de l’officialisation du projet de réseau d’énergie mis en œuvre par la SPL Territoire d’Innovation. Il s’agit d’un réseau intelligent de chaleur basse température qui valorisera la chaleur fatale émise par l’accélérateur de particules Grand collisionneur de hadrons (LHC) de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Devant être maintenu à une température de -271°C, il rejette énormément de chaleur vers l’environnement, et la valoriser réduira ainsi l’impact carbone du refroidissement du LHC (voir le Journal des énergies renouvelables hors-série 2020 « La Climatisation Renouvelable« ). Il permettra de fournir une énergie composée à 55 % de chaleur de récupération à 20 000 consommateurs, à un prix inférieur à celui proposé aujourd’hui sur la commune française de Ferney-Voltaire (Suisse). L’ensemble du réseau est cofinancé à hauteur de 11 millions d’euros par l’Ademe et la Banque des Territoires, et représente un « cap en matière de coopération transfrontalière ». Il vise à utiliser plusieurs sources d’énergies, comme l’énergie fatale du LHC et des bâtiments connectés, en association avec des pompes à chaleur, ainsi que des systèmes de sondes géothermiques qui serviront à stocker la chaleur ou le froid suivant les saisons. Le Français Newheat, basé à Bordeaux et spécialisé dans la production de chaleur renouvelable, annonce la signature d’un contrat avec Lacto Sérum France, filiale du groupe Lactalis (leader mondial des produits laitiers), pour la construction d’une centrale solaire thermique au sol de 15 000 m2 sur le site de Fromeréville-les-Vallons près de Verdun (Meuse). D’une puissance d’environ 13 MW, la centrale alimentera en chaleur la toute nouvelle tour de séchage qui sert à élaborer la poudre de lactosérum (petit lait). Ce projet, sélectionné et soutenu financièrement par l’Ademe dans le cadre de l’appel à projets « Grandes installations solaires thermiques » du Fonds Chaleur, recevra également le soutien financier du Groupement d’Intérêt Public Objectif Meuse ainsi qu’une aide de la Région Grand Est via son programme Climaxion, piloté en partenariat avec l’Ademe. Cette nouvelle centrale permettra à l’usine de réduire sa consommation de gaz et de réduire ses émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an. Les travaux débuteront dès cet été pour une mise en service au premier trimestre 2022. En juin 2019, Newheat avait mis en service une centrale similaire sur le site des papeteries Condat (Dordogne). Le 13 janvier, Total et Engie ont annoncé un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter une unité de production d’hydrogène vert. Baptisé Masshylia, le projet sera localisé sur le site de la raffinerie de la Mède de Total à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). Un électrolyseur de 40 MW sera alimenté par des fermes solaires d’une capacité globale de plus de 100 MW pour une capacité de production de 5 tonnes d’hydrogène par jour. Cette production, entièrement d’origine renouvelable, pourra couvrir les besoins du processus de production de biocarburants de la raffinerie et permettra d’éviter 15 000 tonnes d’émissions de CO2 par an. La mise en chantier est prévue en 2022 pour un début de production en 2024 sous réserve de la mise en place de soutiens financiers et de l’obtention des autorisations publiques nécessaires. Le projet Masshylia est porté par plusieurs acteurs locaux (région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence, pôle de compétitivité Capenergies). À terme, les deux partenaires envisagent de dupliquer ce type de réalisations pour des sites ayant des capacités de production de 15 tonnes d’hydrogène renouvelable par jour. Le 100 % d’électricité renouvelable est techniquement possible, assurent le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). Dans un rapport commun publié le 27 janvier, ils décrivent quatre conditions strictes et cumulatives que les politiques publiques doivent prendre en compte afin de s’orienter vers un mix électrique à forte proportion d’énergies renouvelables, jusqu’à 100 %, à l’horizon 2050. Cette étude marque une étape importante, qui s’insère dans un programme de travail plus vaste visant à élaborer et à comparer des scénarios de transformation à long terme du système électrique français, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le premier point rappelle qu’il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur la réalité de solutions technologiques permettant de maintenir la stabilité du système électrique sans production conventionnelle. Seul un système basé trop fortement sur du photovoltaïque pourrait rencontrer des problèmes de sûreté, qui restent encore à évaluer. Le deuxième point insiste sur l’importance de la flexibilité (pilotage de la demande, stockage à grande échelle ou bon développement des interconnexions transfrontalières des réseaux) pour garantir la sécurité d’alimentation électrique. Des actions dans ces domaines sont donc à entreprendre en parallèle au développement d’un système principalement porté par des énergies renouvelables. Le troisième point appelle à une révision du cadre réglementaire définissant les responsabilités d’équilibrage et la constitution des réserves opérationnelles. Il relève aussi l’importance du souci d’amélioration continue des méthodes de prévision de la production renouvelable variable. Enfin, la dernière condition porte sur l’effort substantiel à consacrer au développement des réseaux d’électricité à compter de 2030, tant au niveau du transport que de la distribution. À l’occasion de la présentation du rapport, Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE a déclaré : « La France s’est engagée dans la neutralité carbone pour 2050. Tous les scénarios nationaux envisagent à cette échéance davantage d’électricité décarbonée et des volumes importants de renouvelables. Pour se diriger vers un mix à très fortes parts d’énergies variables, bien qu’il n’y ait aucune barrière technique infranchissable a priori, il faut regarder les faits scientifiques, techniques et industriels : il reste beaucoup de sujets à résoudre. Le rapport suggère une méthode et des feuilles de route pour traiter ces enjeux. » Des études complémentaires, présentées à l’automne, évalueront le coût économique, l’empreinte environnementale et l’impact sur le mode de vie des français, selon différents scenarii, conclut RTE. Le 14 janvier, un décret a été publié au Journal officiel pour relever le plafond annuel du dispositif d’aide au renforcement des réseaux de distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane. Initialement, les gestionnaires de réseau de gaz, comme GRDF ou GRTgaz, se sont vu imposer un plafond correspondant à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d’utilisation du réseau ATRD et ATRT (Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution et de Transport de gaz naturel). Le décret n° 2021-28 du 14 janvier porte ce chiffre à 2 %. Cette décision devrait permettre d’accélérer le développement de la production de biométhane, afin d’atteindre les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celle-ci prévoit 14 à 22 TWh de biométhane injecté dans le réseau de gaz en 2028, pour une production totale de biogaz (incluant la cogénération) de 24 à 32 TWh PCS. Un collectif composé d’acteurs de la filière gaz a lancé une pétition adressée notamment à la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili « pour une nouvelle RE2020 multi-énergies ». La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est la nouvelle réglementation encadrant la construction neuve, succédant à la réglementation thermique 2012 (RT2012). Elle fixe de nouvelles règles concernant les usages énergétiques et l’enveloppe du neuf individuel et collectif. Ce collectif gazier estime qu’elle représente un danger pour les filières du gaz, car elle favoriserait certains systèmes fonctionnant à l’électricité comme les PAC, notamment pour les usages de chauffage. Les chaudières à gaz sont dorénavant en revanche considérées trop polluantes, car contraires aux ambitions climatiques françaises et seront donc bannies des constructions neuves d’ici l’été 2021. Le collectif demande de laisser le choix de l’énergie utilisée aux citoyens plutôt que d’interdire, afin d’assurer la pérennité de la filière gazière représentant 130 000 emplois en France. Concernant le poids des constructions neuves dans les consommations de gaz en France, rappelons qu’elles représentent chaque année environ 1,1 % des logements au total. De plus, d’après les diagnostics de performance énergétique (DPE) un logement moyen en France consomme 250 kWh/m²/an contre 50 kWh/m²/an pour le neuf afin de respecter la précédente réglementation (RT2012). Le collectif s’oppose également à cette RE2020 au motif de soutenir le gaz renouvelable. Mais, d’après GRTgaz, le gaz commercialisé en France était en 2019 à 99,74 % non-renouvelable et l’objectif national ne vise pas à additionner la consommation de gaz renouvelable au gaz fossile actuellement consommé, mais bien à s’y substituer, en commençant par les logements existants.
La filière gaz, par le biais du biométhane et de l’hydrogène, a donc bien son rôle à jouer dans la transition énergétique. En partenariat avec l’Ademe et la FNCCR, Observ’ER a publié le 11 janvier dernier la onzième édition de son baromètre des énergies renouvelables électriques en France. L’ouvrage présente en détail, et par région, l’actualité des huit principales filières de production d’énergie renouvelable électrique sur les 12 derniers mois afin d’éclairer les territoires sur leur trajectoire en matière de transition énergétique. Parmi l’ensemble des informations de l’ouvrage, deux peuvent être mises en avant. Le rythme de progression du parc électrique renouvelable s’avère une nouvelle fois trop lent en 2020. Si la crise du Covid a joué un rôle, les professionnels interrogés par Observ’ER pointent surtout les sempiternelles lourdeurs administratives, les restrictions d’accès au foncier en raison des servitudes aéronautiques militaires ou civiles mais aussi la montée de difficultés d’acceptabilité des nouvelles installations par les populations locales. Autre résultat du baromètre, l’analyse des objectifs renouvelables électriques des nouveaux schémas régionaux d’aménagement (SRADDET) montre que si de belles ambitions sont affichées (notamment dans le photovoltaïque) il n’en demeure pas moins une interrogation sur la capacité des territoires à réaliser leurs objectifs. La croissance des filières reste en effet encore largement pilotée par les appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie. Sous la pression du mouvement des Gilets jaunes, le président de la République avait annoncé en 2019 la création de la Convention Citoyenne pour le Climat afin de donner davantage de légitimité à son action climatique et d’offrir des visions nouvelles pour appuyer la politique du gouvernement, critiquée par la population. Après neuf mois de travail, les 150 citoyennes et citoyens représentatifs de la population et tirés au sort, ont élaboré 149 propositions que le Président avait promis à l’été 2020 de reprendre « sans filtre » en les transmettant au Parlement ou aux Français par référendum. Malgré cela, la plupart des propositions ont été retoquées ou abandonnées au fil du temps, au grand regret des garants et des participants de la Convention, ainsi que de nombreux acteurs politiques ou économiques concernés. Le 9 janvier 2021, le gouvernement a enfin dévoilé le « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets », inspiré des propositions de la Convention. De nombreux acteurs comme Reporterre, le Réseau Action Climat ou encore Alternatives économiques estiment que ce projet de loi n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Par exemple, l’article 4 prévoit d’encadrer la publicité sur certaines énergies fossiles, mais ne remet pas en cause les subventions publiques dont elles bénéficient et ne propose toujours pas d’augmenter la fiscalité carbone. L’article 21 souhaite décliner la PPE au niveau régional, alors que cette obligation existe déjà au niveau des SRADDET. L’article 23 vise à abaisser le seuil de 1 000 m² à 500 m² pour l’obligation d’installation de système de production d’énergie renouvelable (ou de toiture végétalisée) sur les surfaces commerciales et les entrepôts, mais cette obligation ne concerne toujours qu’une partie infinitésimale du parc des bâtiments en France. Le texte sera discuté en Conseil des ministres à la mi-février et au parlement fin mars 2021. Suite à une décision de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le producteur français d’énergie renouvelable, Albioma, annonce la fin du charbon de sa centrale de Bois-Rouge sur l’Île de La Réunion pour une conversion 100 % biomasse. Les travaux débuteront dès 2021 en privilégiant les gisements locaux de biomasse disponibles (bagasse, bois forestier, bois d’élagage, etc.), complétés par des granulés de bois importés issus de forêts certifiées type FSC et PEFC, pour une conversion total prévue en 2023. Selon l’énergéticien, cette transformation fera passer la part des renouvelable du mix énergétique de La Réunion de 35 % à 51 % et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 640 000 tonnes équivalent CO2 par an. Albioma poursuit par ailleurs sa stratégie de développement en annonçant le 25 décembre dernier, la mise en service industrielle de sa centrale 100 % bagasse Vale do Paraná, située dans la ville de Suzanápolis dans l’État de São Paulo. Avec ce site, le Français, confirme son implantation au Brésil où il possède déjà trois unités similaires. Engie annonce que la plateforme de recherche et développement semi-industrielle, Gaya, vient de franchir une étape dans la production de biométhane à partir de combustibles solides de récupération (CSR). Situé à Saint-Fons (Rhône), ce projet a été initié en 2010 par Engie et cofinancé par l’Ademe pour un investissement total de 66 millions d’euros. Gaya est aussi un projet collaboratif réunissant onze partenaires français et européens dont, Tenerrdis, qui a labellisé le dispositif. La première phase du programme a axé ses recherches sur la pyrogazéification à partir de biomasse sèche (bois, paille, co-produits d’industrie du bois, etc.). Ces produits, chauffés en l’absence d’oxygène, produisent un gaz de synthèse qui sera ensuite épuré. Pour la deuxième phase du projet, Engie, annonce que la production de gaz renouvelable à partir de CSR, en l’absence de filières de recyclage dédiées, est aussi effective. Le passage au stade industriel se fera au Havre avec la construction d’une première unité de production à partir de 2023. Le projet, baptisé « Salamandre », devrait permettre dès 2026 de produire jusqu’à 150 GWh de gaz renouvelable. Les deux décisions sont tombées coup sur coup. D’abord l’arrêt définitif du forage de Vendenheim lundi 7 décembre. Ensuite la suspension par la préfète du Bas-Rhin des autres projets de géothermie profonde du département mercredi 9 décembre. En cause : le séisme de trop ressenti quelques jours plus tôt à proximité d’un puits injecteur. Magnitude : 3,59. Cet épisode a définitivement mis à mal la théorie selon laquelle les tremblements apparus depuis le début du chantier devaient être liés à d’autres causes. À plusieurs reprises, l’entreprise Fonroche avait estimé qu’il était « impossible » que des travaux de fracturation aient de telles conséquences… Une appréciation qu’elle a finalement accepté de revoir. Vendredi 11 décembre, elle a annoncé traiter 300 dossiers d’habitants victimes de potentiels dégâts matériels suite à ces tremblements de terre. Dans la filière, c’est évidemment la soupe à la grimace. En particulier parce que ce projet de Vendenheim s’annonçait prometteur. À partir de 2021, il devait permettre de produire à la fois de l’électricité (avec une puissance de 10 MW) et de la chaleur (40 MW). L’installation semblait par ailleurs en mesure d’alimenter l’industrie du lithium à hauteur de 30 voire 40 % de la demande française. Pour autant, pas question de jeter le bébé avec l’eau du bain. « Le contexte de ce projet était très spécifique, rappelle Aurélie Lehericy, présidente du Syndicat national du chauffage urbain (SNCU). Avec des failles et donc un risque de sismicité, ce qui n’est pas le cas avec la géothermie utilisée par les réseaux de chaleur qui s’appuie sur des nappes, notamment au Dogger ». Rien à voir a fortiori avec les opérations de géothermie de surface. Même les installations de type de Vendenheim ne doivent pas être enterrées trop vite, ajoute-t-on à l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG). « Des sites en exploitation dans le bassin rhénan existent déjà depuis plusieurs années en France (Rittershoffen, Soultz-Sous-Forêts) et en Allemagne (Landau, Insheim) », a rappelé l’association au lendemain de la crise alsacienne. Reste que les riverains de telles installations pourraient, eux, avoir du mal à se laisser convaincre. À l’AFPG, un groupe de travail pour « tirer toutes les leçons de ce qui s’est passé », et travailler sur la question de l’acceptabilité sociale des projets a été créé. En Alsace, une enquête administrative a parallèlement été diligentée par la préfète. Ses conclusions sont attendues à la fin du mois (O.D.). Observ’ER vient de mettre en ligne son étude annuelle du suivi du secteur solaire thermique dans ses applications collectives ou pour des opérations de grandes tailles. Le document, disponible en libre accès, présente un état des lieux complet de la filière à travers des indicateurs de marché, et également d’une approche qualitative basée sur une dizaine d’entretiens menés auprès d’acteurs du marché (bureaux d’études, industriels, associations) afin qu’ils livrent les tendances concernant leur activité au cours de l’année 2019 et du premier semestre 2020. Du côté des opérations solaires thermiques collectives, l’humeur reste à la morosité avec un marché nettement en baisse par rapport à 2018 (- 34 %) et qui ne semble pas regagner de la vigueur en 2020. Les professionnels du monde du bâtiment continuent de se détourner de cette technologie. Si certains restent échaudés par des contre-références passées, la majorité ne se sent pas suffisamment incitée par la réglementation (RT 2012 et la future RE 2020) ou les aides financières (le Fonds chaleur) pour investir dans le solaire thermique. Concernant les opérations de très grande taille, comme l’installation de la Papeterie de Condat-sur-Vézère (4 210 m2) mise en service en 2019, la dynamique est plus positive. Les appels d’offres organisés par l’Ademe ont permis de faire émerger de beaux projets. L’enjeu est désormais d’enclencher un mouvement qui doit prendre de l’ampleur pour attirer davantage d’industriels ou d’agriculteurs. L’alimentation des serres par l’énergie solaire thermique est par exemple un domaine prometteur. L’Ocean Energy Europe Conference & Exhibition qui s’est déroulée du 1er au 4 décembre a été l’occasion pour l’Écosse et le Pays Basque d’annoncer le projet EuropeWave de 20 millions d’euros, dans lequel ces territoires collaboreront sur 5 ans dans le but de promouvoir l’énergie des vagues, dite houlomotrice. Tous deux engagés dans un processus de décarbonisation de l’économie, ils souhaitent devenir leaders dans ce secteur émergent en aidant l’Europe à atteindre l’objectif d’énergie marine de 100 MW pour 2025 et de 1 GW pour 2030. EuropeWave vise à repérer et évaluer les technologies en développement et à sélectionner les plus prometteuses en termes techniques et économiques pour les tester sous forme de démonstrateurs dans les eaux écossaises et basques. Pour le ministre de l’énergie écossais, il s’agit d’une opportunité pour continuer à travailler avec ses partenaires de l’Union européenne en France et en Espagne notamment. Le groupe allemand Weltec, spécialiste de la construction et de l’exploitation d’installations de biogaz et de biométhane vient d’annoncer la mise en service de l’unité de biométhanisation de Vire en Normandie. Ce projet de 11 millions d’euros, réalisé en partenariat avec Agripower France, un regroupement d’une quarantaine d’exploitations agricoles locales, permettra de traiter environ 70 000 tonnes de substrats qui seront transformés en biogaz et en biométhane. Les 200 tonnes d’intrants quotidiens provenant d’un rayon de sept kilomètres sont issues d’effluents animaux comme le fumier de bovins, les lisiers de porcs et de rebuts d’abattoirs. Cette unité innove aussi en utilisant la chaleur fatale d’une usine spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux domestiques située à 500 mètres : les deux sites ont été reliés par une conduite d’eau chaude. Avec ce système, les intrants sont chauffés à 70°C et il n’est pratiquement pas nécessaire de réchauffer les trois digesteurs, les matières entrantes étant déjà à la température requise pour la digestion anaérobie. L’unité de Vire injecte environ 270 m³ de gaz vert par heure dans le réseau public et sont ainsi directement disponibles au niveau national comme source d’énergie ou carburant alternatif. Quarante fois moins d’émissions de CO2 que le gaz. Trois fois moins que la biomasse. L’analyse de cycle de vie (ACV) de la chaleur consommée par la société alsacienne Roquette montre un avantage net à la centrale géothermique de Rittershoffen qui lui fournit 25 % de ses besoins (contre 50 % pour le bois et 25 % pour le gaz). Selon une étude présentée mercredi 18 novembre, un kilowattheure produit grâce aux calories du sol génère précisément 5,9 kg de CO2, dont la moitié liée à la consommation d’électricité, des pompes de production notamment, durant la phase exploitation. « Pour chaque installation, le chiffre dépend donc du mix du pays », insiste Mélanie Douziech, assistante de recherche à Mines ParisTech et co-autrice de l’étude. L’ACV s’intéresse à d’autres paramètres environnementaux et le bilan des radiations ionisantes, qui évaluent l’impact des déchets radioactifs issus de l’électricité d’origine nucléaire, donne a contrario l’avantage au bois et au gaz, du fait du mix électrique français. N’émettant pas à l’usage de particules fines, la géothermie reprend l’avantage en revanche sur le gaz ou même la biomasse quand on parle d’impact sur la santé humaine ou sur la toxicité des eaux.
Ces résultats ont un double intérêt pour les spécialistes de la géothermie profonde : d’abord, donner des arguments aux développeurs qui ont parfois du mal à vendre les vertus de leur technologie. Ensuite, optimiser certains choix. À Rittershoffen toujours, le forage effectué par un équipement diesel pèse assez lourd sur le bilan CO2 global. Choisir une foreuse électrique n’aurait donc rien eu d’anecdotique. Au-delà de ces conclusions, cette étude est un test du nouvel outil d’ACV simplifié développé dans le cadre du projet européen Géoenvi, « avec des académies et des exploitants, car son but est de prendre en compte des données réelles, par exemple sur les quantités de ciment ou d’acier nécessaire », insiste Guillaume Ravier, ingénieur d’études et développement chez ES-géothermie, qui a lui aussi contribué à ces travaux. Une utilisation généralisée des lignes directrices de cet outil simplifié va donner des gages de sérieux à des analyses que chacun faisait jusqu’alors avec ses propres choix méthodologiques. Les industriels et les réseaux de chaleur ayant souvent plusieurs sources d’énergie, l’intégration de la distribution de la chaleur n’a ainsi pas été retenue dans les calculs. Plusieurs unités fonctionnelles ont parallèlement été définies, comme la durée de vie de l’installation, estimée dans l’ACV à trente ans. Événement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le Forum EnerGaïa 2020 a dû être annulé cette année en raison de la pandémie. Une partie du programme des conférences prévues aura cependant lieu sous format digital les 9 et 10 décembre prochain. Le premier jour, la conférence plénière d’ouverture accueillera des personnalités de premier plan, telle la sociologue et philosophe Dominique Méda, pour méditer sur le sujet de la matinée « Accélérer la transition, pour une société plus résiliente ». L’après-midi, les Assises Régionales de l’Énergie se focaliseront sur la façon de rendre la rénovation accessible à tous, et les outils développés par la Région pour le faire. Le lendemain, le 10 décembre, deux grands sujets sont au programme. Le matin sera dédié à l’éolien offshore flottant et à la préparation des acteurs aux prochains appels d’offres pour des fermes flottantes commerciales. L’après-midi sera consacré à l’émergence de la nouvelle industrie de l’hydrogène, en faisant intervenir plusieurs industriels de la chaîne de valeur. Partenaire de l’événement, Le Journal du Photovoltaïque a préparé une édition spéciale EnerGaïa, gratuite et téléchargeable ici. L’an prochain, le Forum EnerGaïa se tiendra les 8 et 9 décembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier. Le 24 novembre, le ministère de la Transition écologique a détaillé les grandes lignes de la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), et a notamment annoncé la fin du gaz dans les nouveaux logements individuels. La nouvelle RE2020 est depuis de nombreux mois le théâtre d’une bataille entre gaziers et électriciens, et cette annonce semble avoir tranché en défaveur du gaz. Pour l’habitat individuel, le gaz sera banni des constructions neuves, dès l’été 2021. Nous savions déjà que la RE2020 comprendrait un nouveau critère sur les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, nous savons que la limite sera de 4 kg de CO2 par m² et par an, dès son entrée en vigueur à l’été 2021, éliminant de facto le gaz. Pour les logements collectifs, l’objectif à terme est le même, mais les contraintes seront progressives avec une limite d’émission de gaz à effet de serre fixée 14 kg de CO2/m²/an entre 2021 et 2024. Critiqué sur le risque de voir ressurgir le chauffage à résistance électrique, le gouvernement répond vouloir limiter son recours, car « s’il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage est cher à l’usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l’hiver ». Heureusement pour le secteur du bâtiment, les mesures concernant les émissions associées à la phase de construction seront appliquées progressivement pour lui permettre de s’approprier les nouvelles techniques, notamment l’ossature bois et les matériaux biosourcés. Autre information importante, le confort d’été est pris en compte dans la construction des logements, grâce à un critère intégrant les périodes de canicule. Le programme européen des baromètres EurObserv’ER vient de livrer son dernier opus consacré à la filière des pompes à chaleur. Portée à la fois par une volonté politique forte de certains États membres de décarboner leur production de chaleur, et également par une demande accrue de confort d’été pour faire face aux vagues répétées de surchauffes estivales, le marché des pompes à chaleur de l’Union européenne a écoulé près de 3,9 millions d’unités en 2019. Dans ce total, les équipements aérothermiques représentent plus de 97 % des ventes (3 792 855 unités sur un marché de 3 886 530), mais pour la première fois depuis longtemps la filière géothermique affiche un taux de croissance important (8 %). Lancées à grande échelle, il y a une quinzaine d’années, les pompes à chaleur représentent aujourd’hui un parc évalué à 40 millions d’unités pour une production d’énergie renouvelable de 12,7 millions de tonnes équivalent pétrole (tep), soit environ 12 % du total de la chaleur et du refroidissement renouvelable au sein de l’UE. De plus en plus de pays membres utilisent les pompes à chaleur, notamment les technologies aérothermiques, comme principal équipement de chauffage pour les logements neufs. Un chemin que prend d’ailleurs la France avec plus de 815 000 pompes à chaleur aérothermiques vendues en 2019. L’annonce toute récente de la fin du chauffage au gaz dans les logements individuels neufs dès 2021 devrait encore renforcer ce marché. Mi-parcours pour Pixil. Contrairement à ce que son nom semble indiquer, « the Pyrenees Imaging eXperience : an InternationaL network » n’est pas une initiative anglophone, mais un projet de recherche franco-espagnol. Des deux côtés de la frontière, des entreprises locales et des scientifiques testent ensemble de nouveaux outils de modélisation du sous-sol basés sur l’imagerie géophysique afin de faciliter l’émergence de projets de géothermie profonde. Financé à 65 % par des fonds européens dans le cadre du programme Interreg (pour un investissement total de 1,3 M€), ce travail présente un double objectif. Il doit permettre de valoriser le potentiel du sous-sol pyrénéen et de valider des modèles innovants qui pourront être utilisés ailleurs pour limiter les risques de forage. En particulier dans les milieux complexes ou cachés que les spécialistes de la géothermie hésitent à investir, par peur d’un échec. « L’enjeu pour nos adhérents sera de s’approprier ces outils pour leurs propres recherches », souligne Emmanuelle Robins, responsable de projets du pôle de compétitivité Avenia, basé à Pau, qui est l’une des parties prenantes de Pixil. Les six partenaires du programme apportent chacun leurs compétences en géophysique, en mathématiques ou en informatique, à l’instar du Barcelona Supercomputing Center qui coordonne le réseau. Crise sanitaire oblige, son épilogue programmé à l’automne 2021 est finalement attendu en avril 2022. Le Français Voltalia, producteur et revendeur d’électricité renouvelable vient d’annoncer la mise en service de la centrale de stockage de Mana située dans l’Ouest guyanais. D’une capacité de 10 MW et 13,6 MWh, cette nouvelle station vient compléter l’unité de stockage de Toco, inaugurée en 2019 et adossée à la centrale solaire de Savane des Pères, détenue par Voltalia et la Banque des Territoires. Le centre de stockage de Mana se décompose en deux parties : une première unité qui sera pilotée par EDF et chargera les batteries pendant les heures creuses pour les décharger aux heures de pointe, lorsque le coût de production est plus élevé. La seconde, permettra une injection rapide d’électricité pour une meilleure continuité de l’approvisionnement en cas de problèmes sur le réseau. Les deux unités de stockage ont été construites et assemblées à Quimper (Bretagne) avant d’être transportées en Guyane, où la société bretonne Entech SE a réalisé la mise en service. Elle s’occupera d’une partie de la maintenance et de l’exploitation. Principal lauréat d’un appel à projets de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) en 2018, le projet Mana bénéficie de contrats de rémunération d’une durée de 10 ans et dispose du soutien du Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER). EIT InnoEnergy, premier réseau européen pour l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’énergie durable, a inauguré le 4 novembre le Centre européen d’accélération de l’hydrogène vert (EGHAC). L’EGHAC gérera plusieurs axes de travail, dont la promotion et la co-création de projets industriels, l’établissement de connexions avec d’autres chaînes de valeur industrielles et énergétiques, l’accélération du développement technologique, la stimulation de croissance du marché ou l’amélioration de l’acceptation sociétale de ce nouveau vecteur. Pour les prochains mois, l’une de ses principales priorités sera de réduire l’écart de prix entre les technologies émettrices de carbone et l’hydrogène vert. « Le Green Deal de l’Union européenne est le point de départ idéal pour le Centre européen d’accélération de l’hydrogène vert. S’appuyant sur l’élan politique, le centre utilisera l’hydrogène vert comme moteur de la décarbonation en profondeur de l’industrie européenne. Dans ce contexte, il créera un pipeline de projets pionniers à grande échelle, lancera une nouvelle génération de partenariats public-privé et accélèrera la vitesse de livraison de méga à gigawatts », a annoncé Ann Mettler, directrice principale de Breakthrough Energy. EIT InnoEnergy estime que le secteur de l’hydrogène vert devrait représenter un marché de l’ordre de 100 milliards d’euros d’ici 2025 et générer un demi-million d’emplois directs et indirects. L’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre national d’études spatiales (CNES) annoncent un plan de transition énergétique, photovoltaïque et biomasse, sur le site du centre spatial guyanais situé à Kourou en Guyane. Cette zone de 700 kilomètres carrés, comprend un centre de contrôle, trois ensembles de lancements opérationnels (plus un autre en construction pour Ariane 6), ainsi que des usines de production d’ergols (carburants de propulsion). Le projet prévoit la construction d’une centrale solaire de 10 MW et deux unités de biomasse en cogénération pour alimenter la climatisation des bâtiments. « Cette combinaison pourrait permettre d’économiser environ 50 GWh par an, réduisant ainsi l’empreinte carbone d’environ 45 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone », selon Teddy Peponnet, responsable ESA du projet de transition énergies renouvelables au Centre Spatial Guyanais (CSG). Ce plan vise à produire 90 % de l’énergie consommée par le Port spatial d’ici la fin 2025. La mise en service des installations est prévue début 2023. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, en concertation avec Rodolphe Alexandre, président de la Collectivité territoriale de Guyane a décidé de réorienter le projet du Larivot, devant remplacer la centrale électrique au fioul de Dégrad-des-Cannes. La centrale de Dégrad-des-Cannes, pilier du système électrique guyanais, mise en service en 1982, a dépassé sa durée de fonctionnement initiale et devra impérativement cesser son activité en 2023 car non-conforme aux nouvelles normes réglementaires d’émissions de CO2. La centrale du Larivot, initialement prévue pour marcher au fioul, va finalement être alimentée par des biocarburants dès sa mise en service, a confirmé la la préfecture de Guyane lundi 26 octobre. Le nouveau projet, inscrit dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Guyane, validée par décret le 30 mars 2017, sera situé près du port de Larivot (Cayenne) et sera alimenté par de la biomasse liquide (issue de colza) couplée à du photovoltaïque. Des essais avec biomasse liquide ont été concluants à la centrale de Jarry en Guadeloupe en juillet 2020. Selon Frédéric Maillard, président d’EDF Production Électrique Insulaire, filiale du Groupe EDF, « Les filières d’approvisionnement en biomasse liquide, les plus pertinentes d’un point de vue environnemental et social, seront sélectionnées en totale conformité avec les directives européennes (réglementation RED 2 notamment). Toutes les filières non-éthiques comme l’huile de palme, ainsi que les OGM seront exclues. » Toujours selon Frédéric Maillard, 300 personnes seront en moyenne nécessaires, chaque jour, pendant les trois ans de la construction et 100 emplois durables sur la durée de vie de la centrale. Pierre Dartou, le nouveau chef du gouvernement de la Principauté de Monaco et Thomas Battaglione, directeur général de la SMEG (Société Monégasque de l’électricité et du gaz) viennent de signer un traité de concession des boucles thalassothermiques du Larvotto et de La Condamine. Ces ouvrages, actuellement en cours de réalisation, seront exploités sur une durée de 30 ans par le groupement SMEG, SOGET et MES. Monaco s’est fixé comme objectif de réduire de 50 % ses émissions de CO2 en 2030 et a interdit l’utilisation de fioul pour la production de chaleur à compter du 1er janvier 2022. Ces projets permettront d’après la SMEG de produire 35 GWh par an d’énergie décarbonée, soit une économie de 6 925 tonnes de CO2 Le réseau sera connecté à 3 500 logements, majoritairement des immeubles et fournira à la fois chauffage et eau chaude sanitaire, mais également rafraîchissement grâce à des pompes à chaleur réversibles. La surface raccordée représente 7 % de la surface utile totale des bâtiments de Monaco, soit 200 000 m2. La ville était déjà précurseuse dans l’utilisation de pompes à chaleur sur son littoral avec l’installation en 1963 d’un système sur eau de mer pour chauffer une piscine. Pierre Dartou, le nouveau chef du gouvernement de la Principauté de Monaco et Thomas Battaglione, directeur général de la SMEG (Société Monégasque de l’électricité et du gaz) viennent de signer un traité de concession des boucles thalassothermiques du Larvotto et de La Condamine. Ces ouvrages, actuellement en cours de réalisation, seront exploités sur une durée de 30 ans par le groupement SMEG, SOGET et MES. Monaco s’est fixé comme objectif de réduire de 50 % ses émissions de CO2 en 2030 et a interdit l’utilisation de fioul pour la production de chaleur à compter du 1er janvier 2022. Ces projets permettront d’après la SMEG de produire 35 GWh par an d’énergie décarbonée, soit une économie de 6 925 tonnes de CO2 Le réseau sera connecté à 3 500 logements, majoritairement des immeubles et fournira à la fois chauffage et eau chaude sanitaire, mais également rafraîchissement grâce à des pompes à chaleur réversibles. La surface raccordée représente 7 % de la surface utile totale des bâtiments de Monaco, soit 200 000 m2. La ville était déjà précurseuse dans l’utilisation de pompes à chaleur sur son littoral avec l’installation en 1963 d’un système sur eau de mer pour chauffer une piscine. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, en concertation avec Rodolphe Alexandre, président de la Collectivité territoriale de Guyane a décidé de réorienter le projet du Larivot, devant remplacer la centrale électrique au fioul de Dégrad-des-Cannes. La centrale de Dégrad-des-Cannes, pilier du système électrique guyanais, mise en service en 1982, a dépassé sa durée de fonctionnement initiale et devra impérativement cesser son activité en 2023 car non-conforme aux nouvelles normes réglementaires d’émissions de CO2. La centrale du Larivot, initialement prévue pour marcher au fioul, va finalement être alimentée par des biocarburants dès sa mise en service, a confirmé la la préfecture de Guyane lundi 26 octobre. Le nouveau projet, inscrit dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Guyane, validée par décret le 30 mars 2017, sera situé près du port de Larivot (Cayenne) et sera alimenté par de la biomasse liquide (issue de colza) couplée à du photovoltaïque. Des essais avec biomasse liquide ont été concluants à la centrale de Jarry en Guadeloupe en juillet 2020. Selon Frédéric Maillard, président d’EDF Production Électrique Insulaire, filiale du Groupe EDF, « Les filières d’approvisionnement en biomasse liquide, les plus pertinentes d’un point de vue environnemental et social, seront sélectionnées en totale conformité avec les directives européennes (réglementation RED 2 notamment). Toutes les filières non-éthiques comme l’huile de palme, ainsi que les OGM seront exclues. » Toujours selon Frédéric Maillard, 300 personnes seront en moyenne nécessaires, chaque jour, pendant les trois ans de la construction et 100 emplois durables sur la durée de vie de la centrale. La ville de Valence (Drôme) vient d’inaugurer sa première chaufferie biomasse pour alimenter son réseau de chaleur urbain qui fonctionnait à partir d’énergies fossiles (chaufferie gaz et cogénération gaz) depuis 1967. Cette mise en service intervient dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, confié à Énergie Verte de Valence (groupe Coriance) en charge de l’exploitation, du développement et de la gestion du réseau de chaleur. C’est en 2017 que les travaux d’adaptation ont débuté : passage en basse pression du réseau, rénovation complète des 10 900 mètres linéaires du réseau de chaleur existant, construction de 24 sous-stations supplémentaires et mise en place de la chaufferie biomasse située rue de la Forêt et alimentée grâce aux ressources en bois du département. La puissance totale installée de la chaufferie est de 43 MW. Elle consommera, à terme, jusqu’à 20 000 tonnes de déchets de bois (bois-énergie) par an. Douze camions par semaine approvisionneront le site. Ce nouveau réseau couvrira les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de 7 500 équivalents-logements et permettra d’éviter les émissions de plus de 12 000 tonnes de CO2 chaque année pour un investissement total de 24,5 M€, dont une partie, 5,6 M€, est financée par l’Ademe Auvergne-Rhône-Alpes. La société française, Enens, spécialisée dans la distribution de carburants et de combustibles, vient de créer Altens, une filiale dédiée à la production et la distribution de carburants alternatifs. Le Parlement européen ayant adopté un nouveau règlement imposant aux poids lourds de réduire leurs émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2019), les carburants alternatifs cherchent à se positionner dans le paysage de la mobilité décarbonée, notamment dans le transport routier de marchandises, dans les bus et les engins liés au BTP et à l’agriculture. La gamme de ce nouvel acteur est élaborée à partir de matières premières issues de filières locales : colza (produit localement), huiles alimentaires recyclées (récupérées notamment auprès des restaurants) et résidus viniques (filière viticole). L’usine de transformation est située à Poitiers et les cuves de stockage sur le port de La Pallice à La Rochelle. Les carburants alternatifs produits par Altens sont destinés exclusivement aux professionnels, car ils nécessitent une capacité de stockage dont ne disposent pas les particuliers. La Française de l’Énergies (LFDE) a annoncé la mise en service de la première centrale solaire thermique de Moselle (qu’elle détient à 51 % via la société Cellcius), en partenariat avec la régie municipale de Creutzwald, Énes (49 %). Connectée au réseau de chaleur urbain, elle est composée de 5 300 m2 de surface utile de panneaux, qui produiront 2 610 MWh par an (estimation), de quoi réduire de 560 tonnes les émissions d’équivalent CO2 par an. Ce projet bénéficie d’une aide de l’Ademe de 1,3 million d’euros, conditionnée à la mise en service d’une centrale biomasse de 3,5 GW qui assurera la part croissante des besoins du réseau, prévue en 2021. LFDE est une entreprise locale spécialisée dans la récupération de gaz présent dans les charbons et anciennes mines, qui approvisionne également en électricité verte et en chaleur ses partenaires locaux comme Énes. Vous retrouverez l’article détaillé du projet de Creutzwald dans le numéro 253 du Journal des Énergies renouvelables, disponible fin octobre. Un an après la présentation par la ministre de la Transition écologique et solidaire de l’époque de 25 actions pour développer les réseaux de chaleur et de froid renouvelables, les principaux acteurs de la filière tirent un bilan alarmiste de la situation. Le message est simple : sans un soutien réaffirmé et renforcé de l’État, ces 25 actions ne permettront pas, à elles seules, de soutenir la compétitivité de la filière, qui est aujourd’hui en difficulté. En effet, le fort décrochage du prix des énergies fossiles (plus de 30 %) a très fortement dégradé la compétitivité économique des énergies renouvelables. Cette situation est par ailleurs accentuée par les orientations de la future réglementation environnementale (RE 2020) et du décret tertiaire envisagées par le gouvernement, très défavorables aux réseaux de chaleur et de froid. Sur le terrain, les conséquences ont été un retour des donneurs d’ordres du secteur tertiaire aux énergies fossiles et à des installations de froid autonomes, qui aggravent les impacts des îlots de chaleur urbains. Les professionnels du secteur appellent solennellement les pouvoirs publics à prendre des mesures fortes et plus volontaristes, comme notamment la mise en place de mécanismes de soutien complémentaires à la chaleur et au froid renouvelables. Ils demandent également une révision urgente des orientations de la future « RE 2020 » et du projet de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). La Française de l’Énergies (LFDE) a annoncé la mise en service de la première centrale solaire thermique de Moselle (qu’elle détient à 51 % via la société Cellcius), en partenariat avec la régie municipale de Creutzwald, Énes (49 %). Connectée au réseau de chaleur urbain, elle est composée de 5 300 m2 de surface utile de panneaux, qui produiront 2 610 MWh par an (estimation), de quoi réduire de 560 tonnes les émissions d’équivalent CO2 par an. Ce projet bénéficie d’une aide de l’Ademe de 1,3 million d’euros, conditionnée à la mise en service d’une centrale biomasse de 3,5 GW qui assurera la part croissante des besoins du réseau, prévue en 2021. LFDE est une entreprise locale spécialisée dans la récupération de gaz présent dans les charbons et anciennes mines, qui approvisionne également en électricité verte et en chaleur ses partenaires locaux comme Énes. Vous retrouverez l’article détaillé du projet de Creutzwald dans le numéro 253 du Journal des Énergies renouvelables, disponible fin octobre. L’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG) publie une étude sur les coûts de la géothermie de surface. Cinq ans après une première édition, la filière veut rappeler les atouts d’une technique de production de chaud et de froid souvent oubliée dans le spectre des énergies renouvelables, car elle demande des investissements importants. La géothermie n’a pourtant pas à rougir face à l’option gaz si l’on évalue non plus la mise de départ, mais le prix du kilowattheure sur la durée de vie de l’installation. Suivant les modèles et les technologies, les courbes de coûts peuvent par exemple se croiser après trois ou dix ans de fonctionnement en ce qui concerne les ménages. Estimant que jouer la concurrence entre énergies renouvelables n’est pas un pari gagnant, l’AFPG se refuse en revanche à se comparer aux options solaire ou biomasse. La géothermie a, il est vrai d’autres arguments à faire valoir. Les vagues de chaleur se multipliant, « c’est le rafraîchissement qui permet désormais de se démarquer », insiste Virginie Schmidlé-Bloch, secrétaire générale de l’AFPG. Dans le détail, le guide s’efforce de distiller les conseils en matière d’installation. Il différencie trois segments de marché (particuliers, collectif et tertiaire) et quatre solutions technologiques. « Les captages horizontaux ne sont pas adaptés au collectif et sauf quand la ressource est avérée, la géothermie sur aquifère n’est pas pour les particuliers, illustre Virginie Schmidlé-Bloch. Les sondes sont en revanche pertinentes quel que soit le segment de marché ». A noter que l’association vient aussi de publier un guide méthodologique à destination des bureaux d’études appelés à s’interroger sur l’option géothermie. La centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet (Isère) vient d’être inaugurée après dix ans de travaux. Commandé par EDF et construit par VINCI Construction France, ce nouvel ouvrage vient remplacer six centrales et cinq barrages anciens par un nouveau barrage et une nouvelle centrale. L’installation, entièrement souterraine, au cœur de la montagne, permet d’augmenter de 40 % la production d’hydroélectricité sur le même tronçon de rivière (La Romanche). D’une puissance de 97 MW, la centrale hydraulique de Gavet produira 560 GWh/an, l’équivalent de la consommation électrique des habitants des villes de Grenoble et Chambéry cumulés soit 230 000 habitants. Le chantier de construction représente un investissement de 400 millions d’euros pour le Groupe EDF. 94 % des investissements ont été réalisés auprès d’entreprises françaises, dont 28 % sont situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Au plus fort du chantier, 306 personnes ont travaillé simultanément et 74 emplois d’insertion ont été créés. Mais suite au différend opposant la France et l’Union européenne, qui souhaite que les concessions d’EDF arrivant à expiration soient ouvertes à la concurrence, l’ensemble des autres projets hydroélectriques français sont au point mort depuis plusieurs années. Les acteurs de la filière espèrent voir aboutir les prochaines négociations avec Bruxelles. Un déblocage nécessaire à la fois pour la relance économique et la transition énergétique. Fin septembre, Engie a inauguré le Engie Lab Crigen, un centre de recherche et d’innovation sur le gaz et les énergies renouvelables. Basé à Stains (Seine-Saint-Denis) le laboratoire est désormais l’un des principaux centres de R&D d’Engie dans sa stratégie de transition énergétique. Son budget de fonctionnement est de 40 millions d’euros par an et il emploie deux cents personnes, en grande majorité des chercheurs, de 11 nationalités différentes. Dix équipes couvrent l’ensemble des domaines de recherche. Trois, absorbant à elles seules 45 % du budget, se consacrent aux gaz verts et plus particulièrement à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable. Trois autres sont centrées sur l’activité B to B et trois encore sur des technologies nécessaires pour réussir la transition énergétique comme l’intelligence artificielle pour la maintenance prédictive ou les protocoles d’utilisation de drones ou de robots pour la sécurisation de sites. Une dernière équipe se focalise, entre autres, sur la réduction de l’impact des installations énergétiques, un thème englobant notamment l’impact sur la biodiversité. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) avec le soutien de l’Ademe et de la FNCCR vient de lancer une campagne de publicité en faveur des énergies renouvelables, intitulée #CestLeBonSens. Prévue pour une durée de deux mois, cette campagne présente 21 contenus qui seront diffusés sur les réseaux sociaux, mêlant des formats vidéo (film manifeste, interviews d’experts), formats d’interpellations (visuels, GIF) et formats d’engagements (quiz, sondages) sur Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. Cette action vise à informer et sensibiliser les Français aux énergies renouvelables en démontrant qu’elles sont un levier clé pour répondre à l’urgence climatique à laquelle nous faisons face, aussi bien individuellement que collectivement, précise le SER. En 2019, les énergies renouvelables représentaient 17,2 % de la consommation finale brute d’énergie du pays. Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, la France s’est fixé l’objectif de porter cette part à 32 % d’ici 2030. « Les énergies renouvelables, c’est le bon sens ! », tel est le slogan de cette nouvelle campagne. L’IRENA, vient de publier son rapport annuel sur l’emploi dans les énergies renouvelables « Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019 ». Les chiffres sont en progression par rapport à l’édition précédente puisque les technologies renouvelables représenteraient environ 11,5 millions d’emplois dans le monde en 2019, contre 11 millions en 2018. Sans surprise, avec 3,9 millions d’emplois le secteur du photovoltaïque serait le premier pourvoyeur avec 33 % de la main-d’œuvre mondiale de la branche. En terme de progression nette, les biocarburants sont ceux qui affichent la meilleure performance. Poussés par une croissance de la production de 2 % pour l’éthanol et de 13 % pour le biodiesel en 2019, les emplois dans les biocarburants dans le monde ont atteint le chiffre de 2,5 millions. De son côté, l’éolien emploierait 1,2 million de personnes, dont 21% sont des femmes. Au delà des chiffres, le rapport milite pour un renforcement de la base de compétences nécessaire pour soutenir la transition énergétique mondiale. Il rappelle l’enjeu des formations professionnelles et avance des arguments pour une utilisation accrue des technologies de l’information et des communications pour l’apprentissage à distance. Le rapport est en libre téléchargement sur le site de l’agence. Engie Solutions annonce les travaux de raccordement du centre commercial marseillais « Les Terrasses du Port » au réseau de géothermie marine Thassalia pour une durée de 10 ans. La géothermie marine consiste à exploiter la différence de température entre l’eau chaude de surface et l’eau froide des fonds marins, pompées grâce à des canalisations. Sur la côte, des échangeurs et des pompes à chaleur permettent de produire, selon les besoins, du chaud ou du froid. L’eau est ensuite acheminée vers les bâtiments pour les chauffer ou les climatiser. L’énergie extraite servira à chauffer ou climatiser le centre commercial, un bâtiment de 63 000 m2, via un réseau d’eau chaude (60°C) et un réseau d’eau glacée (5°C). Projet référent en matière d’énergie renouvelable du fait de la récupération d’environ 70 % des thermies/frigories de la mer, Thassalia affiche un coefficient d’efficacité énergétique extrêmement élevé par rapport à un parc équivalent qui serait équipé d’installations autonomes de chauffage/climatisation. Le bilan est de 70 % de réduction des gaz à effet de serre, à quoi s’ajoute une réduction de 40 % de la consommation d’électricité. Les travaux de raccordement devraient s’achever dans le courant du premier trimestre 2021. L’ensemble du projet bénéficie d’un soutien du Fonds Chaleur de l’Ademe à hauteur de 3,3 millions d’euros. L’étude annuelle d’Observ’ER sur le marché 2019 des équipements individuels solaires thermiques vient d’être mis en libre téléchargement sur le site d’Observ’ER. Ce travail indique un volume de 20 795 m2 de capteurs solaires thermiques vendus l’an passé en France métropolitaine. Le chiffre est certes faible, mais il marque une quasi-stagnation par rapport à 2018 (+2 %, 20 440 m2). L’année 2019 est ainsi la première année à ne pas enregistrer de baisse des ventes au cours de la dernière décennie. La nouveauté observée vient essentiellement du fait que les ventes des CESI (chauffe-eaux solaires individuels) n’ont pas diminué comparées à celles de 2018. Concernant les systèmes solaires combinés (chauffage + eau chaude), la faible augmentation des surfaces vendues (+1 %) est dans la lignée de ce qui était observé depuis 2017. Cependant, malgré cette pause dans la chute de l’activité, le secteur métropolitain reste précaire, et cela, en dépit des aides à l’investissement disponibles dans la rénovation qui peuvent se révéler très incitatives (voir l’Actu de la semaine dernière). Dans les territoires d’Outre-mer, le solaire thermique reste à des niveaux autrement plus importants (73 625 m2) même si le secteur enregistre un recul de 21 % comparé à 2018. Guillaume Perrin, chef du service chaleur et froid à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), vient de publier un ouvrage intitulé Rafraîchissement urbain et confort d’été – Lutter contre les canicules. Avec la récurrence des canicules dans l’hexagone, les records de chaleur ne cessent de se multiplier et d’après les projections du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), le phénomène va s’accentuer dans les années à venir. La ville, avec sa densité, est en première ligne avec la formation d’îlots de chaleur. La ville stocke plus de chaleur que la campagne. Ceci est principalement dû aux propriétés des matériaux qui composent les bâtiments, les voies de circulation et les infrastructures. Leur comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur est différent de celui de la terre nue ou végétalisée. Pourtant, des solutions existent et peuvent être mises en place sur le court et le long terme. Matériaux, trames vertes et bleues, architecture bioclimatique ou réseaux de froid urbain, cet ouvrage vise à donner les clés d’action pour les villes et les acteurs privés du territoire souhaitant agir dans le domaine du confort d’été et de la lutte contre les canicules. 176 pages – Éditions Dunod Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable, vient d’inaugurer la centrale hydroélectrique Aqua Bella. Située sur la rivière Arc, sur les communes d’Aiguebelle et de Randens en Savoie, la centrale est dite de basse chute (5 mètres) « au fil de l’eau ». La spécificité du barrage est d’être gonflable, ce qui permet de maintenir le niveau du plan d’eau. En période de crues, le barrage se dégonfle, laissant ainsi passer l’eau et autres solides. Équipée de 4 turbines, la centrale a une capacité de 2,2 MW et permet d’alimenter 4 820 foyers en électricité. L’originalité du projet a été son ouverture aux riverains via une plateforme de financement participatif (AkuoCoop) qui a permis de récolter 300 000 euros. Méthanor, société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, a aussi investi 956 000 euros dans ce projet aux côtés d’Akuo Energy et a fait l’acquisition de 11 % du capital de la centrale, sachant que le coût du financement total s’élève à 12,85 M€. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a proposé dans son premier discours sur l’état de l’Union, ce mercredi 16 septembre, de porter à 55 % la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne d’ici 2030, contre un objectif de -40 % seulement auparavant. Il s’agit d’un « objectif ambitieux, réalisable et bénéfique pour l’Europe », a assuré Ursula von der Leyen. « Les émissions ont déjà baissé de 25 % depuis 1990, tandis que notre économie a connu une croissance de plus de 60 %. Et maintenant, nous avons davantage de technologie, d’expertise, etc. » L’objectif 2050 est l’un des marqueurs du « Green Deal », le pacte vert européen qu’Ursula von der Leyen défend comme le projet phare de sa présidence. Elle a indiqué que 30 % du plan de relance de 750 milliards seront consacrés à la réalisation des objectifs du « Green Deal ». Ursula von der Leyen répond ainsi à de nombreuses pressions pour intensifier l’effort. Ainsi l’appel lancé par le groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC), qui compte plus de 250 membres, pour la plupart des fonds de pension et des gestionnaires d’actifs. Ces investisseurs, qui gèrent plus de 33000 milliards d’euros d’actifs, ont appelé à relever de 40 % actuellement à au moins 55 % l’objectif 2030. La déclaration conjointe estime qu’il s’agit là du « niveau minimum d’ambition nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ». Les eurodéputés de la commission Environnement avaient plaidé eux pour -60 % et les grandes ONG environnementales pour au moins -65 %. Ces dernières se récrient donc, de façon plus ou moins véhémente, devant l’insuffisance du réajustement. « 55 % c’est du travail à moitié fait, qui nous condamne à l’effondrement climatique » peut-on ainsi lire sur le compte Twitter Greenpeace EU qui dénonce également l’inclusion des émissions absorbées par les puits de carbone dans ces objectifs. Suite à l’annonce du plan de relance national et son volet écologique, la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, a apporté des précisions sur la réforme de l’aide « MaPrimeRénov », outil phare de l’aide à la transition énergétique pour les particuliers en France. Un nouveau barème des aides est actuellement en réflexion pour une mise en action prévue à partir du 1er octobre 2020. La ministre a, par ailleurs, assuré que les critères environnementaux seraient davantage pris en compte, ce qui devrait mettre en valeur les équipements « énergie renouvelable » par rapport à ceux utilisant des énergies fossiles. Cependant, sans même attendre la revalorisation annoncée, le corpus des aides à l’investissement des particuliers dans les EnR est d’ores et déjà ambitieux dans les niveaux proposés, mais cette information ne semble pas encore suffisamment connue du grand public. Ainsi « MaPrimeRénov », qui peut se cumuler à d’autres aides comme les certificats d’économie d’énergie (CEE) ou des primes régionales ou locales, a été relativement peu utilisé depuis sa mise en place au 1er janvier 2020.
Après 9 mois d’existence, alors que le gouvernement attendait plus de 200 000 dossiers, seulement 90 000 ont été déposés auprès de l’Anah, qui gère le dispositif. La crise sanitaire et économique du début d’année n’a pas poussé les particuliers à investir, pourtant, dans plusieurs cas de figure d’investissement EnR, les niveaux d’aides disponibles sont réellement attractifs. Pour illustrer ce point, Observ’ER a utilisé le simulateur d’aide mis à disposition sur le site du réseau FAIRE. Étant donné la multitude des aides régionales ou locales pouvant exister, les simulations ont porté sur des opérations localisées dans deux villes : Évry (Île-de-France) et Orléans (Centre-Val de Loire). Ainsi, l’association de « MaPrimeRénov », dans sa version actuelle, aux CEE et parfois complétée par des aides « Action Logement », permet une aide à l’investissement oscillant entre 88 % et 100 % pour des équipements EnR tels qu’une pompe à chaleur eau/eau, un chauffe-eau solaire individuel, un système solaire combiné ou un poêle à bois. Ces taux portent sur une simulation pour un foyer de 4 personnes appartenant à la tranche de revenus la plus basse (moins de 30 572 € hors Région Île-de-France et moins de 42 381 € en Île-de-France). Pour la tranche intermédiaire, ces niveaux d’aide évoluent entre 24 et 51 %. Soit des niveaux nettement supérieurs à ce que proposait la mesure de crédit d’impôt dans des cas similaires. De plus, pour la partie de l’investissement qui n’est pas aidée, les particuliers peuvent se tourner vers l’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique des logements. Les tranches de revenus les plus élevées sont également concernées, mais avec des niveaux d’aides très faibles (de l’ordre de 2 à 4 %). Bien sûr, dans tous les cas de figure, les aides ne sont possibles que si les équipements ont été installés par un professionnel qualifié RGE. Aussi, au-delà de la revalorisation annoncée, l’enjeu pour les professionnels des secteurs des énergies renouvelables est de faire connaître ces dispositifs qui, s’ils se distinguent par les niveaux des aides proposés, peuvent en revanche se révéler complexes à solliciter. L’Agence locale de l’énergie et du climat de la métropole bordelaise fait partie d’un réseau de 500 agences européennes, et soutient des projets européens visant à partager les bonnes pratiques auprès des acteurs de la transition énergétique. Dans ce cadre, elle est partenaire du projet Interreg atlantic area – GeoAtlantic, auprès d’agences espagnole, portugaise, irlandaise et britannique. Le guide Geo Atlantic édité en ligne est composé de plusieurs plateformes d’informations différentes selon le profil des acteurs concernés, élus locaux, porteurs de projet, professionnels et artisans, ainsi que les particuliers. Il se décline suivant différentes thématiques : montage de projets, retours d’expériences d’experts, documents de formations techniques et d’accompagnement administratif… Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif de l’UE d’atteindre au moins 27 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 et fait le pari que cela impliquera d’énormes changements au niveau des communes et des métropoles. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ont présenté la stratégie hydrogène nationale qui devrait mobiliser 7,2 Md€ d’ici à 2030 sur les 100 milliards d’euros du plan de relance annoncé. « La France a la conviction que l’hydrogène décarboné sera l’une des grandes révolutions de notre siècle : pour la décarbonation du secteur industriel, pour développer et déployer des solutions de mobilité sans émission, pour stocker l’énergie et apporter des réponses complémentaires à l’intermittence des énergies renouvelables », a expliqué la ministre de la Transition écologique. Les trois piliers de cette stratégie seront le soutien aux projets nationaux dans le but de faire émerger une offre française, la mise en place de mécanismes de soutien à une large production d’hydrogène et soutenir l’industrialisation sur le territoire. La recherche et l’innovation sur des composants clés comme les réservoirs ou les piles à combustible feront l’objet d’une attention particulière, car la France entend jouer un rôle de premier plan sur l’ensemble de la chaîne d’activité, et cela, au niveau international. Toutes les valorisations sont concernées puisque le plan hydrogène français couvre aussi bien les solutions de stockages énergétiques, mais également les solutions de mobilité sur route, sur mer ou dans le domaine de l’aviation. Sur le plan économique, le développement de cette filière pourrait créer, selon le ministère, de 50 000 à 100 000 emplois d’ici 2030. Géré par l’Ademe, SINOE est un outil d’analyse principalement destiné aux collectivités territoriales afin de les aider à optimiser leur politique de gestion des déchets ménagers et à améliorer leur service. SINOE dispose notamment d’une base de données consolidée qui repose sur un historique unique de 10 ans d’informations sur la gestion des déchets ménagers et assimilés en France. Pour accompagner la filière, SINOE a mis en ligne un document présentant en détail un état des lieux du parc des installations de méthanisation en France, réalisé en partenariat avec Observ’ER. Il est présenté suivant les différents types d’unités (à la ferme, centralisées, à partir de déchets ménagers, de stations d’épuration et de déchets industriels) avec des indicateurs de puissance installée, d’énergie produite et des cartographies illustrant le déploiement des sites sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cet état des lieux se base sur la dernière mise à jour de l’outil SINOE qui présente un panorama au 1er janvier 2020. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2019 des pompes à chaleur dans le secteur du résidentiel (jusqu’à 30 kW). L’un des principaux faits marquants est la forte progression des ventes des équipements aérothermiques (+38 % pour un total de 815 400 unités) et notamment des PAC de type air/eau qui ont enregistré un bond de 80 % par rapport à 2018 avec 168 530 unités. Ce segment a été très fortement porté par la mesure « Coup de Pouce Chauffage » mise en place en janvier 2019. Autre point à souligner, avec plus de 646 000 unités vendues en 2019, les PAC air/air sont pour la première fois les équipements les plus vendus dans le champ des systèmes de chauffage central individuels (45 % des ventes en 2019). Jusqu’alors, les chaudières à condensation gaz et fioul étaient les premiers équipements diffusés. Côté géothermie, les ventes de pompes à chaleur sont en légère hausse (+3 % pour 3 300 unités). Sur cette technologie, les ventes ne sont plus en recul depuis 2016, mais le marché reste à un niveau très faible. Candidat du Parti démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden a dévoilé mardi 14 juillet un ensemble d’actions en faveur du climat qu’il compte mettre en œuvre s’il est élu. D’ici 2035, il souhaite que le secteur électrique soit 100 % décarboné en sortant des centrales à charbon et à gaz, et en déployant les énergies renouvelables électriques ainsi que le stockage à grande échelle. Pour cela, il compte investir 2 000 milliards de dollars dans un vaste plan de transition, largement inspiré par l’aile gauche du parti, qu’il veut orienter en premier lieu vers les communautés les plus « blessées historiquement ». Il promet, par ailleurs, que les Etats-Unis reprendront leur place dans la course contre le dérèglement climatique, abandonnée selon lui par Donald Trump. Rapidement critiqué par les Républicains, Biden est accusé de vouloir tuer le secteur américain de l’énergie, aujourd’hui majoritairement dépendant des énergies fossiles, et donc de menacer l’économie tout entière. On lui reproche également de rester flou sur les moyens de financement de son plan, et d’avoir passé sous silence la question de la taxe carbone, instrument largement préconisé parmi les économistes de l’énergie. 556 députés européens ont adopté le 10 juillet le rapport présentant leur stratégie en matière de stockage de l’énergie, jugé majeur dans la réalisation des objectifs de décarbonation de l’UE. Si les technologies de stockage par stations hydraulique de pompage sont déjà bien connues et largement utilisées, le rapport invite les députés à davantage s’intéresser aux batteries chimiques de nouvelles générations, au stockage thermique et à l’hydrogène. En effet, le Parlement demande aux Etats membres de lever les obstacles réglementaires qui pourraient freiner le développement de ces technologies. La recherche sur la production d’hydrogène vert est largement plébiscitée pour réduire ses coûts, afin de créer une véritable filière industrielle à moyen terme. Le rapport demande également à la Commission d’évaluer la possibilité d’adaptation des infrastructures gazières à ce nouveau vecteur énergétique. La crise sanitaire a permis de mettre en lumière certaines limites des modèles mondialisés très dépendants de chaînes d’approvisionnement lointaines, c’est pourquoi le Parlement souhaite continuer les efforts visant à produire des équipements énergétiques, et notamment des batteries, dans l’espace européen en réduisant les importations de matière première à l’extraction polluante. La Commission estime que pour atteindre l’objectif de décarbonation fixé à 2050, l’UE devra stocker six fois plus d’électricité qu’actuellement, et ce, dans un contexte où les solutions par pompages les plus simples sont déjà quasiment saturées. Jusqu’au 29 juillet, va se tenir une enquête publique relative au projet d’installation d’une centrale hydroélectrique à Alfortville (commune située à 3 km au sud-est de Paris, dans le département du Val-de-Marne), sur la rive droite du barrage du Port-à-l’Anglais. Développée par JMB Hydro (filiale de Total Quadran) avec Voies navigables de France (VNF), la centrale sera composée de trois turbines Kaplan pour une production annuelle de 12,5 gigawatt/heure d’électricité qui seront injectées directement dans le réseau. Le chantier estimé à 8,5 millions d’euros et devrait durer 13 mois pour un coût d’exploitation qui devrait avoisiner les 363 000 euros par an. Aurélie Ingrand, désignée commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Melun, tiendra plusieurs permanences dans les mairies d’Alfortville et de Vitry-sur-Seine jusqu’au 29 juillet. Dans le cadre du projet « Ringo » initié par RTE (Réseau de Transport d’Électricité), le site de Vingeanne situé en Côte-d’Or vient de réceptionner les premiers containers destinés au stockage des énergies renouvelables produites localement. La production d’énergies renouvelables (éolien et solaire) a augmenté de 21 % entre 2018 et 2019 en Bourgogne-Franche-Comté. Ce dispositif inédit permettra de tester le stockage des surplus ponctuels de production des énergies renouvelables et leur déstockage pour un investissement de 24 millions d’euros. Développées par le groupe Nidec Asi, les batteries utilisées sont de type Lithium ion à forte densité énergétique et pourront stocker l’équivalent de la production de 5 éoliennes soit la consommation de 10 000 foyers. L’expérimentation débutera en juin 2021 pour un lancement officiel prévu pour 2024. Deux autres sites expérimentaux verront le jour en Haute-Vienne et dans les Hautes-Alpes. L’institut Fraunhofer ISE a publié un communiqué de presse le 1er juillet présentant les chiffres de la production d’électricité en Allemagne sur la première moitié de l’année 2020. Avec 55,8 % de l’électricité produite, les énergies renouvelables électriques ont atteint un nouveau record. Le solaire et l’éolien, principaux contributeurs, ont produit 102,9 TWh, contre 92,3 TWh sur la même période en 2019. La production solaire a connu une croissance de 11,2 % grâce à des conditions d’ensoleillement excellentes d’avril à juin, l’éolien croît également de 11,7 % et a même atteint le seuil des 45 % de la production totale au mois de février. En revanche, la biomasse a peu évolué et la production hydroélectrique a chuté de 9 %. Au total, 136,1 TWh ont été produits à partir de solaire, éolien, hydroélectricité ou biomasse mi-2020. La production à partir de gaz a augmenté de 13,9 % au détriment des centrales à charbon de houille dont la production a diminué de 46 % et celles de lignite de 36,3 %. Ces changements sont principalement dus à l’augmentation des prix des quotas du système ETS, passés à 21,92 €/t-CO2. Enfin, sur la même période, la production d’origine nucléaire a diminué de 12,9 %. Facebook annonce que son data center situé au Danemark alimentera en chaleur la ville d’Odense située au sud du pays. Ce centre de données, mis en service en septembre dernier, a été conçu pour intégrer un réseau de récupération de chaleur qui sera distribuée via le système de chauffage urbain de la ville. L’objectif est de récupérer et de distribuer 100 000 MWh d’énergie par an pour alimenter 6 900 foyers en chauffage. Le data center d’Odense est alimenté à 100 % par de l’énergie renouvelable, à travers un accord d’achat d’énergie avec trois fermes éoliennes nordiques. Le géant Américain vient d’investir 416 millions de dollars dans le projet Prospero Solar, une ferme solaire située au Texas qui aura une capacité de 300 MW. Avec ces différents projets, Facebook confirme sa volonté d’intégrer les énergies renouvelables dans son business model. Le syndicat du solaire Enerplan a publié le 1er juillet un communiqué de presse pour réagir aux 148 mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Dans le domaine du photovoltaïque, le syndicat soutient évidemment la mesure 11.2.2 de hausse du plafond du guichet tarifaire, ainsi que la mesure 11.1.2 visant à relever le seuil d’obligation de permis de construire et d’évaluation environnementale à 500 kW afin de faciliter la mise en œuvre des projets de petites tailles. Les citoyens ont également proposé la mise en place d’un guichet unique rassemblant les différents interlocuteurs techniques et administratifs via la proposition 11.2.6, ne nécessitant théoriquement pas de traduction juridique. Ceci montre une volonté d’accélération des démarches d’après Enerplan qui se félicite également de la proposition 11.3 portant sur l’autoconsommation, le partage de chaleur et d’électricité localement produite entre bâtiments. Le syndicat regrette cependant que les discussions relatives au CITE, notamment sur l’élargissement de son éligibilité, soient repoussées à l’automne. Le président d’Enerplan, Daniel Bour, invite le président de la République à reprendre sans filtre, comme prévu, et au plus vite, les propositions de la Convention. L’association France gaz renouvelables, chargée de promouvoir le gaz renouvelable dans le paysage énergétique français, vient de publier quatre propositions pour soutenir le plan de relance post-Covid-19 : libérer les capacités de production ; permettre plus d’investissement en faveur du raccordement ; autoriser le mécanisme Méthaneuf dans les programmes de construction de logements neufs ; soutenir la compétitivité et l’innovation en faveur des objectifs de transition énergétique et d’économie circulaire. L’association annonce la parution prochaine, en janvier 2021, d’une étude consacrée aux externalités positives de la méthanisation sur les territoires. Quatre grands thèmes (gaz à effet de serre, eau, déchets, résilience des exploitations agricoles) seront ainsi passés au crible des groupes de travail de l’association et les résultats validés par un comité scientifique indépendant. Alstom SA, constructeur français d’infrastructures de transport et le groupe gazier italien Snam ont conclu un accord sur 5 ans pour le développement de trains à hydrogène renouvelable en Italie. Alstom fabriquera et assurera la maintenance des trains, neufs ou convertis à l’hydrogène et Snam construira les infrastructures nécessaires pour produire et transporter l’hydrogène qui sera produit à partir d’énergies renouvelables. L’objectif est de disposer des installations nécessaires pour construire les trains ainsi que les infrastructures associées d’ici début 2021. Alstom, qui a déjà développé un train à hydrogène en Allemagne, le Coradia iLint (mis en service en 2018), poursuit son expansion dans le secteur. Selon Marco Alvera, directeur général de Snam, « L’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables deviendra compétitif par rapport aux combustibles fossiles dans quelques années et jouera un rôle clé dans la transition énergétique, en particulier dans l’industrie, le chauffage et les transports. » L’entreprise drômoise McPhy, spécialisée dans les équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène vert, remporte l’appel d’offres lancé par la joint-venture public-privé Hympulsion (Engie, Michelin et Crédit agricole) dans le cadre du projet Zero Emission Valley. Initié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme pionnier en France et en Europe prévoit le déploiement d’ici fin 2023 de 20 stations hydrogène et d’une flotte de 1 200 véhicules à pile à combustible zéro-émission. Les 15 électrolyseurs de technologie alcaline seront alimentés par de l’électricité d’origine renouvelable locale : hydraulique, photovoltaïque et éolien. Ce projet mobilise près de 52 M€ sur 10 ans dont 15 M€ financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 14,4 M€ par l’Ademe et 10,1 M€ de fonds du programme européen CEF Transport. Le 18 juin l’AIE a publié un rapport en coopération avec le FMI pour partager des recommandations sur les politiques publiques et privées de l’énergie à mettre en œuvre afin de construire un futur plus résilient et de réduire notre impact sur l’environnement. Le Sustainable Recovery Plan contient une série d’actions pour les années 2021-2023 visant à relancer l’économie tout en améliorant les systèmes énergétiques. Il permettrait d’atteindre une croissance moyenne de 1,1 % en créant 9 millions d’emplois par an et de réduire de 4,5 milliards de tonnes eqCO2 les gaz à effet de serre émis annuellement d’ici à 2023. Les actions auraient également des impacts positifs sur la santé et amèneraient une réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère à hauteur de 5 %, l’accès à des cuisinières propres à plus de 420 millions de personnes ainsi qu’à l’électricité à 270 millions de personnes. L’AIE estime le montant des investissements nécessaires à 1 000 milliards d’US$ par an ce qui ne représente que 0,7 % du PIB mondial. Faisant écho au travail de l’AIE et son Sustainable Recovery Plan, l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), vient de publier un rapport intitulé Post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality. Ce document présente un ensemble de recommandations aux gouvernements dans la conduite de leurs investissements et de leurs politiques de relance économique post-COVID-19. Au centre de ce travail, le rôle des énergies renouvelables dans l’atteinte d’un système entièrement décarboné d’ici 2050. Pour l’agence internationale, le doublement des investissements de transition énergétique actuels, pour les porter à 4 500 milliards de dollars annuels au cours des trois prochaines années, fournirait un stimulant efficace aux investissements du secteur privé qui pourraient être multipliés par 3 ou 4. Les retombées économiques avancées par le rapport sont une augmentation du PIB mondial de 1,3 % et la création de 19 millions d’emplois supplémentaires. Chaque million de dollars investi dans les énergies renouvelables créerait trois fois plus d’emplois que dans les combustibles fossiles. Le rapport passe au crible tous les domaines énergétiques et ne se cantonne pas à la seule production d’électricité. Les besoins de chauffage et de refroidissement sont également traités, tout comme les nouvelles mobilités, le stockage de l’énergie, les investissements dans les infrastructures (les réseaux) ou les actions de maîtrise de l’énergie. L’aéroport Toulouse-Blagnac, l’Agence régionale énergie climat d’Occitanie et Hydrogène France (Engie Solutions) viennent de signer une convention cadre pour la réalisation d’une station de production et de distribution d’hydrogène vert sur le site aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Intitulé Hyport, ce projet prévoit l’installation d’un électrolyseur de technologie alcaline alimenté par de l’électricité d’origine renouvelable locale : hydraulique (barrages pyrénéens), photovoltaïque et éolien. Cette station, dont la construction démarrera cette année, assurera la fourniture d’hydrogène vert au service non seulement de la mobilité (bus destinés à assurer le transport des passagers entre l’aérogare et les avions, véhicules utilitaires légers, flottes captives, etc.) mais aussi des applications aéronautiques et industrielles. Le projet toulousain Hyport a reçu le soutien de la Région Occitanie, de l’Ademe et de l’Europe à travers le programme JIVE2 (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe). L’association Qualit’EnR œuvre pour la formation et la qualification des entreprises d’installation de production d’énergie renouvelable. Qualit’EnR lance une nouvelle qualification pour le solaire photovoltaïque qui couvrira les installations de panneaux photovoltaïques jusqu’à 250 kWc, QualiPV 0 à 250 kWc. Celle ci répond aux exigences du référentiel « Reconnu garant de l’environnement » (GRE) et permet aux installations réalisées par des installateurs qualifiés de bénéficier du tarif d’achat ou de la prime d’autoconsommation si elles y sont éligibles. Jusque là, QualiPV module Élec ne couvrait que les installations jusqu’à 36 kWc. Maintenant, les installateurs qui réalisent également de grandes toitures pourront demander uniquement la qualification 0 à 250 kWc. Ceux qui ne réalisent que des installations de petite taille devront garder la 0-36 kWc, car ils ne pourront se faire auditer sur une installation de puissance supérieure à 36 kWc, ce qui est nécessaire pour valider la qualification. Le think tank spécialisé dans les énergies renouvelables REN21 a sorti son rapport annuel le 16 juin faisant le bilan des énergies renouvelables dans le monde et proposant des recommandations afin de surmonter les obstacles auxquels font face les secteurs du transport et du chauffage. En effet, des progrès impressionnants ont été réalisés ces 5 dernières années, mais toujours limités au secteur de l’électricité. La part des énergies renouvelables dans la consommation totale n’est passée que de 9,6 % en 2013 à 11 % en 2018. Si l’électricité renouvelable représente un quart de la production mondiale, dans le chauffage et le refroidissement, le renouvelable ne représente que 10 % du total, et seulement 3 % dans les transports. D’autre part, REN21 explique que ces progrès sont notamment dus à des politiques publiques initiées il y a des années, très favorables dans le secteur de l’électricité, mais que les obstacles rencontrés il y a 10 ans sont toujours les mêmes pour les secteurs du chauffage et refroidissement et des transports. Ces secteurs ont plus que jamais besoin du soutien de politiques publiques efficaces afin de créer les conditions propices à leur développement, indispensable à la lutte contre le changement climatique. Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, Arttic, le Centre aérospatial allemand (DLR) et quatre universités européennes annoncent le lancement du projet Hyflexpower. Déployé à Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne) sur le site de Smurfit Kappa, une entreprise spécialisée dans la fabrication de papier recyclé, ce programme a pour objectif la mise en service du démonstrateur industriel « power-to-X-to-power » qui intégrera une turbine à gaz fonctionnant à l’hydrogène vert. La preuve que l’hydrogène renouvelable peut servir de moyen flexible de stockage de l’électricité excédentaire, le stockage des productions variables d’origine renouvelable étant l’un des principaux enjeux de la transition énergétique. Ce projet européen a été initié dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et sera étalé sur quatre ans. Le budget total est de 15,2 millions d’euros, dont 10,5 millions sont financés par l’Union européenne. Après une phase de transition où la turbine fonctionnera sur un mix gaz naturel et hydrogène, l’objectif final est d’atteindre une exploitation 100 % à l’hydrogène en 2023. Le 9 juin était organisé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) une conférence de presse en ligne sur le thème de la relance post-Covid, à l’occasion de la publication de son rapport « Les énergies renouvelables : un levier de la relance économique ». Ce dernier dévoile les propositions, filière par filière, qu’il considère nécessaires afin de permettre une relance cohérente avec les objectifs nationaux. Parmi celles présentées, la fiscalité carbone reste l’une des plus emblématiques, avec notamment une redistribution à destination des ménages et des collectivités nécessaire afin de faciliter l’abandon des énergies fossiles au niveau local. Le syndicat prône également une simplification et une accélération des délais d’autorisation et des appels d’offres, d’autant plus utiles dans un contexte de prise de retard due à la crise sanitaire. Il met également au premier plan le besoin de soutenir l’industrie nationale par la préservation des outils de production et du rythme des appels d’offres. Le SER appelle par ailleurs à une accélération du développement des réseaux de gaz renouvelable via l’augmentation des plafonds d’investissement pour les gestionnaires de réseaux dans le cadre du droit à l’injection, et ce jusqu’en 2023 au moins. Le rapport fait l’inventaire, filière par filière, des préconisations du SER, ainsi que de celles spécifiques aux territoires ultra-marins, dont les problématiques sont très spécifiques. L’association européenne de la géothermie, l’EGEC, a publié le 8 juin son rapport sur le marché européen au sens large (incluant l’Islande et la Turquie) de l’année 2019. Le marché de la géothermie se développe rapidement selon l’EGEC, en particulier son versant électrique, mais est très sensible aux politiques de soutien mises en place. À fin 2019, on dénombrait 130 centrales géothermiques électriques, 36 projets en développement et 124 projets en cours de planification, pour un total de 3.3 GWe. Ces chiffres indiquent que le nombre de centrales géothermiques en opération, qui fonctionnent en base, pourrait doubler dans les 5 à 8 prochaines années. L’Europe est un des principaux marchés de la géothermie sur réseaux de chaleur et de froid. En 2019, 5,5 GWth ont été installés dans 25 pays et de nombreux projets lancés par rapport à 2018. Le marché de la pompe à chaleur géothermique, à quant à lui, franchi le cap des 2 millions de PAC en opération, avec la Suède qui en comptabilise à elle seule plus de 600 000, montrant ainsi l’importance des politiques en place pour développer les énergies renouvelables plutôt que conventionnelles. Selon l’EGEC, la géothermie a besoin, pour continuer sa croissance, d’un cadre stable de soutien, de systèmes d’assurances adaptés, du développement d’une réelle politique de R&D, d’un prix du carbone et de la fin du soutien aux énergies fossiles, gaz compris. Selon l’Observatoire des transitions environnementales et sociétales publié par le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés, le nombre de décisions de justice rendues sur des actions relatives à des sources d’énergie renouvelable a été multiplié par 7 entre 2000 et 2019. Cette évolution est d’une part alimentée par le fort développement des projets EnR sur le territoire mais également par le durcissement des groupes d’opposants qui ont radicalisé leur approche en déposant systématiquement des recours pour toute nouvelle opération. Dans l’éolien, sans surprise, les recours sont les plus nombreux avec 141 décisions de justice disponibles en 2019, contre 13 en 2000. C’est toutefois nettement moins que le pic de 507 décisions atteint en 2013. Sur 74 recours étudiés plus précisément par le cabinet d’avocats depuis 2015, environ 50 ont été introduits par des opposants aux projets, le plus souvent réunis sous la forme d’associations. La plupart des recours concernaient les permis de construire et les autorisations ICPE, aujourd’hui remplacés par les autorisations uniques. Dans deux cas sur trois, les juridictions se prononcent en faveur des projets. Le photovoltaïque donne également lieu à de nombreux recours avec 144 décisions de justice disponibles concernant une autorisation de projet en 2019, contre 10 en 2000. Le pic a été atteint en 2015 avec 231 décisions de justice. « Les décisions apparaissent moins clémentes avec les projets photovoltaïques puisque près d’une décision sur deux leur est défavorable », indique le rapport sur la base d’une analyse de plus d’une cinquantaine de recours sur les 5 dernières années. Face aux répercutions économiques liées à la crise sanitaire Covid-19, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) vient d’annoncer une série de 14 propositions. Parmi ces préconisations on peut retenir : mobiliser un financement exceptionnel du CAS-FACE (fonds d’électrification rurale) et sécuriser les réseaux de distribution d’électricité, soutenir la filière du biométhane, créer de nouvelles infrastructures de mobilité propre, adapter les procédures de validation et de soutien des projets d’énergie renouvelable, s’engager dans l’efficacité et la rénovation énergétiques. La FNCCR plaide pour un plan national de travaux de proximité, portés par les collectivités, qui seront créateurs d’emplois et de dynamisme local, dans la période incertaine qui s’ouvre. « Nous souhaitons que l’État puisse agir en libérant les initiatives locales vertueuses : création d’infrastructures essentielles, au service de tous, soutien à des entreprises en difficulté, création d’emplois, offre de nouveaux services… » Le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a lancé une consultation publique, ouverte du 1er au 26 juin, portant sur les projets d’ordonnance et de décrets relatifs à l’énergie et au climat, en transposition du paquet européen « une énergie propre pour tous les européens ». Les dispositions concernent l’information sur les systèmes de chauffage collectifs, d’eau chaude et de froid, le droit à la déconnexion d’un réseau de chaleur, le périmètre de contrôle des systèmes thermodynamiques ainsi que les systèmes de régulation des flux d’énergie. Elles rendent notamment obligatoire la diffusion d’informations, à destination des occupants d’immeubles, sur leur consommation de chaleur et les charges associées, créent l’obligation d’inspecter les systèmes thermodynamiques de plus de 70 kW, et de proposer l’entretien de ceux de moins de 70 kW, ce qui représente un gisement grandissant d’économie d’énergie d’après le MTES. Face à la crise liée au Covid-19, les gouvernements préparent des plans de relance économique et envisagent de redéployer les activités essentielles au niveau local. Or, les projets d’énergies renouvelables représentent non seulement une activité essentielle pour la résilience économique des territoires, mais permettent également une implication des acteurs locaux – citoyens, coopératives, communes, petites et moyennes entreprises -, avec des retombées financières très importantes. Une étude allemande récente a démontré qu’un projet énergétique porté par des acteurs locaux est en moyenne bien plus rentable pour un territoire qu’un projet porté par un acteur privé extérieur. Ce travail, réalisé par l’Institut des technologies de l’énergie décentralisée (IdE) et l’université de Kassel, s’est basé sur des données réelles de parcs éoliens. Les résultats font valoir que pour un projet de 21 MW (7 éoliennes de 3 MW), une opération portée par des acteurs locaux génère 8 fois plus de retombées financières pour le territoire (58 millions €, contre 7 millions € pour le projet “externe”. La richesse générée par le parc circule entre les acteurs locaux et permet de nouvelles activités et profits par « effet multiplicateur », engendrant ainsi un cercle local vertueux. Pour mémoire une étude similaire réalisée par Energie Partagée avait démontré la même tendance. Le 25 mai, huit entreprises (Akuo Energy, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, Ørsted et Vestas ) ainsi que les organisations professionnelles européennes du solaire et de l’éolien, SolarPower Europe et WindEurope, ont lancé la campagne « Pour l’hydrogène renouvelable ». Il s’agit d’un mouvement rappelant le rôle incontournable des énergies renouvelables dans le cadre d’une relance économique durable en ligne avec le Green Deal européen. Les signataires ont appelé la Commission européenne à faire le choix de l’électrification directe des besoins énergétiques pour décarboner le transport et le chauffage. Eolien et photovoltaïque joueront un rôle de premier plan dans cette montée en puissance du vecteur électricité. Mais tous les usages ne sont pas électrifiables : industrie lourde, fret routier et maritime, aviation dépendent actuellement de ressources fossiles, et notamment du gaz. L’hydrogène permet de répondre aux besoins de ces secteurs. Lorsqu’il est produit en Europe par électrolyse et électricité 100 % renouvelable, il est propre et permet de renforcer la sécurité énergétique de l’Europe. C’est pour les signataires de l’appel, le seul moyen d’arriver à une décarbonation totale des besoins énergétiques de l’Europe. Le 25 mai, la Cour des comptes a publié le rapport sur la Structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. En réponse à la demande du Parlement, il a été établi pour faire un bilan de la filière bois en France, aussi bien en sa qualité de matière première agricole et industrielle, que de source de séquestration du carbone mais aussi d’énergie renouvelable, afin de préserver les ressources et donc les filières qui en dépendent, et d’améliorer la cohérence des politiques publiques au plus près des territoires et des citoyens. Entre autres, la Cour des comptes préconise la création d’un fond d’aide au repeuplement forestier confié à un opérateur public et regroupant tous les financements existants et l’amélioration de l’information immobilière et environnementale. Elle recommande aussi d’étendre au secteur forestier l’expérimentation de paiements pour services environnementaux, en cours dans les secteurs de l’agriculture, et prévu par le plan biodiversité du MTES. Elle met également en avant la nécessité pour la filière de davantage se coordonner notamment en rapprochant les réseaux du Centre National de la Propriété Forestière des chambres d’agriculture. RTE vient de mettre en ligne sur son site une première carte des estimations prévisionnelles des congestions résiduelles à un horizon de temps de trois à cinq ans. Cette publication fait suite à une demande de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui avait sollicité les gestionnaires de réseau pour identifier des points de congestion et ainsi permettre aux acteurs de proposer des solutions de flexibilité, et notamment de stockage, d’écrêtement de production ou d’effacement. Cette carte recense les ouvrages sous contraintes (lignes aériennes, lignes souterraines ou transformateurs), les postes électriques les mieux situés pour gérer chaque contrainte de manière efficace, la puissance maximale à limiter et l’énergie associée. Ces données traduisent le besoin prospectif de flexibilité – modulation de production, consommation, stockage ou autre – sur le réseau, en fonction des saisons et des projections de production EnR des centrales locales. RTE met ainsi à disposition les données permettant aux acteurs d’analyser leur intérêt à contribuer à la gestion des contraintes sur le réseau de transport, grâce à leur flexibilité. Cette démarche facilite l’émergence d’alternatives tierces aux limitations de production. A terme, la carte couvrira l’ensemble des régions continentales (donc hors Corse) mais actuellement la première région détaillée est celle des Hauts-de-France. En octobre 2020, les résultats sur la région Nouvelle-Aquitaine devraient être disponibles. Viendront ensuite en 2021, Grand Est, Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Centre – Val de Loire. Les contraintes sur les autres schémas (Île-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire) seront disponibles après 2022. Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, British Airways et Shell viennent d’engager 1,1 millions d’euros supplémentaires dans le programme Altalto. Développé par la société britannique Velocys, spécialiste des carburants durables, ce projet prévoit la construction d’une usine de biocarburant issu de déchets ménagers solides afin de les transformer en carburant d’aviation propre. Elle permettrait de valoriser plus de 500 000 tonnes/an de déchets non recyclables destinés à la décharge ou à l’incinération. La technologie, développée par Velocys prévoit une réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre avec une amélioration de la qualité de l’air due à la disparition des rejets d’oxyde de soufre. Ce projet ambitieux aura aussi l’avantage d’améliorer l’approvisionnement en carburant du Royaume-Uni, qui importe actuellement plus de 70 % de ses carburants d’aviation. Velocys prévoit la création d’un centaine d’emplois liés à la construction et à l’exploitation de la future usine. D’après l’AIE, 2020 donnera lieu à l’installation d’un moins grand volume de capacités renouvelables électriques qu’en 2019, et c’est la première fois que ces marchés ne sont pas à la hausse d’une année sur l’autre, principalement du fait de la crise du Covid-19. Malgré cela, ces secteurs ont montré une forte résilience et les projets retardés devraient se rattraper en 2021. Concrètement, cette année, 13 % de capacités en moins seront mises en service par rapport à 2019, soit 167 GW de nouvelles capacités seulement d’après le rapport Renewable Market Update publié le 20 mai. Cela correspondra toujours à une croissance de 6 % des capacités renouvelables installées dans le monde à la fin de l’année 2020, soit davantage que la capacité totale installée en Europe et Amérique du nord combinées. Beaucoup de projets faisaient déjà face à des difficultés de financement, d’intégration sur le réseau et à des incertitudes politiques lorsque la crise sanitaire est survenue. Cependant elle est également l’occasion pour de nombreux gouvernements de repenser la relance via un soutien accru aux technologies renouvelables. L’AIE insiste sur le fait que l’impact du Covid-19 va bien au-delà du secteur électrique, et que la transition vers une société décarbonée doit se faire dans le reste de l’économie également, comme le transport et la chaleur. La production de chaleur renouvelable est également prévue à la baisse en 2020, et la chute récente des prix du pétrole et du gaz risque de heurter la compétitivité des sources d’énergie renouvelables en l’absence de politiques publiques de soutien supplémentaires. Selon une récente étude de l’organisme allemand Oeko Institut, le secteur des centrales électriques allemandes au lignite serait entré dans une zone qualifiée de « vallée de la mort ». La lourde chute des prix de référence de l’électricité en Allemagne (- 18% en 2020 pour atteindre environ 36,50 € / MWh) a conduit à une surabondance de charbon et de gaz dans le pays. « Aux prix actuels de l’électricité et du carbone, les usines de lignite ayant une efficacité moyenne de 35 % n’ont aucune chance de couvrir leurs coûts de personnel et principaux coûts d’entretien », a déclaré Felix Matthes, responsable de la recherche énergétique et climatique à Oeko Institut. À ce niveau, les opérateurs chercheraient davantage à mettre hors service les centrales électriques plutôt que de se voir imposer des modifications majeures de la part d’une future réglementation ou des syndicats. Ce constat s’applique essentiellement aux centrales construites ou modernisées avant 1995 mais concerne également de plus en plus des sites plus récents construits après 1995. Les opérateurs seraient tentés de fermer ces centrales si leurs marges tombaient en dessous d’un seuil de 6 € / MWh. Une loi de sortie du charbon pour l’Allemagne doit être mis en consultation publique à la fin du mois de mai. L’un des principaux enjeux sera d’accompagner financièrement le secteur à la fermeture des sites. Le 11 Mai, la Commission du Mékong a annoncé la volonté du Laos d’entreprendre le processus de consultation préalable pour son 6e projet de centrale hydroélectrique, la centrale Sanakham de 684 MW. Situé à 2 km en amont de la frontière avec la Thaïlande, la centrale au fil de l’eau mesurera 350 m de long et 58 m de hauteur, et comptera 12 turbines de 57 MW chacune. Le gouvernement du Laos a fourni un ensemble d’études techniques, dont une analyse d’impact environnementale et de la pêche sur les membres de la Commission du Mékong, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam. Le projet estimé à 2 milliard de $ est prévu pour débuter en 2020, pour une mise en service en 2028, afin d’exporter la majorité de l’énergie produite vers la Thaïlande. Le projet nécessitera l’accord de la Commission, qui est notamment préoccupée par le destin des communautés vivant sur les rives du fleuve, sujet clivant mis en avant par de nombreuses ONG. La consultation devrait durer au moins 6 mois. Sia Partners vient de publier mardi 12 mai son cinquième observatoire du biométhane en France. La filière se porte bien et le nombre d’unités installées connait une forte croissance depuis la mise en place des tarifs d’achat en 2011. Avec 47 unités de méthanisation raccordées en 2019, soit une hausse de 62 % par rapport à 2018, la filière française est considérée comme la plus dynamique d’Europe. Une croissance qui devait se poursuivre en 2020 avec une perspective de 200 unités raccordées aux réseaux d’ici la fin de l’année. Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 aura un impact direct sur la filière : ralentissement des chantiers, révision des financements, études à l’arrêt… Pour limiter ces effets le gouvernement annonce deux principales mesures : des délais supplémentaires octroyés aux projets en cours pour réaliser leur mise en service ainsi qu’une suspension des contrats d’achat pour les producteurs en difficulté. Face à la crise économique liée au Covid-19, l’Oxford Review of Economic Policy vient de publier une étude sur les potentialités de différents types de politiques de relance face au double objectif de relancer l’économie et d’intensifier la lutte contre le réchauffement climatique. Le prix Nobel Joseph Stiglitz et Lord Nicholas Stern de la London School of Economics sont co-auteurs du rapport ; l’auteur principal est le professeur Cameron Hepburn de la Smith School of Enterprise and the Environment de l’université d’Oxford. Ils ont interrogé en avril dernier 231 fonctionnaires des finances, des banquiers centraux et des experts sur les cinq continents quant à différentes politiques de relance. En combinant les réponses, les auteurs relèvent cinq points économiquement et climatiquement efficaces : investir dans des infrastructures d’énergies renouvelables et de capture et stockage de carbone ; dans l’efficacité énergétique des bâtiments ; dans l’éducation et la formation pour répondre au chômage immédiat ; dans la régénération et la résilience des écosystèmes (en particulier l’agriculture raisonnée) et dans la recherche et développement « propre ». Selon Cameron Hepburn, « Quand on investit dans les énergies renouvelables, cela génère à court terme plus d’emplois, précisément quand on en a besoin, et permet à long terme de disposer d’énergie à un coût très limité. ». Les auteurs évaluent à six mois la période de temps qu’il reste pour prendre les bonnes décisions et mettre l’économie sur la route d’une décroissance durable des émissions de gaz à effet de serre. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2019 des pompes à chaleur dans le secteur du résidentiel (jusqu’à 30 kW). Avec 815 400 PAC air/air et air/eau vendues, auxquelles s’ajoutent 118 380 chauffe-eau thermodynamiques (CET), les technologies aérothermiques progressent de 34 % et réalisent une très belle année. Pour les pompes à chaleur de type air/eau, le marché a été très fortement porté par la mesure Coup de Pouce Chauffage mise en place en janvier 2019. Destinée à accélérer le remplacement des chaudières les plus anciennes, et donc les plus polluantes, cette mesure propose aux particuliers des aides pour l’achat de différents équipements de chauffage dont les chaudières biomasse, les systèmes solaires ou les PAC eau/eau ou air/eau. Parmi l’ensemble des options possibles, les pompes à chaleur air/eau sont les principales bénéficiaires de cette mesure. A la différence des autres technologies, elles bénéficient d’un réseau commercial très bien implanté en France et elles sont familières à un grand nombre d’installateurs. Le résultat a été une croissance de 80 % de leurs ventes en 2019. Les pompes à chaleur air/air restent les plus diffusées avec une activité portée à la fois par le remplacement d’anciens systèmes de chauffage électrique et par l’équipement de logements neufs. En 2018 et 2019, ce segment a également profité de deux périodes estivales très chaudes, comportant parfois des épisodes de canicules comme en 2019, ce qui a eu un effet direct sur les ventes, puisqu’elles peuvent être utilisées en mode climatisation. Pour les pompes à chaleur géothermiques, le bilan est inverse car les ventes restent à un niveau désespérément bas (3 300 pièces). Le contexte général du segment reste inchangé : une technologie très mal connue du grand public et des équipements chers à l’achat qui dissuadent la grande majorité des particuliers d’envisager plus avant ces solutions qui ont pourtant un très bon rendement énergétique. Dans un communiqué de presse du 6 mai l’IRENA a annoncé avec l’ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) vouloir préparer l’après-crise afin de fournir de l’énergie renouvelable aux systèmes de santé et à l’économie. Les propositions concerneront à la fois les problématiques court-terme de gestion de crise et les sujets de moyen et long termes pour soutenir l’économie et confirmer l’amélioration sanitaire. La région abrite la moitié de la population mondiale et est particulièrement dépendante des énergies fossiles. De plus, l’ESCAP affirme que 200 millions de personnes vivent sans accès à l’électricité et 1,2 milliard ne disposent pas d’appareils de cuisson neutres pour la santé. La secrétaire exécutif de l’ESCAP Armida Alisjahbana a énoncé le besoin pour les différentes parties prenantes d’adopter la devise « no more business as usual » afin d’inclure davantage de soutenabilité sociale et environnementale dans leurs décisions stratégiques. Avec les baisses budgétaires, les États risquent de délaisser l’accès à l’énergie à court terme dans les régions les plus pauvres et rurales, ce qui pourrait sévèrement impacter leur capacité de réaction pour aider les patients atteints du covid-19 (transport et réfrigération des vaccins). Pour y arriver, les solutions décentralisées de production d’électricité comme le PV seraient plus simples et rapides à mettre en place, et celles pour la cuisson propre pourraient limiter le dangereux cocktail covid-particules fines. C’est également une question d’indépendance énergétique pour ces États, qui, sur les moyen et long termes, pourraient trouver dans les énergies renouvelables, des solutions accessibles pour combattre la précarité énergétique et le changement climatique et créer des emplois locaux. Le 22 avril, à l’occasion de la Journée de la Terre, Google a présenté son nouvel outil de d’optimisation énergétique actuellement testé dans ses data centers. Développé sous le nom de « plateforme intelligente de calcul carbone » il s’agit d’un outil capable d’optimiser la consommation énergétique suivant les meilleures heures de production d’électricité renouvelable. En effet, l’outil permet de prévoir les tâches que doivent effectuer les data centers, ainsi que d’anticiper les pics de production solaire et éolienne journaliers et, ainsi de créer un nouvel emploi du temps afin de synchroniser les tâches énergivores avec ces moments. Sans que cela n’affecte l’utilisation des services comme Maps ou Youtube fonctionnant tout au long de la journée, il permet de décaler les missions les moins urgentes dans le planning, comme les mises à jour de base de données Google Translate. L’entreprise prévoit à terme de déployer ce système dans tous ses sites, et devrait publier une étude détaillée courant 2020. Jeudi 23 avril s’est tenu un webinaire entièrement dédié aux résultats de la 19e édition de l’État des énergies renouvelables en Europe, une publication réalisée chaque année par le consortium EurObserv’ER et disponible en ligne depuis fin février. Cet ouvrage de référence présente le bilan du développement énergétique, économique et technique de l’ensemble des technologies renouvelables au sein de chacun des pays membres de l’Union européenne. Animé par l’allemand RENAC, en charge de la communication au sein du consortium, le webinaire a été l’occasion de revenir sur les principaux résultats des différents chapitres du bilan. Observ’ER, leader du consortium, a ouvert la session avec les indicateurs énergétiques et notamment la situation de l’Union européenne vis-à-vis des objectifs de pénétration des filières renouvelables dans son bilan énergétique. Le néerlandais TNO Energy for Transition a présenté les volets emplois et chiffres d’affaires, ainsi qu’un point sur les coûts moyens des différentes technologies EnR et sur les consommations d’énergies fossiles évitées par le développement des énergies renouvelables. Franckfurt School of Finance and Management s’est chargé des indicateurs de suivi des investissements dans les technologies renouvelables. Enfin, le Fraunhofer Institut a passé en revue les principaux enseignements des chapitres dédiés à l’innovation et la compétitivité ainsi qu’à la flexibilité des réseaux électriques pour l’intégration des nouvelles puissances renouvelables. La dernière partie de la session en ligne a été l’occasion pour l’équipe du consortium de répondre aux questions des participants. Les baromètres EurObserv’ER sont issus d’un programme financé par la Commission européenne et complété par l’ADEME pour la traduction en français des livrables. La vidéo du webinaire dans son intégralité est disponible à partir du site des baromètres. Le groupe français McPhy, spécialiste des équipements de production, de stockage et de distribution d’hydrogène vient d’être sélectionné pour accompagner deux projets dans la mobilité zéro-émission. Le premier projet prévu en Centre-Val de Loire a pour objectif de convertir les surplus d’électricité renouvelable (éolien et photovoltaïque) en gaz vert. L’hydrogène produit permettra de répondre aux besoins de mobilité grâce à une station de recharge dédiée qui sera installée en fin d’année. Situé dans la Région Grand Ouest, le second projet a pour objectif de recharger des véhicules légers et lourds dédiés au transport de personnes. La phase test débutée mi-mars a été conduite avec succès. La technologie utilisée a aussi été sélectionnée pour équiper de nombreux projets, notamment à Paris et à Rouen ainsi que dans le cadre du projet « EAS-HyMob » en Normandie. Le groupe helvético-suédois ABB annonce la signature d’un accord avec l’entreprise bordelaise Hydrogène de France (HDF), spécialiste des technologies de l’hydrogène. Ce partenariat prévoit l’assemblage et la production de piles à combustible de forte puissance (supérieure à 1 MW) destinées à l’alimentation des navires de haute mer. Les piles à combustible transforment l’énergie chimique de l’hydrogène en électricité par une réaction électrochimique. Avec l’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène, toute la chaîne énergétique peut être propre. Le transport maritime étant responsable d’environ 2,5 % du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, la pression s’accroît pour que l’industrie maritime passe à des sources d’énergie plus durables. « Avec la demande sans cesse croissante de solutions permettant un transport maritime durable et responsable, nous sommes convaincus que les piles à combustible joueront un rôle important pour aider l’industrie maritime à atteindre les objectifs de réduction du CO2 », a déclaré Juha Koskela, directeur général d’ABB Marine & Ports. La production sera assurée par Hydrogène de France à Bordeaux. Dans un communiqué de presse daté du 20 avril, l’IRENA (International Renewable Energy Agency) présente les perspectives développées pour atteindre les objectifs climatiques dans son rapport « Global Renewables Outlook : Energy transformation 2050 ». D’après lui, les investissements nécessaires à une stratégie de décarbonisation pourraient être de l’ordre de 130 000 mds de $ mais engendreraient des bénéfices socio-économiques considérables. La transformation du système énergétique pourrait accroitre le PIB mondial de 98 000 milliards de $ par rapport aux scénarios actuels, faisant passer le nombre d’emplois dans les énergies renouvelables à 45 millions, dans l’efficacité énergétique à 21 millions et dans la flexibilité à 15 millions. Le Directeur général de l’IRENA appelle les gouvernements à « aligner les efforts de récupération à court terme sur les objectifs à moyen et long terme de l’Accord de Paris et du Programme de développement durable des Nations Unies » afin de construire une économie plus résiliente et durable. L’objectif du rapport est de proposer des stratégies afin de réduire d’au moins 70 % les émissions à l’horizon 2050. Si elles diffèrent selon les régions du monde, elles se basent sur des solutions renouvelables atteignant environ 75 % du mix énergétique, ainsi qu’une électrification d’au moins 50% des besoins comme le chauffage et les transports. Cependant les gains au niveau des emplois ne seraient pas répartis équitablement suivant les différentes zones économiques. C’est pourquoi les perspectives de l’IRENA mettent en garde les gouvernements contre leur manque d’ambition, et de coordination aux niveaux international, régional et national, pour notamment soutenir les communautés les plus vulnérables. Jean Jouzel, climatologue du CESE et plusieurs autres personnalités signent une tribune sur @LaCroix qui rappelle que « La crise profonde que nous traversons actuellement ne doit pas nous faire oublier les enjeux du changement climatique ». La France est un très mauvais élève de la transition énergétique et est aujourd’hui le deuxième pays le plus en retard en matière de développement des EnR par rapport aux objectifs 2020. Ses émissions de CO2 baissent très peu malgré des objectifs ambitieux à 2050 qui équivalent à diviser par 6 nos émissions. Le climatologue constate que les mesures prises concrètement sont bien insuffisantes et pointe notamment la baisse de la Contribution climat énergie (CCE). Dans le même temps, les objectifs annoncés pour notre feuille de route climatique sont les mêmes que ceux d’avant la baisse de la CCE, qui devait avoir un rôle très incitatif sur les entreprises… Les mesures de soutien économiques prises dans le cadre de la crise du coronavirus doivent absolument servir d’accélérateur pour « reconfigurer notre économie » et tenter de rattraper le retard pris. Les gouvernants ont un atout gagnant en main, c’est le moment d’en faire usage. EurObserv’ER vous invite à découvrir, le 23 avril 2020 à 11h, les points clés de son rapport annuel récemment paru. Dans ce webinaire d’une heure, vous découvrirez où l’Union européenne se situe par rapport à ses objectifs 2020, quels secteurs énergies renouvelables sont les plus créateurs d’emplois et quels pays en profitent davantage, quelles sont les tendances d’investissement à l’oeuvre dans ces secteurs… Le webinaire dévoilera combien de tonnes de CO2 ont été évitées grâce à l’usage des énergies renouvelables en Europe et quel est le niveau de flexibilité des systèmes électriques des différents pays. Pour vous inscrire cliquez ici. Vous pouvez aussi télécharger librement le rapport ici. Dans une tribune publiée dans Le Monde daté du 14 avril, Pascal Canfin, président de la commission Environnement du Parlement européen appelle à une « alliance européenne pour une relance verte » post-crise sanitaire liée au Covid-19. Les quelque 180 signataires indiquent notamment que « L’alliance s’engage à proposer les solutions d’investissement nécessaires, et alignées avec les engagements pour le climat, pour relancer l’économie après la crise. Si nous relançons l’économie dans la mauvaise direction, nous irons encore plus vite dans le mur de la crise climatique. » Parmi les signataires on compte 79 eurodéputés des groupes du Parlement européen Renew Europe, 37 patrons et hauts responsables d’entreprise, 28 associations d’entreprises, 11 ministres européens, 7 ONG et 6 think tanks. Cette tribune a été aussi publiée dans sept quotidiens européens. L’IRENA (l’agence internationale des énergies renouvelables) a publié en mars son rapport Electricity Storage Valuation Framework. Divisé en trois parties, il s’adresse à la fois aux décideurs, aux régulateurs et aux experts techniques. La méthode proposée pour évaluer la valeur économique du stockage se décline en 5 phases, allant de l’identification des solutions techniques les plus pertinentes à l’évaluation de la viabilité des projets. Par exemple, les batteries fournissent une réponse rapide à des signaux et les STEPs du stockage plus long terme de gros volume en période creuse. L’objectif du rapport est d’offrir les clés pour une meilleure intégration des énergies renouvelable électriques, notamment solaires et éoliennes, grâce à une meilleure compréhension de la valeur offerte par les moyens de stockage par rapport à d’autres techniques de flexibilité. Le rapport se conclut par l’analyse de 8 types de cas concrets, illustrés par de nombreux exemples en services aujourd’hui à travers le monde. Selon un rapport publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le secteur des énergies renouvelables a ajouté 176 gigawatts (GW) de capacités nouvelles de production dans le monde en 2019. Si ce chiffre est légèrement inférieur à celui qui avait été enregistré en 2018 (179 GW), le fait marquant est que les technologies renouvelables ont représenté 72 % de l’ensemble des nouvelles capacités installées en 2019 sur le globe et cela pour toutes les filières confondues (fossiles et nucléaire inclus). Jamais depuis 2012, première année où les capacités électriques renouvelables annuellement installées ont été supérieures à celles des énergies fossiles, la domination des technologies renouvelables n’a été aussi prégnante. Ainsi l’an passé leur rythme de progression a été 2,6 fois supérieur à celui des énergies fossiles. Sans surprise, l’éolien et le photovoltaïque sont les principaux moteurs de cette dynamique avec à eux seuls 90 % des 176 GW mis en place en 2019. Ainsi, l’énergie solaire a ajouté 98 GW, dont 60 % en Asie, et l’énergie éolienne a progressé de près de 60 GW, tirée par la croissance en Chine (26 GW) et aux États-Unis (9 GW). Les technologies renouvelables ont représenté au moins 70 % de l’expansion totale de la capacité électrique dans presque toutes les régions du monde hormis en Afrique et au Moyen-Orient, où elles représentaient respectivement 52 % et 26 % des ajouts nets. Ces ajouts ont porté la part renouvelable de toute la capacité électrique mondiale à 34,7 %, contre 33,3 % fin 2018. « Bien que la trajectoire soit positive, il faut en faire plus pour mettre l’énergie mondiale sur la voie du développement durable et de l’atténuation du climat – qui offrent tous deux des avantages économiques importants », a déclaré le directeur général de l’IRENA, Francesco La Camera. « En cette période difficile, nous voyons l’importance de renforcer la résilience de nos économies. Dans ce qui doit être une décennie d’action, des politiques volontaristes sont nécessaires pour augmenter les investissements et accélérer l’adoption des énergies renouvelables. » Dans une lettre adressée à la Présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, publiée le 7 Avril, l’EGEC (European Geothermal Energy Council) appelle à la création d’un marché européen de la chaleur à l’image de ceux existants pour l’électricité ou le gaz. L’EGEC est une organisation à but non lucratif comptant plus de 120 membres issus de l’industrie de la géothermie, qui promeut l’information et le développement de l’énergie géothermique. D’après l’association, l’existence de marchés pour l’électricité et le gaz les avantagerait aux dépends de la chaleur, et notamment la chaleur renouvelable. La moitié de la consommation d’énergie en Europe passe par la chaleur, et 80 % de celle-ci vient des énergies fossiles, qui ne sont actuellement pas soumises à un prix du carbone uniformisé. De plus, les énergies fossiles bénéficient de subventions directes et indirectes, incompatibles avec l’accord de Paris, et les objectifs européens. Ainsi les solutions de chauffage et de refroidissement renouvelables peinent à se développer dans la plupart des États membres. Le secrétaire général de l’EGEC appelle donc à soutenir la chaleur renouvelable par la création d’un marché européen de la chaleur, par une législation appropriée et l’institutionnalisation d’un opérateur de réseau de chaleur qui serait chargé de gérer des infrastructures dédiées aux sources de chaleur renouvelables. Une façon également de sortir par le haut de la crise économique actuelle en investissant dans des énergies peu carbonées et créatrices d’emplois. Après trois mois de chantier en plein cœur de la cité Descartes de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), la phase de forage vient de s’achever. La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) et son délégataire de service public GéoMarne (filiale locale du Groupe Engie), annoncent la réalisation de deux forages déviés de 1 900 mètres dans le Dogger (nappe d’eau souterraine où la température de l’eau se situe entre 50 et 95 °C). D’ici quelques semaines, un réseau de chaleur alimenté à 82 % par la géothermie sera effectif et permettra d’alimenter une dizaine de quartiers de Champs-sur-Marne et de Noisiel, soit environ 10 000 équivalent logements, et de faire fonctionner le futur centre aquatique. Cette réalisation représente un investissement de 40 millions d’euros. La Région Ile-de-France accompagne ce projet à hauteur de 4 millions d’euros et l’Ademe, 6 millions. La fin du chantier marque également la clôture de la collecte de financement participatif. Les citoyens locaux et plus largement, les Franciliens, avaient la possibilité de prendre part au projet grâce à un dispositif ouvert sur la plateforme Lumo. Cette collecte a atteint début février la somme d’un million d’euros. Le confinement impose un ralentissement économique d’ampleur, et par conséquent une réduction de la consommation globale d’énergie. L’APERe (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) rapporte qu’en Belgique, la consommation a diminué de 10% par rapport à une année classique sur la même période. Ce chiffre résulte d’une réduction de 15% de la consommation des entreprises, compensée pour partie par l’augmentation de celle des ménages. Le 28 mars de 9h à 17h, plus de la moitié de la consommation d’électricité en Belgique était fournie par des sources renouvelables. Le solaire représentait 33 %, l’éolien 28 % et la biomasse 3%. Bien que la météo ait été particulièrement propice, l’APERe explique qu’en diminuant notre consommation, il est possible d’intégrer davantage de renouvelables dans le mix. C’est ce que vise la Transition énergétique : une plus grande sobriété énergétique afin de couvrir notre consommation d’énergie par des sources renouvelables. Sur les marchés cependant, les prix négatifs lors de certaines périodes creuses nous invitent à repenser l’organisation du système électrique centralisé afin de pouvoir intégrer la flexibilité de la demande et de l’offre. L’APERe rappelle également que « le confinement ne perturbe pas le fonctionnement de nos installations renouvelables, contrairement aux centrales fossiles et nucléaires qui doivent actuellement – comme d’autres secteurs d’activité – fonctionner avec un personnel réduit, ce qui pose d’importantes questions de sécurité ». Terres d’Énergie, producteur indépendant d’énergies renouvelables et le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne annoncent la signature d’un « partenariat stratégique » avec la Banque des Territoires qui investira 90 millions d’euros dans la société. A ce jour, Terres d’Énergie détient 821 installations solaires en toitures, 28 centrales solaires au sol et 2 parcs éoliens, pour une capacité installée cumulée de 488 MW, principalement en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Occitanie. « Nous sommes ravis d’accueillir la Banque des Territoires au capital de Terres d’Énergie, pour accélérer la croissance de la deuxième plateforme d’énergie solaire en France », déclare Nicolas Jeuffrain, président et co-fondateur de Terres d’Énergie. Avec ce partenariat, la Banque des Territoires réitère sa volonté d’accompagner les acteurs indépendants de la filière énergies renouvelables. Il faut rappeler que fin 2019, la Banque des Territoires est également entrée au capital, à hauteur de 50 %, de la société CNR Solaire 1, filiale de la Compagnie nationale du Rhône, et d’un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques de Total Quadran d’une capacité de 143 MW. La Banque des Territoires dispose désormais d’un portefeuille de parcs éoliens et solaires de plus de 4 GW. La Commission européenne lance une grande consultation citoyenne sur les objectifs climat de la politique européenne à 2030. Le Green Deal européen a pour but de faire de l’Europe le premier continent neutre en matière de climat en 2050. Ceci implique d’augmenter les objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre d’ici à 2030 à au moins 50 %, voire 55 % par rapport au niveau de 1990. Un tel objectif permettrait de rythmer davantage la progression nécessaire atteindre la neutralité climat en 2050. La consultation cherche à rassembler vos avis sur le niveau d’ambition que doivent afficher les politiques européennes en matière d’énergie et de climat et les actions à mettre en place dans les différents secteurs. Elle a également pour objet de récolter des informations, trajectoires, études et recommandations pertinentes en matière de réduction de gaz à effet de serre. Pour participer, remplissez le questionnaire en ligne avant le 23 juin 2020. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude annuelle sur le marché des appareils de chauffage domestique au bois. Le rapport est librement téléchargeable à partir du site de l’association. Dans son ensemble, les ventes ont été stables, enregistrant un très léger recul en 2019 par rapport à l’année précédente (376 640 pièces contre 378 980 un an auparavant). Ces résultats ont été impactés par un nouvel hiver aux températures très douces, phénomène qui traditionnellement n’incite pas les ménages à engager des dépenses pour changer leur système de chauffage. Par ailleurs, l’annonce de la fin du crédit d’impôt dans son ancienne version au 31 décembre 2019 n’a pas suffisamment poussé les particuliers à avancer leurs achats avant la mise en place d’un nouveau dispositif en 2020. Si l’on se penche plus en détail sur la dynamique de chaque segment, les poêles à granulés, qui représentent 95 % des ventes d’appareils indépendants automatiques (poêles, inserts, foyers fermés ou cuisinières) ont reculé de 2 % soit 149 510 pièces écoulées contre 152 960 en 2018. Ce recul sur le segment phare est le premier observé depuis 2014 et le second au cours des 11 dernières années. La bonne nouvelle est venue du segment des chaudières avec une augmentation générale de 53,7 % des ventes. Cependant, cette progression est uniquement due aux appareils automatiques à granulés qui ont plus que doublé leurs ventes par rapport à 2018 (14 190 contre 6 900). Cette très forte croissance vient de la mise en place de l’offre Coup de Pouce Chauffage en début d’année 2019. Orientée vers le remplacement des chaudières les plus anciennes et les plus polluantes (notamment au fioul), l’offre propose des aides modulables suivant les niveaux de revenus des particuliers et qui peuvent atteindre 4 000 euros pour l’achat d’une chaudière biomasse performante. Le nouveau rapport que l’AIE vient de publier sur le biogaz et le biométhane indique que le monde n’utilise qu’une petite fraction du potentiel de production de biogaz. Les sociétés modernes produisent des quantités croissantes de déchets organiques – résidus agricoles, déchets agroalimentaires et déjections animales – qui peuvent être utilisés pour produire du biogaz et du biométhane. Le biogaz peut fournir électricité et chaleur de façon locale et peut constituer un combustible pour la cuisine. Sa transformation en biométhane le rend aussi pratique que le gaz naturel, sans les émissions nettes de CO2 qui lui sont associées. L’utilisation de davantage de ressources locales organiques pour fournir de l’énergie permet également de poursuivre les objectifs de l’économie circulaire, dans laquelle les ressources doivent être réutilisées sous forme de cycle vertueux. Toutes les régions du monde ont les moyens de produire du biogaz et / ou du biométhane et les ressources en déchets organiques devraient augmenter de 40% d’ici à 2040, selon le rapport de l’AIE. Les meilleures perspectives se trouvent dans la région Asie-Pacifique où la consommation et les imports de gaz naturel ont augmenté rapidement ces dernières années. Les potentiels sont également intéressants en Amérique du Nord et de Sud, en Europe et en Afrique. Dans un article publié le 24 mars 2° Investing Initiative présente les résultats de 4 études portant sur les particuliers consommateurs de produits financiers. Avec un premier rapport annuel datant de 2013, 2DII est un think-tank qui promeut la prise en compte des risques climatiques dans les stratégies d’investissement et la régulation européenne. Cette série d’études a pour objectif de guider les décideurs politiques pour l’élaboration du Sustainable Finance Action Plan dans le cadre du Green New Deal. Les deux tiers des répondants français et allemands affirment vouloir investir leur argent de manière responsable, et 43% des répondants indiquent que leur objectif principal serait d’influencer l’économie réelle pour qu’elle prenne davantage en compte l’environnement. D’autre part, l’une des études montre que des phénomènes de greenwashing sont partout présents, même dans les produits financiers dits « socialement responsables ». Parmi les 52% des 230 fonds analysés communiquant sur leurs impacts, 99% feraient des déclarations ambiguës et floues sur les bénéfices environnementaux apportés par leur portefeuille. D’après les réponses d’un sondage du dernier des rapports, 85% des Européens seraient prêts à agir, par le biais de leurs choix financiers, en faveur de l’environnement, des problématiques sociales et éthiques. Il existe un Ecolabel destiné à évaluer la nature plus ou moins soutenable des produits financiers sur la base de leurs impacts environnementaux, dont une seconde version est en cours de discussion. Son analyse par 2DII montre qu’elle est construite sur des critères qui ne peuvent être mesurés dans le cadre des législations actuelles. En conclusion, le 2DII recommande de créer un cadre réglementaire permettant d’évaluer les preuves des impacts environnementaux des stratégies d’investissements et de développer des recommandations régulant les assertions du secteur de la finance quant aux impacts environnementaux que ses produits pourraient avoir ainsi que les informations qui doivent être délivrées aux clients investisseurs. Le groupe Total vient d’annoncer la construction d’un site de stockage d’énergie par batteries à Mardyck dans l’enceinte de l’établissement des Flandres, situé dans la zone portuaire de Dunkerque. Avec un investissement de 15 millions d’euros, ce projet utilisera une solution de stockage lithium-ion avec 11 conteneurs de 2,3 MWh chacun, fabriqués par Saft, filiale de Total spécialiste des batteries pour l’industrie. Opérationnel d’ici la fin de l’année ce programme permettra de réguler les fréquences et la variabilité de production propres aux énergies renouvelables mais aussi de stabiliser le réseau. Total ambitionne 25 GW de capacité de production installée en électricité renouvelable (photovoltaïque et éolien) d’ici 2025. Dans le cadre du Green Deal voulu par la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la Commission a annoncé le 13 mars dernier que les projets européens d’infrastructures énergétiques transfrontalières bénéficieront de 980millions d’euros grâce au programme Connecting Europe Facility (CEF). L’appel à projets est ouvert jusqu’au 27 mai 2020, et concerne ceux qui remplissent déjà un certain nombre de critères leur permettant d’être considérés comme des Projets d’Intérêt Commun (PCIs). Ils doivent impacter au moins deux États membres, accroître la compétitivité du secteur énergétique, améliorer la sécurité d’approvisionnement de l’Europe et contribuer aux objectifs de développement durable. Dans un second temps, ils seront analysés plus finement sur des critères de maturité, de solidarité et de caractère innovant. La liste des PCIs est mise à jour tous les deux ans, la dernière, datant d’octobre 2019 entrera en vigueur le 31 mars 2020. Par exemple, le financement des projets d’interconnexion transfrontalière pourrait permettre de davantage tirer parti de productions renouvelables variables, comme ceux entre la France et le Royaume-Uni. Cependant les changements de statut juridique à la suite du Brexit pourraient compliquer les démarches, ou changer les critères de sélection. L’association NegaWatt et Solagro avec le soutien de l’Ademe proposent un site regroupant une série d’articles destinés à contrer les idées reçues circulant sur les énergies renouvelables. Ils balaient des sujets qui vont de l’occupation des terres par les centrales photovoltaïques à la possibilité de cohabitation entre les éoliennes et l’avifaune en passant par l’étude de l’impact de l’éolien en terme d’artificialisation des terres. Un site très utile pour démonter les contre vérités qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Observ’ER avait déjà consacré en 2019 un hors série entier du Journal de l’Éolien sur la question des rumeurs propagées sur ce secteur et a mis en ligne une série de données et informations très factuelles sur le site du même magazine (rubrique tout sur l’éolien) dans lesquelles puiser pour monter un argumentaire renseigné. La commission européenne a publié hier sa nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, qui doit constituer l’un des socles pour parvenir à une économie neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. S’il est indiqué que « la réduction des émissions dans l’industrie dépendra d’un principe de primauté de l’efficacité énergétique et d’un approvisionnement sûr et suffisant en énergie à faible teneur en carbone à des prix compétitifs », le document manque de rappeler que les énergies renouvelables dans leur ensemble doivent constituer la première ambition de cette décarbonation du secteur énergétique et en particulier électrique. Le seul secteur des EnR qui appelle une réflexion industrielle en propre est celui des énergies renouvelables en mer, qui se verront consacrer un document stratégique centré notamment sur les chaines d’approvisionnement sur lesquelles le développement de ces énergies repose. La Commission soutient à juste titre le recours à tous les vecteurs d’énergie et annonce qu’une attention particulière sera consacrée à l’hydrogène propre dans le cadre d’une réflexion sur l’intégration des secteurs. Enfin, est annoncée également l’élaboration d’une stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente qui visera à pérenniser l’avance technologique de « l’industrie européenne de la mobilité ». Attendons maintenant des textes plus précis ! Dans un communiqué de presse du 10 mars, Drone Volt annonce avoir conclu un protocole d’entente avec Hydro-Québec, plus grand producteur d’électricité du Canada et l’un des principaux exploitants de centrales hydroélectriques au monde. Ce protocole vise à convenir de l’utilisation exclusive d’un type de drone destiné à l’inspection des lignes haute-tension d’Hydro-Québec, capable de mesures très précises, tout en maintenant des lignes sous tension. L’objectif est de diminuer les coûts de ces inspections et le risque pour les techniciens, et d’éviter les traditionnelles interventions par hélicoptère. Créée en 2011 et basée à Villepinte (Seine-Saint-Denis), Drone Volt est une entreprise spécialisée dans les drones civils et l’intelligence artificielle. Elle fournit à ses clients des solutions clé en main et des formations au pilotage de drones, notamment des administrations comme le ministère des Armées et des industriels comme Engie. L’entreprise française commercialise également des gammes de drones pour le nettoyage de panneaux solaires en toiture. L’utilisation de drones dans le monde de l’énergie se développe, témoin EDF qui les utilise pour la surveillance de son parc hydroélectrique. Le 5 mars dernier, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en collaboration avec ses partenaires Sustainable Energy for All (SEforALL), le PNUD et le Fonds vert pour le climat, a lancé une plateforme d’investissement climatique. L’objectif de cette action est d’augmenter le flux de capitaux vers les pays en développement et d’initier de nouveaux projets basés sur des énergies renouvelables. « Alors que l’Agence adopte une approche plus orientée vers l’action, aider les pays en développement à accéder au financement nécessaire pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, tout en soutenant des résultats sociaux et économiques, est une priorité claire », a déclaré le directeur général de l’IRENA, Francesco La Camera. Pour soutenir la mise en œuvre de la plateforme d’investissement climatique, l’IRENA organisera une série de forums régionaux conçus pour mettre en relation les promoteurs de projets enregistrés, les gouvernements et les partenaires financiers. Ces forums seront organisés autour de 14 clusters régionaux permettant d’adapter les activités aux besoins spécifiques des pays. Ces clusters sont construits autour de cinq sous-régions en Afrique, quatre en Asie et deux en Amérique latine ainsi que des clusters spécifiques pour les Caraïbes, les îles du Pacifique et l’Europe du Sud-Est. Les porteurs de projets sont encouragés à enregistrer leurs projets sur la page Web dédiée sous le cluster régional correspondant. Le 20 février, RTE a publié une note de précision sur les bilans CO2 du parc électrique français. Elle porte sur le bilan CO2 associé au secteur, et non à l’évaluation économique des différents leviers d’action. D’après cette note, l’électricité française produite en 2019 est majoritairement décarbonnée : 484 TWh (379 TWh nucléaires, 60 TWh hydrauliques, 45 TWh éoliens et solaires) contre 42 TWh provenant des centrales fossiles. Les émissions du secteur électrique ont diminué ces dernières années pour atteindre 19 millions de tonnes de CO2, et la France est toujours l’un des pays européens avec le contenu carbone de l’électricité le plus faible. A titre de comparaison le secteur électrique en Allemagne émet 270 millions de tonnes, et l’Italie 90 millions. RTE affirme que les énergies renouvelables se sont bien substituées, au cours des années récentes, aux énergies fossiles et non au nucléaire. La production nucléaire a stagné à 63 GW entre 2005 et 2019, et la légère baisse de production est due aux travaux de « grand carénage » d’EDF. L’augmentation de production renouvelable se traduit donc par une réduction des moyens fossiles (5 millions de tonnes de CO2 en France et 17 millions en Europe grâce aux interconnexions électriques). On peut ajouter que l’un des chapitres de la dernière édition de l’État des énergies renouvelables en Europe, publié par EurObserv’ER aborde cette thématique. Ainsi pour l’année 2018, on évalue à 351,3 millions de tep les volumes d’énergies fossiles auxquels se sont substitués des énergies renouvelables pour des besoins électriques, ou de transport. Mardi, Energy Observer, le premier bateau autonome à hydrogène a quitté le port de Saint-Malo. Direction le Maroc ou les Canaries selon les conditions météo, le navire mettra ensuite le cap sur Saint-Barthélemy. L’hydrogène à bord d’Energy Observer est produit par électrolyse d’eau de mer dessalinisée par osmose, puis traitée pour être utilisée par un électrolyseur embarqué. Pour cette expédition, une nouvelle pile à combustible fournie par Toyota, permettra de restituer aux moteurs de l’électricité à partir de l’hydrogène stocké. Autre amélioration, les panneaux solaires qui ont été étendu portant la surface totales à 202 m² pour une puissance cumulée de 34 KW. Pour 2020, l’équipage s’est fixé pour objectif de parcourir 37 000 km, presque la circonférence de la terre. La traversée du canal de Panama permettra de rejoindre Hawaï et enfin Tokyo, du 24 juillet au 9 août pour les Jeux Olympiques. Dans le cadre des débats organisés par la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le futur appel d’offres de l’État pour construire un nouveau parc éolien d’une puissance de 1 GW (soit 300 km2 d’emprise) au large des côtes normandes. Le premier atelier d’échanges avec le public aura lieu le samedi 7 mars de 14h à 17h au port du Havre. En petit groupe, les citoyens sont invités à donner leur avis et leurs recommandations sur la localisation des futures machines dans la macrozone préalablement identifiée et qui s’étend de Cherbourg au Tréport. Le débat devra également identifier, au sein de cette même zone de 10 500 km2, d’autres zones de projets potentiels qui seront lancés à partir de 2023. Mazars, organisme international spécialisé dans l’audit, et l’association Financement participatif France (FPF) viennent de publier le baromètre des plateformes de financement alternatif et participatif (crowdfunding) en France. 2019 est annoncé comme une année record avec + 56 % de fonds collectés pour atteindre 629 millions d’euros. L’environnement et les énergies renouvelables, avec 92,2 millions d’euros, arrivent en deuxième position des investissements derrière l’immobilier. Cet excellent chiffre vient corroborer les indicateurs du 6e baromètre de l’Ademe, qui révèle que 52 % des Français sont favorables aux énergies renouvelables. Le financement participatif poursuit donc sa croissance et n’est plus un phénomène de mode. En cinq ans il est devenu une source de financement non négligeable pour les porteurs de projets. Avec 473 TWh, 2019 a été l’année qui a affiché la plus faible consommation française d’électricité depuis 10 ans. Le chiffre représente une baisse de 0,5 % par rapport à 2018 (corrigée de l’aléa météorologique). La production électrique sur le territoire a été également en baisse de 2 % par rapport à 2018, soit 537,7 TWh. La France reste cependant le plus grand exportateur européen avec un flux de 84 TWh exportés à ses frontières contre 28,3 TWh importés. Dans le détail, l’énergie charbonnière a diminué de 71,9 % pour des raisons d’orientation de politique énergétique du pays (confirmées par la PPE), celle d’origine nucléaire de 3,5 % pour des problèmes de disponibilité de certaines centrales et l’hydroélectricité de 12,1 % pour cause de sécheresse accrue. En revanche, l’énergie éolienne a connu une hausse de 21,3 % et le solaire photovoltaïque 7,8 %. Ces évolutions du mix productif électrique 2019 ont conduit à une baisse des émissions de CO2 de 6 % par rapport à l’année précédente. RTE n’indique pas l’impact de ces évolutions sur les émissions de CO2 induites par nos importations d’énergie en provenance de pays où le mix est davantage carboné. En 2019 RTE a investi 1 456 M€ pour sécuriser et adapter le réseau aux nouveaux besoins du mix, notamment avec des interconnexions avec l’Italie (Savoie-Piémont) et l’Angleterre (IFA 2), ainsi que les travaux d’Avelin-Gavrelle pour la sécurité d’alimentation des Hauts-de-France. C’est également l’année de lancement des travaux de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Au total, 128 km de lignes aériennes ont été supprimées au profit de 213 km de lignes souterraines. Le réseau du transporteur national compte désormais 105 942 kilomètres de lignes électriques. Premier propriétaire immobilier de France avec 99 millions de mètres carrés, l’État entend montrer l’exemple dans l’application du décret tertiaire issu de la loi Elan, caractérisé par des objectifs drastiques de réduction de consommation énergétique dans des délais courts. C’est ainsi qu’à la suite du Conseil de Défense écologique du 12 février et dans le cadre de la stratégie pour des services publics éco-responsables, la Direction de l’immobilier de l’État et la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages lancent un deuxième appel à projets auprès des services de l’Etat pour financer des travaux « à gains rapides » présentant un temps de retour sur investissement (RSI) court grâce aux économies d’énergie réalisées. Un premier appel à projets avait été lancé en 2018 dans le cadre du Grand plan d’investissement. Il avait permis de financer pour 1 milliard d’euros, 39 projets de rénovation ou de reconstruction des cités administratives et finançant principalement des travaux concourant à la performance énergétique. Les travaux ciblés doivent correspondre à des actions « simples, immédiates et économes » permettant de réaliser facilement des économies d’énergie à moindre coût, tout en prenant en compte le confort des occupants. Ces projets doivent permettre de mettre en avant une démarche « Services publics eco-responsables » avec des objectifs ambitieux de réduction de 2/3 de la facture énergétique et de 50 % de l’émission des gaz à effet de serre. De plus, leur mise en œuvre devra s’accompagner d’une information auprès des occupants, afin de les associer à la démarche. Les actions présentant un temps de retour sur investissement entre 1 et 5 ans sont privilégiées. Le plafond est fixé à 10 ans. Pour sa 6e édition, le baromètre de l’Ademe révèle que 52 % des Français pensent qu’il serait possible, d’ici une vingtaine d’année, de produire quasiment toute l’énergie nécessaire au pays à partir d’énergies renouvelables et 64 % déclarent qu’ils seraient prêts à payer plus cher pour passer d’une énergie classique à une énergie renouvelable. « L’augmentation moyenne consentie atteint près de 12 %, un record depuis 2014 », assure l’agence dans un communiquédu 11 février. La production d’EnR à domicile fait des émules. Ainsi, 68 % des Français, + 2 points, seraient prêts à payer un peu plus cher pour produire eux-mêmes leur propre électricité. La production locale d’énergies renouvelables a également le vent en poupe : 86 % des sondés plébiscitent la production locale d’EnR même si elle coûtait un peu plus cher, 57 % (+3 points) seraient prêts à participer personnellement au financement de ce type de projet en y plaçant une partie de leur argent et 31 % (+ 3 points) pourraient même y investir plus de 500 euros. Toutefois, le baromètre révèle que les Français ont une très mauvaise connaissance de l’existence de ce type de projets : seuls 8 % des Français savent si de tels projets existent dans leur région. Enfin, le baromètre révèle que les attitudes hostiles à l’implantation d’installations d’EnR (syndrome « Pas dans mon jardin ») déclarées par l’ensemble de la population sont également minoritaires et/ou en régression. Le gouvernement a annoncé que l’État se dotait d’un outil de suivi de ses consommations de gaz, d’électricité, d’eau, de fioul, de chauffage urbain. « L’objectif est de mieux gérer son énergie et piloter son parc Immobilier », expliquent Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué commun en date du 14 février. Cet outil (OSFI, pour Outil de suivi des fluides interministériel), développé avec l’entreprise française Deepki, « permet de dresser une cartographie des consommations énergétiques du parc immobilier et ainsi d’être un véritable outil d’aide à la décision. » Il permet de : détecter une anomalie sur facture ; optimiser son contrat ; analyser les consommations via des courbes de charges ; de prendre les décisions d’investissements les plus judicieuses visant à réduire les consommations énergétiques. Le déploiement d’OSFI fait partie d’une série de mesures pour réduire les consommations énergétiques et émissions de Co2 des bâtiments publics. Tout comme, notamment, l’éradication du chauffage au fioul d’ici 2029, l’interdiction dès 2020 de l’achat de nouveaux systèmes de chauffage au fioul et la mise en open data dès maintenant des diagnostics de performance énergétique (DPE) des bâtiments publics. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a réagi le 19 février à la consultation publique de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Si l’organisme rassemblant des collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau salue « une approche conciliant compétitivité et dynamique d’emplois créés et développés dans les territoires grâce à la transition énergétique », le ton change à propos du biogaz. Ainsi, la FNCCR demande de renforcer la place du biogaz et soutenir financièrement son développement. La fédération « regrette une cible de production de biogaz trop modeste, à l’horizon 2023 : 6 TWh injectés contre 8 TWh inscrits dans la précédente PPE (2016). Cette réduction va ainsi à contre-courant de l’accélération du développement de la filière constatée en 2019. Par ailleurs, la FNCCR regrette le manque d’ambition concernant l’objectif de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en 2030, fixée à seulement 7 %, loin des ambitions initiales de 10 %. » Et d’ajouter, « il paraît nécessaire de limiter les appels d’offres à des productions élevées (supérieures à 30 GWh annuels) et de sanctuariser des volumes de production en guichet ouvert pour faciliter l’industrialisation et la baisse des coûts. Dans le même temps, il semble indispensable de mettre en place des outils pour faciliter le développement des projets (analyse des gisements au niveau départemental, aide à la faisabilité, aides spécifiques pour le gaz porté…). » Le verdict est tombé. En quête d’une ressource géothermale à 70 degrés dans un réservoir du jurassique, Plaine de Garonne Énergies a dû accepter l’échec de son forage à 1 600 mètres. « On a trouvé une eau à un débit de 240 litres/heure alors qu’on en attendait 200 à 300 m³ selon les projections du BRGM », lance Christophe Raymond. Intervenant à l’occasion d’un atelier des Assises européennes de la transition énergétique organisées fin janvier, le directeur de cette filiale de Cofely Engie et de Storengy semble déçu, mais pas abattu. Et pour cause : ce cas de figure avait été anticipé par le délégataire et son autorité concédante Bordeaux Métropole. « On s’est lancés car l’Ademe a accepté de couvrir le risque pris par cette exploration à hauteur de 90 % des coûts », confie Christian Guillaume, chef du service production et distribution d’énergie de la collectivité. « Lors de notre consultation, nous avons demandé aux entreprises d’imaginer différents scénarios. Avec un plan B pour que quoi qu’il arrive, on puisse créer un réseau de chaleur et un tarif compétitif ». Sur la rive droite de la Garonne, le forage a de fait repris pour remonter jusqu’à une nappe du Crétacé dont la température est plus faible (45 degrés), mais dont l’existence ne fait pas de doute. Si les choses se passent désormais comme prévu, l’installation géothermique développera une puissance de 7 MW de chaleur (contre 16 prévus initialement) et le complément sera apporté par une chaufferie biomasse dont le bâtiment avait été préconstruit avant de lancer les forages. Celui-ci aurait été affecté à un autre usage en cas de succès… Mais être prévoyant s’avère parfois utile. Le projet ClearGen permet de produire de l’électricité à partir de l’hydrogène coproduit par la SARA (Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles) dans sa raffinerie de Martinique. Porté par HDF Energy (Hydrogène de France Energy), en partenariat avec la SARA, le laboratoire ICMCB/CNRS, Ballard Power Systems Europe et JEMA, ce projet a pour but d’exploiter de manière industrielle de l’hydrogène pour produire de l’électricité avec une pile à combustible de grande puissance (1 MW). Financé à hauteur de 10 millions d’euros conjointement par le FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) de l’Union Européenne et la SARA, il consiste en la récupération de l’hydrogène non valorisé et initialement brûlé en torchère, pour produire de l’électricité. Celle-ci est vendue sur le réseau martiniquais à EDF SEI à travers un contrat d’achat de 15 ans. Le succès de l’intégration de cette technologie dans un contexte industriel très complexe et règlementé qu’est celui d’une raffinerie SEVESO ouvre un champ de possibilités pour la valorisation des sous produits issus des industries chimiques et pétrolières à grande échelle, notamment aux membres du consortium européen. HDF Energy a par ailleurs annoncé, le 10 décembre dernier, la construction à Bordeaux de la première usine de fabrication de piles à combustible de forte puissance, qui permettront de multiplier les projets de type ClearGen. Jeudi 6 février, Eiffel Investment Group, la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et Ademe Investissement ont annoncé le lancement du fonds Eiffel Gaz Vert. Doté de 115 M€, cet outil est destiné à soutenir le développement de 50 à 100 unités de méthanisation en France et en Europe au moyen de prises de participation minoritaires, apports en capital ou quasi-capital. L’un de ses objectifs est notamment d’aider les projets à passer la phase délicate de construction de l’unité de méthanisation avant qu’elle n’entre en production et que des financements de long-terme ne prennent le relais. En proposant un financement minoritaire, le fonds préserve ainsi le contrôle des industriels et agriculteurs sur leurs projets, tout en leur permettant d’allouer leurs fonds propres vers davantage d’opérations. Le nouvel outil est rapidement entré en activité puisqu’un premier projet a été engagé à hauteur de 8 M€. Il s’agit d’une opération située dans le Doubs et portée par Naskeo. La Banque Européenne d’Investissement et ProBTP étudient la possibilité d’entrer dans le fonds Eiffel Gaz Vert, ce qui pourrait alors porter son budget à 200 M€. En partenariat avec l’Ademe et la FNCCR, Observ’ER a publié le 30 janvier dernier la dixième édition de son Baromètre des énergies renouvelables électriques en France. L’ouvrage présente en détail, et par région, l’actualité des 9 principales filières de production d’énergie renouvelable électrique sur les 12 derniers mois, afin d’éclairer les territoires sur leur trajectoires en matière de transition énergétique. En légère hausse, les filières les plus dynamiques que sont l’éolien et le solaire photovoltaïque, ont vu leurs puissances installées progresser respectivement de 1,5 GW et presque 1,2 GW au cours de l’année écoulée. Ainsi la production électrique renouvelable de la France aura couvert l’équivalent de 23 % de l’énergie électrique nationale consommé et ce malgré un secteur hydroélectrique dont le niveau de production a été particulièrement en raison d’une année 2019 particulièrement sèche. Cependant, la progression des puissances installées a été en deçà des attentes notamment pour l’éolien et le PV qui auraient dû croître d’au moins 2 GW chacun, et maintenir ce rythme dans les années à venir, pour rester dans la feuille de route des objectifs 2023 de la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie. Les réseaux Amorce, Cler Réseau pour la transition énergétique, Flame et FNCAUE ont annoncé, dans un communiqué du 1er février leur mobilisation « pour un service public de la rénovation énergétique (SPPEH) à la hauteur des enjeux. » Ces réseaux veulent « pérenniser les structures d’accompagnement, les généraliser à tous les territoires et développer leurs missions pour atteindre les objectifs quantitatifs tout en garantissant la qualité et l’efficacité des rénovations grâce à un conseil objectif et indépendant des intérêts commerciaux. Le SPPEH doit être un service de proximité offert à tous les citoyens, et adapté aux différentes situations des ménages. » Le collectif fustige le choix de l’État de se désengager du financement du SPPEH pour le faire reposer sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), via le programme SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique, et sur les collectivités). « Ce choix risque de fragiliser l’écosystème de la rénovation », prévient-il, ajoutant que « le SPPEH ne peut pas se limiter au programme SARE. » Les 4 réseaux demandent donc « un cadre plus adapté et un financement pérenne pour le SPPEH en utilisant par exemple une partie de la contribution climat énergie pour financer les politiques de rénovation et plus largement de transition énergétique portées par les collectivités. » L’allemand Siemens a annoncé le 4 février le rachat pour 1,1 milliard d’euros à l’espagnol Iberdrola de la participation de 8,1 % qu’il détient dans sa filiale d’éoliennes Siemens Gamesa, issue de la fusion en 2017 de l’espagnol Gamesa et de la division énergie éolienne de Siemens. Une fois l’opération bouclée, Siemens détiendra quelque 67 % de la Siemens Gamesa. Il n’entend pas lancer d’offre sur le reste du capital, a-t-il précisé dans un communiqué. « Siemens et Iberdrola ont reconnu depuis longtemps la nécessité d’une consolidation » dans le secteur des énergies renouvelables, et « ont fait un premier pas dans cette direction », explique Joe Kaeser, patron du groupe, cité dans ce même communiqué. L’Ademe a publié une mise à jour de son étude de 2017 sur les coûts des énergies renouvelables en France. Photovoltaïque, éolien terrestre et en mer, hydrolien, petite hydroélectricité, géothermie profonde de haute énergie, bois énergie, solaire thermique individuel, pompes à chaleur individuelles, biomasse collective, solaire thermique, géothermie, cogénération biogaz, injection de biogaz, l’étude détaille les principaux paramètres régissant les coûts de production de ces différentes énergies et l’évolution de ces coûts. Pour certaines filières, une comparaison internationale est réalisée pour les coûts actuels. Enfin, le stockage de l’électricité et les coûts de production des technologies solaires en zone non interconnectée (ZNI) sont également dans le scope de l’étude. « Globalement, l’étude constate que le coût des énergies renouvelables poursuit sa baisse rapide. Des filières comme le photovoltaïque, l’éolien terrestre, le bois énergie, atteignent aujourd’hui, pour une partie significative des installations, des coûts inférieurs à ceux des technologies conventionnelles », explique l’Ademe. « Dans ce contexte, les soutiens publics au MWh se réduisent significativement, mais leur rôle assurantiel reste important pour permettre l’accès à des financements à bas coût. » Chez les particuliers, le développement des solutions d’énergies renouvelables « nécessite le maintien des aides publiques. En effet, même les solutions les plus effiicaces (bois énergie et géothermie), peinent à se développer à cause de barrières freinant le passage à l’action (le coût de l’investissement initial est particulièrement élevé) », relève l’étude. L’Ademe a annoncé le lancement de trois appels à projets à destination des entreprises pour soutenir la production de chaleur renouvelable, à partir de biomasse, d’énergie solaire ou de combustibles solides de récupération (CSR). Ces appels à projets s’inscrivent dans le cadre du Fonds chaleur et du Fonds économie circulaire. Les entreprises peuvent candidater à un ou plusieurs de ces appels à projets avant le 14 mai 2020. L’appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire » permet aux entreprises d’être soutenues pour financer les installations de production de chaleur à partir de biomasse ayant une production annuelle supérieure à 12 000 MWh. L’appel à projets « Energie CSR » permet aux entreprises d’être soutenues pour le développement d’unités permettant la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR). Enfin, L’appel à projets « Grandes surfaces solaire thermique » permet aux entreprises d’être soutenues pour financer les installations de production de chaleur moyenne température (< 110° C) à partir d’énergie solaire. Encore loin de son objectif d’atteindre une part d’énergies renouvelables de 20 % de sa consommation finale d’énergie en 2020, l’Union européenne a vu cette part progresser à 18 % en 2018, contre 17,5 % un an plus tôt, explique l’office européen de statistiques dans un communiqué publié le 23 janvier. Si les Pays-Bas (7,4 %), Malte (8 %), Luxembourg (9,1 %) et la Belgique (9,4 %) sont les pays avec la plus faible part d’énergies renouvelables dans leur consommation, la France (16,6 %) est l’un des pays les plus en retard, respectivement à 6,4 points de pourcentage de son objectif. Les Pays-Bas, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Slovénie viennent ensuite au classement des pays éloignés de leurs objectifs. Douze États sur 28 (le Royaume-Uni quittera l’UE à la fin du mois) ont en revanche déjà atteint ou dépassé leurs objectifs nationaux pour 2020. La Suède reste de loin le champion des énergies renouvelables dans l’UE, avec plus de la moitié (54,6 %) de son énergie issue de sources renouvelables. Viennent ensuite la Finlande (41,2 %), la Lettonie (40,3 %), le Danemark (36,1 %) et l’Autriche (33,4 %). Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) « rappelle le rôle majeur des équipements de production d’énergie renouvelable pour permettre de remplir les objectifs de neutralité carbone », dans un communiqué diffusé le 17 janvier. Cette annonce est intervenu après le début des simulations qui déterminernt les critères principaux de la future règlementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Pour mener à bien ces simulations, le gouvernement a arrêté 2 paramètres de calcul : le facteur d’émission de CO2 de l’électricité utilisée pour le chauffage, qui voit sa valeur actualisée à 79 g/kWh, et un coefficient de conversion entre énergie primaire et énergie finale de l’électricité de 2,3 (contre 2,58 jusqu’ici). Pour le SER, 3 leviers importants doivent désormais, être priorisés. « Un niveau d’isolation et de conception bioclimatique efficient, avec un niveau de BBio référence exigeant pour mieux intégrer la récupération des apports gratuits internes et solaires pour réellement décarboner le secteur du bâtiment. Cette exigence en matière de réduction des consommations doit nécessairement s’accompagner d’un développement massif des énergies renouvelables afin de couvrir les besoins résiduels. » Deuxième levier, « la mise en place d’un ratio de chaleur renouvelable contraignant est donc essentielle pour que le déploiement des productions de chaleur renouvelable (aérothermie/géothermie, biomasse, solaire, énergies fatales) permette aux bâtiments neufs de tendre vers la neutralité carbone. » Dernier axe, « la valorisation de l’électricité renouvelable produite in situ à la fois sous forme d’autoconsommation mais aussi d’injection sur le réseau électrique doit être prise en compte afin de favoriser le développement de réseaux locaux intelligents et de territoires à énergies positives. » Total installera et exploitera « jusqu’à 20 000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas, dans les provinces de Hollande-Septentrionale, de Flevoland et d’Utrecht », a annoncé l’énergéticien français dans un communiqué du 22 janvier. Il s’agit du « plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe », explique Total. « Ce réseau de recharge couvre près de 15 % de la demande actuelle en matière de charge pour véhicules électriques aux Pays-Bas », ajoute le groupe. Et de préciser que « dans le cadre de cette concession, l’électricité qui alimentera ce réseau de recharge sera à 100 % d’origine renouvelable (solaire, éolien, …), fournie par Total Netherlands et produite aux Pays-Bas. » Total a l’« ambition d’opérer 150 000 points de charge en Europe à horizon 2025 », explique encore le communiqué. Lhyfe a annoncé avoir levé 8 millions d’euros de fonds pour installer en Vendée un premier site industriel de production d’hydrogène vert, qui sera opérationnel au premier semestre 2021. La construction du premier site industriel de Lhyfe débutera ce semestre, « il produira dès le premier semestre 2021 de l’hydrogène vert en grande quantité (plusieurs centaines de kg) », indique l’entreprise nantaise dans un communiqué du 16 janvier. La promesse de Lhyfe : « une solution de production clé-en-main d’hydrogène vert, modulaire et évolutive. » L’entreprise conçoit, développe et opère ses sites de production pour répondre aux besoins en hydrogène vert des territoires. Pour produire son hydrogène, par électrolyse de l’eau, Lhyfe se connecte en effet directement aux énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biomasse solide, etc). L’entreprise « s’adresse aux collectivités, aux industries et au monde du transport qui souhaitent s’approvisionner en hydrogène vert et réduire ainsi instantanément et drastiquement l’impact environnemental de leur mobilité (bus, bennes à ordures, flottes de véhicules lourds ou légers) ou de leur process. » Le premier site, situé en Vendée à proximité du parc éolien Bouin, est co-financé à hauteur de 3 millions d’euros par la communauté de communes de Challans-Gois, la région des Pays-de-la-Loire et la Bpi France. Il sera complété par une première station à hydrogène à La Roche-sur-Yon, laquelle alimentera une première ligne de bus et des véhicules de la collectivité (bennes à ordures ménagères). La Commission von der Leyen (du nom de sa présidente) a dévoilé le 14 janvier à Strasbourg un plan d’investissement pour son ”Pacte vert”. Il s’appuie sur un nouveau fonds pour soutenir les régions les plus dépendantes au charbon. Avec son « mécanisme de transition juste », une proposition législative soumise à négociation entre les États membres et le Parlement européen, la Commission espère mobiliser jusqu’à 100 milliards d’euros au cours de la prochaine décennie et ce, par le biais de multiples sources de financement. Le « Fonds de transition juste », selon des documents vus par l’AFP, serait en lui-même doté de 7,5 milliards d’euros entre 2021 et 2027 (soit la période du prochain budget pluriannuel de l’Union européenne). De l’argent frais, assure-t-elle, pour un nouvel outil qui s’inscrira dans la politique de cohésion de l’UE qui, traditionnellement, aide au développement des régions. Ce Fonds est accompagné d’autres moyens de financement, via des programmes d’investissement de l’Union mais aussi de la Banque européenne d’investissement (BEI), en pleine mue pour devenir la « banque du climat » de l’UE. Viendront s’ajouter des dépenses en faveur du climat réparties dans les différentes catégories du budget de l’UE, par exemple les transports ou l’agriculture, ainsi que des investissements privés-publics. La Commission veut qu’un quart des dépenses du budget pluriannuel y soit consacré. Le Parlement européen a en tout cas offert le 15 janvier son soutien au « Pacte vert », tout en appelant à plus d’ambition en matière de lutte contre le changement climatique. Dans une longue résolution, adoptée à 482 voix pour, 136 contre et 95 abstentions. les eurodéputés répondent point par point à la feuille de route dévoilée en décembre par Ursula von der Leyen. La création d’une « coalition d’action » pour accélérer le déploiement des énergies marines renouvelables (EMR), particulièrement l’éolien en mer, a été annoncée le 13 janvier. Le groupe norvégien Equinor et le groupe danois Orsted sont à l’origine de cette « coalition d’action pour les énergies renouvelables marines », qui compte également MHI Vestas, Siemens Gamesa, CWind, Global Marine Group, Shell, TenneT, The Crown Estate, Jera et Mainstream Renewable Power. Elle représentera « le secteur de l’éolien offshore lors des dialogues mondiaux sur les actions climatiques », explique Equinor dans un communiqué. Elle préparera aussi un document de perspective pour 2050 pour inclure industriels, financiers et gouvernements dans des actions pour accroître de manière durable les capacités éoliennes offshore. « En 2020, les Français placent l’écologie parmi leurs priorités pour leur mode de chauffage », selon la troisième édition du baromètre sur le chauffage des Français réalisée par Ipsos pour Via Sèva en partenariat avec l’Ademe. « Deux répondants sur trois sont prêts à changer de mode de chauffage pour accéder aux énergies renouvelables et faire des économies », est-il expliqué. « La répartition du mix énergétique idéal pour le chauffage, privilégié par les Français, est composée de solaire, de géothermie et de récupération de chaleur », poursuit le document. « Pour atteindre ce mix idéal, ils comptent sur les pouvoirs publics (74 %, contre 67 % en 2017) tant sur le plan global (ministère, Ademe…) qu’à l’échelle locale (municipalité…) et sur les fournisseurs d’énergie (54 %). » S’agissant des réseaux de chaleur renouvelable, la moitié des sondés (49 %) en ont entendu parler mais sans savoir comment cela fonctionne et vers qui se tourner. « Quand on leur a présenté les réseaux de chaleur, 76 % des sondés se sont déclarés intéressés par un raccordement. Et 67 % attendent que les candidats aux municipales de 2020 dans leur ville intègrent un réseau de chaleur fonctionnant aux énergies propres dans leurs propositions, avance le sondage. Mais ce n’est pas tout, plus des trois quarts des répondants (78 %) seraient prêts à investir si un appel à financement participatif était lancé pour créer un réseau de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables dans leur ville ou leur quartier. » En 2018, et pour la première fois, l’Allemagne a produit plus d’électricité grâce aux énergies renouvelables qu’au charbon, selon un rapport publié le 3 janvier par l’institut allemand Fraunhofer ISE. Durant les 12 mois de 2018, les énergies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque, biomasse et hydroélectricité) ont produit 219 TWh d’électricité en Allemagne, soit 4,3 % de plus qu’en 2017, mais surtout ont couvert 40,4 % de la production électrique allemande, contre 38 % pour le charbon (lignite et houille confondus). Pour rappel, le pays s’est fixé pour objectif de produire 65% de son électricité à partir des énergies renouvelables en 2030. Un bémol cependant, compte tenu des « prix très bas de l’électricité produite à partir du lignite et de la faible valeur des certificats d’émissions de CO2, l’Allemagne exporte d’importants volumes d’électricité » vers ses pays voisins, explique Bruno Burger, responsable de ce rapport. En 2018, le pays a ainsi exporté 45,6 TWh, principalement vers les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède et a importé seulement 8,3 TWh d’électricité de France. Selon l’institut Fraunhofer ISE, la part des énergies renouvelables, qui a approximativement doublé depuis le début des années 2010, devrait rester supérieure à 40 % en 2019, compte tenu du nombre d’installations renouvelables en construction (en prenant en compte les aléas météorologiques). « D’ici la fin du mois, nous lancerons la consultation publique [et en ligne] sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et notre Stratégie nationale bas-carbone, qui sont notre feuille de route pour réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone que vous avez désormais inscrit dans la loi » pour 2050, a déclaré le 7 janvier la ministre de la Transition écologique et solidaire devant les députés. Les textes seront ouverts à la consultation publique du 20 janvier au 19 février. « Ces mesures seront renforcées par les propositions des 150 citoyens [de la Convention citoyenne pour le climat] qui travaillent d’arrache-pied et que le président de la République rencontrera vendredi [10 janvier] », a ajouté Élisabeth Borne. Le gouvernement a officiellement lancé le 8 janvier une aide financière à la rénovation énergétique des logements, destinée à remplacer le précédent système de crédit d’impôt (crédit d’impôt à la transition énergétique – CITE). Baptisée « MaPrimeRénov’ », il s’agit d’une « aide juste et simple qui finance ces travaux de rénovation énergétique et s’adresse à tous les propriétaires qui occupent leur logement. L’aide est calculée en fonction de deux éléments : les revenus et le gain écologique apporté par les travaux de chauffage, d’isolation ou de ventilation », explique le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales dans un communiqué. Le site internet maprimerenov.gouv.fr et un numéro de téléphone (0.808.800.700) doivent aider les particuliers à déterminer la prime à laquelle ils sont éligibles. Cette prime doit être versée dans les 15 jours après la validation de la demande. « Le système tel qu’il était n’était pas satisfaisant », a assuré le ministre du Logement, Julien Denormandie, lors d’une conférence de presse dans les locaux de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). « Tout ça prenait 18 mois. La conséquence, c’est que vous aviez un reste à charge trop important pendant une durée trop longue. » Le réseau collaboratif REN21 vient de publier un nouveau rapport, Renewables in Cities 2019 Global Status Report, qui se consacre au déploiement des EnR dans les villes du monde et au rôle des politiques territoriales dans la transition énergétique. Le rapport examine les tendances de développement des EnR dans les villes et met en avant les bénéfices induits en termes de lutte contre la pollution de l’air, l’accès à l’énergie et les retombées socio-économiques. . La publication a pour but d’aider à la compréhension du rôle important des villes dans la transition énergétique. Les deux tiers de la consommation d’énergie finale dans le monde sont localisés dans les villes, on comprend donc l’intérêt à ce qu’elles soient motrices en termes de transition énergétique. REN 21 a dénombré plus de 250 villes qui ont adopté des objectifs de consommation 100 % EnR mais remarque que leur mise en œuvre est encore peu satisfaisante du fait notamment d’incohérences entre les différents niveaux de politiques territoriales. La publication présente des politiques efficaces et des modèles d’affaires performants pour inciter à les dupliquer. Le financement participatif gagne le monde de la géothermie. Depuis le début du mois de décembre, les habitants de Noisel et de Champs-sur-Marne (77) sont invités à prêter entre 50 et 10 000 euros sur trois ans à GeoMarne. Cette filiale d’Engie Réseaux est chargée de construire un réseau de chaleur alimenté par une centrale puisant ses calories à 1 900 mètres de profondeur. Des visites sont actuellement proposées deux fois par semaine pour visiter le chantier de forage qui devrait durer jusqu’à la fin février. Début janvier, l’offre de financement sera étendue aux dix autres communes de l’agglomération et en février, tous les franciliens pourront participer. Dans d’autres filières renouvelables, les opérateurs sont encouragés à proposer cette nouvelle forme d’épargne pour bénéficier de mécanismes de soutien plus favorables. Bien que ce ne soit pas le cas dans le monde de la géothermie, « nous voulons associer les riverains pour leur montrer l’intérêt de cette opération pour leur territoire », explique Pierre Hourcade, Directeur général d’Engie Réseaux. Il estime que ce type de démarche peut au passage contribuer à renforcer l’acceptabilité des projets. Confiée à l’opérateur Lumo, désormais intégrée à Société générale, la collecte d’épargne vise à rassembler entre 500 000 et 1 million d’euros sur les 40 M€ d’investissement total… Un ballon d’essai puisque sur d’autres projets, l’énergéticien n’exclut pas d’ouvrir le capital de ses sociétés de production aux collectivités ou aux habitants. Fébus, la nouvelle flotte de huit bus 100 % hydrogène avec « zéro émission » a été inaugurée à Pau (Pyrénées-Atlantiques) par François Bayrou le mardi 17 décembre. Longs de 18 mètres et très silencieux, ces nouveaux bus feront un trajet de 6 kilomètres en 17 minutes (dont 85 % en voie propre) et pourront accueillir jusqu’à 125 personnes. Fébus a été conçu par le groupe belge Van Hool et aura une fréquence de passage toutes les huit minutes aux heures de pointe. L’hydrogène nécessaire est produit sur place par électrolyse de l’eau à partir d’électricité verte certifiée par des garanties d’origine. A terme, l’électricité nécessaire sera produite par des panneaux solaires. Avec zéro émission de gaz à effet de serre et de particules fines, les moyens de transports à hydrogène se rangent aux côtés des véhicules roulants au biométhane ou à l’électricité dans le but de décarboner le secteur de la mobilité. A noter aussi qu’une flotte de bus à hydrogène a été aussi mise en service cet automne dans les Yvelines et le Pas-de-Calais. L’inauguration officielle de la ligne Fébus de Pau se déroulera le 13 ou le 14 janvier prochain en présence du président Emmanuel Macron. La centrale géothermique de Bouillante a obtenu début décembre l’autorisation de procéder à deux nouveaux forages. L’installation compte aujourd’hui cinq puits et avait déjà prévu d’en réaliser trois autres. De quoi alimenter une nouvelle turbine d’ici 2021… et doubler une production d’électricité décarbonée qui fournit aujourd’hui près de 7 % de la demande guadeloupéenne (à un prix d’environ 30 ct€/kWh, ce qui est compétitif dans un contexte outre-marin). Les deux premières turbines dites « à ailettes » valorisent la vapeur sèche qui émane de la faille géologique de Bouillante. La nouvelle installation « à fonctionnement binaire » utilisera une deuxième fois la chaleur pour faire monter un gaz en température avant qu’il ne se détende dans la turbine. « Nous allons investir 15 M€ dans les nouveaux puits et 35 M€ dans l’équipement », rapporte Étienne Nicolas, directeur du site. Si de nombreuses craintes s’étaient exprimées lorsqu’EDF a cédé l’installation en 2016, le groupe américain Ormat qui l’a repris a semble-t-il apporté quelques garanties. En étant plus réactif dès lors qu’il y a une panne ou en optimisant la gestion du niveau de réinjection dans le réservoir fournissant la vapeur, il a fait passer son taux d’efficience de 56 à 93 %. Ormat réfléchit par ailleurs dès aujourd’hui à un projet de quatrième turbine qui pourrait nécessiter de nouveaux forages plus au nord. Depuis sa création, l’installation géothermique contribue aussi à l’attrait touristique de Bouillante en réinjectant une partie de l’eau chaude issue du sous-sol dans une source d’eau chaude très prisée. On notera la parution ce jour d’un document intéressant sur le site Énergie en lumière, qui est financé par le projet E2S de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), dans le cadre des activités du consortium public-privé Pau droit énergie.Ce document présente les points de vue contrastés d’un certain nombre d’acteurs institutionnels et d’acteurs du marché de l’électricité au sujet des offres d’électricité verte. Si chaque fournisseur prêche évidemment pour sa paroisse, on pourra s’arrêter sur la réflexion originale d’Yvan Debay, d’Origo, qui pointe la nature particulière des contrats de fourniture d’électricité : ce sont avant tout des contrats de responsabilité d’équilibre, accompagnés le cas échéant de garanties d’origine (GO). Dès lors il n’y aurait pas de différence que l’on achète l’électricité au même producteur que celui qui nous vend la GO ou ailleurs. Plusieurs fournisseurs insistent cependant sur l’intérêt de conclure des contrats d’achat d’électricité avec des producteurs locaux. Certains vont jusqu’à inclure la blockchain pour garantir une couverture de la consommation au pas de temps demi horaire… Paramètres très divers qui soulignent la pertinence du travail de montage d’un label entrepris par l’Ademe avec les différentes parties prenantes. Notre rédaction en avait déjà fait écho dans le hors série du Journal des Énergies Renouvelables consacré aux offres vertes et poursuivra son suivi. A l’occasion du forum Energaïa qui se tient à Montpellier les 11 et 12 décembre, la lettre des Clés de la Transition Énergétique des Territoires a réalisé une édition spéciale. Au sommaire du numéro : un article sur les certificats d’économies d’énergie (CEE) comme outils de financement pour les collectivités, une présentation de la politique en faveur du développement du biométhane agricole dans le département du Lot-et-Garonne, un portrait du maire de Banyuls-dels-Aspres (Pyrénées-Orientales) et de ses actions très orientées énergies renouvelables ou le détail du projet de la Cleantech Vallée qui accompagne la transition économique et écologique du Gard rhodanien après la fermeture d’une centrale thermique. Les Clés de la Transition Énergétique des Territoires est une publication mensuelle éditée par Observ’ER et disponible gratuitement en ligne sur le site : www.clesdelatransition.org Un « groupe de travail sur le développement équilibré de l’énergie éolienne en France » va être mis en place, a annoncé la secrétaire d’État à la Transition écologique le 3 décembre à l’Assemblée nationale. Ce groupe de travail traitera « de la répartition territoriale, mais aussi du démantèlement et de l’insertion paysagère » des éoliennes, a expliqué Emmanuelle Wargon en réponse au député UDI du Nord Guy Bricout, qui l’interrogeait sur le nombre d’éoliennes dans la région Hauts-de-France. « À ce jour, 1 500 éoliennes sont déjà en place, 800 ont été autorisées et non encore construites, et 733 projets sont en cours d’instruction. C’est fou ! », s’est exclamé le député. « Il est vrai que la région des Hauts-de-France ainsi que le Grand-Est sont les deux régions les plus directement concernées par le développement de l’éolien et en accueillent une large part », a indiqué la secrétaire d’État. « Mais c’est également vrai que nous devons veiller à une répartition équilibrée sur le territoire des différentes énergies renouvelables et de l’énergie éolienne », a-t-elle poursuivi, en référence au groupe de travail qui va être créé sur cette question. Et de préciser que « les concertations démarrent maintenant très en amont » et que le gouvernement favorisait « les projets citoyens dans lesquels les habitants peuvent eux-mêmes participer aux implantations des éoliennes. » L’entreprise Newheat a annoncé la signature des contrats du projet Emasol, une centrale solaire thermique alimentant le réseau de chaleur de Pons (17). « Cette centrale sera la 2e installation solaire thermique de grande dimension (plus de 1000 m2) alimentant un réseau de chaleur urbain en France, après la centrale réalisée sur la commune de Châteaubriant (44) mise en service en 2018 », explique Newheat dans un communiqué du 29 novembre. D’une surface de capteurs solaires thermiques de 1786 m2 représentant une puissance crête de 1,5 MWc, elle «produira de l’eau chaude (< 90° C) qui viendra en complément de la chaufferie biomasse existante afin de réduire l’utilisation de la chaufferie au gaz actuellement en place et émettrice de CO2. » La production attendue de cette centrale est de 1 000 MWh par an, « ce qui représente 90 tonnes d’émissions de CO2 évitées par année de fonctionnement. » Ce projet a été sélectionné et est soutenu financièrement par l’Ademe dans le cadre de l’appel à projets « grandes installations solaire thermique » du Fonds chaleur et par la Région Nouvelle Aquitaine. « Il sera porté financièrement principalement par Newheat, et par des acteurs locaux : la SEM Energies Midi Atlantique et la ville de Pons. » Waga Energy a annoncé mi-novembre une levée de fonds de 10 M€ pour soutenir son expansion en Amérique du Nord. « Cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement de Waga Energy : après avoir démontré la performance et la fiabilité de notre solution Wagabox® en France, nous engageons son déploiement à l’international, afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de contribuer à la lutte contre le changement climatique, défi majeur de notre génération », explique Mathieu Lefebvre, cofondateur et PDG de Waga. Cette jeune entreprise grenobloise a développé une technologie permettant d’injecter dans le réseau de gaz le méthane issu des décharges. Elle a reçu pour cette innovation le Grand prix de la lutte contre le changement climatique 2016 décerné par l’Ademe et le ministère en charge de l’environnement. Créée en janvier 2015, la société double chaque année ses effectifs et compte aujourd’hui 40 salariés. Les fonds levés vont permettre d’épauler le développement de la société en Amérique du Nord, débuté en mars avec l’ouverture d’une filiale aux États-Unis, à Philadelphie, et d’une autre en octobre au Canada, à Shawinigan dans le berceau de l’hydroélectricité québécoise. Dans une tribune intitulée « RE2020 : que reste-t-il du label E+C- ? », Thierry Rieser, gérant d’Enertech et auteur de ce texte, appelle les pouvoirs publics à revoir en urgence certains axes de travail de la réglementation environnementale 2020 (RE2020). Le document, lisible ici, est cosigné par plus de 90 acteurs de terrain, BE, architectes, urbanistes et associations, « tous concernés par la prochaine RE2020. » Au premier rang des récriminations, la disparition du bilan Bépos (comme bâtiment à énergie positive). « Sans bilan BEPOS, comment compte-t-on définir un bâtiment à énergie positive ? », se demande Thierry Rieser. Autre sujet, « le moment est venu de cranter les avancées d’E+C- pour que la performance énergétique et climatique des bâtiments neufs soit vraiment au rendez-vous des contraintes qui pèsent sur l’humanité. Mais plusieurs signaux inquiétants sur des choix concernant quelques points très techniques mais fondamentaux nous font craindre au contraire que la France enclenche la marche arrière, par exemple en redonnant aux convecteurs électriques une place que la RT2012 leur avait retiré avec raison, au détriment d’autres solutions plus performantes comme les pompes à chaleur et des énergies renouvelables », peut-on lire dans cette tribune. Et Thierry Rieser d’ajouter : « Au moment des derniers arbitrages imminents, les propositions que nous formulons n’ont pas d’autre ambition que de permettre à notre pays d’être réellement à la hauteur de ses ambitions, que nous partageons tous. » Fonroche Géothermie veut associer cogénération et extraction minière sur le site d’une ancienne raffinerie d’hydrocarbures. À Vendenheim (Bas-Rhin), où l’entreprise paloise projette de construire une centrale de géothermie profonde, des analyses ont montré une concentration importante en lithium dans l’eau issue des puits de forages. Conséquence, elle pourrait chaque année en extraire jusqu’à 1 500 tonnes avant que l’eau ne soit rejetée dans la nappe… selon des procédés qu’il va désormais falloir tester. Côté énergétique, cette installation produira 10 MW d’électricité et 40 MW d’énergie thermique ; de quoi alimenter 26 000 logements en eau chaude et en chaleur ou jusqu’à 70 hectares de serres agricoles. Avec deux autres projets analogues conduits dans la région strasbourgeoise (à Hurthigheim et à Eckbolsheim), Fonroche Géothermie estime être en mesure de fournir 30 à 40 % de la demande industrielle française en lithium. Cette double valorisation aurait un intérêt économique évident pour l’énergéticien, mais aussi pour des filières comme l’automobile aujourd’hui pieds et poings liés à une poignée de pays comme le Chili, l’Australie ou la Chine. Conjuguer géothermie et extraction permettrait en outre de limiter l’impact environnemental du lithium et donc de l’électromobilité. À Vendenheim, Fonroche Géothermie utilisera la technique dite du doublet géothermique permettant d’aller chercher l’eau chaude en utilisant les failles existantes (donc sans fracturation hydraulique). À l’horizon 2023, l’entreprise envisage d’investir 320 M€ et de créer 200 emplois dans la géothermie profonde. (Olivier Descamps) Atawey a annoncé, le 12 novembre, la signature d’un accord cadre avec la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA). « Ce projet a pour objectif de promouvoir la mobilité durable grâce au déploiement de stations pour les vélos à hydrogène sur le territoire », explique cette entreprise basée à Savoie Technolac, au Bourget-du-Lac, et qui conçoit et fabrique l’intégralité de ses stations de production d’« hydrogène vert » dans ses ateliers. « Atawey permettra le déploiement de cette mobilité propre dans les premières communes auvergnates et rhônalpines pour l’été prochain. » Fin 2019, l’entreprise disposera d’un parc de 18 stations (pour vélos et voitures), dont 15 avec production d’hydrogène sur site par électrolyse de l’eau. « La finalisation de la PPE, on a l’objectif de la faire très rapidement, tout en tenant compte des travaux et réflexions conduits sur les questions de maîtrise de la demande et de trajectoire carbone » de la France, a déclaré Sophie Mourlon, directrice de l’Énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC – ministère de la Transition écologique et solidaire), à propos de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sur la période 2023-2028 lors d’une conférence sur les énergies renouvelables qui s’est tenu à Bercy le 20 novembre. « Notre objectif est de présenter, pour une ultime consultation publique obligatoire sur internet, cette PPE finalisée sur le volet offre d’ici la fin de l’année. Je ne peux pas mettre ma tête à couper que nous y parviendrons mais c’est bien l’objectif, ce qui permettrait d’adopter très rapidement au début de l’année 2020 », a-t-elle ajouté. Pour rappel, après le lancement de l’élaboration mi-2017 et le débat public en 2018, ce projet de feuille de route énergétique pour 2019-2028, très attendu, a été annoncé en novembre 2018 par le président Emmanuel Macron, mais le texte final toujours pas publié. « Malgré un verdissement continu des réseaux, un retard inquiétant est constaté sur les objectifs de 2023 fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) » (période 2018-2023), avertissent l’association de collectivités Amorce, le Syndicat national du chauffage urbain (SNCU) et la Fédération des services énergie environnement (Fedene, regroupant les entreprises du secteur). Dans l’édition 2019 de leur enquête annuel sur les réseaux de chaleur et de froid, ils clament qu’il est « urgent d’accélérer le rythme actuel de développement des réseaux (création, extension) et de poursuivre leur verdissement afin d’atteindre l’objectif de 2023, soit une multiplication par 5 du rythme de développement de 2018 (soit +2 TWh/an). » Pour autant, 51,7% des énergies utilisées par les réseaux de chaleur proviennent désormais de sources renouvelables et de récupération, contre 27 % il y a dix ans, selon l’étude. En 2018 leur coût global est resté inférieur à celui du gaz collectif et de l’électricité. Les partenaires soulignent dans le même temps « l’impact positif » des 25 mesures annoncées par le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du groupe de travail ministériel qui s’est réuni cette année et se félicitent également de l’augmentation du Fonds chaleur. La transition vers les énergies renouvelables pourrait réduire jusqu’à 80% d’ici 2050 les impacts de la pollution de l’air sur la santé, selon une étude publiée le 19 novembre par Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Selon ce document, un scénario dans lequel la majorité de l’électricité est produite par le solaire et l’éolien pourrait réduire les effets sanitaires de la production électrique de 80 % par rapport aux systèmes actuels. « Le principal gagnant de la décarbonation est la santé », explique l’auteur principal, Gunnar Luderer, mettant ainsi en avant le rôle clé des politiques climatiques pour la santé humaine. Selon lui, tous les scénarios de décarbonation (PIK en a étudié 3) présentent un avantage en matière de santé publique, mais celui insistant sur les renouvelables est le plus bénéfique. La loi Énergie et Climat a été promulguée le 9 novembre au Journal officiel. Comportant 69 articles, cette loi, datée du 8 novembre 2019, est présentée par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, comme un « nouveau pilier » de la transition écologique. De fait, elle actualise les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, une baisse de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, contre 30 % précédemment, et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Elle pérennise également le Haut Conseil pour le climat (créé en novembre 2018) et prévoit un dispositif progressif de rénovation énergétique des logements « passoires thermiques ». Par ailleurs, la loi entérine le décalage de 2025 à 2035 pour la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique. Sur le même sujet, la ministre a appelé au micro de France inter le 10 novembre EDF à « réfléchir » à son rôle au cas où un scénario « 100 % énergies renouvelables » serait retenu à terme pour la fourniture d’énergie en France, au dépend de nouvelles centrales nucléaires. « Je vous confirme qu’on étudie à la fois un scénario dans lequel on continue à faire de nouvelles centrales nucléaires, et aussi un scénario 100 % renouvelables », a indiqué la ministre. « On doit avoir tous les éléments sur la table mi-2021 » et « on a dit qu’on ne prendrait pas de décision sur de nouvelles centrales nucléaires avant la mise en service de Flamanville », a-t-elle rappelé. Une déclaration qui intervient au lendemain de la publication par Le Monde d’un document interne d’EDF dans lequel l’énergéticien évalue à au moins 7,5 mds€ le coût unitaire d’éventuels nouveaux EPR, soit plus du double du prix initial du réacteur nucléaire de troisième génération de Flamanville qui a accumulé les déboires et dont la facture actuelle atteint 12,4 mds€. Atos et Météo-France ont annoncé le 12 novembre la création d’une nouvelle plateforme qui « permet aux producteurs et agrégateurs d’électricité verte de mieux prévoir leur production en France et en Europe. » Le spécialiste de transformation digitale et le groupe de météorologie s’associent en effet pour développer une plateforme de prévision des productions d’électricité renouvelable à destination des professionnels du secteur. Ce service permet ainsi aux producteurs et agrégateurs d’électricité renouvelable « d’anticiper les conditions d’équilibre du système et notamment les autres besoins de production, et d’intégrer au mieux les énergies renouvelables au sein du réseau électrique français et européen », explique les deux partenaires dans un communiqué commun. Concrètement, la plateforme utilise des algorithmes de « Machine Learning » pour déterminer des prévisions les plus précises possibles, et ainsi fournir un service dit de « météo-sensibilité ». Elle fonctionne sur la base de données météorologiques fournies par Météo-France, d’historiques de production, ainsi que d’informations sur les équipements physiques en place. « Candidat-e aux municipales, vous portez un projet d’avenir pour votre commune. Avec ce guide ”Demain, mon territoire”, nous avons voulu montrer que, pour chaque défi du quotidien, il existe une palette de solutions éprouvées pour engager une transition écologique qui, si elle est désormais inéluctable, puisse également être désirable », explique Arnaud Leroy, PDG de l’Ademe dans le communiqué annonçant cette publication qui prend la forme de 20 fiches pratiques abordant une multitude de thématiques (les déplacements, les logements, la nature en ville, la consommation responsable, la sensibilisation des jeunes…). Ces fiches, disponibles ici, contiennent des chiffres clés, des pistes d’action et des exemples de solutions mises en œuvre. Elles répondent aux divers enjeux d’un territoire, de l’alimentation à la mobilité, en passant par l’énergie, l’économie circulaire, l’aménagement, l’adaptation au changement climatique, etc. « L’objectif est de prouver aux candidats qu’il est possible d’envisager une ville plus sobre en carbone. » « Les professionnels du génie climatique vont pouvoir bénéficier d’un coup de pouce pour se former à l’installation des systèmes valorisant la chaleur renouvelable grâce au programme FEE Bat » (Formation des professionnels aux économies d’énergie dans le bâtiment), ont annoncé Qualit’EnR et FEE Bat dans un communiqué commun diffusé le 6 novembre. Grâce à un partenariat signé entre les deux organismes, les installateurs pourront ainsi « bénéficier d’une prise en charge financière des formations agréées en chaleur renouvelable à partir du 1er janvier 2020. » Les équipements concernés sont les suivants : pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques, appareils bois énergie (poêles, chaudières, etc.), chauffe-eau solaires et systèmes solaires combinés (chauffage solaire) et forage géothermique. Les installateurs sont invités à se rapprocher des centres de formation agréés dans les prochaines semaines pour en savoir plus. Un annuaire est disponible sur formation-enr.org. Le dispositif d’appui aux projets citoyens d’énergie renouvelable créé par la Banque des Territoires, le Crédit Coopératif et l’Ircantec a annoncé, le 5 novembre, deux premiers investissements. Ces deux projets, en cours de développement, sont portés par des acteurs territoriaux. Il s’agit du parc éolien d’Ichy (Seine-et-Marne) et du parc photovoltaïque de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence). Pour le premier projet, EnRciT s’engage au côté du développeur Arkolia, du SDESM Énergies (la SEM dédiée aux EnR du Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne) et d’Énergie Partagée Investissement pour installer 5 ou 6 éoliennes qui totaliseront environ 15 MW de puissance. EnRciT investit 35 000 € en fonds propres, et détient 10 % du capital de la société de projet. Sur le second projet, la reconversion d’un terrain militaire en une installation photovoltaïque de 4,34 MW, EnRciT, associé à Enercoop PACA et à Egrega, investit 46 000 € en fonds propres et prévoit de se désengager au profit d’acteurs locaux une fois que la construction sera achevée. EnRciT a été créé « pour aider collectivités et citoyens à franchir le cap de la phase délicate du développement des projets de production d’énergie renouvelable. », rappelle Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des Territoires. Les risques afférents à cette étape « représentent un frein pour de nombreux acteurs pourtant prêts à agir pour la transition énergétique à l’échelle locale », expliquent les deux partenaires. CDC Habitat et Enedis ont signé, le 29 octobre, « une convention de partenariat en faveur de la transition énergétique au bénéfice de l’habitat social ». Ce partenariat est décliné en 4 axes : accompagner la maîtrise des besoins énergétiques ; favoriser le transfert en concession des colonnes montantes électriques ; accompagner l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques ; développer l’information des locataires sur l’optimisation de la consommation d’électricité. CDC Habitat est la filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec plus de 500 000 logements gérés dont une majorité de logements sociaux. Au total, il loge plus d’un million de personnes sur le territoire métropolitain. Comme il le fait tous les 4 ans depuis 1994, le ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté l’édition 2019 de son « Rapport sur l’environnement en France. » Ce rapport vise à dresser un panorama complet de l’état de l’environnement, de ses évolutions et des réponses apportées. Nouveauté de cette nouvelle édition, elle introduit une grille de lecture inédite dans ce type de rapport : celle des « limites planétaires », au nombre de neuf. « Connaître l’impact de la France vis-à-vis de ces différentes limites, son empreinte, est indispensable pour conduire une transition écologique utile à la planète », explique le ministère. Malheureusement, s’agissant de la France, le constat est implacable : la majorité des neuf limites est dans le rouge. Autre innovation, l’ensemble des sujets et données synthétiques qui constituent la publication est désormais mis à disposition sur un même support. Ce site internet permet de « garantir un accès facile et immédiat à un ensemble de données environnementales fiables, régulièrement actualisées et relevant de différentes échelles géographiques (régional, national et international), afin de devenir une source de référence pour les citoyens et les acteurs de la transition écologique. » La nouvelle édition du rapport fera également l’objet de dossiers thématiques (focus), dont la parution s’échelonnera dans les prochains mois. La géothermie de surface peut désormais se targuer de reposer sur des technologies éprouvées. Encore faut-il que leur mise en œuvre réponde aux contraintes du terrain et aux recommandations des fournisseurs. Dans un guide présenté fin septembre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) s’efforce d’aborder une à une toutes les problématiques techniques qu’il faut résoudre afin de garantir la performance d’une installation : le dimensionnement de la pompe à chaleur (PAC) ou du champ de sondes, la maintenance des ouvrages souterrains, l’optimisation des débits de circulation… S’appuyant sur deux cents retours d’expérience jugés « extrêmement positifs », l’Ademe invite à ne pas exagérer les risques de dysfonctionnements. L’objectif n’étant pas que chacun se renvoie la balle si un imprévu pointe le bout du nez, l’agence rappelle toutefois la nécessité de se poser une vingtaine de questions en amont des projets et définit les responsabilités des uns et des autres dans la durée. Dans le cas d’un pompage sur nappe par exemple, le bureau d’études techniques se doit lors de la phase de conception de dimensionner les équipements selon la hauteur de relevage ou les pertes de charges. Mais il est tout aussi essentiel de vérifier les hypothèses de départ au moment de l’installation. Puis de choisir un exploitant capable de garantir qu’il respectera les recommandations propres à la pompe immergée. De même, c’est durant l’intégralité de la vie de l’installation que la température de l’eau chaude sanitaire doit être garantie en tout point du réseau pour éviter les risques de développement de légionelles. Ou qu’il faut vérifier que la taille des équipements est toujours adaptée à la consommation. Un guide sur les contrats d’objectifs territoriaux et patrimoniaux pour les projets énergies renouvelables thermiques a été publié par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce récent outil de financement proposé par l’Ademe est adapté aux « petits » projets thermiques, « petits dans le sens où ils ne pouvaient passer les fourches des seuils minimaux du Fonds Chaleur, tout en notant toutefois que ces projets avaient besoin de subventions pour émerger », explique la FNCCR. Les contrats sont actuellement portés aussi bien par des communautés de communes, des syndicats d’énergie que des métropoles. Sur 36 pages, le guide présente les spécificités de cet outil de financement, les différents opérateurs qui peuvent les porter et de nombreux retours d’expérience. L’Institut de développement durable et des relations internationales (Iddri) et le think tank Agora Energiewende ont dévoilé le 21 octobre une évaluation et un calculateur en libre accès basés sur trois scénarios de référence d’évolution du mix électrique français pour évaluer le besoin de financement public pour les énergies renouvelables électriques à l’horizon 2040. « La baisse conséquente des coûts de production des technologies éolienne et photovoltaïque favorisera leur développement à moindre coût pour les dépenses publiques », assurent les partenaires. « La différence entre les prix garantis aux producteurs renouvelables et leurs revenus tirés sur le marché serait bien plus faible que par le passé et, dans certains cas, négligeable, poursuivent-ils. Ces mécanismes de soutien pourraient même devenir une source de financement pour l’État, dans certains cas et pour certaines technologies, si les prix de marché passent durablement au-dessus des prix garantis aux producteurs d’énergies renouvelables. » L’Iddri et Agora Energiewende ajoute : « malgré les progrès récents de l’industrie, les mécanismes de soutien fournissent une garantie qui reste utile pour réduire le coût de financement (et donc le coût de production) des énergies renouvelables avec des engagements financiers faibles pour le budget public. Une approche pragmatique passerait donc par une modification progressive de ces mécanismes pouvant passer par une baisse de la durée des contrats garantis ou la limitation du soutien à certains volumes de production pour « passer la main » progressivement aux acteurs privés pour les technologies matures. » Le programme européen Interreg France Angleterre de coopération transfrontalière a annoncé, le 16 octobre, l’approbation du projet hydrolien Tiger (pour Tidal Stream Industry Energiser). « Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons approuvé le plus gros projet Interreg qui soit ! », précise l’entité dans un communiqué. Le coût total du projet s’élève en effet à 46,8 millions d’euros (dont 69 % des fonds nécessaires, soit 28 M€, proviennent du Fonds européen de développement régional (FEDER). 19 partenaires, français et anglais, sont impliqués dans le projet, qui sera mené par Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult depuis Hayle, au Royaume-Uni. « Le projet a pour but de stimuler la croissance dans le domaine des énergies hydroliennes en développant une capacité hydrolienne allant jusqu’à 8 MW sur des sites dans la région de la Manche et tout autour, engendrant par là-même l’innovation et le développement de nouveaux produits et services », précise encore Interreg. L’objectif est également économique puisqu’il s’agit de passer d’un coût de production de 300 €/MWh aujourd’hui à 150 €/MWh en 2025 puis 100 €/MWh en 2030. La Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) publie le 23 octobre un ouvrage de référence sur l’électrification rurale décentralisée (ERD) par énergies renouvelables : « Électrifier l’Afrique rurale, un défi économique, un impératif humain ». Cet ouvrage propose d’établir un diagnostic complet de la situation de l’accès à l’électricité en zone rurale en Afrique subsaharienne, d’en tirer des leçons et de formuler des préconisations pour les années à venir. Concret, précis, fouillé et nourri de nombreux exemples, il est mis à disposition librement afin que toutes les parties prenantes se saisissent de la question de l’accès à l’énergie, se forment, s’informent et agissent. Edité par Observ’ER (éditeur également du Journal des Énergies Renouvelables), cet ouvrage a été financé par l’Ademe, l’Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD) et Synergie Solaire. Le PDF est à télécharger (gratuitement) ici. Le 15 octobre se sont tenues à Lille les États généraux de la chaleur solaire 2019. Le choix des Hauts de France venait saluer les différentes actions de la région en matière de solaire dont notamment la création en 2018 du collectif Coresol (Collectif Régional de l’énergie Solaire). Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour le secteur du solaire thermique de faire le point sur ses progrès ainsi que sur ses obstacles. Du côté des points positifs, les professionnels ont salués les opérations issues des appels d’offres grandes surfaces organisés par l’Ademe qui ont débouché sur de belles réalisations sur réseaux de chaleur ou dans l’industrie, avec souvent des surfaces unitaires de plusieurs milliers de m2. Autres axes importants : la rénovation, où plusieurs exemples d’installations sont venues illustrer la pertinence du solaire thermique comme solution performante que ce soit dans l’habitat, le tertiaire ou pour répondre à des besoins spécifiques dans l’hôtellerie ou le médico-social. Parmi les obstacles à un développement plus large figure encore la trop grande méconnaissance du solaire thermique par les prescripteurs, les bailleurs ou les promoteurs immobiliers. Autre motif d’inquiétude, l’incertitude sur la place du solaire thermique dans la prochaine RE2020 qui régira la construction neuve. Le « Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération » fustige « l’écart considérable entre les objectifs de la loi de transition énergétique et du plan national d’action en faveur des énergies renouvelables, qui tablait sur 33 % de chaleur renouvelable dans la consommation de chaleur en 2020, et la réalité sur le terrain. » Publié le 14 octobre par le CIBE, la Fedene, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Uniclima, avec la participation de l’Ademe, ce document avance en effet une part de la chaleur renouvelable certes en hausse de 1,2 point en un an, mais ressortant à 19,9 % de la consommation finale brute de chaleur en 2018 (18,7 % en 2017). Ce retard est d’autant plus préoccupant que « la chaleur représente en effet 50 % de notre consommation énergétique », rappelle le Panorama. « Afin de combler ce retard, il est essentiel que l’État mobilise l’ensemble des leviers de développement de la production de chaleur renouvelable et de récupération, en particulier le Crédit d’Impôt à la Transition Énergétique et le Fonds Chaleur, qui représentent deux vecteurs essentiels d’accélération. En parallèle, les conditions d’une reprise de la trajectoire de la Contribution Climat Energie, outil stratégique de développement des filières thermiques renouvelables, devront être analysées », préconise le SER dans un communiqué. Une « Plateforme Hydrogène » a été inaugurée le 10 octobre sur le campus de Toulouse INP. Si elle existe depuis 2010 avec le Laboratoire plasma et conversion d’énergie (Laplace), la plateforme en héberge aujourd’hui 3 autres, aux compétences complémentaires : le CIRIMAT (matériaux), le LGC (génie chimique) et l’IMFT (mécanique des fluides), sous tutelle du CNRS, de Toulouse INP et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier. Une large place est faite au développement des technologies utilisant l’hydrogène-énergie : les piles à combustible (vieillissement et multifonctionnalité : capables de fournir de l’électricité, de la chaleur, de l’eau et des gaz inertes) et, plus récemment, les technologies pour maîtriser la combustion de l’hydrogène. Les chercheurs travaillent aussi sur l’allègement des composants, l’approvisionnement et le stockage de l’hydrogène. Avec leurs partenaires industriels, ils étudient également la faisabilité de l’introduction des piles à combustible dans les applications aéronautiques. Le projet PACAERO, qui couvre la période 2015-2020 a apporté 6 M€ à la Plateforme Hydrogène. Ce financement a permis d’augmenter de 400 m² la surface de la plateforme et d’acquérir de nouveaux équipements. Afin de « développer massivement la chaleur décarbonée », « le Fonds chaleur va être porté à 350 millions d’euros l’année prochaine. C’était 250 l’année dernière et 300 cette année », a déclaré, Élisabeth Borne, lors d’un discours prononcée le 7 octobre à Reims. Accompagnée de sa secrétaire d’État, Emmanuelle Wargon, la ministre de la Transition écologique et solidaire a par ailleurs dévoilé les conclusions des travaux du groupe de travail « chaleur et froid renouvelables », soit « 25 décisions concrètes » dont la liste détaillée est à retrouver ici. « Les propositions faites par le groupe de travail et validées par les ministres visent à renforcer l’attractivité des réseaux de chaleur et de froid, leurs bienfaits pour les consommateurs et l’environnement, ainsi que leur compétitivité économique. L’objectif est d’inciter les collectivités territoriales et leurs partenaires à agir dès maintenant pour atteindre les objectifs nationaux à l’horizon 2030, à savoir une multiplication par 5 des quantités de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrées par rapport à 2012 », explique le gouvernement. Dans le cadre du projet porté par Akuo Energy, la turbine de l’hydrolienne de la PME Sabella a été de nouveau immergée avec succès sur son embase le 5 octobre au large de l’île d’Ouessant (Finistère). « Malgré la tempête Lorenzo provoquant une forte houle et n’autorisant qu’une étroite fenêtre météo, les opérations ont été parfaitement menées », s’est félicité le 8 octobre l’entreprise bretonne, précisant que ce prototype de 10 mètres de diamètre (D10) et 1 MW de puissance commencera à injecter de l’électricité sur le réseau de l’île avant la fin du mois. Pour rappel, la machine avait été immergée de juin 2015 à juillet 2016 entre Molène et Ouessant, puis sortie de l’eau pendant deux ans, pour des contrôles et des améliorations. Immergée à nouveau en octobre 2018, elle a dû remettre pied à terre en avril dernier suite à un défaut détecté dans le système de refroidissement de la nacelle qui limitait ses conditions d’utilisation. Sabella prévoit de la retirer en 2021 pour laisser la place aux deux D12, des machines d’un MW également mais de 12 mètres de diamètre. La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a annoncé l’acquisition de la totalité de des projets et actifs de production éoliens et photovoltaïques de VOL-V, ainsi que de sa filiale VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER). Avec cette opération, CNR met la main sur « un portefeuille de près de 1 700 MW dont environ 50 MW construits ou en construction et 130 MW de projets autorisés », explique le premier producteur français d’électricité d’origine 100% renouvelable, sans pour autant préciser le montant de la transaction. Elle lui permet par ailleurs, selon l’aménageur du Rhône, d’étendre ses activités au delà de sa zone d’implantation historique et de récupérer aussi une équipe d’une trentaine de spécialistes. L’entreprise Montpelliéraine Vol-V avait déjà cédé ses activités dans le méthane au groupe Engie en février dernier. Dans un rapport publié le 25 septembre, l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) assure que la consommation totale mondiale d’énergie finale pourrait être assurée à hauteur de 8 % par de l’hydrogène d’ici 2050. Pour autant, l’hydrogène devrait jouer « un rôle modeste dans la prochaine décennie […] mais apporter une contribution substantielle à l’horizon 2050 », grâce aux futures réductions de coûts attendues pour la production par électrolyse et aux progrès d’efficacité des électrolyseurs. Car, rappelle l’Irena, le potentiel du vecteur hydrogène pour décarboner certains usages (dont l’industrie ou l’aviation) dépend au préalable de la manière dont il est produit. L’Agence évoque ainsi les conditions de développement de la production d’hydrogène « vert » (produit par électrolyse en utilisant de l’électricité d’origine renouvelable) mais aussi « bleu » (produit à partir de combustibles fossiles mais en y associant un dispositif de capture et de stockage du CO2). L’Irena fait état de « synergies importantes » existant entre la production électrique intermittente d’unités de productions renouvelables et l’hydrogène. Ce vecteur « semble sur le point de devenir la solution la moins coûteuse pour stocker de grandes quantités d’électricité durant des jours, des semaines ou même des mois » et pourrait dans ces conditions contribuer à améliorer la flexibilité des réseaux électriques (en utilisant les surplus de production d’installations renouvelables). Cependant, les coûts de production élevés et les besoins d’infrastructures associés font partie des nombreux défis auxquels reste confrontée la filière de l’hydrogène « vert » pour participer à la transition énergétique mondiale. Avec une production de 27,1 TWh, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables au deuxième trimestre a couvert 25,5 % de la consommation d’électricité en France, selon le panorama de l’électricité renouvelable publié le 26 septembre par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis, l’Association des distributeurs d’électricité en France (ADEeF) et l’Agence ORE. La production éolienne (+ 29 %) et photovoltaïque (+ 7,1 % par rapport à la même période en 2018) expliquent ces bons chiffres. Tandis que le production hydraulique a été bien moins dynamique qu’au deuxième trimestre 2018 (- 29,5 %). Sur les douze derniers mois, l’électricité renouvelable a permis de couvrir 21% de la consommation en France métropolitaine. McPhy a décidé de mettre en place une gouvernance dissociée. Dans ce cadre, Laurent Carme a été nommé directeur général du spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène. Il succède à Pascal Mauberger, qui dirigeait l’entreprise en qualité de président du directoire puis de président directeur général depuis 11 ans et qui conserve ses fonctions de président du Conseil d’administration. Le mandat de Laurent Carme prendra effet le 4 novembre prochain. En 2019, les installations de nouvelles capacités renouvelables dans le monde « devraient rebondir avec une croissance à deux chiffres » par rapport à 2018, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le 20 septembre. Cette augmentation est le résultat d’une hausse attendue des capacités solaires photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques de 113,7 GW, 57,6 GW et 17,8 GW, respectivement, au niveau mondial pour 2019. Globalement, les installations de capacités renouvelables pourraient ainsi croître de « presque 200 GW » en 2019, soit environ 12 % de plus qu’en 2018. Ce qui est bien, mais pas suffisant. En effet, si les filières renouvelables productrices d’électricité constituent « le socle des efforts mondiaux pour réduire le réchauffement, la pollution de l’air et fournir de l’énergie à tous », selon le directeur exécutif de l’AIE Fatih Birol, selon le scénario Développement durable de l’AIE, les capacités renouvelables devraient être augmentées « de plus de 300 GW par an en moyenne entre 2018 et 2030 » pour suivre une trajectoire compatible avec les objectifs de l’accord de Paris Google a annoncé avoir signé 18 nouveaux accords énergétiques dans l’éolien et le solaire, pour des capacités cumulées de 1 600 MW, afin de continuer à compenser entièrement sa consommation d’électricité annuelle avec des énergies renouvelables. Il s’agit du « plus gros investissement de notre histoire dans ce domaine », explique Sundar Pichai, le patron du géant américain, dans un communiqué du 19 septembre. Et d’ajouter, qu’« une fois que l’ensemble de ces projets sera réalisé, notre portefeuille en énergies sans carbone produira autant d’électricité qu’une ville comme Washington D.C. ou des pays comme l’Uruguay ou la Lituanie. » Les États-Unis, le Chili et l’Europe sont concernés par ces nouveaux investissements. « Le coût en baisse du solaire (plus de 80 % sur la dernière décennie) a rendu le soleil de plus en plus rentable. En outre, notre accord au Chili porte pour la première fois sur une technologie hybride mêlant solaire et éolien. Parce que le vent souffle souvent à d’autres moments que ceux où le soleil brille, combiner les deux nous permettra d’alimenter notre data center chilien avec de l’électricité verte pendant une plus grande partie de la journée », peut-on lire également dans le communiqué. L’ensemble de ces nouveaux accords permet à Google d’augmenter son portefeuille en énergies éolienne et solaire de plus de 40 % pour atteindre 5 500 MW. Powidian a annoncé avoir inauguré sa première plateforme européenne à hydrogène à La Ville aux Dames (37). « Véritable outil industriel permettant de passer rapidement du projet à la réalisation, cette plateforme de 1 800 m2 est le fruit d’une technologie qui permet de convertir, par l’électrolyse, de l’énergie de source renouvelable en hydrogène et ainsi pallier l’intermittence», explique la société française dans un communiqué du 20 septembre. Équipée d’une centrale photovoltaïque de 70 kW, la plateforme est modulaire et reconfigurable. « Tous types d’équipements peuvent y être installés : hydrogène (piles, électrolyseurs stockage H2 sous pression), convertisseurs électriques de puissance, shelters batteries. » Elle permettra notamment de tester de nouvelles technologies, qualifier les équipements et fournisseurs ou d’effectuer des contrôles qualité. RTE a publié le 17 septembre l’exercice 2019 du Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR). Le gestionnaire du réseau de transport électrique national présente ainsi son plan décennal d’évolution du réseau électrique français, à l’horizon 2035, qu’il soumet au gouvernement ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et à l’Autorité environnementale. Le plan identifie plusieurs chantiers (rénovation du réseau, numérisation, capacités d’échange avec les pays voisins, déploiement d’un réseau électrique en mer pour raccorder les futurs parcs éoliens offshore, etc.) pour des « investissements associés […] estimés à 33 milliards d’euros sur 15 ans, soit environ 2 milliards d’euros par an » contre 1,3 milliard d’euros aujourd’hui. Sur les 33 milliards identifiés, 13 milliards concernent l’adaptation du réseau, 8 milliards le renouvellement des ouvrages les plus anciens, 7 milliards le raccordement des énergies marines, 3 milliards le numérique et 2 milliards pour les interconnexions transfrontalières (part France). France énergie éolienne (FEE) n’a pas tardé à réagir, saluant les conclusions d’un document dont les résultats montrent que l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau « est loin d’être aussi coûteuse que certains intérêts voudraient le faire croire et, ne nécessite pas de soi-disants ’’back-ups’’ thermiques. La filière éolienne accueille avec satisfaction ce rapport qui prouve une fois de plus la pertinence de l’éolien pour l’avenir énergétique de la France. » A l’occasion du SPACE, le salon international des productions animales, qui s’est tenu à Rennes du 10 au 13 septembre, l’État, la Région Bretagne, l’Ademe, GRDF, GRTgaz et le Pôle énergie Bretagne ont signé le Pacte biogazier breton. Ce pacte a pour objectif de définir une stratégie collective sur la place du gaz, et principalement du gaz renouvelable, dans la production d’énergie en Bretagne. Les engagemenets mis en avant sont : augmenter la production de gaz renouvelable à partir de ressources maîtrisées, optimiser les valorisations du biogaz breton et structurer l’animation locale de la filière. Cette annonce suit de près celle, le 6 septembre, de la création de l’association des agriculteurs méthaniseurs de Bretagne. Son objectif est de développer la méthanisation dans le secteur agricole breton en favorisant les échanges entre méthaniseurs et porteurs de projets afin de mettre en place des pratiques exemplaires (parcours tutoré de formation des futurs exploitants d’installations de méthanisation, achats groupés afin de répondre aux besoins des agriculteurs méthaniseurs, etc.). Le Premier ministre a annoncé le 13 septembre les 24 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets Territoires d’innovation, une action du Grand Plan d’Investissement, adossée à la troisième vague du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Les territoires retenus (les projets sont co-construits avec les acteurs locaux, collectivités territoriales et partenaires engagés dans le développement économique des territoires) seront financièrement soutenus à hauteur de 450 M€ sur 10 ans, soit un financement réparti entre deux enveloppes distinctes : une enveloppe en subventions pouvant aller jusqu’à 150 M€ et une enveloppe dédiée à l’investissement pouvant aller jusqu’à 300 M€ de fonds propres mobilisables dans une logique d’investissement avisé. Transition numérique, énergie durable, mobilité propre, transformation du secteur agricole (notamment l’agroécologie), transformation du système de santé et adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail, tels étaient les thématiques retenues. Au total, plus de la moitié des projets ont une dimension énergétique et écologique. L’instruction des dossiers de candidatures a associé la Banque des Territoires, les ministères concernés et les services déconcentrés de l’État, ainsi qu’un comité d’auditions composé d’une douzaine d’experts thématiques. France Biométhane « tire le signal d’alarme sur les risques que comporte la loi Climat pour le développement de la filière biométhane en France », annonce Le think tank dans un communiqué du 10 septembre. Il espère ainsi un délai dans la mise en place du nouveau mécanisme d’attribution des garanties d’origine (GO) prévu par la loi Climat Énergie 2019. Car la nouvelle loi « remet en cause [le] système [actuel] : l’État serait désormais le propriétaire des garanties d’origine qu’il céderait aux enchères aux fournisseurs de gaz. Pour accompagner ce changement sans compromettre le développement du secteur, France Biométhane demande que les dispositions précises du nouveau mécanisme soient élaborées en concertation avec la filière. » Et France Biométhane a d’autres motifs d’inquiétude, le think tank « redoute également une remise en cause brutale des mécanismes de soutien à la filière dans la lignée de l’annonce de l’objectif de rachat du biométhane à 67 €/MWh en 2023 dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). » Selon ses calculs, cet objectif aurait pour conséquence directe un arrêt massif d’au moins 500 projets. Chaque projet représentant 3 à 10 millions d’investissement et la création de 10 emplois pérennes dans les territoires ruraux, l’arrêt de 500 projets entraînerait une perte de 3 milliards d’euros d’investissements et de plus de 3 000 emplois dans la filière, détaille le think tank. Premier propriétaire foncier de l’État avec 274 000 hectares (en métropole et en Outre-mer), le ministère des Armées s’est engagé à mettre à disposition d’ici à fin 2022 quelque 2 000 hectares de terrains pour des projets photovoltaïques dans le cadre du plan interministériel « Place au soleil ». Au-delà de la question du foncier, le ministère des Armées doit « prendre en compte la problématique des nouvelles énergies », a expliqué la ministre des Armées, Florence Parly, lors d’un discours prononcé au 2e régiment étranger de génie à Saint-Christol (Vaucluse), où 5,5 hectares seront loués à un opérateur pour implanter des panneaux solaires. La ministre a poursuivi en évoquant « des solutions de carburant alternatif » ou « l’hybridation électrique de certains matériels terrestres ». Une « Task Force Énergie » sera ainsi constituée au sein du ministère dans les jours à venir, a-t-elle assuré. « C’est parce que nous avons l’empreinte environnementale la plus importante de l’État que nous avons l’impérieux devoir d’être un acteur volontaire et engagé de la transition énergétique, a poursuivi la ministre. Car tout, absolument tout est lié. Et lorsque la planète se sera essoufflée, ce sont les Armées qui seront en première ligne. » Entre 2010 et 2019, 2 600 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables pour un quadruplement de leur capacité, explique un rapport publié le 5 septembre et produit par l’École de finance et de management de Francfort et Bloomberg New Energy Finance (BNEF) avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Les capacités installées de centrales fonctionnant à partir d’énergie renouvelable, exception faite de l’hydroélectricité à grande échelle, sont ainsi passées de 414 GW au début de la décennie à 1 650 GW et ont généré 12,9 % de la production électrique mondiale en 2018. « Investir dans les énergies renouvelables, c’est investir dans un avenir durable et rentable, comme l’a démontré l’incroyable croissance des énergies renouvelables au cours des dix dernières années. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Les émissions mondiales du secteur de l’énergie ont augmenté d’environ 10 % au cours de cette période. Il est clair que nous devons accélérer rapidement la transition mondiale vers les énergies renouvelables si nous voulons atteindre les objectifs internationaux en matière de climat et de développement », explique Inger Andersen, la directrice exécutive du programme des Nations unies pour l’environnement. Si en 2018, la part des énergies renouvelables a progressé de 0,4 point, pour atteindre 16,5 % de la consommation finale brute d’énergie en France, le développement de la majorité des filières reste éloigné de ce que prévoyait en 2010 le Plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (PNA EnR), explique le Commissariat général au développement durable (CGDD) dans son suivi annuel de la directive européenne 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables en France (métropole et Outre-Mer). Pour rappel, l’objectif de la France est fixé à 23 % pour l’année 2020, avec une part d’au moins 10 % à atteindre pour le seul secteur des transports. Depuis 2005, la place des énergies renouvelables s’est accrue dans l’électricité (+7,3 points), les transports (+7,2 points) et dans le chauffage (+9,3 points). « La consommation finale brute d’énergies renouvelables atteint 25,7 Mtep en 2018, contre 15,4 Mtep en 2005, soit une évolution de 67 %. Les filières renouvelables qui contribuent le plus à ce développement sont l’éolien, la filière biomasse solide et déchets renouvelables, le biodiesel et les pompes à chaleur, qui représentent plus de 86 % de la hausse », explique le document publié le 3 septembre, qui souligne par ailleurs que « les plus gros écarts aux cibles 2020 concernent la filière biomasse solide (incluant les déchets urbains renouvelables) et l’éolien offshore. » Le consortium IHES piloté par Geps Techno a déployé fin août sa première plateforme houlomotrice (tirant son énergie de la houle en convertissant les mouvements du flotteur en énergie électrique) de moyenne puissance au large du Croisic. L’équipement, construit à Saint-Nazaire, va être testé dix-huit mois sur le site du SEM-REV (une zone d’essais de Centrale Nantes dédiée aux énergies marines renouvelables). Outre son système houlomoteur, le prototype Wavegem (qui mesure 21 m de long, 14 m de large et 7 m de haut) est équipé de 68 m2 de panneaux photovoltaïques. L’installation dispose ainsi d’une puissance totale de 150 kW (80 % houlomoteur, 20 % solaire). Dénommée Wavegem, il s’agit d’« une plateforme autonome hybride de production d’énergie destinée à alimenter des installations maritimes ou insulaires n’ayant pas accès au réseau électrique et souhaitant assurer leur production électrique dans le respect des enjeux environnementaux actuels », explique Geps Techno , qui entend livrer ses premières plateformes dès 2021, dans un communiqué. Les 18 mois prévus d’essais en mer permettront de valider performance et fiabilité de l’installation, mais servira également de « maison-témoin » pour permettre aux futurs clients « de mieux appréhender les caractéristiques de la plateforme et sa capacité à répondre à leurs besoins en termes de production d’énergie mais aussi d’hébergement d’applications autonomes ». EDF Renouvelables a annoncé le 3 septembre l’acquisition de PowerFlex Systems, spécialisée dans le domaine des technologies de recharge. Cette société basée en Californie a développé une technologie brevetée, ce qui lui a permis de déployer des dispositifs de recharge de véhicules électriques évolués « permettant d’optimiser la fourniture d’électricité aux véhicules et de limiter, voire de supprimer, des investissements d’adaptation aux réseaux électriques », explique EDF Renouvelables dans un communiqué. Avec la technologie développée par PowerFlex Systems, « nous sommes à présent en mesure de fournir aux bâtiments commerciaux et industriels un écosystème énergétique unique ; celui-ci permet de fournir une électricité fiable, compétitive et sans émission de carbone, où et quand nos clients en ont besoin », explique Raphaël Declerq, vice-président exécutif solutions décentralisées et stratégie chez EDF Renouvelables aux États-Unis. APPEL A PROPOSITIONS POUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES RACCORDÉES AU RÉSEAU SUR L’AÉRODROME RÉGIONAL DE BERRE LA FARE
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a publié le 9 juillet un rapport intitulé « le verdissement du gaz », qui étudie le rôle de trois filières du biogaz (méthanisation, pyrogazéification et power-to-gas) dans le système énergétique du pays. Pour la CRE, « il existe […] un consensus sur la nécessité de verdir le gaz » ; lequel est actuellement responsable d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre en France, et dont la consommation pourrait augmenter, à travers son utilisation dans les transports, le logement et la production de chaleur. Le rapport souligne que la méthanisation est « la technologie la plus prometteuse, [et] connaît un développement rapide », malgré un coût de production important (entre 90 et 120 €/MWh) comparé au gaz naturel importé. Ce développement rend réaliste l’objectif de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz d’ici 2030, qui nécessiterait une production de biométhane de 39 à 42 TWh. Le rapport souligne que la filière méthanisation doit pour cela développer un modèle économique rentable, ce qui peut passer par la prise en compte de ses externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement de l’économie circulaire, soutien au monde agricole, dépendance moindre aux imports de gaz naturel, etc.). La pyrogazéification et le power-to-gas sont quant à elles moins matures, estime la CRE, elles auront un rôle encore minime pour atteindre l’objectif de 2030, mais pourraient se développer à l’avenir. HydroQuest, Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ont annoncé, dans un communiqué le 8 juillet, leur décision d’interrompre le projet pilote d’hydrolien fluvial à Génissiat. Ce projet devait accueillir, dès 2020, 30 hydroliennes de HydroQuest pour une puissance totale de 2 MW. Le communiqué évoque des contraintes sur le site d’implantation (entre les aménagements CNR de Génissiat et de Seyssel sur le Rhône), « non résolues au terme de deux années d’études techniques poussées et de tests de modélisation hydraulique fine du parc d’hydroliennes ». Le projet avait été annoncé en février 2017, et avait connu des retards afin de conclure les études techniques. Cependant, les trois entreprises se veulent rassurantes et affirment que « cette décision ne remet en aucun cas en cause la technologie des hydroliennes fluviales. » Ce, alors que la filière peine à se remettre du retrait de Naval Énergies (cf. article pp 26-27 du Journal des Énergies Renouvelables n° 247). Inefficace, coûteux, dangereux pour la santé et pour la faune, polluant, bruyant… C’est peu dire que l’éolien a parfois mauvaise presse, peu aidé, parfois par certains relais d’opinion, de bonne foi ou non. Conséquence, la filière est vue par certains citoyens comme une source de nuisances multiples, voire une arnaque pure et simple. C’est en partie pour répondre à ces nombreux fantasmes et rétablir quelques vérités que Le Journal de l’Éolien a choisi de consacrer ce nouveau hors-série aux rumeurs colportées sur l’éolien. Reportages, enquêtes et analyses apporteront les clés pour répondre aux questions, légitimes, que pose le développement de l’éolien sur terre et en mer, mais aussi pour couper court aux fausses polémiques et autres contrevérités. Le magazine répond ainsi point par point aux interrogations que suscitent les turbines : impact écologique des fondations en béton, conséquences sur la santé et sur la faune, incidence sur la valeur mobilière, coûts et bénéfices économiques pour la société, recyclabilité des matériaux… Sans oublier de se pencher sur les nombreux sujets sur lesquels la filière travaille activement, dont l’amélioration de l’intégration paysagère et de l’acceptabilité en général. Vous pouvez consulter le sommaire ici, ou encore acheter le numéro en ligne. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les dernières nouvelles des énergies renouvelables revient dès le 4 septembre. Toute l’équipe de l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) et du Journal des Énergies Renouvelables vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un très bel été ! Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, l’avait annoncé fin mai, c’est désormais chose faite : la bioraffinerie de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône, produit ses premiers litres de biocarburants, a annoncé la compagnie dans un communiqué du 3 juillet. La bioraffinerie, issue de la reconversion d’une ancienne raffinerie, produira 500 000 tonnes d’huiles végétales hydrogénées (HVO) par an, un biocarburant de deuxième génération qui sera produit à 60-70 % à partir d’huiles végétales (palme, colza, tournesol, etc.) et à 30-40 % à partir de retraitement de déchets (graisses animales, huiles de cuisson, huiles résiduelles, etc.). L’utilisation d’huile de palme a suscité une polémique, c’est pourquoi Total s’est engagé à en utiliser au maximum 300 000 tonnes par an, « soit moins de 50 % du volume des matières premières nécessaires », ainsi qu’à utiliser au minimum 50 000 tonnes de colza français par an pour valoriser l’agriculture locale. Des chiffres qui ne convainquent pas tout le monde. Greenpeace, par exemple, n’a pas manqué de critiquer « l’hypocrisie de la France » dans un communiqué du 3 juillet. En cause, les « 550 000 tonnes d’huile de palme par an que le gouvernement a autorisé Total à utiliser dans son usine, ce qui correspondrait à une hausse de 64 % du total de l’huile de palme consommée en France », selon l’ONG. « Les biocarburants sont une énergie renouvelable à part entière et une solution immédiatement disponible pour réduire les émissions de CO2 du transport routier et aérien. Lorsqu’ils sont produits à partir de matières premières durables, comme c’est le cas à La Mède, ils émettent plus de 50 % de CO2 en moins que les carburants fossiles. Notre bioraffinerie permettra de produire en France des biocarburants qui étaient jusqu’alors importés », explique de son côté Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-chimie de Total. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé, dans un communiqué du 26 juin, les 13 lauréats de la deuxième tranche de l’appel d’offres sur la petite hydroélectricité. Ces 13 projets, concentrés majoritairement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, totaliseront 36,7 MW, avec un prix moyen de 87,1 €/MWh. Cette tranche atteint donc l’objectif de raccorder 35 MW par an de petite hydroélectricité, inscrit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). En outre, 5 des 13 lauréats ont choisi d’avoir recours à l’investissement ou au financement participatif, et recevront une majoration de leur tarif de rachat d’électricité si ce choix est respecté. 14 lauréats avaient été annoncés pour la première tranche de l’appel d’offres l’an dernier, pour un total à 36,9 MW et un prix moyen de 89,6 €/MWh. La troisième tranche de l’appel d’offres sera lancée en décembre 2019. Dans un communiqué du 26 juin, le Centre de recherche pour l’énergie solaire et l’hydrogène de Baden-Württemberg (ZSW) et l’Association fédérale allemande de l’énergie et de la maîtrise de l’eau (BDEW) ont annoncé que, sur la première moitié de 2019, 44 % de l’électricité consommée en Allemagne avait été produite à partir de sources renouvelables. C’est un nouveau record pour le pays, pour qui, sur la même période en 2018, ce chiffre n’était que de 39 %. Plusieurs sources d’énergie ont permis d’atteindre un tel niveau, l’éolien sur terre arrivant en tête de liste, suivi par le solaire photovoltaïque. L’éolien en mer connaît quant à lui une croissance importante de 30 % sur la période (première moitié de 2018 – première moitié de 2019). Cependant, selon le ZSW et le BDEW, il y a matière à s’inquiéter. En effet, ces chiffres peuvent être expliqués par des « conditions météorologiques exceptionnelles ». De plus, « il existe des problèmes structurels sous-jacents. Si nous persistons sur cette voie, nous finirons avec seulement 54 % d’énergies renouvelables en 2030 », signale Stefan Kapferer, président du comité de direction générale du BDEW. Pour rappel, l’objectif de l’Allemagne est d’atteindre 65 % d’énergie renouvelable dans la consommation d’électricité d’ici 2030. L’autoconsommation photovoltaïque est un marché en pleine évolution en France, particuliers et professionnels ont aujourd’hui la possibilité d’autoconsommer l’électricité produite par leur installation, mais doivent pour cela comprendre leurs besoins spécifiques, et naviguer parmi les multiples options et modalités existantes, tout en respectant une réglementation changeante. Partant de ce constat, Observ’ER a réalisé un numéro spécial du Journal du Photovoltaïque consacré au sujet, qui propose à ses lecteurs des clés de compréhension pour aborder la pléthore de modèles économiques (et de financement) à disposition et ceux en cours d’ajustement ou d’élaboration : autoconsommation totale ou partielle, avec stockage (batteries, virtuel) ou non, installation à installer soi-même… Particuliers, collectivités et entreprises témoignent. Sans oublier l’autoconsommation collective qui, si elle peine encore à décoller, connaît ses premières réalisations concrètes. Ce hors-série propose illustrations et infographies pédagogiques, reportages et analyses des tendances à venir sur le marché de l’autoconsommation photovoltaïque, et se penche également sur la situation de la filière chez nos voisins européens. Vous pouvez consulter le sommaire ici, ou encore acheter le numéro en ligne. La Commission européenne a publié le 18 juin son évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) des États membres. Ces PNEC, dont l’élaboration a commencé en décembre dernier dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, listent les objectifs nationaux de chaque pays à l’horizon 2030. « Nos recommandations montrent que des efforts supplémentaires sont nécessaires », indique Maroš Šefčovič, vice-président pour l’union de l’énergie, dans un communiqué. Les plans ont une marge d’amélioration, et les mesures qu’ils contiennent sont insuffisantes, notamment concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Dans le document, la Commission indique ainsi que « dans les projets de plans actuels, la part des énergies renouvelables atteinte serait comprise en 30,4 % et 31,9 % en 2030 au niveau de l’Union, au lieu des 32 % prévus ». Certains pays, dont la France, sont déjà en retard sur leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable pour l’horizon 2020, comme l’a montré un rapport de la Cour des comptes européenne publié au début du mois. Les États membres doivent modifier leur PNEC afin de pouvoir atteindre les ambitions déclarées à l’échelle de l’Union. Toute la question est de savoir quels sont les états qui vont faire un effort supplémentaire étant donné que l’objectif à atteindre est collectif et non individualisé par État membre, comme dans le cadre de la directive 2009/28. Les PNEC définitifs doivent être soumis en décembre 2019 au plus tard. Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, présenté par François de Rugy, est en débat à l’Assemblée nationale depuis le 25 juin. En termes d’énergie, le projet de loi prévoit « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 », de « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 » par rapport à 2012, l’objectif actuel de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) étant de 30 %, et enfin de « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 », l’objectif actuel (LTECV) étant à l’horizon 2025. De bonnes nouvelles en théorie pour les énergies renouvelables, qui pourront notamment profiter de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le report de la sortie progressive du nucléaire pourrait ralentir leur déploiement, et le projet de loi ne contient pour l’instant pas de mesures concrètes afin d’atteindre ces objectifs. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC), dans son premier rapport paru le 25 juin, alerte sur le retard d’ores et déjà pris dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Afin de réduire la consommation d’énergie, un amendement a également été adopté sur les « passoires thermiques », les logements dont le diagnostic de performance énergétique est de F ou G : lors d’une vente, jusqu’à 5 % du prix pourra être bloqué afin d’effectuer des rénovations énergétiques. « En 2012, la mise en route du doublet géothermique de Lognes a permis de faire baisser la facture des usagers d’environ 30 % », retrace Xavier Vanderbise, conseiller communautaire en charge de l’aménagement, de l’urbanisme et des réseaux de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne. « Les élus ont donc souhaité que cette énergie soit plus utilisée sur le territoire. » Et ce sera bientôt chose faite : un contrat de délégation de service public a été signé mi-avril entre la communauté d’agglomération et la filiale locale d’Engie Réseaux GeoMarne pour la création d’une centrale géothermique et d’un réseau de chaleur sur les communes de Champs-sur-Marne et de Noisiel. Le doublet géothermique puisera de l’eau à environ 71 °C à 1 900 mètres de profondeur pour fournir 97 GWh/an de chaleur le long de 19 km de réseau, soit auprès de 10 000 équivalents logements. « Nous alimenterons ainsi des bâtiments publics, des copropriétés, de l’habitat social et des bâtiments neufs qui seront construits à court et moyen termes », précise Grégoire Wintrebert, directeur de la direction des confluences chez Engie Réseaux. « Cela représente un investissement de 39 M€, mais le résultat est vertueux : le réseau disposera d’un taux de couverture par les énergies renouvelables de 82 %. » Engie Réseaux devrait lancer les travaux de forage en décembre prochain. La construction de la centrale (qui comprendra 6 MW de pompes à chaleur pour l’optimisation du doublet géothermique et une chaufferie centrale au gaz) se déroulera en 2020 et 2021 pour une mise en service prévue au dernier trimestre 2021. La filière des énergies renouvelables représenterait 11 millions d’emplois à travers le monde en 2018, selon le dernier compte rendu de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (Irena), publié le 13 juin. Un chiffre en hausse par rapport à l’année 2017 (10,3 millions), qui pourrait cependant être expliqué en partie par un affinage des méthodologies utilisées par l’agence. Les 11 millions d’emplois recensés restent majoritairement concentrés dans plusieurs régions du monde, notamment la Chine (39 % de tous les emplois de la filière), l’Inde, le Brésil, les États-Unis et l’Union européenne (UE). La part d’emplois diffère aussi selon les sources d’énergies. Ainsi, la Chine représente 61 % des emplois du photovoltaïque, qui est la première source d’énergie renouvelable en terme de nombres d’emplois, tandis que le secteur des biocarburants, deuxième plus gros employeur, est dominé par le Brésil (40 %) et les États-Unis. L’UE accumule un total de 1,2 millions d’emplois, dont 387 000 dans la biomasse solide et 314 000 dans l’éolien. L’Allemagne demeure l’acteur le plus important de l’UE, suivi par le Royaume-Uni et la France. Le compte rendu souligne que seuls 32 % des emplois dans les énergies renouvelables sont tenus par des femmes, et que les chaînes de production ont tendance à être plus mécanisés aux États-Unis et dans l’UE qu’en Asie et en Amérique du sud. Le ministère des Communications, de l’action pour le climat et de l’environnement irlandais (DCCAE) a révélé le 17 juin un plan d’action pour le climat, avec des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Selon le DCCAE, le mix énergétique de l’Irlande est composé à 85 % d’énergies fossiles, et seulement 30 % de l’électricité produite provient de sources renouvelables. Le pays est en retard sur ses objectifs 2020, et le rapport de la Cour des comptes européenne publié le 6 juin montre qu’il doit augmenter de 5,3 points de pourcentage la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie entre 2017 et 2020 pour atteindre son objectif de 16 %. Le nouveau plan climat a pour but affiché de pallier ce retard, et liste ainsi des objectifs importants dans plusieurs secteurs concernés. Dans le secteur de l’électricité, l’objectif est d’arriver à 70 % d’énergie renouvelable dans la production d’ici 2030 (soit l’ajout de 12 GW, dont une majorité d’éolien terrestre, en prenant en compte les fermetures de centrales fossiles), d’électrifier le transport en ajoutant 950 000 véhicules électriques sur les routes (et ainsi atteindre la barre du million de véhicules électriques) et en créant une infrastructure nationale de bornes de rechargement, et enfin de développer l’autoconsommation et permettre aux particuliers de revendre leur électricité sur le réseau. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a publié son rapport annuel New Energy Outlook, qui trace l’évolution des énergies renouvelables dans la production d’électricité à l’horizon 2050. Les énergies éolienne et photovoltaïque représenteraient 48 % de la production d’électricité mondiale d’ici 2050 selon ces estimations. L’Europe mène la danse avec 80 % de son électricité produite grâce à ces deux sources d’énergies en 2050, tandis que la Chine (48 %) et les États-Unis (35 %) décarbonisent leurs secteurs électriques moins vite en raison de leur dépendance respective au charbon et au gaz. Cela permet au secteur de l’électricité d’être en marche pour ne pas dépasser la barre des 2 °C d’ici 2030, mais le rapport souligne que d’autres technologies doivent être déployées pour poursuivre cette trajectoire au delà de cette date. Le rapport assume également une électrification à 100 % du transport routier et du chauffage résidentiel, qui pourraient donc être responsables d’une importante augmentation de la demande en électricité. Enfin, il signale que d’autres pans de l’économie globale (au-delà de l’électricité) doivent être décarbonisés afin de répondre efficacement au réchauffement climatique. Le producteur d’électricité renouvelable Akuo Energy et l’assureur français MAIF ont révélé dans un communiqué du 5 juin la création de MAIF Transition, un fonds dédié au financement de projets innovants dans le secteur agricole dans chacun des départements français, outre-mer inclus. Ce fonds vise à favoriser l’innovation en permettant aux agriculteurs de valoriser leur foncier à travers la production d’électricité photovoltaïque, et ainsi financer leur transition vers une agriculture biologique et durable. Akuo Energy est un acteur pionnier dans ce domaine grâce à son concept Agrinergie®, qui associe agriculture biologique et autoconsommation d’électricité photovoltaïque. Pour son président Eric Scotto, ce partenariat avec MAIF permet au concept de passer à l’échelle supérieure. François de Rugy, ministre de la Transition énergétique et solidaire, présent lors de la signature du partenariat, a salué le lancement de cette initiative et a déclaré : « Transformation de notre modèle agricole et transition énergétique peuvent marcher main dans la main, et nous avons là un exemple parfait. » L’Observatoire des énergies de la mer a publié son rapport annuel sur les énergies marines renouvelables (EMR) en France. Et le bilan pour 2018 est plutôt mitigé. Bien que les investissements et le chiffre d’affaires de la filière ont augmenté de 2016 à 2018, le nombre d’emplois ETP (équivalent temps plein) en 2018 repasse à son niveau de 2016 et diminue de 21 % par rapport à 2017. Cela s’explique par la perte d’emplois industriels provoqué par le décalage du calendrier de concrétisation des projets dans le pays. Le marché domestique pénalise la filière française, qui effectue 86 % de son chiffre d’affaires à l’export. Le rapport souligne que l’éolien en mer posé et flottant sont les marchés les plus matures parmi les EMR, le posé étant au stade commercial et l’éolien en mer flottant au stade pré-commercial. Ils représentent plus de 85 % des emplois de la filière. En termes géographiques, la région Pays de la Loire reste le leader dans ce domaine, et possède plusieurs projets de parcs éoliens en cours de développement, dont celui de Saint-Nazaire qui vient de recevoir le feu vert de la part du Conseil d’État. La Cour des comptes européenne a publié un rapport qui analyse les politiques et régimes de soutien des énergies renouvelables afin d’évaluer si chaque État membre atteindra ses objectifs de 2020, et si l’Union Européenne atteindra son objectif global de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale. Ce rapport conclut que l’augmentation de la part des sources d’énergie renouvelables « n’est pas suffisante pour permettre d’atteindre les objectifs ». Seuls 11 États membres avaient atteint leurs objectifs de 2020 en 2017, tandis que plusieurs autres sont à la traîne : la France entre autres doit augmenter de 6,7 points de pourcentage la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique de 2017 à 2020 pour atteindre son objectif de 23 %. Afin de pallier ces retards, le rapport émet plusieurs recommandations, notamment une simplification des procédures administratives à l’échelle des États, l’amélioration du suivi et du délai de disponibilité des données statistiques relatives au secteur de l’énergie et l’organisation d’enchères supplémentaires pour augmenter la capacité de production solaire et éolienne dans le secteur de l’électricité. La Commission européenne aura la possibilité d’engager une action en justice contre les États membres n’ayant pas respecté leurs objectifs nationaux. Microsoft a annoncé la signature d’un PPA (contrat d’achat direct entre producteur d’électricité et consommateur) de 90 MW sur 15 ans à partir de 2022 avec le fournisseur Eneco aux Pays-Bas, électricité qui proviendra des parcs éoliens offshore Borssele III et IV. Ce PPA fait suite à la signature d’un autre PPA de 180 MW d’électricité éolienne entre Microsoft et Vattenfall aux Pays-Bas en 2017. Microsoft devient ainsi l’un des plus gros acheteurs d’énergie renouvelable dans le pays. Facebook a également annoncé le 30 mai avoir finalisé un accord afin de financer un projet d’électricité solaire de 379 MW au Texas, le projet Prospero développé par Longroad Energy Partners. C’est la première fois que l’entreprise effectue un investissement direct dans le solaire ou l’éolien. Facebook possède également plusieurs PPA aux États-Unis pour l’achat d’électricité renouvelable, afin d’atteindre son objectif d’être fourni à 100% en électricité renouvelable d’ici à 2020. Selon la compagnie, son investissement direct dans le projet texan pourrait montrer le chemin vers un nouveau modèle de financement des énergies renouvelables pour les grandes entreprises, au-delà des PPA habituels. La Conférence régionale méthanisation qui s’est déroulée à Lyon le 29 mai a permis la signature d’une charte partenariale pour développer la méthanisation dans la région. Signée par les organisateurs de la conférence (la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ademe, la Chambre régionale d’agriculture, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, GRDF, GRTgaz, Bpifrance et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement), cette charte annonce un plan d’action en 6 axes (dont « renforcer la mobilisation des intrants et la qualité du retour au sol des digestats »et « développer l’offre technique régionale tout au long de la chaîne de valeur »). Elle souligne également l’importance de la méthanisation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de développer une économie locale et circulaire, et de créer des opportunités pour le secteur agricole. Cette charte définit entre autre des objectifs à l’horizon 2023 en accord avec les échéances de la PPE : doublement du nombre d’unités en service de fin 2018 à 2023, connexion de 1075 GW dans le réseau de gaz (120 GW en 2018), et 480 GWh valorisés par cogénération fin 2023 (300 GWh fin 2018). Comme le montre un article du Financial Times, le fournisseur d’électricité australien Snowy Hydro, qui possède notamment plusieurs barrages et centrales hydrauliques dans les Snowy Mountains, mise sur le pompage-turbinage afin de stocker l’énergie, dans un contexte de développement rapide des énergies renouvelables intermittentes. Sur les deux dernières années, l’Australie a installé jusqu’à cinq fois plus de puissance éolienne et solaire par habitant que les États-Unis, la Chine ou l’UE. Le projet Snowy Hydro 2.0, en cours de construction, permettra à la compagnie de quadrupler sa capacité de stockage d’ici à 2025 et ainsi de devenir un des plus gros parcs de pompage-turbinage au monde. Stocker l’énergie sous forme d’eau pourrait apporter de la stabilité aux réseaux d’électricité où les ressources intermittentes comme le solaire et l’éolien sont de plus en plus répandues, tout en étant plus efficace que les batteries existantes. Selon la compagnie, ses coûts de stockage en mégawatt par heure sont jusqu’à 60 fois inférieurs à ceux du plus grand parc de batteries lithium-ion du monde, construit par Tesla en 2017 en Australie. AGL Energy, le plus gros producteur privé d’électricité en Australie, a également annoncé vouloir développer deux projets de pompage-turbinage. La Chine est également en train de déployer cette technologie à grande vitesse, ainsi que les Etats-Unis et l’Espagne. Munich, mai 2019 : Sungrow, le premier fournisseur au monde de solutions d’onduleurs et de stockage d’énergie, a présenté l’onduleur string SG250HX, de 1500 Vdc au salon Intersolar Europe 2019. Cet onduleur de 250 kW est associé à une excellente performance et est désormais disponible en pré-vente. Les appareils seront livrés à partir du 3e trimestre.
Le CIBE, la Fedene, la FNCCR, Propellet, et le SER ont pour la première fois organisé jeudi 23 mai à Paris une journée consacrée aux enjeux du bois-énergie dans la transition énergétique, environnementale et sociétale. Olivier David, chef du service climat et efficacité énergétique de la DGEC, a introduit la journée en rappelant que la transition énergétique ne se fera pas sans le développement du bois-énergie, qui constitue le pivot de la fourniture de chaleur renouvelable. La filière est à même de fournir les combustibles nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux à 2028 puisque, à l’heure actuelle, seuls 50 % de l’accroissement naturel des forêts sont prélevés chaque année pour l’ensemble des besoins en bois d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie. Michel Druilhe, président de France Bois Forêt a ajouté : « Et si nous atteignons les objectifs de bois énergie fixés par la PPE, nous prélèverons 70 %. » Les professionnels de la forêt ont rappelé que le bois-énergie constitue un complément de revenus nécessaire aux propriétaires pour financer les opérations d’entretien des peuplements sylvicoles et s’inscrit ainsi dans un schéma de développement durable, qui impose l’utilisation des trois produits (bois d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie). Olivier David, a annoncé par ailleurs que la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, allait lancer prochainement un groupe de travail sur le bois-énergie. L’Ademe a publié le 23 mai un avis sur le chauffage domestique au bois. Parmi les recommandations de l’agence, on trouve : une meilleure information des particuliers et des élus sur les installations performantes et les bonnes pratiques, le maintien du soutien aux nouvelles installations et au remplacement des appareils anciens via le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) ou encore la mise en place d’incitations au remplacement des chaudières au fioul par des chaudières à granulés de bois avec les certificats d’économies d’énergie (CEE) et les dispositifs d’aides associés. « Afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d’accélérer le renouvellement du parc de systèmes de chauffage existant et d’attirer de nouveaux utilisateurs lors des rénovations ou dans le neuf », soutient l’Ademe pour qui « le chauffage domestique au bois est un enjeu incontournable et stratégique de la transition énergétique. » L’agence ajoute que « le bois domestique est une énergie renouvelable et économiquement compétitive pour les particuliers, notamment ceux vivant en zone rurale et périurbaine. » L’Agence internationale de l’énergie renouvelable (Irena) a publié le 29 mai un rapport sur les coûts de production des énergies renouvelables en 2018. Selon ce document, les coûts des technologies liées aux énergies renouvelables ont connu une diminution record l’an dernier. Ainsi, selon l’agence, le coût moyen pondéré global de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire à concentration a diminué de 26 % en 2018, de 14 % pour la bioénergie, de 13 % à partir solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre, de 12 % pour l’hydroélectricité et de 1 % pour la géothermie et l’éolien offshore. « La réduction de ces coûts, notamment pour les technologies solaire et éolienne, devrait se poursuivre au cours de la décennie à venir », ajoute l’Irena. « Plus des trois quarts de l’énergie éolienne terrestre et quatre cinquième de la capacité solaire photovoltaïque qui sera mise en œuvre l’année prochaine produiront de l’électricité à un coût inférieur à toute nouvelle option de centrale à charbon, à pétrole ou à gaz. Plus important encore, ces projets n’auront pas besoin de soutien financier », poursuit l’agence. Le parc des énergies renouvelables électriques s’est accru de 439 MW au premier trimestre cette année, ce qui porte sa puissance à 51,6 GW au 31 mars, selon l’étude mise en ligne le 21 mai par RTE, le Syndicat des énergies renouvelables (SER), Enedis, l’Association des distributeurs d’électricité en France (ADEeF) et l’agence ORE. Côté éolien, le trimestre est historique. Ainsi, plus de la moitié des nouvelles capacités renouvelables installées concernaient des installations éoliennes (243 MW) et la filière éolienne a produit pour la première fois plus de 10 TWh sur un trimestre (10,1 TWh). Le parc solaire a quant à lui battu « son record hivernal » de production avec 2,3 TWh au 1er trimestre (+ 50,6 % par rapport au 1er trimestre 2018) et les bioénergies productrices d’électricité (bois énergie, biogaz, déchets) ont, elles, produit près de 2 TWh au 1er trimestre 2019. Dans leur ensemble, les énergies renouvelables ont ainsi « couvert 20,1 % de la consommation d’électricité en France » métropolitaine au 1er trimestre 2019. S’agissant du volume des projets en développement, il s’élève à 17,6 GW. En un trimestre, il s’est accru de 56 % pour les installations solaires et de 24 % pour l’hydraulique. Suite à la deuxième réunion du groupe de travail national dédié aux réseaux de chaleur et de froid, la FNCCR territoire d’énergie s’est réjouie de voir 90 % de ses propositions retenues par la Secrétaire d’État Emmanuelle Wargon. « Campagnes d’information, plateforme avec des données géolocalisées, accompagnement des collectivités, structuration des réseaux d’acteurs…toutes ces mesures permettent un renforcement positif de la connaissance à disposition des collectivités », explique, dans un communiqué du 22 mai l’organisme rassemblant des collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau. Autre sujet de satisfaction, le froid et le rafraîchissement urbains « sont présents via l’extension du taux de TVA réduit au froid renouvelable et réseaux de froid dans les DOM. » Toutefois, « la route est encore longue et il y a besoin d’une vraie ambition », tempère la FNCCR. « Le point central qu’est la Contribution Climat Energie […] est malheureusement la grande oubliée de ces mesures annoncées. » Autres manques : l’insertion de la dimension « aménagement/urbanisme » (en s’appuyant notamment sur les leviers des PLUi ou des PCAET) et la prise en compte affirmée d’une approche multi-réseaux, « condition essentielle de réussite de la transition énergétique dans les territoires. » La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société RGreen Invest ont annoncé le 20 ami « une nouvelle étape dans leur partenariat » avec le premier investissement réalisé dans le domaine de la méthanisation en France à travers une prise de participation de 5 M€ du fonds Infragreen III dans l’entreprise Méthajoule, situé en région Auvergne Rhône Alpes. Ainsi, Infagreen III et Méthajoule ont signé un partenariat ayant pour objectif de porter des projets de méthanisation situés en France (à hauteur de 10 M€). Le premier projet présenté est une unité de méthanisation agricole en cogénération de 500 kW-e/400 kW-th. Le site, en cours de construction, est situé sur la commune de Sainte-Eulalie, dans le Cantal et produira de l’électricité (vendue à EDF) et de l’énergie thermique qui sera valorisée par un réseau de chaleur de 620 mètres de long desservant une zone d’activités. « Lors du lancement du fonds Infragreen III géré par Rgreen Invest, la BEI a investi 50 M€ lui permettant, en décembre 2018, de se clôturer au-dessus de ses objectifs de levée de capital, pour un montant de 307 M€ », rappelle la BEI dans un communiqué. L’objectif du fonds Infragreen III géré par Rgreen Invest consiste à investir dans des actifs réels du secteur de la transition énergétique et en particulier dans les énergies renouvelables en France et dans l’Union Européenne, en ciblant des projets photovoltaïques, éoliens mais aussi dans la géothermie, la biomasse, la méthanisation, l’efficience énergétique. « Hydroquest et CNM ont tenu les délais et ont installé leur première hydrolienne marine nommée HydroQuest Ocean », se réjouit le développeur isérois dans un communiqué du 10 mai. Hydroquest a en effet immergé début mai une hydrolienne sur le site d’essai d’EDF de Paimpol-Bréhat. Construite par CMN (Constructions mécaniques de Normandie) à Cherbourg, la turbine d’une capacité de 1 MW, qui utilise la technologie du double axe vertical contrarotatif, sera raccordée au réseau à la fin du mois avant une phase de test comprise entre six mois et un an. HydroQuest Ocean mesure 25 mètres de long, 10 mètres de large et 11 mètres de hauteur (sans l’embase) et pèse, toute assemblée, 1400 tonnes. Hydroquest, entreprise concentrée jusqu’alors dans l’hydrolien fluvial, travaille également à un modèle marin de 2 MW qu’elle aimerait déployer dans le Raz Blanchard. Pour ce faire, elle souhaite que l’État lance l’appel d’offres correspondant (cf. l’article du JDER 247 dédié à la filière). Simec Altlantis a annoncé, dans un communiqué du 14 mai, un partenariat technologique avec GE dans l’hydrolien. Selon l’accord en question, les partenaires vont s’unir pour développer des dispositifs, à grand échelle, de génération d’énergie hydrolienne et des solutions de stockage. Les deux groupes travaillent de concert depuis septembre 2018 sur la turbine hydrolienne AR2000 dont deux exemplaires doivent venir compléter le parc de Meygen, en Écosse. Celui-ci comprend quatre turbines d’une capacité totale de 6 MW et passera ainsi à 10 MW. Si la Chine et les États-Unis restent les pays les plus attractifs pour les énergies renouvelables, la France complète désormais le podium, explique le cabinet d’audit EY dans un communiqué du 15 mai. « L’évolution positive du classement de la France est portée par une hausse de l’attractivité sur le solaire photovoltaïque et l’éolien offshore », explique EY. « Cette remontée de l’attractivité relative de la France s’explique également par la baisse de l’attractivité de l’Inde sur le solaire photovoltaïque et de l’Allemagne sur le solaire photovoltaïque et l’éolien onshore. » À l’inverse, l’Inde et l’Allemagne ont respectivement reculé à la quatrième et à la sixième place, en raison d’une baisse de l’attractivité sur le solaire et l’éolien À l’occasion d’un colloque sur les réseaux de chaleur et de froid organisé le 6 mai à Nantes par la Fedene, le SNCU et Amorce, et en amont de l’Euroheat & Power Congress (7 et 8 mai, également à Nantes), l’Ademe a dégainé une étude détaillée sur la filière. Cet état des lieux dresse, pour la première fois, un bilan de l’écosystème des acteurs en présence et fournit une évaluation des retombées socio-économiques actuelles en termes d’activités économiques, d’emplois et de coûts. Parmi les principaux enseignements de ce document : la part des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) ne cesse de progresser en France et atteint 56 % de l’approvisionnement des réseaux de chaleur et de froid en 2017 (27 % dans l’UE, 9 % dans le monde) contre 40 % en 2013 et 27 % en 2005, l’énergie renouvelable dont la part a le plus significativement augmenté étant la biomasse ; le taux de raccordement des bâtiments à un réseau de chaleur en France reste faible (de l’ordre de 6 %) alors que la moyenne européenne est à 13% en secteur résidentiel et tertiaire ; le coût moyen annualisé et actualisé (LCOH) de la distribution primaire de chaleur à destination du secteur résidentiel et tertiaire est compris entre 10 et 27 €/MWh avec une médiane à 19 €/MWh ; le coût complet actualisé (production et distribution) moyen des réseaux enquêtés est de 76 €/MWh. Malgré un avis défavorable de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les textes qui visent à adapter le dispositif d’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant à un point d’injection mutualisé après un transport routier (biométhane porté) ont été publiés au Journal officiel en date du 3 mai. Ces deux textes, un décret et un arrêté ont fait l’objectif d’une consultation à la mi-2018. Les dispositions relatives au mécanisme de dégressivité des tarifs sont ainsi modifiées, afin que « le tarif d’achat puisse être calculé en tenant compte de la production de chacun des sites de production de biométhane livrant à un point d’injection mutualisé après un transport routier ». La mise en œuvre de cette mesure requiert également l’installation d’un dispositif de comptage sur chacun des sites de production, au lieu, jusqu’alors, d’une installation au niveau du point d’injection dans le réseau de gaz naturel. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’est alarmée le 6 mai d’un tassement « inattendu » dans le développement des énergies. Selon le scénario de développement durable (SDD) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), chaque année en moyenne une capacité d’énergies renouvelables de 300 GW doit être installée dans le monde entre 2018 et 2030 pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Or les capacités mondiales ont stagné en 2018 (à 177 GW), selon l’AIE. C’est d’ailleurs la première fois depuis 2001 que la croissance de son développement n’accélère pas d’une année sur l’autre. « Le monde ne peut pas se permettre de presser la touche ”pause” concernant l’expansion des renouvelables, et les gouvernements doivent agir rapidement pour corriger cette situation et permettre un flux plus rapide dans le développement de nouveaux projets », explique Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE, cité dans un communiqué. L’Agence souligne en effet « une rupture inattendue de la tendance (qui) suscite des inquiétudes quant à la réalisation des objectifs climatiques à long terme ». Les gouvernements sont sommés d’« agir rapidement pour corriger cette situation et permettre un flux plus rapide dans le développement de nouveaux projets. » Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2018 des pompes à chaleurs (PAC) dans le secteur du résidentiel (jusqu’à 30 kW). Avec 591 700 PAC air/air et air/eau vendues, auxquelles s’ajoutent 105 140 chauffe-eau thermodynamiques (CET), les technologies aérothermiques progressent de 18 % et réalisent une très belle année. Les PAC air/air restent l’équipement phare du secteur avec un marché évalué à plus de 498 120 pièces. Les voyants sont tous au vert pour le segment. Globalement, le marché a profité de la relance des constructions neuves amorcées en 2016 et qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du premier semestre 2018. Depuis l’activité dans la construction s’est ralentie, ce qui pourrait impacter les dynamiques de marché en 2019. Les PAC air/eau font également une bonne année (93 580 pièces, + 15 % par rapport à 2017). Quant aux CET, ils continuent leur progression en profitant notamment d’une bonne pénétration sur le marché du neuf. Pour les pompes à chaleur géothermiques, le bilan est inverse. Les ventes restent à un niveau désespérément bas (3 080 pièces) et aucun signe de reprise ne semble venir en 2019. Cette technologie, qui pourtant affiche un bilan énergétique et économique performant sur le long terme reste très mal connue du grand public. La technologie de l’énergie houlomotrice pourrait permettre aux groupes pétroliers de convertir des plateformes offshore en centres de production d’énergie renouvelable, ce qu’a bien compris Eni. Le groupe italien s’est en effet associé avec CDP, Fincantieri et Terna. Les partenaires ont ainsi signé le 19 avril un accord non contraignant pour développer et construire des centrales houlomotrices à l’échelle industrielle. Leur objectif est de transformer le projet pilote ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter), un projet pilote sur le site offshore d’Eni à Ravenne, en un projet à l’échelle industrielle et d’explorer le potentiel de lancement de projets à grande échelle, y compris à l’étranger. « L’accord d’aujourd’hui constitue un pas en avant important vers la construction d’un nouveau système de production d’énergie renouvelable générée par l’énergie houlomotrice », explique Claudio Descalzi, PDG d’Eni, dans un communiqué. Les partenaires prévoient la connexion d’une première installation industrielle à un site de production offshore d’Eni d’ici à 2020. Valorem a annoncé l’acquisition de Force hydraulique antillaise (FHA), principal développeur hydraulique des Antilles françaises. Le développeur français acquiert en effet 51 % de FHA et prévoit de monter progressivement au capital. Le fondateur de FHA, Raphaël Gros, conservant à ce jour les 49 % restants. Cette acquisition permet en tout cas à Valorem de mettre la main sur 10 MW d’actifs bénéficiant d’un contrat d’achat d’électricité à long terme, détaille-t-il dans un communiqué qui ajoute que 6 MW sont « prêts à être construits » et que FHA a un portefeuille de projets en développement de plus de 100 MW. « Avec cette acquisition, le groupe Valorem affirme sa position de premier producteur d’énergies vertes sur l’archipel », souligne-t-il. « Valorem souhaite atteindre une capacité globale de 3 GW d’actifs en exploitation dans le monde d’ici 5 ans », explique Frédéric Lanoë, DG du groupe et cité dans le communiqué. Acteur historiquement éolien, Valorem a commencé à diversifier ses activités vers l’hydraulique dès 2017. Dans un communiqué du 11 avril, l’Association négaWatt a annoncé le lancement d’un travail de fond pour la construction d’un scénario énergétique européen. Celui-ci visera zéro émissions nettes de gaz à effet de serre en 2050, en s’appuyant sur une démarche de sobriété et d’efficacité énergétiques et sur le déploiement des énergies renouvelables. Il s’agit donc d’un changement d’échelle pour l’association qui publie déjà des scénarios à l’échelle française. Pour porter ce projet européen, elle a mis en place un réseau d’acteurs impliqués dans les stratégies énergie-climat de 12 pays du continent. Il contient des acteurs de la société civile menant des actions de plaidoyer et des centres d’analyse et de recherche réalisant des outils et trajectoires pour les stratégies énergie-climat de certains Etats membres. Pour se financer, une partie de ce projet a recours au financement participatif, et les contributions sont possibles jusqu’au 15 mai 2019. Chaque année, GreenUnivers publie les chiffres du financement participatif dédié aux énergies renouvelables. En 2018, la société civile a apporté 38,71 millions d’euros, soit une augmentation de 89% par rapport à 2017, permettant de faire sortir de terre 1 131 MW de capacité renouvelable. 65% de ce financement est dédié au solaire. Le taux de rentabilité moyen net de ce financement est de 4,94%, un rendement « très intéressant au regard des courtes durées d’engagement », souligne Stéphanie Savel, présidente de Financement Participatif France (FPF). En moyenne, un projet n’a recours au financement participatif qu’à hauteur de 4,45% de son financement total. Cependant, cet outil a le vent en poupe et jouit d’un soutien institutionnel important. Ainsi, la loi Pacte a autorisé le relèvement du plafond par projet du financement participatif de 2,5 millions d’euros à 8 millions, sur 12 mois consécutifs. Observ’ER a publié les premiers résultats de son étude sur les appareils de chauffage au bois vendus en 2018. La filière a vendu 378 980 unités, ce qui représente une baisse d’1,5% par rapport à 2017. Ce recul vient du déclin des ventes d’appareils à bûches (-11%), que n’a pas compensé la croissance continue des appareils à granulés (+13%). Avec un total de 168 575 ventes, ce segment représente désormais 44% du marché. Par ailleurs, pour la première fois, les ventes de poêles à granulés et de chaudières à granulés ont dépassé leur équivalent utilisant le combustible bûche. L’ensemble des produits poursuit son évolution vers la très haute performance énergétique et environnementale, pour une réduction maximale des émissions. Les principaux acteurs de la filière sont prêts pour les normes EcoDesign qui seront effectives en 2020 pour les chaudières et 2022 pour les autres produits. La filière française du biométhane est « la plus dynamique d’Europe, avec en 2018, 32 nouveaux sites d’injection représentant une augmentation de 73 % par rapport à 2017 », explique le think tank France Biomethane à l’occasion de la publication de l’Observatoire annuel de la filière du Biomethane pour l’année 2018. Ainsi, 84 unités étaient en service à fin février 2019 et totalisent une capacité d’injection de 1 320 GWh/an. Ce parc est essentiellement composé d’installations agricoles autonomes de faible capacité injectant sur le réseau de distribution et 57 % des unités sont concentrées sur les régions d’Ile-de-France, Grand Est, Haut-de-France et Bretagne. « Le nombre de projets en file d’attente a quasiment doublé entre fin 2017 et fin 2018 pour atteindre 661 projets inscrits ayant une capacité cumulée de 14 TWh », détaille Charlotte de Lorgeril, du cabinet de conseil Sia Partners qui a coréalisé l’étude. Cependant, souligne, Cédric de Saint Jouan, président de France Biométhane, « le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) revoit à la baisse les ambitions de développement pour le biométhane. En particulier dans le ”scénario bas“, les pouvoirs publics fixent un objectif de 14 TWh injectés en 2028, ce qui est bien inférieur à la trajectoire imaginée dans la PPE 2015. » Les tarifs d’achat devraient aussi évoluer en faveur d’un système d’appels d’offres « qui ferait passer le prix d’achat du biométhane d’environ 100 €/MWh actuellement à 67€/MWh pour les producteurs », ajoute l’Observatoire. Suite à une mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France, le 7 mars, 107 députés de toutes étiquettes pressent le gouvernement de s’opposer à l’ouverture à la concurrence des ouvrages hydroélectriques d’EDF. La Commission européenne réclame en effet « un calendrier précis » de mise en concurrence d’un « nombre significatif » de concessions hydroélectriques actuellement exploitées par EDF. Les députés signataires de cette proposition de résolution demandent que les barrages soient considérés comme des services d’intérêt général. Parmi eux figurent des élus de gauche et de droite, dont Hubert Wulfranc (PCF), à l’initiative de la démarche, Julien Aubert (LR), Jeanine Dubié (Libertés et territoires), Marie-Noëlle Battistel (PS), Loïc Prud’homme (LFI) ou encore, l’ex-ministre de l’Écologie Delphine Batho (non-inscrite). Les parlementaires souhaitent que l’exécutif se rapproche des sept autres pays de l’Union européenne ayant également reçu des mises en demeure (dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Suède) pour obtenir l’exclusion du secteur hydroélectrique du champ des directives de 2006 et 2014 imposant la mise en concurrence dans les services et les contrats de concession. La FNME-CGT, de son côté, s’est réjouie de l’initiative des députés. L’université finlandaise LUT et l’Energy Watch Group ont publié le 12 avril un rapport concluant que « la transition mondiale vers les énergies renouvelables à 100 % dans tous les secteurs d’ici 2050 est faisable, sûre et plus rentable que le système énergétique actuel. » Ainsi, pour ses auteurs, « la transition énergétique mondiale n’est pas une question de faisabilité technique ou de viabilité économique, mais de volonté politique. » Ce rapport est « le premier » à modéliser un scénario à 1,5°C (objectif de l’accord de Paris) pour un système mondial d’énergie renouvelable à 100 %, optimisé en termes de coûts, multisectoriel et riche en technologies, qui ne repose pas sur des émissions négatives, explique l’Energy Watch group dans un communiqué. La simulation couvre le monde entier, structuré en neuf grandes régions et 145 sous-régions sur un pas de temps de 5 ans, de 2015 à 2050. « Sur la base de ce travail, les scientifiques sont techniquement en mesure d’élaborer des plans de transition à 100 % renouvelables dans toutes les régions », assure le communiqué. « Il convient de noter que l’étude parvient à la conclusion que le monde aura besoin d’un tel approvisionnement énergétique sûr – environ 70 TW d’énergie solaire (essentiellement photovoltaïque) installés, et 8 TW d’éolien – des chiffres qui seront importants pour planifier la trajectoire du monde dans les années à venir et éviter des changements climatiques catastrophiques – conformément aux exigences des mobilisations mondiales actuelles de la part de notre jeunesse », précise Eicke Weber, ancien directeur de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire, cité dans le communiqué. « Les projets de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) restent très imprécis ou insuffisants quant aux moyens mis en œuvre sur les 5 et 10 prochaines années pour atteindre des objectifs ambitieux, notamment dans le domaine de la rénovation des logements et du tertiaire ou celui de la biomasse et du stockage de carbone », déplore le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans un avis, largement adopté le 9 avril en séance, en présence de la Secrétaire d’État auprès du ministre d’état de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon. « Et surtout, l’absence de trajectoire connue pour la Contribution climat énergie (CCE) ou ”taxe carbone” depuis la suspension de sa progression en décembre 2018, rend peu crédible de nombreux aspects de cette programmation du fait du caractère très structurant du prix du carbone pour atteindre les objectifs visés », poursuit le Cese. Il défend « la prévisibilité et la stabilité d’une trajectoire pluriannuelle » et demande de « tenir ce cap en adaptant le rythme de la hausse de la CCE, notamment pour tenir compte de l’évolution des prix hors taxe des combustibles et carburants fossiles. » Emmanuelle Wargon a réagi dans la foulée : « Je ne dis pas qu’il sera impossible de réintroduire un jour une trajectoire carbone mais il me semble que les conditions ne sont absolument pas réunies pour le faire à court terme. » Une position qu’elle avait déjà exprimée, prenant notamment note des conclusions du grand débat. En parallèle, le Cese suggère des aides pour les ménages plus précaires, avec notamment une augmentation du chèque énergie. L’avis demande également aux pouvoirs publics français d’accentuer « leur pression pour remettre en cause l’exonération du transport aérien international et du transport maritime de la fiscalité carbone. » Il demande aussi à la France d’« étudier » la mise en œuvre d’une taxation ou contribution sur ses vols intérieurs. Afin d’ « optimiser le potentiel qu’offre la fiscalité de l’énergie pour tenir les engagements en matière de changement climatique et soutenir une croissance durable », la Commission européenne propose de passer de l’unanimité à la majorité qualifiée pour l’adoption des règles de fiscalité énergétique. Cela permettrait de mettre « un terme à la situation paradoxale qui veut que les carburants et combustibles les plus polluants sont parfois les moins taxés en Europe », explique notamment le Commission dans une communication publiée le 9 avril. « La communication présentée aujourd’hui suggère qu’il serait possible d’avoir recours à la ”clause passerelle” (article 192, paragraphe 2), qui prévoit le vote à la majorité qualifiée pour les mesures de fiscalité de l’énergie qui sont essentiellement de nature environnementale », ajoute la Commission, qui « encourage les États membres à se prononcer rapidement » sur cette question. « Ce choix pourrait être justifié pour des mesures de fiscalité environnementale destinées à la réduction des émissions de CO2 et d’autres émissions polluantes ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique, priorités essentielles de la stratégie de l’union de l’énergie et de l’accord de Paris. » « Les énergies renouvelables représentent la solution la plus efficace et facilement accessible pour inverser la tendance à la hausse des émissions de CO2. Associer les énergies renouvelables à une électrification plus profonde pourrait contribuer à 75 % de la réduction en émissions requise pour le secteur de l’énergie », explique le DG de l’Irena, Francesco La Camera, reprenant les chiffres d’un document intitulé « Transformation énergétique mondiale : une feuille de route pour 2050 » et dévoilée le 9 avril par l’Agence internationale de l’énergie renouvelable. « Il existe des moyens de satisfaire 86 % de la demande mondiale en énergie grâce aux énergies renouvelables, assure l’Irena. L’électricité couvrirait la moitié de la production mondiale finale d’énergie. L’approvisionnement mondial en électricité serait multiplié au moins par deux sur cette période, la plus grande partie étant produite à base de sources renouvelables, majoritairement le solaire photovoltaïque et l’éolien. » Mais les mesures concrètes se font attendre, signale le rapport. « La transformation de l’énergie gagne en dynamisme, mais elle doit encore s’accélérer davantage », explique M. La Camera. « Des actions urgentes sur le terrain à tous les niveaux, notamment le déblocage des investissements nécessaires à l’accélération de la transformation énergétique sont vitales. » EDF a annoncé la création d’une filiale, baptisée Hynamics, dédiée à la production et à la commercialisation de l’hydrogène « bas carbone » pour l’industrie et les transports. Dans l’industrie, Hynamics « installe, exploite et assure la maintenance de centrales de production d’hydrogène, en investissant dans les infrastructures nécessaires », explique l’énergéticien dans un communiqué du 2 avril. Dans les transports, la société « contribue à mailler les territoires de stations-service pour recharger en hydrogène les flottes de véhicules électriques lourds ». Elle évoque « une quarantaine de projets cibles » en Europe. Hynamics, est détenue à 100 % par EDF Pulse Croissance Holding, le fonds d’investissement et incubateur de l’électricien pour les start-up et projets innovants. L’an dernier, EDF avait annoncé son entrée dans le capital de McPhy, société spécialisée dans la production et le stockage d’hydrogène. Alors que la date d’anniversaire de l’annonce du plan hydrogène (juin 2018) se rapproche, régions et industriels ont demandé le 2 avril au gouvernement d’assurer un soutien pérenne à la filière. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Régions de France (institution de représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes) et l’Afhypac (association qui rassemble les entreprises du secteur) appellent désormais « à sa pleine concrétisation, mais surtout à sa pérennisation pour les prochaines années ». « Forte d’une recherche de haut niveau et d’acteurs industriels présents sur toute la chaîne de valeur, la France a tous les atouts pour prendre sa place dans la compétition mondiale», soulignent-ils. Un collectif a répondu au ministère de la Transition écologique et Solidaire, qui demandait que la filière formalise ses contributions à la Programmation Pluriannuelle de l’énergie et des mesures pour faciliter la baisse des coûts du biométhane pour la collectivité. Pour ce faire, l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l’AFG, Amorce, l’Atee, Biogaz Vallée, Coénove, l’Insea, la FNCCR et France Gaz Renouvelables se sont unis pour structurer des propositions autour de huit leviers prioritaires et de pistes complémentaires. Le document a été publié le 28 mars sur le site de l’Atee. Parmi les leviers prioritaires : fixer une nouvelle trajectoire de tarifs, de volumes, et de montants prévisionnels tout en respectant au mieux la contrainte budgétaire et les trajectoires cibles de baisse des coûts ; objectiver/quantifier les externalités positives, et principalement celles qui impactent les finances publiques : eau, air (GES et particules), sols, emploi ; allonger la période d’achat du biométhane de 15 à 20 ans (en cohérence avec la durée de vie des installations) ; fixer à 40 GWh/an le seuil envisagé pour les futurs appels d’offres et les mettre en œuvre en 2021 ; conforter et rendre plus transparent le système français des garanties d’origine biométhane jusqu’à ce que la filière soit mature ; mettre en place un pilotage filière pour l’industrialisation et la baisse des coûts du biométhane ; finaliser le dispositif de droit à l’injection et accorder aux collectivités et syndicats de l’énergie le droit de contribuer au dispositif pour permettre l’utilisation des potentiels plus éloignés des réseaux. Les signataires « souhaitent que le processus de concertation déjà bien engagé permette de définir prochainement un calendrier (prévisionnel) de la révision des mécanismes de soutien. » Après le photovoltaïque, l’éolien ou encore la méthanisation, c’est au tour de la chaleur et du froid renouvelables d’être dotés d’un groupe de travail. Il a été lancé le 25 mars par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat à la Transition écologique, dans le cadre du plan de libération des énergies renouvelables. Comme pour ses prédécesseurs, son but est de réunir les parties prenantes de la filière pour identifier et lever les freins à son développement. Il regardera de près les solutions de distribution, et notamment les réseaux de chaleur, afin d’en faire une filière française d’avenir. Les administrations, les collectivités locales et les fédérations professionnelles constituant ce groupe seront réparties autour de quatre axes de travail : créer et développer les réseaux de chaleur et de froid et mettre en valeur leur attractivité ; assurer la compétitivité économiques des réseaux de chaleur ; renforcer le taux d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur ; innover en créant des outils d’aide à la conception et au pilotage. Les mesures qui ressortiront de ce groupe de travail seront annoncées d’ici fin juin. Le bois énergie représente 40 % des énergies renouvelables produites en France, chaleur, électricité et biocarburants confondus. Partant du principe que le développement de cette énergie ne peut pas se faire à n’importe quelle condition, l’Ademe, le groupement d’intérêt public Ecofor et leurs partenaires ont publié une étude pour une gestion raisonnée de la récolte de bois énergie. Ce document propose aux exploitants de l’information technique pour réaliser des diagnostics préalables au lancement d’un chantier de récolte. Il présente également des recommandations pour les coupes. Les trois recommandations principales sont : limiter au maximum et en toutes circonstances d’évacuer le feuillage lors des opérations de récolte : moduler la récolte des menus bois en en laissant 10 à 30 % sur place ; appliquer une approche raisonnée de la récolte des souches. En effet, les menus bois, souches et feuillages contiennent des éléments minéraux très importants pour la bonne qualité des sols et sont un facteur clé pour la biodiversité forestière. La charge bidirectionnelle est la rencontre entre la capacité de stockage des véhicules électriques et la production variable des énergies renouvelables. L’idée est d’utiliser les véhicules pour stocker l’électricité lorsque la production est importante, et la déstocker quand elle est plus faible… sans empêcher les utilisateurs d’utiliser les véhicules lorsqu’ils en ont besoin ! Cela permet non seulement de pousser au développement des énergies renouvelables, mais également d’offrir aux conducteurs une consommation électrique plus économique. C’est pourquoi le Groupe Renault a annoncé dans un communiqué l’expérimentation à grande échelle de ce principe, à travers toute l’Europe, en commençant par déployer une flotte de 15 ZOE à charge bidirectionnelle aux Pays-Bas et en Europe. Le but est de chercher les voies de la généralisation de ce nouveau modèle et de bâtir des standards communs. L’association américaine des industriels de l’énergie solaire (SEAI) a publié mi-mars les chiffres d’installation de solaire photovoltaïque pour l’année 2018, qui représentent 29 % des nouvelles capacités électriques, en diminution depuis 2016 du fait de la croissance plus importante des centrales thermiques au gaz naturel (54 % en 2018 contre 28% en 2016). Le SEAI estime à 10,6 GW les nouvelles capacités photovoltaïques pour 2018. Ce chiffre est en légère baisse de 2 % par rapport à 2017, et loin du pic de 2016 (15,1 GW) mais celui-ci s’expliquait par un afflux massif de projets cherchant à bénéficier du crédit d’impôt fédéral de 30% qui expirait à la fin de cette même année. Le niveau d’installation de 2018 reste cependant largement supérieur à celui enregistré en 2015 (7,5 GW). Le parc photovoltaïque total en opération à fin 2018 se montait à 62,4 GW, soit 75 fois plus qu’en 2008. Le SEAI note une reprise du marché résidentiel en 2018, mais les utilities restent majoritaires avec 58 % des capacités nouvellement installées. La puissance couverte par des Power Purchase Agreements signées avec des utilities et la fin du crédit d’impôt pour l’investissement résidentiel en 2021 augurent d’un rythme d’installations soutenu pour les prochaines années avec en ligne de mire le doublement du parc total américain sur 5 ans. Neoen, producteur français indépendant d’énergies renouvelables, a annoncé la signature du financement d’El Llano, parc photovoltaïque de 375 MW situé dans l’état d’Aguascalientes au Mexique. Localisé au centre du pays, El Llano sera détenu à 100 % par Neoen, explique l’entreprise dans un communiqué. Le projet a été lauréat en novembre 2017 du 3e appel d’offres public mexicain portant sur les énergies renouvelables. Avec un contrat de vente de l’électricité produite à moins de 19 dollars par MWh, il est l’un des projets solaires les plus compétitifs au monde, contribuant à la bonne performance et à l’indépendance du secteur électrique mexicain. Le chantier mobilisera jusqu’à 820 personnes au plus fort de sa construction et générera des retombées importantes pour les communautés locales. Le début de la production est prévu pour le deuxième trimestre 2020. Par un communiqué du 19 mars, l’entreprise Legendre énergie a annoncé avoir remporté un appel d’offres lancé par la Société d’Economie mixte XSEA, concernant l’élaboration d’une étude de faisabilité et la proposition de préconisations techniques pour un projet d’autoconsommation collective. Legendre Energie devient ainsi assistant maîtrise d’ouvrage pour ce projet qui aura lieu dans la commune de Ploemeur, dans le Morbihan. Il accompagnera le Parc Technopolitain de Soye, qui regroupe des entreprises innovantes et technologiques et une vingtaine de maisons individuelles, dans sa politique de déploiement des énergies renouvelables et de réduction de son empreinte carbone. D’après Legendre Energie, le potentiel maximum d’installations solaires du parc de Soye se situe entre 100 et 300 kW. « Au 31 décembre 2018, 635 installations produisant de l’électricité à partir de biogaz sont raccordées au réseau. Cela correspond à une capacité totale installée de 456 MW. Au cours de l’année 2018, 26 MW supplémentaires ont été raccordés », peut-on lire dans le Tableau de bord : biogaz pour la production d’électricité, publié fin février par le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le document précise que les installations de méthanisation constituent plus des deux tiers du parc pour un tiers de la puissance totale et que la puissance des projets en file d’attente est de 69 MW à la fin de l’année 2018. Sur l’année 2018, la production d’électricité s’élève à 2,1 TWh, soit 0,4 % de la consommation électrique française, en hausse de 11 % par rapport à la production sur 2017. Des chiffres plutôt encourageants à l’heure où la filière a répété son mécontentement suite aux objectifs affichés dans le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dévoilé fin janvier. Virginie Schwarz est d’ailleurs intervenue sur le sujet le 12 mars, à l’occasion de la convention de l’Association française du gaz (AFG). La directrice de l’Énergie au ministère de la Transition énergétique et solidaire a souligné que le développement des énergies renouvelables, et notamment du biométhane, doit s’accompagner d’une « optimisation du coût. » Elle a ajouté que « la PPE est un équilibre entre les préoccupations de développement de ces énergies renouvelables, et en particulier de celles qui ont les externalités les plus positives, mais aussi d’optimisation du coût de développement de ces renouvelables. » 120 députés demandent au gouvernement des objectifs plus ambitieux en matière de biogaz et d’éolien en mer dans la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans une lettre transmise au Premier ministre Édouard Philippe le 7 mars et relayée par Ouest France le 8. Le collectif « Accélérons la transition écologique et solidaire », porté par les députés Matthieu Orphelin, Jean-Charles Larsonneur, Audrey Dufeu Schubert, Jimmy Pahun et Barbara Pompili, est à l’initiative de cette missive signée par des députés de tous bords politiques (à l’exception de la France Insoumise). Cette initiative a pour objectif de peser sur la procédure d’adoption de la PPE gérée par décret afin d’obtenir des objectifs rehaussés pour la production de biogaz et d’énergies marines renouvelables à l’horizon 2030. « Les énergies marines renouvelables et le gaz renouvelable disposent d’atouts évidents (…) Donnons-leur désormais une vraie perspective à travers des objectifs plus ambitieux dans la PPE : au moins 1 GW par an pour l’éolien en mer et une trajectoire des coûts réaliste qui préserve notre capacité à porter la part de gaz renouvelable à 10 % de notre consommation d’ici 2030 », écrivent les députés. Suite à la publication, fin janvier, de l’actuel projet de PPE, la filière du gaz renouvelable et des énergies marines renouvelables n’avaient pas caché leurs déceptions de voir raboter les objectifs de développement associés à leurs filières. Dans un communiqué du 11 mars, Michelin et Faurecia ont annoncé leur alliance autour de la voiture électrique pour développer l’activité de Symbio, entreprise spécialisée dans la greffe de piles à combustible en tant que prolongateur d’autonomie. Ce, après que le 1er février dernier, le manufacturier de pneumatiques a fait de Symbio l’une de ses filiales. Michelin et l’équipementier automobile Faurecia unissent désormais leurs forces dans le domaine des piles à hydrogène en créant, via la signature d’un protocole d’accord, une co-entreprise regroupant leurs activités dans ce domaine et incluant la filiale Symbio. Cette société commune prendra, justement, le nom de Symbio et sera détenue à parts égales entre Faurecia et Michelin. Elle « produira et commercialisera des systèmes de piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds. » Les deux partenaires affirment avoir « pour ambition de créer un leader mondial des systèmes de pile à hydrogène. » Par ailleurs, « la coopération entre Michelin et Engie […] dans le développement de l’écosystème hydrogène et en particulier en matière de mobilité hydrogène, profiteront à la co-entreprise », assure les deux nouveaux partenaires. « L’Union européenne doit fixer son ambition – 0 carbone en 2050, division par deux des pesticides en 2025 – et adapter ses politiques à cette exigence », explique Emmanuel Macron dans une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne ». Pour ce faire, le président de la République plaide pour la création d’une « banque européenne du climat », explique-t-il dans ce texte publié le 4 mars, en amont des élections européennes qui auront lieu en France le 26 mai prochain. Cette proposition de banque dédiée avait déjà été faite par l’économiste Pierre Larrouturou et le climatologue Jean Jouzel dans le cadre de leur projet de Pacte européen Finance-Climat, présenté notamment au Sénat fin janvier. « De la Banque centrale à la Commission européenne, du budget européen au plan d’investissement pour l’Europe, toutes nos institutions doivent avoir le climat pour mandat », précise Emmanuel Macron. A l’occasion du Salon international de l’agriculture, l’Ademe a publié une étude sur l’efficacité énergétique dans l’agriculture. L’Agence a ainsi recensé « une multitude de solutions, pour les différents types de production, qui permettent aux agriculteurs de réduire significativement leur facture énergétique. Ces solutions technologiques et de changement des pratiques agricoles, une fois combinées, pourraient permettre de réduire jusqu’à 43 % la consommation énergétique des exploitations agricoles à l’horizon 2050 », explique-t-elle dans un communiqué. « Pour accompagner la diffusion de l’efficacité énergétique en agriculture, il est nécessaire d’agir à la fois sur les changements de comportement et sur les équipements », explique l’étude. Et l’Ademe de conclure : « Il est nécessaire de maintenir des dispositifs d’aide à l’investissement pour rendre ces technologies attractives pour les exploitations agricoles. La diffusion des solutions énergétiques à faible impact unitaire impose une massification auprès d’un grand nombre d’agriculteurs. Une partie des solutions repose probablement sur l’appropriation territoriale des enjeux par les acteurs agricoles et l’organisation collective à partir de collectifs d’agriculteurs, notamment les groupements de producteurs et les coopératives agricoles qui s’impliquent dans des démarches d’amélioration des performances énergétiques des exploitations agricoles. » Engie a annoncé le 26 février l’acquisition de la société spécialisée dans le biogaz Vol-V Biomasse, c’est à dire toute l’activité de Vol-Vdans la méthanisation : son bureau d’études, ses sociétés de projets, les effectifs qui développent et exploitent ses installations… « Engie dispose désormais d’un portefeuille de près de 80 projets et conforte ainsi son ambition de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane à l’horizon 2030 », précise le groupe dans un communiqué. L’énergéticien « a pour objectif d’accompagner l’industrialisation de la filière pour baisser les coûts d’environ 30 % d’ici à 2030 et atteindre la parité avec le gaz naturel. » Créé en 2009, Vol-V Biomasse revendique « 7 centrales de production mises en service, 3 unités en cours de construction, 9 autres autorisées prêtes à construire et un portefeuille conséquent de projets en développement,« explique l’entreprise dans un communiqué. « Pour faire face aux prochains défis de la filière biométhane que sont l’industrialisation des procédés, le développement à très grande échelle et l’intégration de nouvelles briques technologiques, qui permettront une nécessaire baisse des coûts de production, le groupe Vol-V a souhaité passer le relais à Engie dont les ambitions et les moyens concordent pour accélérer cette évolution. » « L’Union européenne doit fixer son ambition – 0 carbone en 2050, division par deux des pesticides en 2025 – et adapter ses politiques à cette exigence », explique Emmanuel Macron dans une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne ». Pour ce faire, le président de la République plaide pour la création d’une « banque européenne du climat », explique-t-il dans ce texte publié le 4 mars, en amont des élections européennes qui auront lieu en France le 26 mai prochain. Cette proposition de banque dédiée avait déjà été faite par l’économiste Pierre Larrouturou et le climatologue Jean Jouzel dans le cadre de leur projet de Pacte européen Finance-Climat, présenté notamment au Sénat fin janvier. « De la Banque centrale à la Commission européenne, du budget européen au plan d’investissement pour l’Europe, toutes nos institutions doivent avoir le climat pour mandat », précise Emmanuel Macron. EDF a annoncé la création d’une filiale, baptisée Hynamics, dédiée à la production et à la commercialisation de l’hydrogène « bas carbone » pour l’industrie et les transports. Dans l’industrie, Hynamics « installe, exploite et assure la maintenance de centrales de production d’hydrogène, en investissant dans les infrastructures nécessaires », explique l’énergéticien dans un communiqué du 2 avril. Dans les transports, la société « contribue à mailler les territoires de stations-service pour recharger en hydrogène les flottes de véhicules électriques lourds ». Elle évoque « une quarantaine de projets cibles » en Europe. Hynamics, est détenue à 100 % par EDF Pulse Croissance Holding, le fonds d’investissement et incubateur de l’électricien pour les start-up et projets innovants. L’an dernier, EDF avait annoncé son entrée dans le capital de McPhy, société spécialisée dans la production et le stockage d’hydrogène. Alors que la date d’anniversaire de l’annonce du plan hydrogène (juin 2018) se rapproche, régions et industriels ont demandé le 2 avril au gouvernement d’assurer un soutien pérenne à la filière. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Régions de France (institution de représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes) et l’Afhypac (association qui rassemble les entreprises du secteur) appellent désormais « à sa pleine concrétisation, mais surtout à sa pérennisation pour les prochaines années ». « Forte d’une recherche de haut niveau et d’acteurs industriels présents sur toute la chaîne de valeur, la France a tous les atouts pour prendre sa place dans la compétition mondiale», soulignent-ils. Air Liquide a annoncé le 25 février la construction au Canada du plus grand électrolyseur PEM (Membrane Échangeuse de Protons) au monde. D’une capacité de 20 MW, il produira de l’hydrogène décarboné grâce à la technologie Hydrogenics, un spécialiste canadien des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible dans lequel Air Liquide a pris une participation de 18,6 % fin janvier. Ce projet permet ainsi d’augmenter de 50 % la capacité actuelle de site du groupe de production d’hydrogène situé à Bécancour, dans la région de Québec, au Canada. Hydrogène toujours, mais en France cette fois, L’arrêté relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets « Production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs industriels » a été publié au Journal officiel du 24 février. Enfin, Ergosup a annoncé le 18 février la levée de 11 millions d’euros pour le déploiement de ses infrastructures de production et de stockage d’hydrogène vert. L’entreprise française avait déjà levé 2,7 M€ lors d’un premier tour de table en 2015. Cette nouvelle levée a pour objectif d’industrialiser la production de petites séries, développer sa commercialisation et renforcer ses équipes avec le recrutement d’une dizaine de nouveaux collaborateurs. Total Eren a annoncé le 26 février l’acquisition du producteur d’électricité renouvelable basé au Luxembourg NovEnergia Holding Company (NHC), surtout présent dans le sud de l’Europe. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par l’entreprise détenue à 23 % par le géant pétrolier Total, mais NHC « a été valorisée à plus d’un milliard d’euros », indique-t-elle dans un communiqué. NHC détient un portefeuille de 657 MW de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques en Italie, en France, en Espagne, en Bulgarie, en Pologne et au Portugal. « Nous disposons désormais d’une présence significative au Sud de l’Europe », se félicite David Corchia, directeur général de Total Eren. Le Crédit Agricole a annoncé le 26 février le lancement d’un fonds d’investissement de 200 millions d’euros dédié à la transition énergétique, agricole et agroalimentaire. Ce nouveau fonds a pour nom CA Transitions, « le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire », explique la banque dans un communiqué. Il a vocation à accompagner des entreprises, en ciblant plus précisément la production d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents de stockage et de distribution d’énergie ou le recyclage et la valorisation de matériaux. Il « accompagnera le développement des PME, ETI et coopératives engagées dans ces nouveaux modèles. » À l’image de l’électricité verte ou du biométhane, l’hydrogène a désormais sa garantie d’origine (GO) permettant aux utilisateurs finaux de consommer un hydrogène certifié vert ou bas carbone partout dans l’Union Européenne. La plateforme CertifHy propose en effet de l’hydrogène certifié vert ou bas carbone à ses clients dans le cadre d’un projet pilote initié par la Commission Européenne et financé par le FCH JU (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking). Les consommateurs d’hydrogène du secteur de l’industrie et des transports peuvent utiliser dès maintenant l’hydrogène certifié dans leurs processus et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en achetant soit des GO CertifHy Green, soit des GO Low Carbon Hydrogen. Le premier label concerne de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, solaire). Le deuxième concerne l’hydrogène produit à partir d’énergies non renouvelables avec une empreinte carbone faible, à savoir 60 % plus basse que les procédés conventionnels de production par reformage de gaz naturel. « CertifHy est actuellement en phase pilote et une première série de Garanties d’Origine a déjà pu être émise, explique Air Liquide dans un communiqué du 12 février annonçant sa participation à CertifHy. Le projet a en effet émis plus de 75 000 garanties d’origine d’hydrogène vert et à faible teneur en carbone, qui sont désormais disponibles sur le marché. « Les Garanties d’Origine émises pendant cette phase pilote concernent quatre sites de production en Europe, parmi lesquels se trouve le site Air Liquide de Port-Jérôme-sur-Seine (Normandie) où le Groupe produit de l’hydrogène bas-carbone par reformage de gaz naturel tout en captant une partie du CO2 émis », ajoute Air Liquide. Trois autres industriels participent à la plateforme CertifHy : le groupe chimique néerlandais Nouryon, l’entreprise belge de grande distribution Colruyt Group et l’énergéticien allemand Uniper. La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a voté, le 13 février, la création d’une « commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique ». La conférence des présidents doit désormais acter ce vote et la création de la commission d’enquête. « La politique d’accélération du déploiement des énergies renouvelables sur notre sol depuis plus de dix ans appelle aujourd’hui la représentation nationale à dresser le bilan de l’efficacité économique, énergétique et environnementale », écrivent les députés dans la proposition de résolution présentée par le député de l’opposition LR (Les Républicains) Julien Aubert. Les parlementaires soulignent que « d’une part, ni le Parlement, ni les Français n’ont une vision très claire de ce qui est exactement prélevé en taxes et quasi-taxes pour le financement de la transition énergétique. D’autre part, à l’autre bout du tuyau de la dépense, il n’y a aucune visibilité sur le coût de la transition, l’efficience de la dépense et l’impact sur la croissance économique. » À l’occasion de la célébration des 100 ans de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 700 millions d’euros pour la création d’une filière française et européenne de batteries et le soutien d’un consortium franco-allemand, l’Alliance des batteries européenne, lancée en 2017. Le président a également indiqué qu’une usine de batteries serait construite en France. L’Allemagne de son côté a déjà annoncé des investissements considérables pour la construction d’une usine de batteries sur son territoire et un centre de R&D afin de développer de nouvelles technologies. Côté français, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé récemment par la Direction générale des entreprises. Emmanuelle Wargon a annoncé le 7 février, lors du colloque des 20 ans du Syndicat des énergies renouvelables (SER), l’ouverture d’un nouveau groupe de travail consacré à la chaleur et au froid renouvelables. Une initiative dans la lignée des groupes de travail relatifs à la méthanisation, au solaire et à l’éolien lancés par le Secrétaire d’État, Sébastien Lecornu, et qui n’a pas manqué de faire réagir la FNCCR territoire d’énergie. Ce nouveau groupe de travail « confirme l’importance de la thématique », explique, dans un communiqué publié le 12 février, le site des autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) engagées dans la transition énergétique. Et de rappeler que « 50 % de l’énergie finale consommée en France l’est sous forme de chaleur » et qu’« aujourd’hui, la chaleur reste produite à près de 80% par des énergies fossiles ». La FNCCR territoire d’énergie ajoute qu’« en choisissant d’axer ce nouveau groupe de travail sur la chaleur renouvelable mais aussi le froid, c’est une reconnaissance de l’importance de cette thématique pour laquelle la FNCCR territoire d’énergie s’est fortement mobilisée ces quatre dernières années, que ce soit au niveau européen lors des négociations de la nouvelle directive EnR ou lors d’événements et publications dédiés. » Et, surprise, la France n’est pas dans la liste. Parmi les 28 États membres de l’Union européenne, onze ont déjà atteint le niveau requis pour réaliser leurs objectifs nationaux 2020 respectifs, explique l’organisme de statistiques européen Eurostat dans une publication du 12 février. À l’autre extrémité de l’échelle, les Pays-Bas, la France, l’Irlande, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Pologne et la Belgique sont pointés du doigt. Ce sont les pays les plus éloignés de leurs objectifs. Plus généralement, en 2017, explique Eurostat, la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie a atteint 17,5 % dans l’ensemble de l’Union européenne, en hausse de 0,5 % par rapport à 2016 (17 %) et plus du double de son niveau de 2004 (première année pour laquelle les données sont disponibles). L’Europe a pour objectif d’atteindre 20 % d’ici à 2020 et à au moins 32 % d’ici à 2030. L’Ademe a récemment mis en ligne un guide pour présenter les différentes aides financières dont les particuliers peuvent disposer pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. « Des mesures d’évolutions et de simplifications de l’éco-prêt à taux zéro entreront en vigueur au 1er mars et au 1er juillet 2019 », est-il précisé. Les informations de la publication seront alors actualisées. Le guide répertorie les critères d’attribution des aides financières disponibles. Ces critères peuvent être liés au logement, à la situation du particulier et aux caractéristiques techniques des matériels installés. « Le développement des énergies renouvelables doit se faire de façon irréprochable », a plaidé Arnaud Leroy, président de l’Ademe, lors du colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER) qui s’est ouvert le 6 février. La question de l’acceptabilité est revenue à plusieurs reprises au cours des témoignages proposés par la 20e édition de cette manifestation. « Ademe et acteurs des énergies renouvelables, nous avons un enjeu commun : la neutralité carbone en 2050. Il faut faire émerger des solutions territoriales, nous devons construire un consensus sociétal autour de la transition écologique », a poursuivi Arnaud Leroy. « Les questions de l’efficacité et de la sobriété énergétique doivent être notre boussole. Nous avons plusieurs enjeux à relever ensemble : l’économie circulaire, le développement des énergies renouvelables, la biodiversité, l’acceptabilité et la formation aux emplois des énergies renouvelables », a-t-il poursuivi. Et d’annoncer que l’Ademe a lancé un « job Dating », une initiative sous forme de tour de France destinée à mettre en adéquation les besoins des entreprises d’énergies renouvelables et ceux qui cherchent des débouchés professionnels. « La question de l’efficacité et de la sobriété énergétique est une boussole que nous devons garder à l’esprit : ces évolutions sont aussi demandées par la société », a insisté le président de l’Ademe. « Nous avons pour devoir de rendre la transition énergétique acceptable et, même, désirable pour tous les citoyens », a expliqué dans le même sens Jean-Louis Bal, président du SER, en ouverture de ces deux jours de colloque. À l’occasion du Grand débat national, lancé le 15 janvier dernier, et de l’ouverture de la contribution en ligne sur le portail granddebat.fr depuis le 21 janvier, l’Ademe met à la disposition des citoyens des outils sur le thème de la transition écologique afin de fournir des pistes de solutions dans les débats. Après l’emploi, l’eau et l’énergie, et la mobilité, l’agence a ajouté de nouvelles infographies sur la taxe carbone, le logement et l’alimentation. L’ensemble des initiatives de l’Ademe pour le grand débat national est disponible sur son site internet. La deuxième phase d’expérimentation des contrats de transition écologique (CTE) a été lancée le 5 février par la secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon. Huit nouveaux territoires candidats vont tester ce dispositif. Il s’agit de : la Communauté de communes du Trièves et Grenoble-Alpes Métropole (Auvergne-Rhône-Alpes, Isère) ; le Pays Vendômois (Centre-Val-de-Loire, Loir-et-Cher) ; le Pays Terres de Lorraine (Grand-Est, Meurthe-et-Moselle) ; la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Île-de-France, Essonne) ; la Communauté de communes Coutances Mer et Bocage (Normandie, Manche) ; la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime) ; le Groupement d’action locale Sud Mayenne – Pays de Craon, Pays de Château-Gontier, Pays de Meslay-Grez (Pays-de-la-Loire, Mayenne) ; et le Centre Morbihan Communauté et Pontivy Communauté (Bretagne, Morbihan). Emmanuelle Wargon a également annoncé que cette deuxième phase de l’expérimentation permettrait « le déploiement national du dispositif, à l’été 2019, afin de permettre à l’ensemble des territoires intéressés de porter leur candidature auprès du ministère. » « Les objectifs de production de biométhane du projet de PPE pour 2023 sont inférieurs aux projets déjà enregistrés et nettement en retrait par rapport à la précédente PPE avec de surcroit des objectifs de baisse de coût peu réalistes. L’Association française du gaz (AFG), l’Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV), Coénove et France gaz renouvelables estiment que les mesures annoncées pour le biométhane risquent de condamner l’avenir de cette filière sans tenir compte de ses avantages », ont déploré ces acteurs dans un communiqué. Le gouvernement a en effet publié le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028. Et pour les professionnels du biogaz, la PPE dévoilée le 25 janvier menace le développement de la filière. « Comment interpréter le fait que le projet de PPE ramène à 7 % la part du gaz vert dans la consommation en 2030 et conditionne son développement à une baisse des coûts irréaliste ?, s’interroge Coenove dans un communiqué distinct. Au-delà du strict enjeu énergétique, c’est faire, de plus, fi des nombreuses externalités positives que présente le verdissement du gaz pour la filière agricole et l’économie circulaire. » Et d’enfoncer le clou : « Cette PPE fait avant tout dans le « deux poids, deux mesures », considérant que rien n’est impossible pour le secteur électrique et laissant sur la touche l’énergie gaz au mépris même de son avenir renouvelable. » L’Ademe et GRDF ont signé le 23 janvier un nouvel accord de coopération visant à favoriser l’efficacité énergétique et environnementale au travers du développement de solutions utilisant le gaz naturel et les gaz verts. Ce 4e accord est d’une durée de 3 ans. Il s’inscrit dans la lignée de la publication de l’étude prospective publiée en 2018 par l’Ademe et intitulé « Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ?« . « Cette collaboration concerne également les filières moins matures : elle vise à étudier les verrous technologiques de la gazéification et à définir les conditions technico-économiques d’injection d’hydrogène dans les réseaux », précise l’Ademe dans un communiqué. Les deux partenaires indiquent également qu’ils travailleront conjointement sur plusieurs études pour valoriser les atouts environnementaux de la filière bioGNV (Gaz Naturel Véhicule issu du biométhane) : dispositifs techniques pour garantir la traçabilité du bioGNV jusqu’à l’utilisateur final, mécanismes de prise en compte du bilan CO2 du bioGNV et des autres biocarburants, outil d’estimation des gains pour la collectivité de privilégier les transports par autocars au GNV / BioGNV… L’Allemagne va investir 500 millions d’euros sur quatre ans dans un centre de R&D dédié à la technologie des batteries, a annoncé le 23 janvier la ministre de la Recherche allemande, Anja Karliczek, dans un communiqué. Le financement, qui doit « garantir la souveraineté technologique de l’Allemagne », vise à développer toute la chaîne de valeur : la recherche sur les matériaux, la conception de cellules et de processus ainsi que la recherche sur la production de cellules de batterie à l’échelle industrielle. Selon le ministère, les entreprises allemandes BMZ, Liacon Batteries, Customcells, EAS Batteries, TerraE et suisse Leclanché ont déjà annoncé leur participation à la mise en place du projet de recherche. L’emplacement de la nouvelle installation doit, lui, être choisi d’ici mi-2019, et entrer dans la phase de construction dans la foulée. Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, ont signé le 18 janvier, à Limay (78) le contrat du comité stratégique de filière « Transformation et valorisation des déchets ». « Le Comité stratégique de filière s’engage sur les six projets structurants pour répondre aux principaux défis et développer en France une industrie du recyclage performante et compétitive à l’échelle internationale », explique les deux membres du gouvernement dans un communiqué du 18 janvier. À savoir : développer et soutenir l’incorporation de matières premières de recyclage dans les produits finis ; accompagner la croissance des besoins en valorisation énergétique des fractions non recyclables – Combustible solide de récupération (CSR), « qui vise à valoriser énergétiquement les refus de tri. Les refus de tri sont préparés en CSR afin d’éviter leur enfouissement et sont utilisés comme combustible, en substitution d’énergies fossiles » ; accompagner les acteurs de la recyclabilité et le potentiel de valorisation ; accélérer la croissance des entreprises et développer leur présence sur les marchés internationaux ; accompagner les métiers et l’évolution des compétences ; accélérer la robotisation des centres de tri. À l’occasion du Grand débat national lancé le 15 janvier, l’Ademe met à disposition des citoyens des outils sur le thème de la transition écologique afin de fournir des pistes de solutions dans les débats. L’agence a ainsi élaboré et mis à disposition un dossier, accessible en ligne, à vocation pédagogique qui reprend les quatre grands thèmes de la transition écologique : se déplacer, se loger, se chauffer et se nourrir « traités sous l’angle du bénéfice en termes de pouvoir d’achat, de lien social et d’emploi ». Par ailleurs, l’Ademe a réalisé quatre infographies qui illustrent les thèmes mis en avant, également disponible sur le portail « granddebat.fr ». « Le Grand Débat qui vient de s’ouvrir doit être l’opportunité de partager notre vision de la transition écologique avec nos concitoyens, d’expliquer en quoi changer de modèle et de comportements est un impératif pour assurer un futur vivable pour nous et nos enfants », explique son président, Arnaud Leroy, dans un communiqué du 21 janvier. En 2018, les investissements mondiaux dans les « énergies propres » (incluant principalement les énergies renouvelables, hors grands projets hydroélectriques) se sont élevés à 332,1 mds$, selon un rapport publié le 16 janvier par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Le total de ces investissements comptabilisés (qui inclut également les levées de fonds liées aux réseaux intelligents, au stockage d’énergie ou encore aux véhicules électriques) a ainsi baissé de près de 8 % par rapport à 2017. Une baisse qui n’est pas de mauvais augure puisqu’elle s’explique principalement par la réduction des coûts des installations renouvelables, selon le cabinet d’études, qui s’attend à la poursuite de cette tendance en 2019. Plus des trois quarts des investissements ont été effectués dans les filières solaires (130,8 mds$) et éoliennes (128,6 mds$), loin devant la biomasse solide, les biocarburants et les déchets, la géothermie, la petite hydroélectricité ou encore les énergies marines. La Chine est restée de loin « le leader »des investissements dans les « énergies propres » en 2018 (100,1 mds$, soit 30 % du total mondial) et continuera à jouer un « rôle majeur dans la dynamique de la transition énergétique mondiale », selon BNEF. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, a réuni le 14 janvier les acteurs de la filière méthanisation pour effectuer un suivi des mesures destinées à accélérer le développement de cette filière. Au rayon des avancées mises en avant par la secrétaire d’État dans un communiqué, on trouve : l’assouplissement des conditions de mélange des déchets avant méthanisation, sauf lorsqu’il s’agit de biodéchets ; la simplification de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ; l’élargissement des possibilités de sortie de statut de déchet des digestats ; la simplification de la réglementation « loi sur l’eau » ; la réfaction des coûts de raccordement des installations de méthanisation au réseau de transport de gaz naturel ; l’utilisation du bioGNV par les engins agricoles. Pour la suite, « les travaux se poursuivront dans les prochains mois afin d’assurer la mise en œuvre des dernières actions décidées dans le cadre de ce groupe de travail. En particulier, le droit à injection du biométhane dans le réseau de gaz sera rendu pleinement opérationnel d’ici le printemps 2019. » Le Club Biogaz a profité de la réunion pour présenter le label Qualimétha « conception et construction des installations de méthanisation », qui doit contribuer au renforcement des démarches de qualité permettant de professionnaliser la filière de la méthanisation. Pour savoir s’il existe un réseau de chaleur à proximité de son logement, Via Sèva lance « Existe‐t‐il un réseau de chaleur près de chez moi ? », un outil cartographique (réalisé avec le soutien financier de l’Ademe) accessible directement à l’adresse carto.viaseva.org. Les informations disponibles à ce jour concernent 535 réseaux de chaleur et de froid et seront mises à jour au fur et à mesure de l’apport des contributeurs. L’objectif affiché est de faciliter l’accès à l’information relative à l’existence d’un réseau de chaleur et/ou de froid près de chez soi, tant pour le grand public que pour les professionnels (équipementiers, bureaux d’étude, porteurs de projet) : plan des réseaux (à l’échelle de la rue), taux d’énergies vertes utilisées, contacts pour se raccorder, sources d’énergie utilisées, fiches réseaux etc. Grâce au menu déroulant et aux niveaux de zoom puissants, cet outil permet ainsi de visualiser : tous les réseaux, ou les réseaux existants, ou les réseaux prospectifs, ainsi que les possibilités de raccordement. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) lance un appel à contributions sur le développement du stockage de l’électricité en France. « Il s’agit d’étudier le potentiel, mais aussi les éventuels freins au développement du stockage, et de comprendre quelles évolutions seraient à même de permettre un développement du stockage à la mesure des bénéfices qu’il peut apporter au système électrique », explique la CRE dans un communiqué du 11 janvier. Et de préciser que son objet est de « s’assurer que le moindre développement constaté du stockage par batteries résulte de facteurs intrinsèques au marché français actuel, et non pas de barrières réglementaires, tarifaires ou dans les conditions d’accès aux réseaux. » Le régulateur invite les parties intéressées à adresser leur contribution, en répondant au plus tard le 28 février 2019. « En France métropolitaine continentale, le développement des batteries reste lent : un projet de 6 MW vient d’être annoncé pour une mise en service au premier trimestre 2019, et 75 MW pourraient être en service fin 2019. Des projets de batteries se développent néanmoins dans le cadre de démonstrateurs financés par les gestionnaires de réseaux Enedis (Nice Grid, Venteea) et RTE (Ringo) », avance la CRE. Cette solution se développe en revanche rapidement dans différentes régions du monde : Californie, Royaume-Uni, Allemagne, îles et territoires non interconnectés dont les ZNI françaises, Australie, Afrique, etc. La Direction générale des entreprises a annoncé le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dont la finalité est d’identifier les entreprises qui pourraient participer, sur le territoire français, à « un projet d’envergure » concernant « la conception et la production en Europe de cellules et de modules de batteries innovantes et respectueuses de l’environnement, en lien avec des partenaires d’autres Etats membres ». L’AMI se clôturera le 31 janvier 2019. Il intervient dans le cadre du plan d’action adopté par la Commission européenne pour faire de l’Europe un leader dans la production durable et compétitive de batteries. Compte tenu du caractère stratégique de ce secteur et de son poids économique, l’émergence d’une offre industrielle européenne est une ambition européenne portée par le couple franco-allemand, qui envisage de soutenir un grand projet à l’échelle européenne, lequel pourrait être qualifié de Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). L’AMI lancé par la DGE « n’est assorti d’aucun accompagnement financier : le projet proposé par l’entreprise ne pourra être financé par les autorités françaises que s’il est retenu dans le cadre d’un PIIEC qui serait lancé dans le cadre de cette initiative », est-il précisé sur le site de la DGE. En 2018, et pour la première fois, l’Allemagne a produit plus d’électricité grâce aux énergies renouvelables qu’au charbon, explique un rapport publié le 2 janvier par l’institut allemand Fraunhofer ISE. La part des renouvelables dans le mix électrique outre-rhin a approximativement doublé depuis le début des années 2010. L’an dernier, les énergies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque, biomasse et hydroélectricité) ont produit 219 TWh d’électricité en Allemagne, soit 4,3 % de plus qu’en 2017. Elles ont compté pour 40,4 % de la production électrique allemande des douze derniers mois, contre 38 % pour le charbon (lignite et houille confondus). Selon l’institut Fraunhofer ISE, la part des énergies renouvelables devrait rester supérieure à 40 % en 2019, compte tenu du nombre d’installations renouvelables en construction (en prenant en compte les aléas météorologiques). Le ministre canadien des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, a annoncé le 9 janvier que le Canada était devenu officiellement membre de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). Le pays rejoint ainsi 159 autres membres au sein de l’organisme intergouvernemental oeuvrant à la fourniture d’une énergie propre et durable à la population mondiale en croissance. « En devenant membre de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), le Canada pourra accélérer ses efforts en vue de créer un avenir fondé sur l’énergie propre qui stimulera l’économie et créera des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés », explique le ministre dans un communiqué. L’Union européenne prépare une directive pour compléter son paquet énergie propre et un grand pas vient d’être franchi dans la nuit du 18 au 19 décembre. En effet, la présidence du conseil européen et les représentants du Parlement européen ont atteint un accord, qui doit cependant encore être adopté formellement. La directive devra ainsi autoriser l’application de tarifs réglementés pour protéger les clients les plus précaires. Et surtout « les clients pourront participer directement au marché, en tant que clients actifs, par exemple en vendant de l’électricité produite par leur propres moyens, en participant à des programmes d’effacement de la demande, ou en rejoignant des communautés énergétiques citoyennes ». À l’échelle française, ce dernier point pourra favoriser les schémas d’autoconsommation, qu’elle soit individuelle ou collective. Dalkia a annoncé le 18 décembre avoir signé un accord de partenariat avec Amundi Transition Énergétique (ATE) pour faciliter le développement des réseaux de chaleur renouvelable. « Cet accord permettra de proposer aux collectivités territoriales des solutions innovantes et durables conjuguant l’expertise et le savoir-faire de Dalkia, 1er acteur des réseaux de chaleur en France, et un montage original de financement compétitif s’appuyant sur les compétences d’Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs, en matière d’investissements en infrastructures », explique la filiale d’EDF dans un communiqué. Amundi Transition Energétique (ATE) est une filiale d’Amundi (60 %) et d’EDF (40 %). « Dalkia et ATE ont d’ores et déjà prévu de réaliser ensemble un investissement significatif d’ici la fin de l’année, ce qui portera à près de 500 millions d’euros le montant des opérations conclues à date », ajoute Dalkia. L’unité de méthanisation agricole et territoriale Agri Méthane a été inaugurée le 14 décembre par le préfet de la région Loire Atlantique, ainsi que le Conseil régional, le Conseil départemental, la Communauté de communes de Châteaubriant-Derval et la chambre d’agriculture. D’un coût total de 4,6 millions d’euros, l’installation valorise notamment des déchets, des effluents d’élevage et de productions agricoles pour produire de l’énergie électrique et thermique. « L’ensemble des parties prenantes à ce projet a pris ce dossier à bras le corps il y a déjà sept ans pour faire de la Loire-Atlantique un département pilote dans le domaine de la méthanisation », se félicite la préfecture dans un communiqué. La région Pays de la Loire étant la deuxième région agricole française, elle dispose d’un important gisement de déchets méthanisables. « La France compte actuellement 281 unités de méthanisation, le plan Energie – Méthanisation – Autonomie – Azote prévoit 1 000 unités en 2020 », rappelle également la préfecture, qui souligne « la volonté commune de poursuivre cette politique. » Les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour l’éolien en mer sont bien en deçà des attentes des professionnels de la filière. Avec 5 GW d’ici 2028 d’éolien posé en mer et 500 MW d’éolien flottant entre 2020 et 2022, l’ambition affichée ne permet pas « de consolider les investissements publics et privés déjà réalisés ». C’est donc pour sonner l’alarme, et exprimer leur colère, que 9 entrepreneurs dédiés aux Energies Marines Renouvelables (EMR) ont publié une Lettre Ouverte au Gouvernement, l’invitant à revoir les objectifs annoncés pour la filière. Ils rappellent que la filière représente déjà 2 600 emplois en France et que ce chiffre pourrait fortement augmenter. En effet, un « volume global de projets éoliens offshore posés de l’ordre de 10 GW sur la période 2019-2028 », « un objectif d’au moins 3 GW à l’horizon 2030 » pour l’éolien flottant et « l’intégration au sein de la PPE de la filière hydrolienne » permettrait de générer « 15 000 emplois à l’horizon 2030 ». Par ailleurs, des objectifs plus ambitieux permettent de faire baisser les coûts de la technologie d’autant. « Dès lors qu’on cherche à optimiser les coûts de production de l’électricité et réduire son coût pour le consommateur, l’étude de l’Ademe aboutit à une part très importante des énergies renouvelables (EnR) dans le système électrique français. Pour des niveaux de demandes compris entre 430 TWh et 600 TWh, la trajectoire d’évolution du système électrique français, conduit, selon l’optimum économique à une part des EnR de 85 % en 2050 (et 95 % en 2060) dans l’ensemble des cas, hormis dans les scénarios avec déploiement volontariste d’EPR. » Tels sont les enseignements tirés par l’Ademe de son étude Trajectoires d’évolution du mix électrique 2020-2060. « Pour le consommateur, l’augmentation progressive de la part des EnR dans le mix électrique permet de faire baisser le coût total de l’électricité jusqu’environ 90 €/MWh hors taxe sur le long terme (à comparer au coût actuel, près de 100 €/MWh) », assure l’agence, qui entrevoit « de meilleures conditions de rémunération pour les producteurs d’électricité sur le marché de gros, à condition d’éviter une prolongation trop forte du parc nucléaire historique. » Et d’ajouter : « Dans la plupart de ces scénarios, cette évolution permet un développement des EnR sans système de soutien à partir de 2030 pour le photovoltaïque au sol et à partir de 2035 pour l’éolien terrestre. » Le conseil d’administration de l’Ademe a voté le 7 décembre un budget s’élevant à 761 millions d’euros pour 2019. « Il permet une augmentation de plus de 100 millions d’euros pour la chaleur renouvelable et la mobilité durable », se réjouit l’agence dans un communiqué qui précise que « cette hausse de 55 % par rapport à 2017, en cohérence avec la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), porte le Fonds chaleur à 307 millions d’euros. » Avec + 43 % par rapport à 2018, l’augmentation n’atteint pas encore le doublement réclamé par la filière, mais elle est nettement plus importante que la précédente (+ 9 % entre 2017 et 2018). Autres annonces de l’Ademe, « également en hausse de 50 %, le nouveau Fonds Air Mobilité, créé pour accompagner le projet de loi d’orientation des mobilités et le plan hydrogène, est porté à 30 millions d’euros. De même, 34 millions d’euros sont alloués au programme bâtiment durable. » Enfin, 185 M€ seront consacrés à l’économie circulaire, aux déchets et aux sites pollués. « Plusieurs aspects freinent le développement de la géothermie, en particulier sur notre territoire, expose Camille Mehl, chargée de mission énergies renouvelables à l’Alec (Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde). Parmi ceux-ci, il y a une certaine méconnaissance du potentiel, pourtant le deuxième de France, et il manque le réflexe qui consiste à penser à la géothermie lors de projets de construction. » Pour surmonter ces obstacles, l’Alec, dans le cadre du programme européen Interreg Espace Atlantique, vient de mettre en place quatre formations sur la géothermie basse et très basse énergie. La première, à destination des espaces info-énergie (EIE), s’est tenue le mardi 27 novembre, sur le thème « Comment orienter le particulier vers la géothermie dans l’habitat individuel ? ». « Il s’agit de former les conseillers EIE sur un outil de dimensionnement mis au point par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), donc c’est une formation assez technique », précise Camille Mehl. La deuxième, le 11 décembre, sera en revanche un peu plus généraliste et ouverte aux porteurs de projets. Intitulée « La géothermie, une option énergétique pour vos projets : creusons le sujet ! », elle compte déjà 65 inscrits et l’Alec en espère d’autres. Une journée de formation à destination des élus aura ensuite lieu en février et une dernière session sera organisée pour les artisans afin d’amorcer la professionnalisation de la filière. A l’issue du programme, un kit de formation sera réalisé avec en vidéo des interviews d’experts, des visites de sites, des partages d’expérience… le tout mis gratuitement à disposition sur le site de l’Alec. En parallèle, l’agence a mis en place un groupe d’échanges avec 25 acteurs locaux représentant la filière, qui l’aide notamment à déterminer les objectifs des formations. « Une action de conseil aux entreprises afin de faire connaître les bonnes pratiques est également prévue pour 2019, annonce la chargée de mission. Et un projet pilote de géothermie, parmi ceux que nous accompagnons, doit également être choisi pour servir de démonstrateur au sein du programme Interreg Espace Atlantique. » Les bonnes idées ne manquent pas pour faire sortir la géothermie de terre. Lancé en septembre dernier, le premier appel bi-énergie solaire et éolien du Danemark a rendu son verdict le 3 décembre. Il s’est conclu sur un prix exceptionnellement bas de 3,1 euros/MWh sur vingt ans, a annoncé dans un communiqué l’agence danoise de l’énergie. Sur les 17 offres reçues, 6 ont été retenues : 3 projets éoliens terrestres (pour un total de 165 MW) et 3 projets solaires (pour un total de 104 MW). Les projets lauréats doivent être reliés au réseau dans les deux ans qui suivent la signature du contrat. À noter, pour la première fois depuis l’introduction en Europe d’appels d’offres bi-énergie, des projets éoliens sont parvenus à s’imposer face à des projets solaires. Suite aux annonces du 27 novembre sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la filière du biogaz a promptement réagi par la voix de France gaz renouvelables, qui rassemble l’AAMF, les Chambres d’Agriculture France, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, la FNSEA, France biométhane, GRDF et GRTgaz. L’association souhaite que l’objectif actuel de 10 % de gaz renouvelables dans la consommation de gaz en 2030 soit revu à la hausse à l’issue de la concertation que le gouvernement ouvre avec les parties prenantes. Elle s’inquiète par ailleurs concernant l’enveloppe de soutien public comprise entre 7 et 9 milliards d’euros pour la période 2018-2028, sous condition pour le biométhane d’atteindre un coût de production de 67 €/MWh dès 2023. « La filière est bien sûr résolue à s’engager pour atteindre d’ici 2030 cet ordre de grandeur de coûts. […] Pour autant cet objectif risque de s’avérer impossible à réaliser à si brève échéance si l’on souhaite conserver une approche vertueuse de la gestion des différentes familles d’intrants agricoles et de déchets », prévient-elle. « L’enveloppe envisagée pour le 3e pilier des énergies renouvelables françaises représenterait ainsi sur les dix ans à venir moins de 10 % des soutiens financiers accordés aux ENR. Si la compétitivité est une condition essentielle du développement de la filière, France gaz renouvelables insiste sur la nécessité de piloter avec progressivité la trajectoire de baisse des prix de rachat, afin de laisser le temps nécessaire à la filière de consolider l’industrialisation en cours, au risque sinon de casser la dynamique », explique par ailleurs l’association, qui juge également « indispensable, en complément des aspects énergétiques, de rémunérer les services rendus par la méthanisation à l’environnement et à la collectivité. » Et son président, Jacques-Pierre Quaak, de conclure: « avec déjà plus de 11TWh de projets en portefeuille, l’objectif de 8TWh en 2023 de biométhane injecté dans les réseaux gaz peut être largement dépassé. Il faut laisser sa chance au gaz renouvelable made in France. » Devant initialement être présentées en juin 2018, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ont finalement été dévoilées le 27 novembre. Présenté comme l’objectif n° 1, la réduction de la consommation d’énergie vise à multiplier les « bâtiments performants, rénovés et intégrant des énergies renouvelables. » Pour atteindre 40 % d’énergies renouvelables électriques dans la production nationale en 2030, « les filières principales […] seront l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque (PV) et l’éolien terrestre, puis progressivement l’éolien en mer dont la production augmentera au cours de la seconde période de la PPE. Les fortes baisses de coûts observées dans ces filières permettent des développements importants avec des soutiens publics limités. Les sources dont les coûts sont très élevés pour la production d’électricité (biomasse, géothermie) seront orientées prioritairement vers la production de chaleur et aucun soutien à la production d’électricité pour ces filières ne sera mis en œuvre », précise un communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire. L’accent est également mis sur la chaleur renouvelable, « vecteur essentiel de décarbonation. » Avec, notamment, l’ambition de « rendre obligatoire un taux minimum de chaleur renouvelable, qui sera instauré dans tous les bâtiments neufs (individuel, collectif et tertiaire) dès 2020 » et de « renforcer le Fonds chaleur dès 2018 avec un budget de 315 M€ en 2019 et 350 M€ en 2020 et en simplifier l’utilisation. » Les carburants biosourcés et le biogaz ou le gaz de synthèse (avec l’objectif que 10 % de la consommation de gaz soit d’origine renouvelable en 2030), ainsi que l’hydrogène, sont également encouragés. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a salué dans un communiqué « une trajectoire claire qui doit permettre une véritable montée en puissance des énergies renouvelables. » Mais l’organisme « souhaite poursuivre les échanges avec le gouvernement dans les prochaines semaines afin d’affiner les trajectoires de certaines filières, particulièrement les énergies marines renouvelables », a expliqué son président, Jean-Louis Bal. La PPE doit maintenant être traduite dans un projet de décret qui sera soumis, comme la SNBC, à une vaste consultation. Un projet de loi pour amender le report de l’objectif de baisse de la part du nucléaire à 50 % en 2035 – une date qui devient officielle – et non à 2025 comme inscrit dans la loi de transition énergétique de 2015 devra également être examiné par le Parlement. À l’occasion du Salon des maires, le SIAAP (principal syndicat d’assainissement d’Île-de-France) et GRDF ont signé une convention de partenariat en faveur du développement de la production de biométhane grâce à la méthanisation des boues des usines d’épuration des eaux usées. Outre la valorisation de ressources comme l’azote, le phosphore, et le carbone grâce à l’épandage des boues, la méthanisation des boues de stations d’épuration permet de produire du biogaz qui, épuré en biométhane, est injectable dans le réseau de gaz naturel exploité par GRDF, expliquent les partenaires dans un communiqué en date du 21 novembre. EDF Renouvelables au Brésil a annoncé le 28 novembre la signature d’un contrat de vente d’électricité de long terme (PPA) d’une durée de 20 ans avec Braskem, un des leaders mondiaux dans la fabrication de résines thermoplastiques. L’électricité sera produite par un projet éolien d’une capacité installée de 33 MW et situé à 350 km au nord-ouest de Salvador dans l’État de Bahia. La construction de cette extension du projet éolien de Folha Larga 1 (d’une capacité initiale de 114 MW) débutera en 2019. Elle a été remportée à l’enchère fédérale brésilienne d’avril 2018. « À travers ce contrat, Braskem est le premier industriel au Brésil à rejoindre les grandes entreprises qui comme Google, Microsoft, Kimberly-Clark, Salesforce, Procter & Gamble, Walmart et Yahoo font confiance à EDF pour leur fournir de l’électricité renouvelable et les accompagner ainsi dans leur transition énergétique », se réjouit le groupe dans un communiqué. « Avec un portefeuille d’environ 1000 MW de projets éoliens et solaires en construction ou en exploitation au Brésil, EDF Renouvelables figure parmi les leaders du secteur », ajoute l’entreprise. Dans son étude stratégique sur l’hydrolien marin, réalisée aux mois de mai et juin et publiée lundi 19 novembre, l’Ademe ne se montre pas très optimiste sur l’état d’avancement et les perspectives commerciales de la filière. « Un gisement très localisé et relativement limité, une filière dont la maturité technologique reste encore à parfaire […], des coûts en LCOE qui devraient rester au-dessus des 120€/MWh, même avec un développement industriel, […] et une place qui apparaît dans les mix énergétiques des Etats uniquement pour de forts taux d’intégration d’énergies renouvelables », telles sont les conclusions de ce document censé éclairer le gouvernement dans ses choix concernant un éventuel appel d’offres commercial pour cette technologie. « Au regard du rythme de développement de l’éolien offshore et au vu de la base installée de turbines hydroliennes par pays à date, le passage de l’hydrolien à un stade commercial parait anormal dans le court-terme. À un rythme de développement comparable, il faudrait encore 5 à 8 ans à la filière hydrolienne pour tester, optimiser et améliorer les turbines avant de lancer de vrais appels d’offres commerciaux », juge l’Ademe, qui estime que « même si une bonne partie des verrous techniques ont été résolus, la durée cumulée de test reste très faible et la majorité de la filière considère qu’elle ne peut garantir à date une absence d’avaries durant les premières années d’exploitation. » Pour autant, « l’intégration de l’hydrolien marin dans les zones isolées type ZNI [zones non-interconnectées, ndlr] est pertinente à court terme avec des LCOE proches de ceux des générateurs diesel et qui sont amenés à décroître au fil des années », veut croire l’agence, qui ajoute que « seuls le Canada (Nouvelle-Ecosse) et les ZNI à l’international pourraient être en mesure de constituer – en l’état des informations disponibles – la base d’un scénario stable à 2030. » L’étude souligne enfin « un positionnement compétitif de la filière française qui reste bon relativement aux autres pays, de par notamment la complétude de sa chaine de sous-traitants et l’avancement des acteurs clés tels les turbiniers, les acteurs de la connectique, etc. » Pour autant, « les éléments de visibilité sur la stratégie long terme et la pertinence de soutenir le développement commercial de la filière ne permettent pas de scénariser une base installée supérieure à 29 MW en 2030 », prévient l’agence. Au lendemain du dîner caritatif annuel organisé par Synergie solaire, sa présidente, Hélène Demaegdt, a répondu à nos questions sur les changements introduits par la loi PACTE et ses incidences sur Synergie solaire et ses partenaires. Le JDER : Concrètement, quelles sont les incidences de la loi sur l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et les entreprises à mission ? « Une entreprise à mission est une entreprise ou société commerciale qui intègre dans ses statuts un objectif d’ordre social ou environnemental. Cela signifie que l’entreprise se donne officiellement une mission qui vise à l’intérêt général, comme par exemple “l’accès aux Energies durables pour les plus démunis”, qui est l’objet même de Synergie Solaire. Les entreprises qui veulent développer leur RSE ou devenir entreprise à mission proprement dit peuvent ainsi s’approprier notre fonds de dotation et devenir grand donateur (15 000 € /an minimum). Elles peuvent ainsi intégrer la gouvernance, mais surtout bénéficier de notre expérience et être directement opérationnels. Ce, grâce à nos outils et réseaux développés depuis 2010. Enfin, Synergie Solaire met en place également du mécénat de compétence pour permettre aux collaborateurs de vivre concrètement cette implication de l’entreprise. » Le JDER : Quelles conséquences pour l’activité de Synergie solaire ? « Le fonds de dotation Synergie Solaire a depuis toujours été créé pour être au service des OnG et de toute une filière c’est à dire d’un ensemble d’entreprises qui pouvaient être concurrentes ou partenaires. Pour répondre à l’urgence écologique, nous proposons de dépasser la vision strictement économique de l’entreprise et d’y inclure une vision sociale et environnementale plus large , qui donne aussi du sens. Ce n’est plus de la philanthropie c’est bien plus que cela, et la loi Pacte ouvre la voie vers les véritables rôles que l’entreprise peut jouer dans la société. Synergie solaire a déjà bénéficié des dons de 170 entreprises de la filière énergies renouvelables, mais nous espérons voir grandir le nombre d’entreprises engagées avec nous, à travers nous, et surtout leur implication dans le long terme. » Le producteur et fournisseur d’électricité d’origine renouvelable Enercoop a annoncé le 21 novembre le lancement d’un appel d’offres pour des projets neufs d’énergies renouvelables (entre 1 et 10 MW). « L’appel d’offres est ouvert à tous les porteurs de projets et développeurs et vise à sélectionner les projets neufs d’énergies renouvelables qui pourront bénéficier d’un achat de leur production par Enercoop dans la durée (20 à 30 ans) et hors soutien public, pour une mise en service prévisionnelle avant fin 2020. L’électricité 100 % renouvelable qui sera achetée dans le cadre de cette consultation sera destinée à approvisionner exclusivement les clients-consommateurs Enercoop », précise la coopérative dans un communiqué. Enercoop affiche ainsi « sa volonté de passer à la vitesse supérieure en établissant des contrats d’achat de long terme pour des projets neufs hors soutien public », insiste l’Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS). Enercoop est « fier de contribuer à l’émergence de ce nouveau modèle […] en cherchant à le rendre autant que possible accessible aux projets citoyens en amont et aux consommateurs de plus petite taille, en aval. » Pour cette consultation, le calendrier prévisionnel est le suivant : manifestation d’intérêt et de signature de l’accord de confidentialité jusqu’au 12 décembre, soumission des projets jusqu’au 18 janvier et sélection des projets jugés d’intérêt jusqu’au 22 février. Les députés européens ont validé le 13 novembre l’objectif, contraignant, qui vise à atteindre d’ici 2030 une part de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute de l’UE (contre environ 17 % en 2016). Ils ont également adopté leur rapport sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et validé l’objectif d’accroître de 32,5 % l’efficacité énergétique globale des pays membres d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990. S’inscrivant dans l’application de l’accord de Paris sur le climat, cette résolution législative a été adoptée à 434 voix pour (104 contre). Si cet objectif est indicatif, ce qu’ont regretté certains eurodéputés, « c’est véritablement un texte européen où il faut que tout le monde joue le jeu, quitte à jouer après sur les recommandations de la Commission si un Etat ne respecte pas ses objectifs », a assuré, lors d’une conférence de presse, l’écologiste Michèle Rivasi, co-rapporteure du texte. Ces deux objectifs pourront être révisés à la hausse en 2023 en fonction notamment des avancées technologiques dans le domaine. Chaque pays devra aussi présenter un plan tous les dix ans en détaillant sa contribution pour atteindre ces objectifs et les mesures prises au plan national. Ces nouvelles obligations doivent encore obtenir l’aval formel du Conseil européen pour entrer en vigueur. Ces textes introduisent par ailleurs le droit à l’autoconsommation pour les citoyens européens auront le droit de produire de l’énergie renouvelable pour leur propre consommation, mais aussi de stocker et de vendre l’excédent. D’ici la fin de cette année, les États membres doivent faire parvenir à Bruxelles leurs premiers projets de plan national énergie/climat pour la prochaine décennie, tandis que la Commission doit adopter, pour février 2019, de nouveaux textes réglementaires qui complèteront la directive ENR en définissant des critères pour la certification des biocarburants et combustibles issus de la biomasse. L’Ademe a annoncé la création d’Ademe Investissement SAS, autorisée par un décret paru au Journal officiel du 11 novembre 2018. Cette société gérera les interventions en fonds propres de l’agence pour le compte de l’État dans le cadre du Grand plan d’investissements. Doté de 400 millions d’euros par la loi de finances 2017, il s’agit du « premier outil public de financement en fonds propres des infrastructures innovantes, aux côtés d’investisseurs privés », explique l’Ademe dans un communiqué du 13 novembre. « Il permettra d’accompagner les premières mises en œuvre commerciales issues de projets de recherche et d’innovation dans le domaine de la transition écologique et énergétique, notamment ceux soutenus jusqu’ici dans le cadre du programme ”Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique” du Programme d’investissements d’avenir. » Le président de l’Ademe, Arnaud Leroy, explique : « le déploiement des projets d’infrastructures innovantes ainsi que la mise sur le marché rapide d’innovations concourent à accélérer la transition énergétique. La société Ademe Investissement va faciliter les premières commerciales en apportant une partie du financement sous la forme de fonds propres et en catalysant les autres financements. » « Nous allons calibrer un développement qui est assez important, qui va nous conduire à mobiliser, avec nos partenaires évidemment, jusqu’à 800 millions d’euros à l’horizon 2023 » pour le développement du biométhane, a déclaré la directrice générale d’Engie, Isabelle Kocher, à l’occasion de l’inauguration de l’unité de méthanisation de Beauce Gâtinais Biogaz sur la commune d’Escrennes (Loiret). Cette somme devrait atteindre près de 2 milliards d’euros d’ici à 2030 pour un volume de 5 TWh de biométhane par an à cet horizon. « Notre objectif, c’est de gagner entre 30 et 40 % en termes de coûts de ces filières à l’horizon 2030, pour une raison simple : cela permettra la parité en termes de coûts avec le gaz naturel. C’est l’objectif », a-t-elle ajouté. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a pour sa part expliqué que « pour le gaz renouvelable c’est encore un chemin un peu plus long, on est encore plus loin en termes de prix [du marché] et c’est pourquoi nous avons demandé un effort aux industriels pour qu’ils puissent faire baisser les coûts de production. » Il a ainsi encouragé des « méthaniseurs à grande échelle » et s’est dit prêt à « revoir » les règles qui pourraient encore peser sur les coûts de la filière. Énergie Partagée fête son 8e anniversaire. L’entreprise solidaire publie à cette occasion un livret regroupant les 50 projets qu’elle a financé grâce à 16,6 millions d’euros d’épargne de plus de 5 200 actionnaires. « Partout en France, 45 éoliennes, 50 000 panneaux solaires, des réseaux de chaleur, des centrales hydroélectriques et même des unités de méthanisation sont sortis de terre », se réjouit-elle. « Les projets qui se préparent sont tout aussi motivants que ceux qui ont déjà été menés et nous avons besoin d’accélérer leur développement. Le cap est clair : nous devons collecter 10 millions d’euros supplémentaires pour financer les demandes que nous avons sur nos nouveaux projets d’ici 2020 », explique l’entreprise. Et d’afficher l’objectif suivant : « Les installations citoyennes doivent représenter 15 % des énergies renouvelables installées en 2030 ! » Énergie partagée souligne qu’« à la différence des plateformes de crowdfunding, Énergie Partagée finance les projets en fonds propres et accompagne les porteurs tout au long de la vie des projets. » Le producteur indépendant français d’énergie renouvelable, Akuo Energy a finalisé auprès d’EDF Renouvelables, l’acquisition de CHB, un portefeuille de quatre centrales hydroélectriques en exploitation en Bulgarie d’une capacité installée de 63 MW. Cette opération « permet au groupe français de se doter d’une équipe de 30 ingénieurs et techniciens spécialisés dans l’exploitation et la maintenance de centrales hydroélectriques », précise le groupe dans un communiqué du 5 novembre. « Cette acquisition nous permet d’enrichir nos compétences dans l’hydroélectricité et la vente d’électricité sur le marché ; elle vient aussi rééquilibrer avantageusement notre mix énergétique », ajoute Eric Scotto, PDG et cofondateur d’Akuo Energy. L’Ademe, Amorce, la Fedene et le Syndicat des énergies renouvelables (CER) organisent les 4, 5 et 6 décembre la semaine de la chaleur renouvelable au Forum des Images à Paris. Ces trois journées ont pour but de réaffirmer le rôle fondamental de la chaleur renouvelable dans la transition énergétique. À destination des entreprises, des collectivités locales et de l’ensemble des prescripteurs, ces journées permettront d’échanger et de présenter les outils mis à disposition pour faciliter le passage à l’acte. Lors de la première journée, trois parcours sont organisés en direction des différents publics : le Parcours collectivités/réseaux de chaleur, le Parcours entreprises et le Parcours habitat. La journée du 5 décembre proposera, à travers 10 ateliers, un panorama des atouts de chaque filière. La dernière journée invitera le grand public à visiter des installations près de chez lui dans toute la France. Le canton de Genève, en Suisse, s’est fixé un objectif ambitieux : couvrir 20 % de ses besoins en chauffage grâce à la géothermie d’ici 2020. Pour y parvenir, il a mis en place le programme GEothermie 2020, qui consiste à mener des explorations et prospections pour connaître le potentiel du canton en matière de géothermie mais également à développer une filière professionnelle dans le domaine. Au moins d’octobre, les résultats du premier forage exploratoire mené dans le cadre de ce programme ont été présentés : ils révèlent dans la région de Satigny, entre 400 et 745 mètres de profondeur, des débits de plus de 50 litres/seconde d’une eau à une température moyenne de 33 °C. Des résultats fidèles aux hypothèses émises par les premières cartographies réalisées depuis la surface. Trois autres forages exploratoires sont prévus en 2019. « En parallèle, afin de sélectionner le maximum de lieux favorables au développement de projets de géothermie, les SIG réaliseront deux nouvelles campagnes de prospection de grande envergure », annonce le canton dans un communiqué. La première a débuté fin octobre dans la région d’Avusy pour sonder le sous-sol sur 125 km, dont 36 km du côté français de la frontière. « Il s’agit d’une gestion coordonnée d’acquisition des données transfrontalières dans le but de développer la géothermie, affirme M. Pierre-Jean Crastes, président de la Communauté de communes du Genevois dans un communiqué. Il ne faut pas oublier que le bassin genevois est franco-suisse et donc ses ressources traversent les frontières ». La seconde campagne de prospection aura lieu en 2019-2020 et son tracé sera décidé en fonction des résultats des premiers tests. « Ces travaux de prospection associés aux forages exploratoires fourniront une cartographie détaillée du sous-sol genevois et permettront de localiser les sites favorables à l’exploitation de la géothermie d’ici à deux ans sur l’ensemble du territoire, conclut le canton. Ces opérations sont décisives pour augmenter les chances de succès des futurs forages et de garantir une utilisation durable et maîtrisée de la géothermie. » GRDF, GRTgaz et Teréga ont signé avec l’Université Paris Diderot le projet MARS (Méthane renouvelable solaire), un contrat de recherche pour développer des solutions de stockage de l’énergie solaire et de valorisation du CO2 en méthane. Ces recherches permettraient à terme de proposer une solution de recyclage du gaz carbonique en méthane en y stockant au passage de l’énergie solaire. « Recherche fondamentale et recherche appliquée, qu’elles soient académiques ou industrielles, vont ainsi travailler en synergie au développement d’un procédé qui devrait, permettre de transformer le CO2 en une source d’énergie courante et compatible avec les usages actuels, en utilisant la lumière du soleil et une molécule à base de fer », expliquent les partenaires dans un communiqué commun daté du 26 octobre. Le projet MARS s’inscrit dans une démarche conjointe entre acteurs de l’énergie et recherches scientifiques, le développement des résultats et des phases de test se feront conjointement entre les différents acteurs afin de vérifier l’application des solutions proposées par l’Université Paris Diderot aux métiers de la filière gaz naturel. La région Normandie s’est alliée avec le groupe britannique Simec Atlantis Energy pour développer un nouveau projet hydrolien. Le groupe britannique a en effet créé une co-entreprise avec plusieurs institutions régionales (agences de développement, fonds régional d’investissement) pour installer et exploiter plusieurs GW dans la zone du Raz Blanchard. Si le montant des investissements prévus n’est pas précisé, la nouvelle structure, baptisée Normandie Hydrolienne et qui sera détenue à majorité par Atlantis Energy, prévoit de construire et assembler dans la région les turbines utilisées dans ce projet. Atlantis Energy, qui exploite déjà des hydroliennes en Ecosse, « prévoit la livraison d’une capacité opérationnelle initiale de 1 GW dès 2025, qui pourrait être rapidement portée à 2 GW d’ici 2027 », indique son PDG, Tim Cornélius, cité dans un communiqué du 30 octobre. L’heure est désormais à l’obtention des autorisations locales et nationales, ainsi qu’à la confirmation de la faisabilité technico-économique des futurs parcs. La présentation des grandes orientations du gouvernement pour le secteur de l’énergie (Programmation pluriannuelle de l’énergie – PPE – pour les années 2019-2023 et 2024-2028) est de nouveau repoussée à « courant novembre », a annoncé le 24 octobre la nouvelle secrétaire d’État à la Transition écologique, Emmanuelle Wargon. « L’annonce ne sera pas le 30 octobre, ce sera courant novembre. », a-t-elle expliqué sur RMC. Initialement prévue pour fin juin, la présentation de la PPE avait dernièrement été repoussée à la fin octobre. Emmanuel Macron a par ailleurs une « Rencontre avec des acteurs de l’énergie » inscrite à son agenda ce mercredi 24 octobre. Il reçoit en effet des patrons d’entreprises et d’organismes de recherche à l’Élysée. Trois ministres seront présents : François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En réaction à l’absence d’invitation à cette réunion, des représentants d’« acteurs de la transition énergétique […] entreprises des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, associations, collectivités, syndicats » tiendront en même temps dans un lieu public proche de l’Élysée, leur propre réunion de travail sur la PPE. « Le conseil d’administration de l’Ademe a voté, le 18 octobre, une hausse du budget du fonds de 14% pour 2018. Le budget initial de 215 M€ est porté à 245 M€ », a annoncé l’agence dans un communiqué en date du 22 octobre. Le Fonds chaleur, géré par l’Ademe depuis 2009, participe au développement de la production renouvelable de chaleur grâce à la biomasse, la géothermie ou le solaire. Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises. Pour 2019, François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, a indiqué le 2 octobre lors d’une audition au sénat que le Fonds chaleur sera porté à 300 M€. La Commission européenne a donné son feu vert à une aide d’État de 200 millions d’euros consentie par la France pour soutenir la production d’électricité à partir de sources renouvelables à des fins d’autoconsommation jusqu’en 2020. Ce soutien est accessible aux petites installations d’une capacité comprise entre 100 et 500 kW et les bénéficiaires seront sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres organisés jusqu’en 2020, auxquels toutes les technologies liées aux énergies renouvelables peuvent participer. Les installations sélectionnées bénéficieront alors d’un soutien sous la forme d’une prime, accordée pour une période de 10 ans, et d’un complément de rémunération. Dans un communiqué du 22 octobre, l’exécutif européen note que ce soutien public aidera au déploiement d’une capacité de production supplémentaire de 490 MW. « Ce régime stimulera la concurrence entre les sources d’énergie renouvelables pour les autoproducteurs et augmentera davantage encore la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la France », explique Margrethe Vestager, la commissaire à la Concurrence, citée dans le document. « La collaboration entre l’Ademe et la Région Grand Est existe depuis plus de 20 ans, retrace Christèle Willer, vice-présidente de la transition énergétique et de l’environnement de la Région. Mais depuis juillet 2017, elle a pris une nouvelle forme avec la mise en place du programme Climaxion, qui vise à soutenir financièrement le développement des énergies renouvelables. » Et parmi celles-ci, la géothermie de surface. Avec 3 850 installations (incluant celles des particuliers), elle ne représente aujourd’hui que 1,1 % de la production renouvelable de la région, mais l’objectif est de la faire monter en puissance, en accompagnant les porteurs de projet. « Climaxion s’adresse aux collectivités, aux associations, aux entreprises, aux exploitants agricoles… bref, à tous ceux qui peuvent mettre en place des installations géothermales assez importantes pour obtenir un retour sur investissement et faire progresser le mix énergétique de la région, précise Christèle Willer. Il ne s’agit évidemment pas de créer un appel d’air mais bien d’aider à la réalisation de projets qui ont du sens. » C’est pourquoi il n’y a pas d’objectif chiffré ni même de budget réellement dédié. Le financement des projets de géothermie se fait sur le budget global de 5 millions d’euros (pour 2018) attribué aux énergies renouvelables. Depuis juin 2017, 26 dossiers ont ainsi pu bénéficier de 734 427 € de subventions de la part de la Région, couvrant entre 40 et 50 % du coût des études ou des travaux. Et le Grand-Est entend bien continuer en ce sens et même, amplifier le mouvement. « Le bilan 2018 ainsi qu’un état des lieux du potentiel de la géothermie de surface sont en cours de finalisation, annonce la vice-présidente. Pour 2019, nous allons nous appuyer sur ce dernier pour informer et sensibiliser les porteurs de projet potentiels et continuer à améliorer la communication et le partage d’expérience pour faire émerger de nouveaux dossiers et inciter les acteurs à s’emparer de cette opportunité. » Après une longue attente, le suspense a pris fin mardi 16 octobre en début de matinée lorsque l’Elysée a annoncé le nouveau gouvernement par communiqué. Emmanuelle Wargon, qui était directrice générale des affaires publiques de la communication de Danone, remplace Sébastien Lecornu comme secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce dernier, devient ministre chargé des collectivités territoriales. Il épaulera ainsi Jacqueline Gourault, nommée mardi à la tête d’un grand ministère de la Cohésion des territoires. Ce jeune homme (32 ans) a pour lui d’avoir encadré les trois groupes de travail sur l’éolien, le solaire et la méthanisation durant son passage au ministère de la Transition écologique et solidaire. Il était aussi à la manœuvre sur les Contrats de transition écologique (CTE), censés aider les territoires à organiser leur transition dans l’énergie, le recyclage, la protection de l’environnement, etc. et dont le premier a été signé le 11 octobre entre l’État et la Communauté urbaine d’Arras. Une quarantaine de projets, de réduction des consommations d’énergie, de mobilité propre ou de développement des énergies renouvelables, ont été retenus et mobiliseront des financements de 48 millions d’euros sur 4 ans de la part des différents partenaires impliqués. La région Île-de-France et la direction régionale Île-de-France de l’Ademe ont lancé la 8e session de l’appel à projets sur la chaleur renouvelable et des réseaux de chaleur. Les pré-candidatures doivent être déposées jusqu’au 24 octobre et les candidatures jusqu’au 19 décembre prochain. Cet appel à projets « s’adresse aux maîtres d’ouvrages publics et privés souhaitant développer une installation de production de chaleur renouvelable, de gaz renouvelable ou de réseau alimenté en chaleur renouvelable », précise l’Ademe. Il a pour objectif de financer les projets d’extensions, de création, de densification ou d’interconnexion de réseaux de chaleur, pour les réseaux de chaleur valorisant plus de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). La performance énergétique du réseau sera également prise en compte. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier, par des subventions du Fonds chaleur, du Fonds déchets et/ou des aides régionales. L’Ademe souligne que « la création d’une chaufferie biomasse doit être justifiée par l’impossibilité de recourir aux autres EnR&R (critère de sélection fort de l’appel à projets) ». Il est également précisé qu’une « attention particulière est portée sur la provenance et la qualité de l’approvisionnement ». Les énergies renouvelables vont continuer de progresser ces cinq prochaines années et en particulier les bioénergies, estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans la dernière édition de son rapport annuel sur les perspectives des énergies renouvelables (Renewables 2018), publié le 8 octobre et qui porte sur la période 2018-2023. L’Agence estime en effet que les énergies renouvelables vont poursuivre leur progression, surtout dans le secteur de l’électricité : elles représenteront presque un tiers de la production électrique dans cinq ans. Toujours dans l’électricité, les capacités renouvelables ont progressé de 178 GW l’an dernier, tirées par le solaire (97 GW), dont plus de la moitié ont été installées en Chine. La croissance de l’éolien terrestre a en revanche ralenti pour atteindre 44 GW de capacités nouvelles. Mais « les usages des renouvelables s’étendent beaucoup plus lentement dans les secteurs des transports et de la chaleur », regrette l’AIE, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique. Elle en profite pour souligner le rôle important mais sous-estimé de la bioénergie, produite à partir de biomasse, qui constitue la plus grosse source d’énergie renouvelable en raison de son utilisation pour le chauffage et les transports. « Sa part dans la consommation totale d’énergie renouvelable dans le monde est d’environ 50 % aujourd’hui, en d’autres termes autant que l’hydro, l’éolien, le solaire et toutes les autres énergies renouvelables combinées », souligne le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, lors d’une audition au Sénat le 2 octobre, a annoncé que le fonds chaleur augmentera à 300 millions d’euros en 2019. Dans un communiqué du 8 octobre, le Club de la chaleur renouvelable « se félicite » de l’annonce du ministre, mais « attend sa confirmation dans le projet de loi de finances pour 2019, sous la forme d’une augmentation du budget de l’Ademe », laquelle gère ce fonds qui permet de soutenir la production de chaleur à partir d’énergies renouvelables. « Cette première étape vers le doublement nécessaire du Fonds chaleur annoncé par le Président de la République pendant la campagne présidentielle est une avancée importante », ajoute le Club, qui « sera également attentif à la manière dont ce renforcement de l’enveloppe du Fonds chaleur se répercutera sur le niveau d’aide accordé à chaque projet. Celui-ci doit, en effet, impérativement permettre de renforcer l’attractivité des projets de chaleur renouvelable et de récupération, à la fois pour les monteurs de projets mais aussi pour les usagers (ménages, activités tertiaires ou industrielles), qui doivent bénéficier d’une offre compétitive par rapport aux modes de chauffage à partir d’énergies fossiles ou électriques. » À la suite d’un appel à projets lancé par Voies navigables de France en 2015, le groupement HydroQuest-Hydrowatt a été retenu pour l’installation de quatre hydroliennes fluviales dans le Rhône, à Caluire et Cuire, près de Lyon, a fait savoir le consortium dans un communiqué du 8 octobre. Actuellement assemblées au Port de Lyon Edouard Herriot, les hydroliennes seront acheminées par voie fluviale puis installées et immergées dans le Rhône courant octobre, pour un raccordement et une mise en service d’ici la fin de l’année. « Ce parc hydrolien permettra de produire 1 GWh d’électricité par an », avance le communiqué qui précise qu’avec 320 kW de puissance installée, « ce projet représente une première mondiale dans le domaine du fluvial. » Le projet de ferme hydrolienne a été testé par HydroQuest à Orléans sur la Loire depuis 2015. Un autre projet de plus grande envergure, un parc de 39 hydroliennes, est prévu dans l’Ain en amont du barrage de Génissiat courant 2019. Albioma a annoncé la « mise en service industriel », le 26 septembre, de sa centrale 100 % bagasse/biomasse Galion 2 en Martinique. Elle « multipliera par trois la production d’électricité renouvelable sur l’île (passant de 7 % à 22 %) », précise la compagnie dans un communiqué publié le 1er octobre. D’une puissance installée de 40 MW, l’installation fournira toute l’année, en plus de la vapeur pour alimenter la sucrerie du Galion, de l’électricité pour le réseau électrique de la Martinique à partir de la combustion de bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre, d’autres formes locales de biomasse d’origine végétale et de résidus de bois d’œuvre, en provenance d’exploitations forestières gérées durablement. « Les essais de la centrale ont débuté en janvier 2018, l’installation a pu fournir à la sucrerie du Galion la vapeur dont celle-ci avait besoin pendant la campagne sucrière, les tests de conformité au référentiel EDF se sont déroulés pendant l’été, détaille Albioma. La validation des résultats de cette dernière étape permet le démarrage du contrat conclu avec EDF pour une durée de 30 ans ». L’Agence danoise de l’énergie a annoncé le 27 septembre le lancement d’un appel d’offres bi-énergie solaire et éolien. Les projets, dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 novembre prochain, devront ainsi proposer le meilleur prix pour espérer être sélectionnés. « Le budget pour ces appels d’offres neutres technologiquement en 2018-2019 est de 842 millions de couronnes danoises [113 M€] dont 254 MDKK [34 M€] seront attribuées en 2018 et le reste lors d’une prochaine enchère à l’automne 2019 », est-il précisé dans un communiqué. Au final, cet appel d’offres devrait permettre l’installation de l’équivalent de 140 MW d’éolien à terre, précise l’agence. Un autre appel d’offres a été lancé le 13 septembre au Danemark, ils concernaient les installations solaires photovoltaïques de petite taille. Engie Réseaux Bourgogne Franche Comté, en partenariat avec Nicéphore Cité, a annoncé le lancement d’un appel d’offres visant à identifier des solutions innovantes permettant d’améliorer la précision de localisation des fuites d’eau sur un réseau de chaleur en fonctionnement et de mieux évaluer le débit de fuite. « L’objectif de cet appel à projet est de proposer un système complémentaire aux solutions actuelles utilisées pour localiser les fuites des réseaux d’eau chaude et d’eau surchauffée, explique l’entreprise. La solution innovante proposée doit permettre de localiser une fuite à 50 cm près et d’évaluer le débit de fuite sans occasionner de coupure du service de fourniture de chaleur, avec un coût de mise en œuvre réduit. Le système doit être facilement utilisable et robuste », est-il précisé. La date limite de participation est fixée au 20 décembre à minuit. Engie Réseaux Bourgogne Franche Comté mettra à disposition du lauréat une installation permettant la mise en place d’un pilote pour une durée de 9 mois. Au vu des résultats, une collaboration commerciale pourra être envisagée et, le cas échéant, être étendue à l’ensemble du périmètre d’Engie Réseaux. C’est précisément là que François de Rugy a choisi d’effectuer, le 7 septembre, son premier déplacement officiel en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. La centrale géothermique de Cachan s’est en effet offert une nouvelle jeunesse et améliore ses performances grâce à une innovation mondiale : le forage sub-horizontal. Deux puits de moins et 100 m3/h de débit de plus… voilà le défi que vient de relever Dalkia sur la centrale géothermique de Cachan, dans le Val-de-Marne. Comment ? Grâce aux forages sub-horizontaux, qui ont remplacé les forages traditionnels, en place depuis 1984. Ces derniers s’enfonçaient à la verticale sur 400 m puis avec un angle de 40° sur 1400 m alors que les sub-horizontaux ont consisté à creuser environ 1600 m à la verticale, puis 1 000 m avec un angle de près de 90°. « La technique avait déjà été éprouvée par l’industrie pétrolière mais pour des diamètres de forage plus petits, souligne Célia Robert, chargée de projet chez Dalkia. Mais en matière de géothermie, c’est une première mondiale, une véritable innovation. » La difficulté étant en outre que la partie horizontale du forage doit être bien droite: Dalkia puise l’eau dans une nappe du Dogger qui ne fait que 50 mètres d’épaisseur ! L’intérêt cependant de cette technique, c’est que l’eau, ici à 69 °C, s’accumule dans la partie horizontale puis remonte, aidée d’une pompe, le long des forages verticaux jusqu’à la surface. Et c’est ainsi que le débit augmente : il est passé de 350 m3/h à 450 m3/h alors que seuls deux forages sub-horizontaux ont été creusés en remplacement des 4 puits précédents. Le réseau de chaleur alimenté par la centrale va ainsi voir passer son pourcentage d’énergie renouvelable d’environ 60 % à au moins 66 % « et sans doute même à 70 ou 75 % », précise Célia Robert. D’une longueur de 12 km, il alimente aujourd’hui l’équivalent de 7 000 logements, y compris des bâtiments publics. Le chantier n’est cependant pas encore achevé : les forages ont commencé en septembre 2017, se sont achevés en mars 2018… et ce sont maintenant tous les équipements de la boucle géothermale qui sont en commande ou en cours d’installation. « L’ensemble de la centrale avait plus de 30 ans donc tout est à changer et à adapter aux nouveaux débits, note la chargée de projet. La mise en service est donc prévue pour octobre 2019. » Au total, un investissement de 19 millions d’euros aura été nécessaire pour cette unité innovante de 13,5 MW, qui permettra d’économiser 12 000 tonnes de CO2 par an, par rapport à une solution au gaz. « Malgré une dynamique impressionnante (la plus forte en Europe) sur le nombre d’unités, la France reste ”un petit pays” du biométhane au sens de la capacité, peut-on lire dans le dernier Observatoire européen publié le 25 septembre par France biométhane. Avec les tailles d’unités actuelles, il faudrait atteindre un total de 120 centrales pour dépasser les 40 000 Nm3/h et rejoindre le podium européen. » Pour autant, « la France prend une trajectoire propre », souligne l’organisme. Avec 18 nouvelles centrales sur les 48 nouvelles installation en Europe, la France regroupe un tiers des nouvelles unités en Europe. En revanche la capacité des centrales de biométhane françaises, largement en dessous la moyenne européenne (340 Nm3/h versus 937 Nm3/h de biogaz traité par installation) « empêche la France de bénéficier d’un coût de production du biométhane plus faible. Un constat qui s’explique par les nombreuses contraintes réglementaires et législatives qui persistent », selon Cédric de Saint Jouan, président du think Tank. La filière allemande reste de son côté leader du marché européen, même si son rythme de progression semble se stabiliser à 8 nouvelles unités par an sur les 3 dernières années. A contrario, et après une ascension fulgurante en 2016, le dynamisme du biométhane au Royaume-Uni ralentit nettement. Enfin, le Danemark et les Pays-Bas enregistrent une belle progression autant sur la capacité que sur le nombre d’unités et pourraient bientôt rejoindre la Suède, pays historique de la filière, qui connait peu d’évolution depuis 3 ans. « Avec une enveloppe totale de près de 600 M€/an (dont un tiers au Fonds chaleur), les énergies renouvelables thermiques bénéficient de moins de 10 % des soutiens aux énergies renouvelables dont elles représentent pourtant près de 60 % de la production, indique un rapport interministériel réalisé par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l’économie (CGE). Ainsi, l’augmentation globale de l’aide aux énergies renouvelables thermiques parait justifiée, tant en montant qu’en procédures réglementaires. » Ce document, publié le 24 septembre, avance 14 recommandations pour faire en sorte de maximiser le soutien aux énergies renouvelables thermiques. Elle invite notamment « à mettre à l’étude une modulation de la contribution climat énergie (CCE ou ”taxe carbone”) de nature à préserver la compétitivité de la chaleur des aléas des cours mondiaux des combustibles fossiles. » La mission recommande également une mise à jour annuelle et une publication des données relatives aux aides publiques aux énergies renouvelables thermiques et électriques, en fonction de la quantité de CO2 évité ou du kWh produit, « pour décider des priorités d’aide de la nation à chaque sorte d’énergie. » Elle souhaite également que « le cas de la cogénération soit spécifiquement étudié pour sa contribution à la chaleur et non à l’électricité, dans l’idée d’en basculer une partie sur le Fonds chaleur au profit de cette même cogénération et pour ne pas favoriser l’utilisation directe du biogaz pour l’électricité ». Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont dépassé l’an dernier de 6,7 % le budget carbone, c’est-à-dire le volume maximum d’émissions de gaz à effet de serre censé ne pas être dépassé pour que le pays respecte ses engagements de lutte contre le réchauffement climatique. C’est ce qui ressort du premier bilan de l’Observatoire climat-énergie des ONG Réseau Action Climat et CLER, publié le 13 septembre. Cet observatoire, qui sera mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles données disponibles, compare les objectifs définis par la stratégie nationale bas carbone (SNBC) adoptée dans le cadre de l’Accord de Paris pour le climat et ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), avec ses émissions et sa consommation d’énergie réelles en 2017. Dans le détail, le secteur des transports, qui représente environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre, a dépassé de 10,6 % son budget carbone. Le bâtiment est encore plus mauvais élève, avec un dépassement de 22,7 %. L’écart est moindre pour l’agriculture (+3,2 %) et seule l’industrie a réussi à être dans les clous des objectifs (-0,8 %). Concernant la consommation nationale d’énergie, elle a dépassé de 4,2 % les objectifs en 2017, tirée par la consommation d’énergies fossiles (supérieure de 4,5 % aux objectifs). Enfin, la France n’a pas non plus respecté la trajectoire fixée pour augmenter la part des énergies renouvelables. En 2016 (derniers chiffres disponibles), le pays affichait un retard de 12,8 %. Alstom avance dans son projet de train à hydrogène. Le constructeur a ainsi présenté deux premières rames, lesquelles ont accueilli le 17 septembre leurs premiers passagers, sur une ligne secondaire longue de 100 km en Basse-Saxe, dans le nord de l’Allemagne, a rapporté l’AFP. Conçues en France et assemblées en Allemagne, elles vont désormais parcourir tous les jours, et pendant deux ans, un aller-retour chacune entre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude. Ce prototype est équipé de piles à combustible qui transforment en électricité l’hydrogène stocké sur le toit et l’oxygène ambiant. Des batteries lithium-ion lui permettent en outre de stocker l’énergie récupérée pendant le freinage, qui est réutilisée dans les phases d’accélération. Si ces deux trains sont encore des prototypes, le groupe français a déjà signé des lettres d’intention avec quatre Länder (régions) allemands, toujours selon l’AFP. Alstom doit ainsi fournir dans trois ans 14 rames à l’autorité régionale des transports de Basse-Saxe, pour remplacer tout le parc diesel de la ligne pilote de Cuxhaven à Buxtehude. « L’augmentation de capital envisagée d’environ 450 millions d’euros vise à permettre à Neoen de réaliser son programme d’investissement et d’atteindre à fin 2021 une capacité en exploitation et en construction d’au moins 5 GW (contre 2 GW aujourd’hui) », peut-on lire dans un communiqué de Neoen publié le 19 septembre. Ce document détaille la première étape de son projet d’introduction en bourse avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Impala, l’actionnaire majoritaire du producteur indépendant d’énergies renouvelables, a d’ores et déjà annoncé qu’il souscrirait à l’offre et qu’il avait l’intention de demeurer l’actionnaire majoritaire. Neoen est actif en Australie, en France, au Portugal, en Finlande, en Jamaïque, en Zambie, au Salvador, au Mexique et en Argentine et développe des projets dans plusieurs autres pays : Irlande, États-Unis, Mozambique, etc. L’État et l’Ademe ont lancé le 10 septembre la campagne de communication nationale « Faire », entendre « faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. » Portée par le slogan « tous éco-confortables », cette campagne, dotée d’un site internet dédié, entend « rendre lisible un service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat pour les citoyens » et « entraîner l’ensemble des acteurs publics et privés dans la rénovation ». Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire en a profité pour renouveler les objectifs formulés à l’époque : rénover 500 000 logements par an avec un budget public de 14 milliards d’euros sur cinq ans. Il a visité à cette occasion, et en compagnie du secrétaire d’État à la Cohésion des territoires Julien Denormandie ainsi que du président de l’Ademe Arnaud Leroy une copropriété de trois immeubles dont la rénovation s’est conclue l’an dernier. Le ministre, lors d’une conférence de presse, n’est pas entré dans les détails, alors que plusieurs acteurs, notamment les professionnels du bâtiment, s’inquiètent de modalités encore floues sur des champs comme la transformation en prime du crédit d’impôt à la transition énergétique. Les îles bretonnes de Sein, Molène et Ouessant se sont félicitées le 7 septembre des avancées réalisées depuis le lancement en 2015 d’un programme de transition énergétique visant à parvenir d’ici 2030 à une consommation 100 % renouvelable. « Depuis trois ans beaucoup de choses ont été faites », a assuré à l’AFP le maire d’Ouessant et président de l’Association des îles du Ponant Denis Palluel. « Il y a aussi plein de promesses qu’il faut transformer avec un objectif de 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2023 et 100 % d’ici 2030 », a poursuivi l’édile, toujours auprès de l’agence de presse, soulignant la nécessité de « déverrouiller certains freins techniques, mais surtout réglementaires », en référence notamment à la loi littoral qui empêche l’installation d’éoliennes près des côtes. Le projet de loi Elan qui favorise l’installation d’éoliennes sur des territoires de taille réduite comme les îles, et devrait être définitivement adopté d’ici la fin de l’année, devrait d’ailleurs lever ce frein. Seulement 500 unités de méthanisation sont en activité en France, a rapporté l’AFP d’une rencontre dans le cadre du salon de l’élevage (Space) qui s’est ouvert le 11 septembre à Rennes. « Il s’agit d’un développement très modeste par rapport aux objectifs de [l’ancien ministre de l’Agriculture] Stéphane Le Foll et par rapport à ce qui se fait dans d’autres pays européens », a constaté Gilles Petitjean, directeur de l’Ademe Bretagne, cité par l’agence de presse. Sur ces 500 unités au plan national, 80 % sont d’origine agricole, les autres étant le fait, par exemple, de collectivités ou d’usines, en particulier dans l’agro-alimentaire. Lancé au printemps 2013 par M. Le Foll et la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, le plan « Énergie Méthanisation Autonomie Azote » (EMAA) prévoyait « 1 000 méthaniseurs à la ferme en 2020 », avec le double objectif de réduire les engrais chimiques en les remplaçant par l’azote issu des effluents d’élevage et de développer les énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique, rapporte encore l’AFP. Si la Bretagne compte actuellement environ 80 unités de méthanisation agricole, « il faut qu’on arrive à atteindre 50 à 100 installations par an » dans la région, a fait valoir le représentant de l’Ademe. Un objectif qui ne pourra pas être atteint sans la mise en pace de la série de mesures annoncées fin mars par le ministère de la Transition écologique et solidaire. On connaît désormais la date de publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028, dont la publication est attendue depuis le mois de juin. Le gouvernement sera en effet en mesure de présenter sa feuille de route énergétique « à la fin du mois d’octobre », a indiqué mercredi 5 septembre le tout nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Ce texte précisera « la part de chaque énergie, le développement des énergies renouvelables que nous voulons faire », a-t-il souligné, alors qu’il était interrogé sur la part du nucléaire dans la production d’électricité. Organisé du 19 mars au 30 juin dernier, le débat public sur la PPE présente un bilan globalement satisfaisant. C’est en tout cas ce qui ressort d’un document publié le 30 août par la Commission nationale du débat public (CNDP), qui souligne toutefois certains manquements. « Les moyens alloués au débat étaient insuffisants et le maître d’ouvrage a manifestement sous-estimé l’engagement requis par cet exercice. (…) Complexe et difficilement identifiable, [il] n’a pas précisé clairement ses attentes à l’égard du débat public […] ni la manière dont il prendrait en compte ses conclusions », explique la présidente de la CNDP, Chantal Jouanno. « Total s’est positionné en tête des lauréats du dernier appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie pour la petite hydroélectricité », a annoncé le groupe français dans un communiqué du 5 septembre. « 1er lauréat avec 33 % des volumes attribués », l’arrivée de Total dans le secteur ne passe pas inaperçu. D‘autant que « Direct Energie [racheté en avril dernier par Total], via sa filiale Quadran, s’est également placé en tête du classement, en remportant 5 projets d’une puissance totale de 12,2 MW, soit environ un tiers des dossiers sélectionnés lors du premier appel d’offres public sur la petite hydroélectricité », précise l’énergéticien. À se demander jusqu’où porteront les ambitions du groupe. « Nous serons candidats au renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques en France », a en effet déclaré, sans plus de détails, son PDG, Patrick Pouyanné, à l’occasion d’un entretien avec le magazine Capital de septembre. De quoi imaginer l’arrivée d’un nouvel acteur dans ce dossier de l’ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques français imposée par la Commission européenne et qui traîne en longueur. Le Parlement californien a adopté, le 28 août, une loi visant à imposer des objectifs d’énergies propres pour la production d’électricité sur le long terme. Le texte impose 50 % de la production d’électricité à partir de sources propres et renouvelables au 31 décembre 2026, 60 % fin 2030 et 100 % fin 2045. Pour entrer en vigueur, il doit désormais être signée par le gouverneur de la Californie, Jerry Brown. L’exploitation de trois nouvelles centrales géothermiques en cogénération va permettre de faire passer « la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de l’Eurométropole de Strasbourg de 16 % à 20 %, atteignant les objectifs fixés par le Plan Climat Energie Territorial à l’horizon 2020 », annonce la collectivité sur son site internet. Et les projets sont en très bonne voie. Sur le premier d’entre eux, porté par Fonroche à Vendenheim, les résultats du premier forage sont en effet positifs. « A 4 600 mètres de profondeur, nous avons trouvé une eau à 200°C au lieu des 185°C attendus et des perspectives de très bons débits, annonce Jean-Philippe Soulé, directeur de la géothermie à Fonroche. Nous allons donc pouvoir disposer d’une centrale de 9 MWé au lieu des 6 MWé initialement prévus. » La centrale pourra en outre produire de la chaleur puisqu’elle tournera en cogénération. A sa mise en service, prévue d’ici 2020, elle ne fournira cependant de la chaleur que pour l’éco-parc où elle se situe et éventuellement pour de futures serres agricoles. Mais des discussions sont en cours avec l’Eurométropole pour la création d’un réseau de chaleur au nord de Strasbourg. En attendant, Fonroche creuse. « Nous avons développé une machine en interne pour ne plus avoir à dépendre des tarifs et de la disponibilité des trois seules machines de ce type à disposition en Europe. Et elle vient d’entamer le forage du deuxième puits. » D’autres chantiers l’attendent ensuite, à commencer par ceux d’Eckbolsheim et d’Hurtigheim pour lesquels Fonroche dispose déjà des autorisations administratives. Des centrales en cogénération de 6 MWé y sont également prévues, et cette fois, les réseaux de chaleur pour absorber la production existent déjà. Mais Fonroche n’a pas encore décidé par laquelle commencer. L’une d’elle complètera en tout cas le trio espéré par l’Eurométropole qui comptera également la centrale d’Illkirch, développée et construite par Electricité de Strasbourg. Celle-ci ira puiser une eau géothermale à 150°C à environ 3 000 mètres de profondeur pour alimenter en priorité un réseau de chaleur et affichera donc une capacité de 28 MWth. Le premier forage commencera en août, pour une mise en service en 2020. Dans les temps pour les objectifs de l’Eurométropole. Petrobras, Total et Total Eren (détenue à 23% par Total depuis septembre 2018) ont signé un protocole d’accord pour envisager des projets en commun dans les énergies solaire et éolienne sur le territoire brésilien, a annoncé Petrobras dans un communiqué publié le 10 juillet. « L’objectif est d’exploiter en commun le fort potentiel du Brésil en matière d’énergies renouvelables, notamment dans le nord-est du pays », explique Nelson Silva, directeur de l’organisation et des systèmes de gestion de Petrobras. Et de préciser que le volume d’investissements de Petrobras et Total n’avait pas encore été défini, ni la participation de chaque compagnie. « Il faut d’abord analyser les opportunités et déterminer par la suite si nous avons les moyens de présenter des projets viables », souligne-t-il. Petrobras exploite déjà quatre parc éoliens avec 104 MW installés, ainsi qu’une usine de recherche et développement d’énergie solaire d’1,1 MW dans l’Etat de Rio Grande do Norte. Evergaz a annoncé le 3 juillet une prise de participation dans deux unités de méthanisation en Belgique : AM Power (44 %) à Egem et Bio NRGY (44 %), situées à Aalter. Développée et mise en service en 2012, AM Power est un des plus gros sites d’Europe avec une puissance de 7,5 MWél. et une capacité de traitement de 180 000 tonnes par an de déchets. En exploitation depuis 2012, BioNRGY traite des fumiers, lisiers, coproduits, glycérine, etc., pour une capacité de traitement de 60 000 tonnes par an et une valorisation du biogaz en cogénération de 2,9 MWél. Les deux centrales sont détenues en partenariat avec Stefaan Delabie, « un pionnier du biogaz en Belgique », précise la société française dans un communiqué. Evergaz s’était déjà déployée en Allemagne en 2017 et avait accueilli dans son capital le fonds d’investissement Meridiam en avril 2018. « Cette opération en Belgique confirme la forte ambition d’Evergaz et renforce son statut de spécialiste français et européen du biogaz », explique la société. À l’occasion de la clôture du débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui s’est tenue vendredi 29 juin dernier au Cese à Paris en présence de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, Jacques Archimbaud, président de la CPDP (commission particulière du débat public) PPE, a prononcé un discours dans lequel les énergies renouvelables avaient, bien sûr, une place de choix. « Elles conservent une popularité élevée, comparable à celle qui apparaît dans toutes les études d’opinion. Compte tenu de l’évolution à la baisse de leurs coûts, les participants [au débat public sur la PPE] ne font de hiérarchie entre elles qu’au regard de leur bonne adaptation à la ressource locale. S’ils comprennent qu’on puisse maintenir des formes de subventionnement nécessaire à leur solvabilité, ils souhaitent que le poids des engagements passés ne pèse pas excessivement sur les efforts à venir. Ils s’interrogent sur une forme de rente dont les retombées profiteraient plus à des actionnaires éloignés qu’aux territoires qui les accueillent. Ils souhaitent par ailleurs, sans qu’on déshabille les énergies électriques montantes qui ont encore besoin d’un petit coup de pouce, qu’on accroisse l’effort en matière de chaleur renouvelable et de réseaux de chaleur. » Jacques Archimbaud a par ailleurs prévenu : « un fort sentiment d’injustice ressort des échanges : la transition énergétique est belle et bonne mais elle concerne surtout ceux qui peuvent s’y impliquer; moins les locataires que les propriétaires, moins les classes populaires que les classes moyennes, moins les anciens que ceux qui peuvent investir sur le plus long terme. » Son rapport sera publié début septembre. À voir ce que le gouvernement en fera… Avec 113 TWh, l’électricité d’origine renouvelable a assuré 41,5 % de la production totale d’électricité de l’Allemagne au premier semestre, selon les données du site Energy Charts de Fraunhofer ISE. Un chiffre record est supérieur de 9 % à celui enregistré au premier semestre 2017, détaille l’institut de recherche allemand dans un communiqué. L’éolien arrive en tête des sources renouvelables dans le mix énergétique allemand avec 55,2 TWh. La biomasse a injecté 23 TWh dans le réseau. Suivent le photovoltaïque (22,3 TWh, + 12 % par rapport au premier semestre 2017) et l’hydroélectricité (12,5 TWh). La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse (LR) a adopté le 3 juillet sa stratégie Energie-Climat, laquelle prévoit que les énergies renouvelables représenteront en 2030 40 % de la consommation francilienne, avec un objectif de 100 % en 2050. Des ambitions louables mais « irréalisables », selon l’opposition de gauche, qui s’est abstenue, et qui critique notamment le « manque de moyens » pour mettre en œuvre cette stratégie. Valérie Pécresse a défendu « trois principes » : la « sobriété », en réduisant de 40 % la consommation énergétique régionale d’ici 2050, « la production d’énergie renouvelable » en la multipliant par quatre sur le territoire, et « la réduction de la dépendance énergétique », notamment vis à vis des énergies carbonées et du nucléaire, « en tendant vers une région 100% énergie renouvelable en 2050 ». « La région Île-de-France était la dernière de la classe en matière de politique énergétique », a-t-elle déclaré, affirmant que sa stratégie était « ambitieuse mais réaliste ». Le plan énergie-climat va miser sur « l’énergie éolienne, la géothermie, les énergies de récupération des déchets, le solaire voltaïque, la biomasse, l’hydrogène et la micro-électricité », a-t-elle ajouté. La Société générale a acquis la plateforme de financement participatif de projets d’énergies renouvelables Lumo. Cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, s’inscrit dans le cadre de l’objectif de la banque de lever 100 milliards d’euros pour la transition énergétique sur la période 2016-2020. Depuis sa création en 2012, Lumo a « collecté des fonds auprès de milliers d’investisseurs particuliers, au profit d’une quarantaine de projets éoliens, photovoltaïques ou hydrauliques qui produiront plus de 260 millions de kWh d’électricité verte chaque année, soit la consommation annuelle de près de 100 000 foyers », explique un communiqué du 21 juin. Quelques jours plus tard, Lendosphere annonçait de son côté avoir franchi « le cap des 100 projets […] pour le financement participatif de la transition énergétique. » Dans un communiqué du 25 juin, cet autre acteur du crowdfunding explique avoir collecté plus de 26 M€ depuis la création de la plateforme, en décembre 2014. « Les 100 projets représentent une capacité installée supérieure à 4 200 MW, pour lesquels le financement participatif représente tout ou partie du financement total », avance Amaury Blais, président de Lendosphere. « Développer et promouvoir les gaz renouvelables par le mariage du monde agricole et de l’énergie, au service des territoires », telle est la mission que s’est fixée l’association France Gaz Renouvelables, créée le 20 juin. Sur son compte Twitter, cette nouvelle association indique qu’elle est le fruit de l’initiative de pas moins de huit partenaires. Il s’agit de : GRTgaz, GRDF, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), France Biométhane et l’Association Technique Energie Environnement (ATEE). Dans le cadre du récent Plan Hydrogène, l’Ademe et GRDF ont annoncé le lancement d’un programme de démonstration de 50 piles à combustible au gaz naturel avec l’« objectif de contribuer au déploiement de cette technologie à très haute performance énergétique en maisons individuelles. » Inédite, cette opération engagée pour une durée de 3 ans (2018-2020) vise à obtenir le retour d’expérience des installateurs et des utilisateurs de ces piles installées en maison individuelle sur l’ensemble du territoire. Elle permettra de : confirmer les performances environnementales, mesurer l’intérêt, la perception et l’appropriation des professionnels et des particuliers pour cette technologie innovante ; communiquer sur ses atouts auprès grand public ; accompagner son intégration sur le marché français ; ouvrir la voie aux technologies fonctionnant à l’hydrogène. « Les partenaires sont d’ores et déjà mobilisés pour sélectionner, d’ici la fin de 2018, les sites susceptibles de rejoindre cette opération », expliquent les deux partenaires. Les six premiers projets de parcs éoliens offshore français vont pouvoir se poursuivre, a annoncé le 20 juin le président de la République lors d’un déplacement à Plévenon (Côtes-d’Armor), près de la zone où l’un des parcs doit être construit. L’État, qui avait décidé de renégocier les financements publics accordés à ces parcs attribués lors d’appels d’offres en 2012 et 2014, va réduire de 15 milliards d’euros le soutien public dont ils vont bénéficier. « La négociation a permis de diminuer de 40 % la subvention publique et d’avoir un ajustement des tarifs (de rachat de l’électricité qui sera produite par ces parcs) de 30 % », a détaillé Emmanuel Macron, devant des industriels et des élus. « Soulagement pour la filière. Et une excellente nouvelle pour la France qui va pouvoir valoriser son potentiel exceptionnel et accentuer son leadership mondial dans la transition énergétique », a réagi sur twitter la DG des énergies renouvelables en France d’Engie, Gwenaëlle Huet, par ailleurs présidente de la Commission éolienne du SER. Pour rappel, en cas d’échec de ces négociations, le gouvernement menaçait d’annuler les résultats de ces appels d’offres. Parmi les six parcs concernés, trois sont développés par EDF, au large de Fécamp (Seine-Maritime), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Courseulles-sur-Mer (Calvados), deux par Engie au large du Tréport (Seine-Maritime) et de l’île de Noirmoutier (Loire-Atlantique), et un par l’espagnol Iberdrola, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Ils représentent chacun une puissance d’environ 500 MW et doivent entrer en service progressivement à partir de 2021. L’Agence nationale de recherche (ANR) a décidé de consolider Solaris, le laboratoire commun de l’Institut Jean Lamour (IJL) et l’entreprise Viessmann Faulquemont, en injectant 62 500 € de subvention supplémentaire sur une durée de 18 mois (à compter du 1er avril 2018), explique un communiqué du 8 juin. Deux axes principaux de recherche sont identifiés : l’amélioration de la résistance à la corrosion des capteurs solaires pour une installation en bord de mer et l’optimisation de la régulation thermique du capteur en ayant recours à un nouveau matériau thermochrome. « L’objectif est de mettre au point des innovations à même de relancer les ventes de capteurs solaires thermiques qui subissent depuis plusieurs années la concurrence notamment du photovoltaïque », est-il précisé. Soaris a jusqu’ici permis la mise au point d’une nouvelle génération de capteurs dits thermochromes à base d’oxyde de vanadium permettant une régulation thermique du capteur. Cette innovation, brevetée sous le nom Thermprotect et développée en partenariat avec l’Ademe, représente 90-95 % de la production de panneaux solaires thermiques chez Viessmann. Le département américain de l’Énergie (DoE) a annoncé le 14 juin que l’université de l’Utah recevrait 140 M$ sur les cinq prochaines années pour la recherche et développement dans le secteur de la géothermie. Le site de Milford dans l’Utah a en effet été sélectionné pour devenir le laboratoire de terrain Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy (FORGE), précise le DoE dans son communiqué. « Ce nouveau site sera dédié à la recherche pour les systèmes géothermiques avancés (EGS) ou les réservoirs géothermiques naturels », est-il précisé. GRHYD (Gestion des Réseaux par l’injection d’HYdrogène pour Décarboner les énergies), premier démonstrateur power-to-gas de France, a été inauguré le 11 juin à Cappelle-la-Grande dans les Hauts-de-France. L’objectif de ce projet est de transformer l’excédent de production électrique des énergies renouvelables en hydrogène stockable et transportable dans les réseaux de gaz naturel. Dans un communiqué, son pilote, Engie (à travers son centre de recherche Engie Lab Crigen), et ses 10 partenaires rappellent qu’il teste l’injection d’hydrogène dans le réseau de distribution de gaz, à hauteur de 6 % pour démarrer et jusqu’à 20 % au maximum, pour répondre aux besoins de chauffage, d’eau chaude et de cuisson de 100 logements, ainsi que pour le centre de soin du quartier Le Petit Village de Cappelle-la-Grande. GRHYD a nécessité six ans d’études, d’autorisations et de démonstrations pour un budget de 15 millions d’euros. Trois containers ont été installés « contenant les technologies de pointe : un pour l’électrolyse, un pour le stockage et un pour l’injection dans le réseau d’hydrogène », détaille le communiqué. Le projet est soutenu par l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir opéré par l’Ademe et labellisé par le pôle de compétitivité Tenerrdis. Le fabricant grenoblois Hydroquest et Constructions navales de Normandie (CMN) ont annoncé le 7 juin qu’ils prévoyaient de mettre en service leur hydrolienne marine entre Paimpol et Bréhat au printemps 2019, plutôt qu’en fin d’année 2018 comme prévu initialement. Les deux partenaires expliquent que les conditions météo hivernales pourraient compromettre l’installation de la machine d’une tonne qu’ils développent depuis 2016. Ce projet de démonstrateur innovant pour la filière hydrolienne marine a été retenu lors de l’appel à projets « Énergies renouvelables en mer et fermes pilotes hydroliennes fluviales ». L’hydrolienne, de 25 mètres de large pour une hauteur de 11 mètres, sortira des ateliers CMN d’ici fin 2018 « pour être installée dans le cadre d’un accord passé avec EDF, sur le site de Paimpol-Bréhat à partir d’avril 2019. » Sa mise en service sur le site d’EDF est, elle, « prévue au printemps 2019 pour une première période de 12 mois ». Le Fonds chaleur devrait augmenter d’un peu plus de 20 %, a affirmé le 7 juin Sébastien Lecornu aux députés de la commission des Finances lors d’une audition. Le secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a précisé : « Pour l’année 2018, l’année en cours, on sera globalement à quelque chose comme 245 millions d’euros », soit 45 M€ supplémentaires par rapport aux autorisations d’engagement actuelles. Pour rappel, si le président de la République s’était engagé à doubler le Fonds chaleur durant le quinquennat, la somme allouée pour l’année 2018 était restée stable. Désormais, « On n’est pas encore au doublement […] mais la tendance est là », a expliqué Sébastien Lecornu, confiant que le gouvernement avait « trouvé des marges de manœuvre (…) au sein du budget de l’Ademe », laquelle gère le Fonds. La Commission nationale du débat public (CNDP) organise à l’Assemblée nationale, samedi 9 juin, le lancement du G400 Energie, soit la plus grande réunion d’habitants tirés au sort jamais organisée en France. En leur qualité de consommateurs, d’usagers et de contribuables, 400 habitants informés tout au long du débat, se prononceront par vote électronique sur des questions clés de la politique française de l’énergie à l’occasion des discussions en cours sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), laquelle doit être révisée d’ici fin 2018 pour porter sur les périodes 2018-2023 et 2024-2028. Afin de traduire l’expression nationale la plus large possible, un débat public PPE a été mis en place pour organiser un total de 80 rencontres publiques, 12 ateliers d’information et de controverse, ainsi que 55 cahiers d’acteurs et 637 avis et questions présentés sur un site dédié : www.ppe.debatpublic.fr. Engie a annoncé, dans un communiqué du 6 juin, l’acquisition du producteur indépendant d’énergies renouvelables Langa, pour un montant non précisé. Le groupe breton, présent dans le solaire, l’éolien, le biogaz et la biomasse, possède un portefeuille d’installations en exploitation qui devrait atteindre, d’ici fin 2018, une capacité installée de 215 MW (dont 165 MW d’énergie solaire et 39 MW d’éolien). Langa revendique également une capacité d’1,3 GW en projets qui verront le jour à horizon 2022. Avec cette acquisition, « Engie vise le développement, en France, de près de 3 GW d’éolien et près de 2,2 GW de solaire à l’horizon 2021 », explique l’énergéticien. « L’alliance des deux Groupes et notamment les compétences spécifiques des équipes de Langa sur les toitures et les centrales au sol, ainsi que le portefeuille global de projets en développement, fera d’Engie un leader incontournable sur le territoire », ajoute Gwenaelle Huet, directrice générale d’Engie France Renouvelables. Le salon Expobiogaz, co-organisé avec le Club Biogaz ATEE et qui a ouvert ses portes le 6 juin à Strasbourg, a dévoilé les lauréats de ses prix. Le Trophée de l’Innovation a ainsi été remis à la plateforme de financement participatif dédiée aux projets d’énergies renouvelables Enerfip. L’innovation est en partie technologique, « celle-ci est notamment amenée par le programme de recherche menée par l’équipe R&D d’Enerfip, le projet « BlockChain Proof of Concept (PoC) » : il s’agit de l’application de la technologie BlockChain à la gestion de titres », explique le salon dans un communiqué. Le prix coup de cœur du jury 2018 a été, quant à lui, décerné à CH4Process, une petite structure indépendante et spécialisée dans l’assistance technique à l’exploitation de site biogaz. Le compresseur gaz GC65, réalisé avec la société Mattei, « apporte une solution industrielle, abordable, performante énergétiquement et respectant les réglementations Atex et pression, pour les sociétés souhaitant utiliser du biogaz comprimé dans leur process (jusqu’à 10 bar g) : projets de microépuration, brassage de petits digesteurs, pilotes méthanisation et méthanation. » « L’hydrogène peut […] devenir une solution majeure dans notre mix énergétique demain », a expliqué Nicolas Hulot le 30 mai à l’Assemblée nationale. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a confirmé qu’il présentera le 1er juin un plan visant à faire de la France « un leader mondial » de la technologie hydrogène qui représente « une révolution potentielle pour les systèmes énergétiques. » L’ancien animateur propose de « fixer à 10 % la part d’hydrogène produit à base des sources renouvelables à l’horizon 2023. » Il a également annoncé une enveloppe de 100 millions d’euros « pour accompagner les premiers déploiements [des] technologies de production et de transport dans les territoires », expliquant qu’il y a un « besoin d’innovation, de démonstrateurs, de construire des champions économiques du stockage, de l’électrolyse. » Aujourd’hui, a expliqué le ministre, « avec la baisse des prix spectaculaire des énergies renouvelables, il devient enfin possible de produire des quantités importantes d’hydrogène à bas coût et évidemment sans émissions de gaz à effet de serre. » Pour Nicolas Hulot, l’hydrogène rend « possible le stockage à grande échelle des énergies renouvelables, permettant ainsi de rendre crédible un monde où l’hydrogène vient se substituer petit à petit aux [énergies] fossiles, au nucléaire, pour combler les intermittences du solaire et de l’éolien. » Le ministre a également pointé le rôle de l’hydrogène, « s’il est produit à base de renouvelables », dans la « mobilité sans émissions ». Et de conclure, « toute la filière hydrogène existe en France. Ne loupons pas cette transition énergétique. Soyons les premiers sur cette filière. » Cap Vert Energie a annoncé le 24 mai le lancement de son activité hydroélectricité qui sera dirigée par Jean-Baptiste Sallé. Le groupe entend ainsi exploiter « un parc d’une puissance de plus de 20 MW en 2023 » en France, une activité qui s’ajoute au développement et l’exploitation d’installations solaires et de méthanisation. La stratégie de l’entreprise dans l’hydroélectricité portera « d’abord sur l’acquisition de centrales en exploitation, puis sur le développement et la construction de nouvelles centrales hydroélectriques gérées en propre. » Cap Vert est actuellement en discussion pour des actifs en Nouvelle Aquitaine, précise l’entreprise dans un communiqué. Le contexte actuel (« vieillissement des centrales hydroélectriques existantes, accroissement des contraintes administratives pesant sur le renouvellement des tarifs et des concessions et nouvelles normes environnementales ») est synonyme de « réelles opportunités de développement » dans cette filière, explique le groupe. La plateforme CertiMétha, basée à Chaumesnil (Aube) et dédiée au biogaz, entamera sa construction début 2019, pour être opérationnelle à la fin de l’année, ont annoncé l’ensemble des partenaires le 30 mai dans un communiqué commun. Cette « infrastructure mutualisée de R&D pour accélérer la mise sur le marché des innovations et optimiser les technologies et pratiques opératoires » comprend un laboratoire d’analyses et un démonstrateur de hautes technologies. « Plateforme d’innovation conçue par la filière pour la filière, CertiMétha concrétise la volonté de Biogaz Vallée et d’Evergaz, sous la houlette du Conseil départemental de l’Aube, de structurer la filière méthanisation en France », expliquent ses initiateurs. Le projet compte le soutien du Programme des investissements d’avenir (PIA) à hauteur de 2,2 M€ et l’engagement de 8 investisseurs privés à son capital (1ère levée de fonds de 620 000 € fin 2017) : Evergaz, K-Révert, Biogaz Vallée, Decoval Servipack, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, Innolab, Carakters et BioEnTech. La plateforme « offrira les ressources à l’échelle industrielle pour tester et certifier des matériels et procédés, former les professionnels et finaliser les programmes de recherche appliquée, privés ou publics. » Le nouveau président de l’Ademe, Arnaud Leroy, a présenté le 22 mai son cahier d’acteur, soit la contribution de l’agence au débat sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celui qui a succédé mi-mars à Bruno Lechevin a tenu à mettre les choses au clair : la PPE a vocation à donner « des signaux économiques clairs » et de « la visibilité » aux filières des différentes énergies. Il ne s’agit en aucun cas de rouvrir un débat sur la politique énergétique française. « Il ne faut pas se tromper de focale. Ce débat-là a déjà eu lieu en 2012, il est clos », a-t-il insisté. « Certains y ont vu l’opportunité de refaire le match, de revenir sur la loi de transition énergétique : ce n’est pas le cas », a poursuivi Arnaud Leroy, ajoutant que « l’objet de la PPE n’est pas la question de relancer ou non le nucléaire. » Dans son document versé au débat PPE, l’Ademe préconise de multiplier par deux la part des énergies renouvelables entre 2016 et 2028, en augmentant leur production de 70 %, à 490 TWh contre 290 TWh aujourd’hui. Pour cela, les 200 TWh supplémentaires devront provenir de l’éolien, du solaire photovoltaïque, du bois énergie, de la méthanisation et des pompes à chaleur. Arnaud Leroy s’est par ailleurs montré optimiste sur le doublement du Fonds chaleur, expliquant qu’un conseil d’administration de l’Ademe aura lieu au mois de juillet sur le sujet. « Nous demandons plusieurs dizaines de pourcents de hausse avant les prochaines échéances électorales locales », soit avant les élections municipales de 2020, les collectivités portant désormais une partie des investissements. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2017 des pompes à chaleurs (PAC) dans le secteur du résidentiel. Avec 487 090 PAC air/air et air/eau vendues, auxquelles s’ajoutent 84 420 chauffe-eau thermodynamiques, les technologies aérothermiques progressent de 9 % et conservent une belle dynamique. Les PAC air/air restent l’équipement phare du secteur avec un marché évalué à plus de 405 000 pièces. Les voyants sont tous au vert pour le segment. Les opérations en rénovation, notamment le remplacement d’anciens systèmes de chauffage électriques, continuent de progresser et les installations dans le neuf ont bénéficié du rebond de la construction amorcé au second semestre 2016. Les PAC air/eau font également une bonne année (81 700 pièces, + 10 % par rapport à 2016). Sur l’ensemble des systèmes de chauffage central individuel vendus en France en 2017 (y compris chaudières fioul, gaz et bois), les pompes à chaleur aérothermiques ont représenté 36 % des équipements. À l’opposé, les PAC géothermiques restent à un niveau de ventes très faible (3 100 pièces). Si l’activité 2017 a été stable par rapport à 2016, mettant ainsi fin à plus de cinq années successives de baisse, le segment a vu ses ventes se contracter de plus de 60 % en cinq ans et reste un marché de niche. L’intersyndicale de Grenoble et la direction de General Electric Hydro ont signé le 22 mai plusieurs accords, mettant un point final au plan social en cours depuis dix mois et sauvant une centaine d’emplois sur le site, ont fait savoir les partenaires sociaux. « Nous devions être 450 à rester selon le plan initial de juillet dernier, nous serons 550 l’an prochain », sur ce site de production de turbines hydroélectriques de pointe qui comptait 800 salariés, a déclaré Nadine Boux, porte-parole de l’intersyndicale (CFE-CGC, CFDT, CGT). Les trois syndicats signataires, restés unis durant toute la durée du conflit, se sont engagés à ne pas contester ce nouveau plan de sauvegarde de l’emploi devant la justice. À partir du 1er janvier 2020, tous les nouveaux bâtiments résidentiels de Californie devront être dotés de systèmes solaires photovoltaïques. Tel est le sens de la décision adoptée le 9 mai par la Commission en charge de l’énergie de la Californie et prise dans le cadre de la modification des standards de construction en termes d’efficacité énergétique. Il s’agit du premier État américain à imposer une telle mesure. Outre cette obligation, les nouvelles normes adoptées portent également sur la mise à jour de la réglementation sur l’enveloppe thermique, les exigences de ventilations résidentielles et non résidentielles, ainsi que les exigences d’éclairages des bâtiments non résidentiels. Ces mesures devraient entraîner un coût supplémentaire de 40 dollars par mois sur les crédits de maison à 30 ans mais pourraient permettre de réduire de 80 dollars par mois les factures liées à l’énergie, estime la Commission, qui affirme que l’objectif est une réduction de 50 % de la consommation énergétique dans les nouveaux logements. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé « de ne pas modifier le tarif de distribution Turpe HTA-BT applicable aux autoconsommateurs individuels » et d’« introduire une composante de gestion spécifique dans la nouvelle formule tarifaire, optionnelle, à destination des utilisateurs raccordés au réseau basse tension participant à une opération d’autoconsommation collective. » Ces propositions sont à retrouver dans son projet de décisionconcernant la tarification de l’autoconsommation mis en ligne le 15 mai sur son site. Concernant les autoconsommateurs individuels, la CRE clarifie la rédaction du point portant sur la composante de gestion due par ceux-ci, afin d’expliciter le tarif applicable aux autoconsommateurs sans injection. Le groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) est désormais adhérant de Qualit’Enr, a annoncé, le 16 mai, l’association pour la qualité dans les énergies renouvelables. « Cette participation permettra de renforcer la représentation des clients au sein de Qualit’EnR et de renforcer l’action des deux associations en matière de lutte contre l’éco-délinquance », précisent les deux associations dans un communiqué commun. Le GPPEP rejoint le collège « utilisateurs » de Qualit’EnR, qui fait partie des 4 collèges représentant les différentes parties prenantes de la filière : installateurs, industriels, institutionnels et utilisateurs. « L’arrivée du GPPEP vient ainsi renforcer la représentation des intérêts des particuliers au sein de l’association, avec le bénéfice de son expertise spécifique au photovoltaïque. » En 2017, l’industrie des énergies renouvelables a créé plus de 500 000 nouveaux emplois dans le monde (+ 5,3 % par rapport à 2016), selon les chiffres publiés le 8 mai par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). Pour la première fois, le cap des 10 millions de personnes employées dans le secteur (y compris les grandes centrales hydroélectriques) est dépassé, avec 10,3 millions. Avec 3,4 millions d’emplois (+ 9 %), l’industrie solaire photovoltaïque reste, devant la biomasse (3 millions), le plus grand employeur de toutes les technologies d’énergies renouvelables, tandis que les emplois dans l’industrie éolienne se sont légèrement contractés l’année dernière (1,15 million). La majeure partie de la fabrication se déroule dans un nombre relativement restreint de pays et 60 % de tous les emplois liés aux énergies renouvelables se trouvent en Asie, avance l’Irena. L’Ademe a lancé le 14 mai la nouvelle édition de son appel à projets « grandes installations solaires thermiques de production d’eau chaude ». Cet appel à projets est à retrouver ici. Il concerne des projets de production d’eau chaude sanitaire ou de process pour : les industries consommatrices d’eau chaude (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, métallurgique) ; les activités agricoles (laiteries, fromageries, maraîchers utilisateurs de serres…) ; le secteur tertiaire (hôtels, piscines collectives, restaurants, cantines d’entreprises, centres sportifs, blanchisseries…) ; tous bâtiments à occupation permanente avec des besoins en eau chaude sanitaire ; les maîtres d’ouvrage qui développent des réseaux de chaleur. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 septembre 2018. Le gouvernement a lancé le 14 mai le programme « 10Kverts » avec l’objectif de « favoriser l’accès des jeunes et les demandeurs d’emploi aux emplois verts et verdissants », comme l’explique le ministère du Travail dans un communiqué. Ce programme prévoit 10 000 formations aux métiers de la transition écologique dès 2018 dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). Il entend également intensifier la formation des salariés en insertion par l’activité économique, notamment dans le champ du recyclage, de l’économie circulaire et des ressourceries, mais aussi cofinancer la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) de ces filières. Les professions vertes, qui ont une finalité environnementale, et verdissantes, dont l’exercice évolue avec les préoccupations environnementales, représentent 4 millions d’emplois, selon le ministère. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, cité dans le communiqué, ajoute avoir confié « à Laurence Parisot le soin de bâtir le Plan de programmation de l’emploi et des compétences prévu par la loi pour la Transition énergétique pour la croissance verte de 2015, pour préparer nos filières à ces grandes mutations. C’est aussi la mission du Comité AcTE, constitué de 15 personnalités du monde socio-économique et que j’ai installé le vendredi 30 mars 2018, de nous aider à accélérer cette dynamique et à bâtir la croissance économique de demain. » Organisé le 2 mai à Lisbonne par l’initiative Énergie durable pour tous (SEforALL), le « Forum Énergie durable pour tous » s’est ouvert par un appel aux dirigeants mondiaux à faire davantage pour que personne ne soit laissé pour compte lors de la transition énergétique, afin de réaliser l’Objectif de développement durable 7. Un « Rapport d’avancement énergétique » a été publié par cinq institutions, dont l’AIE, à l’occasion de cette manifestation. Il dresse un bilan complet des avancées réalisées dans le monde concernant les quatre cibles mondiales relatives à l’énergie : l’accès à l’électricité, les modes de cuisson non polluants, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. S’agissant du développement des énergies renouvelables, le document explique qu’il a été spectaculaire dans le secteur de l’électricité, mais « moindre dans le transport et le chauffage, qui représentent ensemble 80 % de la consommation mondiale d’énergie ». Si les progrès réalisés en Chine depuis 2010 ont permis de faire progresser la consommation mondiale d’énergies renouvelables de 30 % en valeur absolue, le Brésil est le seul pays à dépasser largement la moyenne mondiale pour la part d’énergies renouvelables dans toutes les utilisations finales. En 2015, les ENR satisfaisaient 17,5 % de la consommation énergétique finale dans le monde et en se basant sur les politiques actuelles, elles ne devraient pas dépasser 21 % en 2030 soit une progression « loin de la hausse nettement plus importante requise ». Allianz a annoncé le 4 mai qu’il n’assurerait plus les centrales et mines associées au charbon et qu’il veut complètement se désinvestir du secteur d’ici 2040. « Allianz cessera avec effet immédiat de proposer des solutions d’assurance aux centrales au charbon ou aux mines de charbon individuelles, qu’elles soient en activité ou en projet », explique l’assureur allemand dans un communiqué. « En tant que leader de l’assurance et des investissements, nous souhaitons promouvoir la transition vers une économie respectueuse du climat », poursuit son PDG, Oliver Bäte, cité dans le communiqué. Les sociétés qui produisent de l’électricité à partir de plusieurs sources, comme le charbon, d’autres combustibles fossiles ou des énergies renouvelables, continueront cependant d’être assurées. L’objectif du premier assureur européen est toutefois d’éliminer complètement d’ici 2040 les risques liés au charbon de ses activités d’assurance. Le régulateur grec des marchés de l’énergie lancera cette année des appels d’offres pour un volume total de 1 GW, a-t-il annoncé le 30 avril. Un appel d’offres solaire de 300 MW et un autre de même puissance dédié à l’éolien seront clôturés le 2 juillet, tandis qu’un troisième, de 400 MW, concernera les deux technologies. Si aucune date n’a encore été fixée pour ce dernier, d’autres appels d’offres bi-technologies devraient avoir lieu en 2019 et en 2020. Les deux plateformes dédiées au financement participatif dans les énergies renouvelables, Wiseed et Lendosphère, ont annoncé le 24 avril la signature d’un partenariat entre les deux structures pour financer les projets issus des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les deux entités vont ainsi proposer une offre commune dédiée aux porteurs de projets lauréats. « Il s’agit de coordonner, sur les territoires et dans le temps, leurs savoir-faire contractuels, commerciaux et de communication afin de créer des synergies favorisant la réussite des collectes de fonds, précisent les partenaires. Ce mécanisme évitera aux développeurs de multiplier les démarches avec les différentes plateformes et d’allonger les délais des collectes. » Un même projet pourra ainsi être financé en même temps ou successivement sur les deux plateformes Première mise en service d’une installation d’énergies renouvelables aux Émirats arabes unis pour EDF. L’installation en question, de 200 MW, constitue la première tranche d’un ensemble de 800 MW appelé Dewa III et pour lequel EDF s’est associée à Masdar et Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). « Cette nouvelle réalisation, livrée conformément à un calendrier exigeant, témoigne du savoir-faire de nos équipes quant au développement de grandes centrales solaires photovoltaïques », a déclaré Bruno Bensasson, nouveau directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle énergies renouvelables, dans un communiqué du 1er mai. Dewa III constitue la phase 3 de l’un des plus puissants projets de parc solaire au monde, le Parc Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui développera une capacité de 5 GW. Représentant un investissement total de 14 milliards de dollars, Il avait été attribué à un tarif très compétitif de 2,99 c$/kWh. Aux 200 MW désormais installés, succèderont deux mises en service successives de 300 MW, en 2019 puis en 2020. « La géothermie est fiable, une énergie renouvelable de base permettant de fournir un large spectre de services essentiels pouvant contribuer à la stabilité du réseau », explique le département américain de l’Énergie (DoE) dans un communiqué du 23 avril annonçant l’octroi d’une enveloppe de 14,5 millions de dollars de financement pour accélérer la recherche sur les technologies innovantes de forages en géothermie. Les États-Unis disposent actuellement d’une capacité installée de 3,8 GW mais d’un potentiel de 100 GW ou plus, selon le DoE. Les candidats peuvent déposer des projets jusqu’au 31 mai prochain. Le producteur d’énergies renouvelables Eoly, le développeur et opérateur de parcs éoliens offshore Parkwind et le gestionnaire d’infrastructures gazières belge Fluxys ont annoncé, le 24 avril,coopérer en vue de construire une installation power to gas en Belgique. Il s’agit d’une installation à l’échelle industrielle de 24MW, destinée à convertir de l’électricité verte en hydrogène vert pouvant être transporté et stocké dans les infrastructures de gaz naturel existantes. Une étude de faisabilité détaillée de l’installation sera réalisée dans un premier temps. « Contrairement aux projets de démonstration en Europe, Eoly, Parkwind et Fluxys ambitionnent de concrétiser en Belgique une des premières installations power to gas à l’échelle industrielle », soulignent les trois partenaires dans un communiqué. « L’objectif est de construire une installation Power to gas capable de convertir plusieurs MW d’électricité en hydrogène vert, qui pourra être proposé au marché en tant que carburant ou matière première décarbonisée. » Les possibilités d’utiliser l’installation « pour compenser les fluctuations de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne (offshore) et d’offrir ainsi des services de support au réseau » seront également examinées. Accélérer le déploiement global des énergies renouvelables par six, voilà ce qui permettrait de limiter la hausse des températures à 2°C, estime l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) dans une réactualisation de son rapport REmap. « Si nous voulons décarboner assez rapidement l’énergie mondiale pour éviter les impacts les plus graves du changement climatique, les énergies renouvelables doivent représenter au moins les deux tiers de l’énergie totale d’ici 2050 », explique Adnan Z Amin, directeur général de l’Irena. 94 % de l’effort nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique pourraient être réalisés en développant en parallèle les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Côté efficacité énergétique, la progression attendue est de 2,8 % par an d’ici 2050, contre 1,8 % actuellement. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale doit quant à elle passer de 18 % en 2015 à 65 % en 2050 (de 17 % à 70 % pour l’Europe). Atlantis Resources a annoncé le 23 avril avoir soumis au gouvernement un « plan stratégique » pour le développement d’ici 2025 d’un parc d’hydroliennes de 1 GW au Raz Blanchard, en Normandie. Sa capacité pourrait même doubler en 2027, à 2 GW. La proposition d’Atlantis comprend le développement d’un site d’assemblage, d’essais, d’exploitation et de maintenance de turbines en Normandie. « La construction du site de 2 GW au Raz Blanchard devrait attirer 3,3 milliards d’euros d’investissements et ouvrir un marché d’exportation de turbines valorisé à 400 millions d’euros par an, avec un potentiel de création de 10 000 emplois », explique le spécialiste des projets hydroliens dans un communiqué. « La France possède au raz Blanchard une mine d’or d’énergie renouvelable dont l’exploitation est peu coûteuse », avance Tim Corneliis, PDG d’Atlantis, et les « discussions sur ce projet industriel ont été engagées avec le gouvernement français et les autorités ». La Cour des comptes a rendu public le 18 avril un rapport sur le soutien aux énergies renouvelables. L’institution déplore que « la France a peu fait profiter son tissu industriel du déploiement des énergies renouvelables », alors même que les moyens financiers mobilisés par l’Etat « sont pourtant conséquents. » Ce document de 117 pages propose deux orientations : à l’occasion de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de 2018, définir une stratégie énergétique cohérente entre les objectifs de production d’énergies renouvelables électriques et l’objectif de réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix ; clarifier les objectifs industriels français associés au développement futur des EnR. La Cour formule également 6 recommandations dont : la publication du calcul des coûts de production et des prix, actuels et prévisionnels, de l’ensemble du mix énergétique programmé dans la PPE ; accroître des moyens du fonds chaleur ; faire évoluer les procédures d’appels d’offres et d’autorisation administrative ; étendre les appels d’offres pour l’attribution d’aide à la production d’électricité d’origine éolienne aux installations de plus de 6 MW ; fixer des plafonds de prix pour les projets dans les filières non matures. Dédié aux avantages de la chaleur solaire dans la rénovation, un nouveau livret signé Enerplan, en collaboration avec Uniclima et avec le soutien de l’Ademe et de GRDF, a été publié le 12 avril. Intitulé « Rénovation + Solaire thermique – La nouvelle dynamique », cet ouvrage a été développé pour Socol, structure qui réunit près de 3 000 professionnels œuvrant pour structurer la filière. « Dès à présent, avec la Contribution Climat Energie, le solaire thermique est rentable. Sur 20 ans, en intégrant les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance, la chaleur solaire s’avère moins chère qu’une solution classique fonctionnant à 100 % au gaz ou au fioul, avance le syndicat en présentation du livret. En comparaison avec d’autres solutions conventionnelles, le solaire s’affirme comme la plus rentable du marché en rénovation, notamment grâce au soutien du Fonds Chaleur de l’Ademe. » La Tunisie va lancer à la fin du mois d’avril un appel d’offres international pour la production électrique de 800 MW grâce à l’énergie renouvelable. « L’appel d’offres pour des investissements de deux milliards de dinars (674 millions d’euros) sera lancé le 27 avril », a expliqué, au cours d’une série d’annonces, le Premier ministre Youssef Chahed. Dans le détail, le projet a pour objectif la production de 800 MW d’électricité grâce aux énergies solaire et éolienne. Six gouvernorats sont concernés : Tataouine, Tozeur, Kébili (sud), Sidi Bouzid, Gafsa (centre) et Nabeul (est). Pyro-gazéification, méthanisation, synthèse catalytique, bio-fermentation alcoolique, cultures de micro-algues, valorisation des ressources renouvelables, de sous-produits d’activités, captage du dioxyde de carbone… autant de domaines concernés par l’appel à manifestation d’intérêts lancé par la région Nouvelle-Aquitaine. Dénommé « Production innovante de gaz ”verts”, de biocarburants ”avancés” à partir de ressources renouvelables », l’objectif de cet AMI est de produire de manière innovante (en phase post R&D), à partir de ressources renouvelables (biomasse, sous produits d’activités économiques , déchets en fin de vie…), des vecteurs énergétiques intéressants et d’avenir, à savoir par exemple le syngaz, le méthane de synthèse, l’hydrogène renouvelable, ou encore les biocarburants 2G de type bio-éthanol, bio isobutène ou biodiesel d’huiles végétales, etc. Les quatre cessions de dépôts de candidatures sont ouvertes jusqu’au : 1er juin 2018, 1er octobre 2018, 1er avril 2019 et 1er octobre 2019. Les candidats retenus disposeront ensuite de 3 ans maximum pour développer et déposer à maturité un dossier de demande d’aide à l’investissement à la Région. Pour les projets sélectionnés, le soutien régional concernera la phase d’études techniques et économiques préalables et d’investissements (jusqu’à 60 % maximum sur le coût total HT). Avec 44 centrales de production de biométhane en exploitation à fin 2017, le secteur connaît une croissance de 40 % du nombre d’unités et un doublement de la capacité de production qui atteint plus de 0,6 GWh, expliquent le think tank France Biométhane et le cabinet SIA Partners dans leur 3e Observatoire annuel du biométhane en France, publié le 9 avril. Le document annonce par ailleurs que cette tendance devrait se prolonger sur 2018 et 2019 aux vues du portefeuille de projets en liste d’attente de raccordement sur les réseaux de gaz. Pour le président de France Biométhane, Cédric de Saint Jouan, les récents résultats du groupe de travail sur la méthanisation assurent une visibilité pour la filière qui va lui permettre de continuer sur sa lancée actuelle, sans toutefois l’accélérer. « Cela ne permet pas non plus de rassurer sur l’atteinte de l’objectif de 10 % de la consommation de gaz à base de biométhane en 2030 ; objectif qui devrait être revu lors de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie qui sortira en fin d’année », ajoute-t-il dans un communiqué. Avec 8,3 %, 2017 a été la 7e année consécutive de croissance à un tel niveau pour les énergies renouvelables, selon les données publiées le 5 avril par l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). À la fin de l’année 2017, la capacité mondiale installée en termes d’énergies renouvelables a ainsi augmenté de 167 GW, pour atteindre 2 179 GW. Les nouvelles capacités de solaire photovoltaïque ont représenté plus de la moitié des nouvelles mises en service toutes technologies confondues avec plus de 93 GW en plus entre 2016 et 2017. La croissance du solaire (+ 32 %) a d’ailleurs surpassé celle de l’éolien (+ 10 %) en 2017. Il faut dire que le coût actualisé de l’énergie (LCOE) solaire photovoltaïque a chuté de 73 % entre 2010 et 2017 tandis que celui de l’éolien baissait de près de 25 % sur la même période, d’après l’Irena. La Chine a représenté près de la moitié des nouvelles capacités renouvelables mises en service l’an dernier (64 % pour l’Asie entière, contre 58 % en 2016). 24 GW ont été raccordées en Europe et 16 GW en Amérique du Nord. À noter, les énergies renouvelables hors réseau ont enregistré une croissance de 10 % en 2017, tandis que l’hydroélectricité a enregistré le plus bas niveau d’ajout de nouvelles capacités en 2017 depuis 10 ans. Par un décret du 19 mars Chantal Jouanno a été nommée présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), en charge d’organiser des débats publics sur les plans et programmes nationaux, comme le débat public sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) lancé le 19 mars dernier. L’ancienne présidente de l’Ademe et secrétaire d’État à l’Écologie succède à Christian Leyrit qui occupait ce poste depuis 2013. Par ailleurs, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a installé le 30 mars le Comité de l’Accélérateur de la transition écologique (AcTE) et en a confié la présidence à Jean-Dominique Senard. Composé de 15 personnalités du monde économique et de la recherche, ce comité aura « pour mission d’accompagner et de stimuler les réflexions du ministère pour la mise en œuvre de l’ensemble des mesures du Plan climat », explique le ministre de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué. 44 % des éco-entreprises d’Île-de-France ont des problèmes pour trouver les profils souhaités lors de leurs recrutements, selon une étude du Pexe, présentée le 29 mars lors de son Forum national. Cette tendance est, tout de même, une bonne nouvelle, qui illustre bien le fait que la transition énergétique est un élément de croissance pour l’économie française. Par ailleurs, 79% de ces éco-entreprises pensent embaucher dans l’année et, en moyenne, chacune pense à mener au moins 3 embauches. Les profils les plus recherchés sont les ingénieurs (23 %), les commerciaux (21 %) et les informaticiens (19 %). Ces résultats sont basés sur un recensement de 400 entreprises situées sur la région. Une piste d’amélioration pour elles cependant, elles ne sont que 8 % à avoir une Gestion Programmée de l’Emploi et des Compétences (GPEC, gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de l’entreprise). L’Ademe a mis à jour son Avis sur l’hydrogène, identifiant 4 contributions majeures de ce vecteur énergétique : nouvelles opportunités pour l’autoconsommation d’énergies locales, le développement des véhicules électriques hydrogène, la réduction des impacts liés à l’emploi actuel d’hydrogène d’origine fossile dans l’industrie et son utilisation à une échelle locale, dans une vision systémique de l’énergie. « Les consommateurs industriels diffus, éloignés des sites de production, constituent une cible prioritaire », avance l’Avis. « La fabrication des équipements de la chaîne hydrogène représente des enjeux de diversification pour de nombreux acteurs industriels ; ces technologies peuvent irriguer des secteurs variés – énergie, réseaux, télécoms, bâtiments, numérique, transport, aéronautique – en créant de la valeur ajoutée pour des intégrateurs de solutions. Enfin, les enjeux en termes d’emploi concernent tout autant des PME, des ETI que des grands groupes industriels ou de services », ajoute l’agence. Après l‘éolien et avant le solaire, la méthanisation a eu les honneurs d’un groupe de travail dont les 15 conclusions ont été dévoilées le 26 mars. Autant de « nouveaux outils qui doivent permettre de développer des revenus complémentaires aux agriculteurs, de professionnaliser la filière et d’accélérer la réalisation des projets de méthanisation tout en faisant baisser les coûts de production du biogaz », explique le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, dans un communiqué. Le lancement d’un appel d’offres pour les projets de méthanisation avec injection « atypiques », la mise en place d’un complément de rémunération pour les petites installations et la facilitation de l’accès au crédit pour la méthanisation agricole doivent « donner aux agriculteurs les moyens de compléter leurs revenus. » D’autres propositions visent à professionnaliser la filière, notamment la création d’un portail national de ressources sur la méthanisation. Enfin, plusieurs outils sont mis en avant dans le but d’accélérer les projets, notamment la simplification de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et la création d’un guichet unique méthanisation pour l’instruction des dossiers réglementaires et la généralisation de la méthanisation des boues de grandes stations d’épuration. Cette dernière proposition ne fait pas l’unanimité du côté des représentants agricoles. Un groupe de travail spécifique, avec les collectivités et les professionnels, est annoncé pour préciser le calendrier et les soutiens. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude préliminaire sur le marché 2017 des appareils domestiques de chauffage au bois. Les ventes d’appareils ont grimpées de 12%, après trois années consécutives de baisse. Les appareils utilisant des granulés prennent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs et ont représenté 38 % du marché en 2017. La croissance de ce segment a été de 28 % par rapport à 2016. Les ventes d’appareils à bûches ont également progressé de 4 %. Selon ses auteurs cette hausse « démontre une prise de conscience de la part des consommateurs sur le fait que les appareils à bois sont non seulement efficaces, économiques, mais également des vecteurs de la transition énergétique. » L’étude sera complétée, dans les semaines à venir, par de nouveaux indicateurs et un pendant qualitatif afin d’avoir un aperçu global de la filière. Il existe « de nombreuses technologies EnRR (énergies renouvelables et de récupération) relativement matures, qui permettent de produire et d’autoconsommer de l’énergie sur un site industriel, que ce soit de la chaleur ou de l’électricité », explique l’Ademe dans une étude sur l’intégration des EnRR dans l’industrie, dévoilée le 22 mars. Depuis les années 1980, l’industrie s’est mobilisée pour « mieux maîtriser sa compétitivité énergétique » et « réduire son empreinte environnementale », note l’Ademe. Mais malgré « quelques belles réussites », « le déploiement des EnRR est encore trop peu avancé dans ce secteur », ajoute l’agence dans un communiqué. L’étude détaille ainsi 12 secteurs industriels et 10 technologies disponibles : quatre en récupération d’énergie (échangeur sur buées, condenseur de groupes froids, échangeur sur fumées ou sur chaudière) et six énergies renouvelables en autoconsommation (géothermie, biogaz, biomasse, solaire thermique, photovoltaïque et éolien). Si les énergies de récupération sont les plus compétitives, car utilisant de l’énergie déjà payée, les énergies renouvelables, même plus coûteuses, permettent de leur côté de réduire la dépendance aux énergies traditionnelles, et de s’affranchir de la hausse prévue du prix du CO2, souligne l’Ademe. Le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2019-2023 est lancé. La Commission nationale du débat public (CNDP) a mis en ligne le 19 mars la plateforme contributive, sur laquelle chacun pourra, jusqu’au 30 juin 2018, poser des questions, déposer son avis et avoir accès à un ensemble de ressources relatives au débat public et à la PPE. Le site dédié au débat répertorie également différents événements et rencontres co-organisés par la CNDP en partenariat avec des organisations de la société civile auprès de « publics cibles ». En avril 2018, la CNDP tirera par ailleurs au sort 400 citoyens (panel baptisé « G 400 ») « qui suivront toute la procédure et seront amenés à se prononcer sur des questions apparues comme clefs au cours du débat ». Suite à ce débat public, dont « l’État devra tenir compte des enseignements », la révision de la PPE devra être adoptée par décret avant le 31 décembre 2018. De son côté, un collectif d’ONG, réuni sous l’égide de RAC France, a annoncé craindre que le débat public n’occulte certains sujets, « comme la situation économique et financière très critique d’EDF, ainsi que les coûts et risques croissants du nucléaire vieillissant ». Le collectif milite pour prendre en compte « les bonnes nouvelles qui changent la donne et permettent de planifier plus sereinement la fermeture progressive de réacteurs nucléaires : la consommation d’énergie qui se stabilise et tend à la baisse, ainsi que le coût des énergies renouvelables qui continue de chuter ». En février dernier, la 17e édition de l’État des énergies renouvelables en Europe a été mise en ligne sur le site EurObserv’ER. En attendant la publication prochaine de ce rapport en version française, l’équipe du programme EurObserv’ER organise le mardi 27 mars, à 11h, un webinaire autour des principaux résultats de l’édition 2017. Cette session (d’une heure, en anglais) sera l’occasion de commenter les principaux agrégats définissant les niveaux de développement actuels des filières renouvelables au sein de l’Union européenne. Ainsi, seront présentés, l’aspect énergétique avec l’avancée de l’objectif de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, la dimension socio-économique au travers des chiffres d’emplois de 2016, mais aussi un bilan des investissements réalisés ou de la flexibilité des réseaux électriques européens à intégrer les productions renouvelables. En fin de séance, les participants pourront poser des questions aux intervenants. Un pré-enregistrement à la session est possible avec ce lien. Pour se connecter au webinaire, c’est ici. La construction de huit stations GNV/bio-GNV sur le réseau Île-de-France par Sigeif Mobilités et l’achat de 330 poids lourds au GNV/bio-GNV par le Groupe FRAIKIN et TAB Rail Road pour leur réseau européen, tel est le projet lancé le 14 mars par Sigeif Mobilités, le groupe Fraikin et TAB Rail Road. Nommé Olympic Energy, il sollicite le financement de la Commission européenne, dont la décision sera annoncée en septembre 2018. Ce partenariat est « exemplaire d’une démarche coordonnée entre un développeur de réseau de stations de carburants alternatifs, un loueur et un utilisateur de poids lourds roulant au GNV/bioGNV, unis dans une même ambition de favoriser la production et l’usage du biométhane », explique un communiqué. Le projet fait le pari, « par le positionnement européen et l’expérience de ses partenaires » de la complémentarité des modes de transport routier, fluvial et ferroviaire. Annoncée dimanche 11 mars, une opération complexe va redistribuer les cartes dans le secteur de l’énergie outre-Rhin. Dans les faits, un « accord de principe » a été signé par EON et RWE : il doit conduire à la cession d’Innogy, filiale d’énergies renouvelables de RWE, à E.ON. E.ON doit d’abord acquérir 76,8 % d’Innogy. Ensuite, RWE entrera, en contrepartie, dans le capital d’E.ON à hauteur de 16,67 %, pour devenir le premier actionnaire de son rival historique et désormais partenaire. Suite à ces opérations en capital, RWE va récupérer des actifs dans les énergies renouvelables d’Innogy ainsi que celles d’E.ON, tandis que les réseaux et portefeuilles clients d’Innogy resteront chez E.ON. Ce montage par étapes, soumis aux autorités de la concurrence, devrait bouleverser le profil de ces deux géants aujourd’hui intégrés « verticalement », c’est-à-dire mêlant des activités de production et de distribution d’énergie. Avec cette opération, E.ON deviendra « une société d’énergie concentrée sur les réseaux d’énergie et les solutions client » et RWE, « un leader européen pour les énergies renouvelables et la production d’électricité conventionnelle. » Côté emplois, E.on prévoit jusqu’à 5 000 suppressions de postes, étalées sur plusieurs années et qui seront réalisées sur la base de départs volontaires et accompagnés par le groupe, qui comptera à terme 70 000 effectifs. Rolf Martin Schmitz, président du directoire de RWE, a estimé de son côté qu’il n’y aura pas ou très peu de réduction de personnel. Dans le cadre d’un appel d’offres, Sigeif Mobilités, société d’économie mixte (SEM) locale créée par le Sigeif et la Caisse des dépôts, a retenu Total pour « construire et exploiter la plus grande station de France exclusivement consacrée au gaz naturel pour véhicule (GNV) et au bio-GNV ». Les travaux d’aménagement au sein de la plateforme logistique du port de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, débuteront à l’automne, pour une livraison prévue au printemps 2019, précise l’énergéticien dans un communiqué du 13 mars. Total s’est engagé à ce qu’un minimum de 10 % de la totalité des volumes de GNV commercialisés sur la station, qui comptera quatre pistes uniquement dédiées au GNV, soient d’origine renouvelable (bio-GNV). Le groupe a pour objectif de déployer 350 stations GNV en Europe à l’horizon 2022, dont 110 stations en France. L’entreprise locale de distribution (ELD) Gaz Électricité de Grenoble (GEG) a présenté, le 9 mars, un plan d’investissement de 125 millions d’euros dans des sources de production d’électricité d’origine renouvelable. Il vise à couvrir, en 2022, l’équivalent du niveau de consommation des 166 000 Grenoblois, uniquement en énergies renouvelables, soit 400 GWh/an et fixe un point de passage en 2020 à 326 GWh. GEG compte surtout sur l’éolien pour réaliser ses objectifs de passer d’une production annuelle renouvelable de 144 GWh (dont 97 en hydroélectricité, 16 en éolien, 12 en photovoltaïque et 19 en biométhane) à presque 400 GWh en 2022 (dont 143 en hydroélectricité, 209 en éolien, 27 en photovoltaïque et 19 en biométhane). « L’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (137 MW raccordés aux réseaux électriques fin 2018) est d’ores et déjà atteint », indique le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) dans son « Tableau de bord : biogaz pour la production d’électricité – Quatrième trimestre 2017 », à propos des installations de méthanisation. Celles-ci représentent d’ailleurs 85 % des mises en service d’installations produisant de l’électricité à partir de biogaz pour l’année 2017. De plus, note le SDES, le rythme de raccordement de méthaniseurs s’accélère (22 MW raccordés au cours de l’année 2017, contre 17 MW en 2016). S’agissant de l’ensemble des installations biogaz, « le rythme des mises en service s’est considérablement accéléré en fin d’année, plus de 50 % de la puissance raccordée durant l’année l’ayant été au cours du seul quatrième trimestre », précise l’organisme du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ainsi, fin décembre 2017, 548 installations ont produit de l’électricité à partir de biogaz, correspondant à une puissance totale installée de 423 MW. Le « Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz – Quatrième trimestre 2017 » indique par ailleurs qu’à « fin 2017, 44 installations ont injecté du biométhane, après production et épuration de biogaz, dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élève au total à 696 GWh/an, en progression de 69 % par rapport à la fin de l’année 2016. » Une capacité supplémentaire de 285 GWh/an a été installée au cours de l’année 2017, contre 131 GWh/an sur l’année précédente. Les synergies entre énergies renouvelables et développement rural « sont possibles, mais qu’à ce jour, elles restent pour l’essentiel inexploitées », selon un « rapport spécial » de la Cour des comptes européenne. La situation et les besoins des zones rurales devraient être davantage pris en compte dans la politique de l’UE en matière d’énergies renouvelables, notamment lors de la conception des futurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, selon le rapport. Le document revient également sur le financement de projets d’énergies renouvelables par le Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) et conclut que la Commission devrait, pour la prochaine période, renforcer les objectifs plus spécifiquement liés aux ENR. « Les ressources financières allouées au développement rural peuvent jouer un rôle dans la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables au niveau national et de l’UE, mais elles devraient alors profiter aux zones rurales », explique M. Samo Jereb, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. « La Commission européenne n’a pas fourni suffisamment de précisions ou d’orientations à cet égard. » Par ailleurs, quatorze ministres de l’Environnement de l’Union européenne, dont Nicolas Hulot, appellent à renforcer les financements « pro-climat » dans le futur budget pluriannuel de l’UE. Ils demandent à la Commission qu’« au moins 20 % » du futur budget de l’UE soit consacré à des investissements en faveur du climat, expliquent-ils dans une déclaration commune diffusée en marge d’un Conseil des ministres de l’Environnement qui s’est tenu le 5 mars à Bruxelles. Le 2 mai prochain, la Commission européenne donnera le coup d’envoi des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel, qui fixera les balises des dépenses de l’Union sur la période 2021-2027. Evergaz et SICAE-Oise ont annoncé le 2 mars leur association « pour développer puis détenir un ensemble de centrales biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne en partenariat avec les acteurs locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locale…) ». Le partenariat prévoit la création d’une société de co-développement et de co-investissement SICAE-OISE/Evergaz appelée « Hauts-de-France Méthanisation ». Et en parallèle, SICAE-OISE entre au capital d’Evergaz. Les deux partenaires ont prévu d’investir 20 M€ sur 5 ans dans les projets biogaz sur ces 3 départements, dont plus de 80 % des énergies produites sont issues des filières renouvelables essentiellement éolienne et dans lesquels « il reste de belles perspectives de développement dans la méthanisation », expliquent les deux partenaires dans un communiqué. Si l’annonce de fonds de prêt à la méthanisation de 100 millions d’euros a eu lieu à l’Élysée, celle-ci est au cœur des discussions du salon de l’agriculture depuis son ouverture, le 24 février. Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, y a présidé la deuxième réunion plénière du groupe de travail sur la méthanisation. Il a également décalé au 26 mars l’annonce de ses résultats, avec des réunions des sous-groupes prévues d’ici-là. Car, comme il l’a expliqué dans un entretien au Figaro, le gouvernement veut « faire du développement de la méthanisation l’un des éléments de la trajectoire énergétique française », dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), et apporter ainsi « une partie de la solution à la crise agricole dans notre pays. » Pour rappel, le fonds lancé par le Président Macron devrait être mis en place dès l’automne 2018 avec Bpifrance, dans le cadre du grand plan d’investissement agricole de 5 milliards d’euros qui doit accompagner la transformation de l’agriculture. Lancé en février 2016, pour un volume total de 180 MW répartis sur 3 ans, l’appel d’offres pour les installations biomasse énergie a livré sa deuxième tranche. Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a désigné 11 nouveaux lauréats : 9 projets pour le lot bois énergie et 2 projets de méthanisation, pour un volume total de 52,9 MW. Le tarif moyen pondéré par la puissance de ces 11 installations est de 122,50 €/MWh, un tarif comparable à celui de la première vague. Cet appel d’offres porte sur un volume annuel de 50 MW pour le bois énergie (plus de 300 kW) et de 10 MW pour de la méthanisation (plus de 500 kW). Or pour cette dernière, seul 1,3 MW ont finalement été attribués pour cette deuxième tranche, au moment où le gouvernement réfléchit à des mesures pour encourager le développement de la filière. Les lauréats bénéficieront d’un complément de rémunération garanti pendant 20 ans. La troisième (et dernière) période de candidature sera ouverte du 29 juin au 31 août 2018. Comme annoncé, Enedis va tester de nouveaux moyens pour mieux intégrer les énergies renouvelables au système électrique, notamment en Vendée et en Champagne-Ardennes, a-t-il annoncé le 22 février. Dès le mois prochain, la filiale d’EDF va ainsi expérimenter une nouvelle manière de raccorder un parc éolien et un parc solaire, en Vendée. Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité proposera au développeur d’accepter, par contrat, que la puissance injectée dans le réseau soit réduite, dans les premiers mois de la mise en service, en échange d’un raccordement plus rapide. « Nous souhaitons industrialiser ces offres dès l’année prochaine », a expliqué, à l’AFP, Hervé Lextrait, chef du département Producteurs d’Enedis, même si pour l’instant le cadre réglementaire manque pour généraliser ces « offres de raccordement intelligentes ». Autre expérimentation qui sera lancée l’an prochain en Champagne-Ardennes : recharger des véhicules électriques grâce au pilotage de l’électricité produite dans des parcs éoliens et utiliser les réserves de courant dans les batteries des véhicules pour aider le réseau électrique, lorsque les éoliennes ne tournent pas. Selon une étude commandée par la Commission européenne et réalisée par l’Irena, l’Agence internationale des énergies renouvelables, l’Union européenne pourrait atteindre une part d’énergie renouvelable dans sa consommation totale d’énergie de 34 % en 2030, contre un objectif actuellement fixé à 27 %. « Le rapport confirme nos propres observations sur la baisse importante des coûts des renouvelables ces dernières années, et la nécessité de prendre en compte ce nouvel environnement dans la fixation de notre niveau d’ambition dans le cadre des négociations à venir pour définir les politiques énergétiques de l’Europe », explique le commissaire européen à l’Action pour le Climat, Miguel Arias Canete, dans un communiqué du 20 février. Or, si les États membres s’en tiennent à leurs projets et programmes actuels, le déploiement des renouvelables n’atteindra que 24 % en 2030, prévient le rapport. L’agence insiste également sur le fait qu’un objectif ambitieux serait «?rentable?» pour les États membres. Pour autant, prévient Adnan Ami, directeur général de l’Irena, si l’UE ne prend pas les « ?bonnes décisions financières maintenant? », le bloc européen risquerait de se retrouver avec « ?de très importants actifs bloqués d’infrastructures énergétiques obsolètes? ». Les batteries électriques produites par l’UE seront « vertes », recyclables et réutilisables pour se distinguer de la concurrence, a expliqué le 20 février le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, qui porte le projet d’une « Alliance européenne des batteries ». « Nous voulons quelque chose de différent par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché », a souligné, selon l’AFP, le commissaire à Bruxelles, en amont du premier « Forum industriel de l’énergie propre », au cours duquel la Commission espère promouvoir son plan stratégique pour le développement de batteries électriques. Pour répondre à la demande d’ici 2025 (un marché de 250 milliards d’euros), Maros Sefcovic estime que l’UE devra se doter de 10 à 20 « giga-entreprises », et former 300 000 à 400 000 personnes pour cette production spécifique. La Commission espère que l’industrie s’engagera sur les 20 priorités identifiées pour développer le marché au sein de l’UE, avec au premier rang « la réduction de l’empreinte carbone » tout au long de la chaîne de production et du cycle de vie du produit. L’industrie a par ailleurs proposé de créer un label européen pour les batteries produites. Dans les tuyaux depuis mai 2017, l’Agence fédérale allemande qui gère les réseaux, Bundesnetzagentur, a annoncé le 19 février le lancement d’un appel d’offres bi-technologie éolien-solaire de 200 MW. À l’instar de la France, « c’est la première fois qu’un appel d’offres inter-technologie est lancé en Allemagne », précise le communiqué de l’Agence. Les candidats peuvent ainsi présenter aussi bien des projets éoliens que des projets solaires et doivent se conformer aux mêmes règles, notamment un prix maximum fixé à 88,4 euros/MWh. Les projets auront une puissance minimale de 750 kW tandis que les centrales solaires au sol ne pourront pas dépasser les 20 MW. « Le groupe de travail sur la méthanisation s’est réuni pour la première fois le 1er février », a expliqué Sébastien Lecornu, le 8 février, en clôture du colloque du SER. Les travaux sont donc d’ores et déjà lancés sur différentes commissions techniques : la simplification des réglementations, l’accès au financement (qui constitue aujourd’hui la principale difficulté de cette filière), les dispositifs de soutien public et la réflexion sur le biogaz dans les nouvelles mobilités. Le secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a expliqué que le sujet était « un enjeu majeur pour l’agriculture française, pour les éleveurs, dans la diversification des revenus pour une partie des agriculteurs français. » C’est pourquoi le calendrier est « particulièrement resserré pour pouvoir présenter un certain nombre de conclusions opérationnelles pour le salon de l’agriculture » (du 24 février au 4 mars), a-t-il annoncé. « Nous savons qu’il suscite encore des débats, que nous avons à nous convaincre collectivement de la maturité de cette technologie. Nous engagerons pour cela dans l’année des études préliminaires au lancement d’un appel d’offres pré-commercial sur l’hydrolien », a annoncé Sébastien Lecornu, le 8 février, en clôture du colloque du SER. L’appel d’offres commercial, lui, aurait lieu en 2019. Ces études techniques préliminaires sur les zones du Raz Blanchard, en Normandie, et du Fromveur, près de l’île d’Ouessant, étaient fortement attendues par la filière et les récentes annonces de Nicolas Hulot n’avaient pas rassuré grand monde. D’autant plus depuis l’abandon par Naval Énergies de l’expérimentation menée sur le site de Paimpol-Bréhat, en Bretagne. Les salariés des quelque 400 concessions hydrauliques de France sont appelés à la grève le 13 mars pour défendre le maintien dans le service public de ce secteur que la France est sommée par Bruxelles d’ouvrir à la concurrence, a appris le 13 février l’AFP de sources syndicales. Cet appel à l’initiative de l’intersyndicale CFDT, CGT, CFE-CGC et FO intervient après une rencontre la semaine dernière avec le cabinet du Premier ministre et alors que le gouvernement semble vouloir accélérer sur ce dossier, selon les syndicats qui refusent que soient « bradés » les barrages. Pour rappel, Bruxelles a mis en demeure la France, en octobre 2015, d’ouvrir à la concurrence ses concessions. Propriétés à 100 % de l’État, les barrages sont actuellement concédés en très grande majorité à EDF, qui détient environ 85 % de la puissance installée, et à Engie, via ses filiales Compagnie nationale du Rhône (CNR) et Société hydroélectrique du Midi (Shem). Pour sa 8e édition, le baromètre annuel OpinionWay pour Qualit’EnR est riche d’enseignements sur les (très) bonnes dispositions des Français en matière d’énergie renouvelable. Première surprise, ils seraient déjà 35 % à disposer, dans leur résidence principale, d’au moins un équipement utilisant des énergies renouvelables, soit une hausse de 3 points par rapport à la vague précédente et 27 % (+5 points) envisageraient de s’équiper. Résultat plus inattendu encore, si les Français encouragent massivement le développement des énergies renouvelables, ils placent en tête de classement le solaire thermique (90 %) devant le photovoltaïque (82 %), l’éolien (81 %) ou le bois énergie (70 %). Autre enseignement qui cautionne sans réserve la nouvelle approche des pouvoirs publics, l’autoconsommation : 88 % des Français préfèreraient consommer leur électricité solaire plutôt que de la vendre au réseau. L’autoconsommation collective ou, dit autrement, de la possibilité de revente à autrui intéresse aussi. Si 57 % des personnes interrogées vendraient sur le réseau l’électricité produite mais non consommée, ils seraient 21% à préférer la revendre à d’autres consommateurs locaux, voire à des associations caritatives ou à des personnes en situation de précarité énergétique (10 %). L’enjeu économique est également abordé. Pour 68 % des Français, s’équiper en énergies renouvelables est perçu comme le meilleur investissement financier, devant l’achat d’un véhicule propre ou un placement immobilier (60 %). La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) s’est fixé l’objectif d’augmenter la part verte des énergies renouvelables et de récupération dans son réseau pour atteindre 60 % d’ici 2020. Pour ce faire, elle a noué avec Engie un partenariat pour la fourniture de 100 GWh de biométhane par an pendant 5 ans, permettant la production de 130 000 tonnes annuelles de vapeur verte à destination du réseau de chauffage urbain parisien. Cet accord « constitue à ce jour le plus important contrat de biométhane en France », assure les deux partenaires dans un communiqué commun. « Après l’abandon du fioul lourd et la réduction pour moitié du charbon, l’introduction du bois, le recours aux biocombustibles liquides (huiles végétales) et à la géothermie, CPCU poursuit le verdissement et la diversification de son mix énergétique par l’acquisition de biométhane », ajoutent-ils. Augmenter la part de chaleur récupérée des unités de valorisation énergétique des déchets ménagers, la part de la biomasse sous forme de granulés de bois notamment et installer une ou plusieurs unités de production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération sont les autres dispositifs et sources d’approvisionnement étudiés par la CPCU pour atteindre son objectif de 60 %. « Vérifier si l’aide apportée par l’Union européenne et les États membres en faveur de la production d’électricité d’origine éolienne et solaire photovoltaïque est efficace », tel est l’objectif de la Cour des comptes européenne. L’institution a annoncé le 1er février qu’elle réalisait un audit pour analyser « la conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies établies aux niveaux nationaux et européen en matière d’éolien et de solaire photovoltaïque depuis 2009, ainsi que les fonds consacrés par l’UE et par les États membres à leur développement. » Le rapport d’audit est attendu pour le début 2019. Les auditeurs se rendront dans quatre États membres: l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce et la Pologne. À l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique, l’Ademe, GRDF et GRTgaz ont présenté une étude de faisabilité technico-économique d’un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050. Le gisement de gaz renouvelable injectable estimé à 460 TWh pourrait couvrir entièrement la demande de gaz en France à l’horizon 2050 selon tous les scenarii. Trois grandes filières de production de gaz renouvelable sont étudiées : la méthanisation (30 % du gisement potentiel), la pyrogazéification (40 %) et le power-to-gas (30 %). Pour atteindre l’objectif à 2050, il conviendrait de lever les freins sur la méthanisation agricole, de mobiliser davantage de ressources agricoles et forestières et de favoriser l’émergence de technologies à fort potentiel mais encore peu matures (pyrogazéification, gazéification des algues etc.). Selon cette étude, un mix gaz 100 % renouvelable permettrait d’éviter les émissions directes d’environ 63 Mt CO2/an ce qui représente 12,6 milliards d’euros, dans l’hypothèse dune taxe carbone à 200 €/t de CO2. Propellet France a annoncé le lancement d’une formation numérique gratuite et accessible à tous (sans inscription) : « Prescrire le chauffage au granulé de bois ». Les vidéos, en ligne depuis le 29 janvier, visent à apporter les clefs pour faciliter la prescription du granulé. Le Mooc cible les bureaux d’Etudes, maîtres d’œuvres et architectes. Mais les autres métiers liés au chauffage pourront largement trouver des détails techniques liés à leur activité, comme par exemple la partie « fumisterie » pour les installateurs. Il se décline en trois chapitres pour un total de plus de 30 leçons (de 1 à 5 minutes chacune, soit une durée totale de 1h30). Le premier chapitre, « Tout savoir sur le granulé », a pour but de présenter le chauffage au granulé de bois, ses atouts et le développement de la filière. Les deuxième et troisième parties, « Conception d’une chaufferie » et « Exploitation et maintenance d’une chaufferie », entendent répondre aux questions techniques que peuvent se poser les prescripteurs sur les labels, le dimensionnement, le stockage et l’exploitation. Enfin, la quatrième partie, « Retours d’expérience », a pour but de montrer des retours d’expériences et témoignages. En 2017, Nicolas Hulot avait martelé le fait que la France n’atteindra ses objectifs en matière d’énergies renouvelables que si les citoyens pouvaient s’associer au financement des projets. C’est dans cette optique qu’a été lancé, lundi 29 janvier, le fonds EnRciT. Doté d’un budget de 10 millions d’euros apporté par la Caisse des Dépôts (5 M€), le Crédit Coopératif (2,5 M€) et l’Ircantec (2,5 M€), son rôle sera de co-investir dans des projets aux côtés des citoyens et des collectivités. EnRciT apportera les moyens financiers nécessaires à la consolidation de la phase de développement (sécurisation du foncier, réalisation d’études ou obtention des autorisations de construire et d’exploiter). Le fonds sera un lien entre les citoyens et les développeurs de projets avant de passer le relai une fois l’investissement réalisé. EnRciT n’a en effet pas vocation à rester au capital des projets une fois leur exploitation lancée. EnRciT cible en priorité les centrales photovoltaïques, au sol ou en toiture, d’au moins 1 MW et des centrales éoliennes. L’objectif est de porter 150 projets au cours des 10 ans à venir, avec une quinzaine de réalisations dès 2018. L’Ademe n’abondera pas au fonds mais elle accompagnera l’outil notamment en apportant un soutien technique et financier dans la phase d’amorçage des projets. Énergies Partagée et les SEM Énergies Posit’if, SDESM Énergies et SIP’EnR ont annoncé le 17 janvier avoir signé la « Charte des acteurs franciliens de l’investissement public et citoyen dans les énergies renouvelables », une convention de partenariat pour favoriser l’essor des énergies renouvelables en Île-de-France. Les partenaires s’engagent « à promouvoir l’investissement participatif, à accompagner les projets des citoyens et des collectivités et à essaimer leur expérience sur le territoire francilien », expliquent-ils dans un communiqué commun. La Société d’économie mixte (SEM) Énergies Posit’if est l’opérateur de transition énergétique de la région Île-de-France, laquelle veut passer de 5 à 11 % d’énergie produite à partir d’énergies renouvelables d’ici 2020. La SEM SDESM Énergies a été créée à l’initiative du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM). Quant à SIP’EnR, il s’agit d’une SEM créée à l’initiative du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris (Sipperec). Catholiques, protestants et orthodoxes ont créé un label « Église verte » pour encourager leurs communautés à prendre le chemin de la « conversion écologique », via un site internet, mis en ligne à l’occasion de la « semaine de prière pour l’unité des chrétiens » (18-25 janvier), où chaque paroisse peut faire son « éco-diagnostic ». « Le label s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens », explique le site internet dédié à cette initiative. À renouveler chaque année, « le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de progression. » Cette initiative a été lancée dans le sillage de la conférence climat COP21 de fin 2015 à Paris. Mais aussi, côté catholique, dans celui de l’encyclique « Laudato si' » publiée quelques mois auparavant par le pape François, qui a fait de « l’écologie intégrale » un marqueur fort de son pontificat. Cepsa et Masdar ont annoncé le 18 janvier la signature d’un protocole d’entente afin d’étendre leurs activités à l’international dans le secteur des énergies renouvelables. Cet accord entre le groupe pétrolier espagnol et le groupe d’Abou Dhabi, spécialisé dans les projets d’énergies renouvelables, vise « à explorer une collaboration sur des projets relatifs aux énergies renouvelables, en particulier éoliennes et solaires ». Les deux groupes « prévoient d’explorer les opportunités qui existent là où ils sont déjà actifs ou dans les régions faciles d’accès comme, parmi d’autres, l’Espagne, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe », expliquent-ils dans un communiqué. EDF, de son côté, avait annoncé le 15 janvier la signature d’un protocole d’accord avec Masdar pour développer des projets en Afrique subsaharienne. Le partenariat explorera les opportunités de développement dans le cadre des investissements déjà existants d’EDF et Masdar dans l’électricité décentralisé et se penchera aussi sur de possibles nouveaux projets, précisent les deux groupes dans un communiqué commun. Les coûts de l’éolien et du solaire vont encore baisser fortement ces prochaines années au point que ces deux énergies seront globalement moins chères que les énergies fossiles (fuel, gaz, charbon), mais les autres énergies vertes progressent également rapidement, estime l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) dans une étude, publiée le 15 janvier, sur les coûts des énergies vertes. Dans les deux prochaines années, les coûts moyens des renouvelables devraient atteindre entre 30 et 100 $/MWh en fonction des technologies, quand les énergies fossiles affichent des coûts entre 50 et 170 $/MWh, note le document. « Se tourner vers les renouvelables […] n’est plus simplement une décision faite au nom de l’environnement mais, de plus en plus largement, une décision économique intelligente », explique Adnan Z. Amin, directeur général de l’Irena, cité dans le communiqué. Au-delà de l’éolien et du photovoltaïque, la baisse des coûts s’observe aussi pour les autres énergies renouvelables, note l’Irena. L’an dernier, des projets dans la géothermie, la biomasse ou l’hydroélectricité se sont ainsi développés avec des coûts autour de 70 $/MWh. Le solaire à concentration et l’éolien en mer font également des progrès et certains projets qui seront mis en service d’ici 2020 et 2022 coûteront entre 60 et 100 $/MWh, prévoit l’Irena. « Cette nouvelle dynamique témoigne d’un changement significatif de modèle énergétique », selon M. Amin. « Les premiers contrats de transition écologique (CTE) seront signés au cours du deuxième trimestre 2018, en concertation avec tous les acteurs des collectivités engagées, en vue d’une expérimentation dans une quinzaine de territoires en 2018 », a annoncé Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, à l’occasion d’un déplacement à Arras le 11 janvier, où le gouvernement a lancé la négociation d’un premier CTE, avant la Corrèze le lendemain. Ces CTE sont censés accompagner des territoires qui ont connu des difficultés industrielles, qui nécessitent un accompagnement social de la transition énergétique (par exemple là où doivent fermer les centrales à charbon) mais aussi des territoires « vertueux » en avance sur la transition. Le ministère fait état, dans un communiqué, de 6 principaux axes pour les futurs contrats : des partenariats au plus proche de la réalité locale – une collaboration à tous les échelons territoriaux – pour la première fois, les entreprises locales pleinement associées – une logique de guichet unique pour le financement des projets – un accompagnement de l’État par une équipe dédiée et une quinzaine de démonstrateurs en 2018. Le monde devra engager des transformations drastiques et immédiates s’il veut avoir quelques chances de rester sous le seuil critique de 1,5 °C de réchauffement, limite la plus ambitieuse fixée par l’accord de Paris, souligne un projet de rapport du groupe des experts du climat de l’ONU (Giec) dévoilé le 11 janvier. Vu la persistance des gaz dans l’atmosphère, le monde n’a plus devant lui que 12 à 16 ans d’émissions au rythme actuel, s’il veut garder 50 % de chances de s’arrêter à ce niveau de température, explique ce rapport commandé au Giec après l’adoption de l’accord de Paris fin 2015 et qui doit être publié à l’automne 2018. Le « seul » moyen de rester à +1,5 °C est d’« accélérer la mise en œuvre d’actions rapides, profondes, multi-sectorielles », avance le projet de texte : réduire « fortement » la demande d’énergie par habitant, développer les énergies renouvelables (qui doivent devenir source dominante d’énergie primaire à partir de 2050), décarboner le secteur électrique d’ici la moitié du siècle, en finir « rapidement » avec le charbon. L’Institut français des relations internationales (Ifri) s’est penché sur un sujet aussi majeur que sensible pour le développement des énergies renouvelables dans une étude publiée le 4 janvier et intitulée La transition énergétique face au défi des métaux critiques. Une domination de la Chine ? « Les enjeux sont ici géopolitiques, économiques, environnementaux, et sont dramatisés par une géographie de la production resserrée autour de quelques pôles producteurs (Chine, Amérique latine, Australie, Congo principalement) », rappelle son auteur, qui préconise notamment la systématisation du recyclage pour que l’Europe garde la main sur cette matière première indispensable. « À défaut de pouvoir relancer une exploration minière ambitieuse, l’UE doit ici investir dans des matériaux alternatifs et dans la constitution de filières de recyclage pour que la transition énergétique ait des retombées tangibles en termes d’emplois industriels sur son territoire », explique l’étude, qui tempère cependant la notion même de criticité. Celle-ci prête en effet « à discussion tant l’équilibre entre l’offre et la demande varie selon les métaux considérés et évolue au fil du temps. » Le parc français installé s’est accru de 2,4 GW de puissance supplémentaire en 2017, explique l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER, éditeur du Journal des Énergies Renouvelables) dans son Baromètre 2017 des énergies renouvelables électriques, dévoilé le 9 janvier. Ce chiffre est supérieur à la progression enregistrée en 2016 (+2,3 GW), il porte la puissance globale à presque 49 GW. Ainsi, « l’objectif 2018 de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) était atteint à 92 % à la fin de 2017 », selon Frédéric Tuillé, responsable des études de l’association. Il ressort également que l’ensemble des filières électriques renouvelables cumule près de 44 500 emplois directs en France et génèrent un chiffre d’affaires conséquent de 15,2 milliards d’euros. Pour 2018, trois évènements pourraient impacter fortement le développement des énergies renouvelables, au premier rang desquels les discussions autour de la PPE, a affirmé Vincent Jacques le Seigneur, président d’Observ’ER. La réécriture des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et la mise en pratique des ambitions photovoltaïques annoncées récemment par EDF sont également plus qu’attendus. Ce, dans l’optique d’un « green new deal« , annoncé par Nicolas Hulot pour 2018. Le gouvernement souhaite encourager « les efforts de recherche et de développement dans toutes les filières d’excellence des énergies renouvelables [notamment] grâce au Programme des investissements d’avenir (PIA) », a annoncé Nicolas Hulot le 8 janvier dans un communiqué. Un « Concours d’innovation », organisé via BPI France et l’Ademe, remplace désormais les appels à projets « Initiative PME ». Il s’inscrit dans le Grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros, annoncé en juillet 2017, avec des priorités sur la neutralité carbone et la compétitivité des énergies. Un appel à projets pour des démonstrateurs sera également lancé, toujours par l’Ademe, au cours du premier trimestre de 2018. « Dans le cadre du PIA3, qui commence cette année, cet appel à projets s’adressera plutôt à des consortiums », a expliqué David Marchal, chef de service adjoint Réseaux et énergies renouvelables au sein de l’Agence, le 9 janvier, à l’occasion de la présentation du Baromètre 2017 des énergies renouvelables électriques d’Observ’ER. Les projets seront ainsi plus importants et concerneront la mise au point pré-commerciale de nouvelles technologies de renouvelables, de stockage d’énergie ou de gestion des réseaux intelligents, avant une mise sur le marché. Réunies à Paris le 12 décembre, des entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles, lors du One Planet Summit, un sommet destiné à empêcher de « perdre la bataille » contre le réchauffement climatique, selon l’expression du Président français, Emmanuel Macron. La Banque mondiale a, par exemple, annoncé qu’elle arrêterait de financer après 2019 l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz, sauf « circonstances exceptionnelles ». De même, l’assureur français Axa a annoncé un désengagement accéléré de l’industrie du charbon et un groupement de plus de 200 grands investisseurs a décidé de mettre la pression sur 100 entreprises parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre, pour qu’elles adaptent leur modèle à la lutte contre le réchauffement. Certaines associations écologistes ont toutefois déploré un manque d’engagements financiers directs des États. Clôturant les débats, Emmanuel Macron, jugeant que le sommet avait permis de commencer à « rattraper un peu de terrain dans ce champ de bataille », a annoncé la création d’une plateforme en ligne « One Planet » qui regroupera toutes les initiatives. Et souhaité que cet événement se répète « chaque année » sous ce format, à Paris ou ailleurs. Le groupe français Enertime (cf. Le JDER n° 240) a annoncé, dans un communiqué du 12 décembre, la signature d’un contrat de vente de licence à la société chinoise Beijing Huasheng ORC Technology pour des applications de la technologie de turbine pour machine ORC. Ce contrat, précise le concepteur de modules à cycle organique de Rankine (ORC), porte sur les applications de 1 MW en récupération de chaleur industrielle moyenne et basse température sur le marché chinois. Il fait suite à une première commande signée en 2015 par ce même client pour la fourniture d’une turbine d’1 MW pour l’aciérie de Baotou Steel à Baotou. Tout comme l’éolien et le photovoltaïque, le biométhane aura son groupe de travail national piloté par le secrétaire d’état à la Transition écologique et solidaire. « Revoir l’environnement réglementaire et administratif [de cette filière] en le simplifiant et mettre en place de nouvelles méthodes de financement », tel est son objectif, énoncé par Sébastien Lecornu le 7 décembre. « Autant de sujets qui freinent actuellement, considérablement, le développement de cette filière d’excellence », a expliqué France Biométhane dans un communiqué. Le think tank n’a en effet pas tardé à « se réjoui[r] » de cette annonce. « La constitution de ce groupe de travail est une excellente nouvelle car il ne fallait pas attendre que cette filière soit tout à fait mature pour l’accompagner », a avancé Cédric de Saint-Jouan, président du think tank France Biométhane, cité dans le communiqué. En raison des fêtes de fin d’année, L’Actu EnR fait une petite pause et reviendra mercredi 10 janvier. Toute l’équipe du Journal des Énergies Renouvelables et d’Observ’ER souhaite de très joyeuses fêtes aux lecteurs de L’Actu et leur donne rendez-vous en 2018 pour une année encore plus renouvelable. Invité le 1er décembre de la matinale de la radio publique France Inter, le ministre de la Transition Écologique et solidaire, Nicoals Hulot, a réaffirmé qu’un ”green deal” était bien dans le calendrier du gouvernement pour 2018. Ce, au détour d’une réponse à un auditeur. « Sur les énergies renouvelables, là où je peux partager l’inquiétude de l’auditeur, je suis en train de préparer avec trois ministères un ”green new deal” pour que le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, puisse changer d’échelle. Cela va prendre un peu de temps, nous allons présenter un plan massif au Président de la République au printemps 2018 et là aussi il faut que les règles ne changent pas, car on a parfois, c’est vrai, fragilisé la filière. Nous avons un potentiel de développement des énergies solaire et éolienne extraordinaire et je voudrais que la France change d’échelle dans ce domaine. » Les premières pistes de ce ”green deal” pourraient être dévoilées lors du One Planet Summit qui aura lieu le 12 décembre à Paris. Le parc d’appareils à granulés ne cesse de progresser et plus de 800 000 foyers se chauffent ainsi en France en 2017, selon un communiqué de Propellet publié le 4 décembre. « Dans un marché du chauffage au bois contrasté, le segment des poêles à granulés est l’une des rares satisfactions offertes par le marché en 2015 et 2016. En 2017, les poêles devraient connaître encore une forte hausse (environ 30 %) ce qui devrait porter le nombre de poêles vendus à 140 000, se réjouit l’association. Quant au marché de la chaudière à granulé de bois, après 2 années consécutives compliquées, au cours desquelles les fabricants et distributeurs ont dû faire face à un prix du fioul bas et des hivers doux, les ventes de chaudières devraient connaitre une embellie cette année avec une progression d’environ 20 % soit 4 700 pièces vendues. » La production de granulés de bois continue, elle, sa courbe de progression et devrait atteindre 1,3 million de tonnes en 2017. « Les poêles à granulés représentent un peu plus de 90 % du marché, et les chaudières à granulés 10 % des installations », précise Propellet. Engie a fait savoir le 4 décembre qu‘il visait 100 % de gaz d‘origine renouvelable en France à l‘horizon de 2050, en misant sur le biométhane et l‘hydrogène pour “verdir” massivement son offre. Alors qu‘il s‘approvisionne aujourd‘hui auprès des grands pays gaziers, le groupe travaille sur une quarantaine de projets d‘unités de biogaz en France dans lesquels il veut investir. Mais l’énergéticien s’est par ailleurs plaint de lenteurs administratives pour faire aboutir les dossiers. « Les dossiers sont là : il y a 400 projets en France, 40 pour Engie, le problème c’est d’arriver à les faire sortir vite et ça c’est un problème d’autorisations, de financement, dans une très petite mesure technique », a indiqué Didier Holleaux, directeur général adjoint d’Engie lors d’une conférence de presse. « Les autorisations sont très lentes, de l’ordre de deux ans pour un digesteur de moyenne capacité », a-t-il regretté. Les investissements d’Engie dans le biogaz devraient passer de quelques dizaines de millions d’euros aujourd’hui à quelques centaines « demain quand les projets vont s’accélérer », a ajouté Didier Holleaux, sans fixer d’horizon précis. La filière va pouvoir profiter de l’arrêté du gouvernement publié la veille sur la réfaction tarifaire, qui prévoit la prise en charge d’une partie des coûts de raccordement au réseau public d’électricité. Le coût du raccordement des projets biogaz va ainsi baisser de 40%. L’Institut costaricien de l’électricité (ICE) a publié un rapport indiquant que le pays d’Amérique centrale a franchi le cap des 300 jours de production électrique 100 % renouvelable. Selon Carlos Manuel Obregón, président exécutif d’ICE, le chiffre pourrait encore grimper. Ce n’est pas la première fois que le Costa Rica bat des records, puisqu’en 2015, la totalité de son électricité consommée provenait de sources d’énergies renouvelables pendant 299 jours, mais 2017 marque d’ores et déjà un nouveau jalon. Le mix électrique en 2017 repose, pour l’heure à 78,26 % sur l’hydraulique, 10,29 % sur l’éolien, 10,23 % sur la géothermie et 0,84 % sur le solaire et la biomasse. Les hydrocarbures ne comptant que pour 0,38 % du mix électrique annuel. Si le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a récemment annoncé qu’il travaillait à réduire à « moins de sept ans » le délai nécessaire en France pour créer un parc éolien en mer, contre « plus de 10 ans » actuellement, il est apparu bien plus flou s’agissant des autres énergies marines renouvelables (EMR), hydroliennes ou énergie thermique des mers. « On va continuer de les soutenir jusqu’au jour où on pourra lancer les premiers appels d’offres », a déclaré le ministre le 22 novembre en clôture des Assises de la mer au Havre. Interrogé par l’AFP sur le fait que les industriels de l’hydrolien réclament un appel d’offres dès à présent pour leur technologie, il a répondu : « Ne brûlons pas les étapes […] Nous allons faire évaluer » cette technologie. Et de poursuivre, « Les hydroliennes ont pris un peu de retard dans leur phase recherche mais je ne doute pas qu’elles joueront un rôle très important dans le mix énergétique ». Naval Énergie doit ouvrir une usine d’assemblage d’hydroliennes à Cherbourg au printemps. Enedis a annoncé le 23 novembre qu’il testerait de nouveaux moyens pour mieux intégrer les énergies renouvelables au système électrique. Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité va ainsi expérimenter une nouvelle manière de raccorder un parc éolien et un parc solaire en Vendée en proposant au développeur d’accepter, par contrat, que la puissance injectée dans le réseau soit réduite en échange d’un raccordement plus rapide. L’objectif est d’industrialiser ces offres dès 2018, même si pour l’instant le cadre réglementaire manque pour les généraliser. Une autre expérimentation, qui sera lancée l’an prochain en Champagne-Ardenne, aura pour objectif de recharger des véhicules électriques grâce au pilotage de l’électricité produite dans des parcs éoliens et utiliser les réserves de courant dans les batteries des véhicules pour aider le réseau électrique lorsque les éoliennes ne tournent pas. Enedis est en train de finaliser l’élaboration d’un consortium réunissant des collectivités, une start-up, un fabricant de bornes de recharge et un constructeur automobile. L’objectif est de tester ce dispositif sur des flottes d’entreprises ou de collectivités. « Nous allons lancer un appel d’offres photovoltaïque et éolien », a déclaré Virginie Schwarz, directrice de l’énergie à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), lors des Assises nationales de l’éolien terrestre organisées le 16 novembre par le SER. « Nous le faisons parce que la Commission européenne nous l’a demandé. » Il s’agira du premier appel d’offres dit de « technologie neutre », mettant en concurrence ces deux énergies renouvelables. Et, on l’aura compris, ce n’est pas l’option préférée des pouvoirs publics et industriels français, lesquels souhaitent conserver les appels d’offres par technologie, avec, notamment, l’appel d’offres pluriannuel éolien, dont la première phase se termine le 1er décembre. « Nous sommes convaincus que cela montrera bien, à la fin, en comparant les deux solutions, que les appels d’offres par technologie sont plus efficaces », a ajouté Virginie Schwarz. Pour les industriels, la récente expérience espagnole devrait décourager Bruxelles d’engager l’Europe dans cette voie. Sur un appel d’offres multi-énergies de 3 000 MW, la quasi-totalité des capacités (2 979 MW) avait finalement été attribuée à l’éolien, au détriment du solaire. « Je vais peut-être un peu modérer votre enthousiasme », a répondu le 21 novembre, devant l’Assemblée nationale, le ministre de la Transition écologique et solidaire au député (LREM) Adrien Morenas, qui louait « une conférence que nous espérons salutaire pour notre planète ». « Le bilan de la COP23 est en demi-teinte », a dit Nicolas Hulot au sujet de la conférence climat de l’ONU qui s’est achevée le 18 novembre, à Bonn. « L’onde de choc du retrait des États-Unis sur ce processus se fait peut-être plus sentir maintenant qu’il ne s’est fait sentir dans un premier temps, et donc je me garderai bien d’un optimisme trop important ». Et de poursuivre : « La communauté internationale, qui était rassemblée (à Bonn) pour la première fois depuis la décision des États-Unis, a démontré qu’il y a quand même une coalition qui demeure solide, mais qui a jeté le doute sur la détermination de certains États. Face à l’urgence, les progrès ont été trop lents, notamment par rapport à l’alerte des scientifiques, qui nous ont affirmé que ce que nous allons décider ou non est déterminant pour l’avenir. Alors, il faut accélérer l’action », a-t-il souligné. « C’est une course contre la montre, et la parole de vérité, c’est la COP24 en Pologne », programmée en décembre 2018, a conclu le ministre. Si le Premier ministre Édouard Philippe a longuement discouru sur l’éolien offshore, le 21 novembre, lors des Assises de la mer au Havre, il n’a, en revanche, pas eu un mot pour l’hydrolien. Ce, alors que mi-novembre, le SER, EVOLEN (un réseau de près de 250 sociétés dont l’expertise couvre toutes les énergies) et le GICAN (Groupement des industries de construction et activités navales) avaient réclamé dans un communiqué commun un appel d’offre pour des fermes hydroliennes commerciales. Ils ont également insisté sur « le lancement dès à présent des appels d’offres annoncés, notamment au large d’Oléron [éolien flottant] ». Les regards se tourneront vers le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, lequel doit clôturer les assises ce mercredi 22 novembre. Le gouvernement va « débloquer une enveloppe de 75 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finance rectificative pour répondre aux premières urgences sur les projets engagés », a déclaré Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, interpellé à l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement du 14 novembre. Ces projets font partie du dispositif « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (Tepos) lancé en 2014 par Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer. Au total, plus de 500 territoires lauréats ont été désignés, portant à 750 millions d’euros l’ensemble des engagements conclus par l’État, alors que les crédits de paiement prévus se montent à seulement 400 millions d’euros. Pointant une « impasse de financement », le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, avait envoyé fin septembre une circulaire aux préfets pour durcir les règles de gestion de ce dispositif, suscitant la colère et l’inquiétude de nombreuses collectivités. Interpellé au Sénat fin octobre, le ministre avait promis des mesures, assurant que « la parole de l’État [serait] tenue » et que le ministère cherchait à faire « un état des lieux précis » de la situation. Dans son récent insight paper intitulé Les énergies renouvelables pour l’industrie , disponible sur le site de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Cédric Philibert dévoile les directions envisageables pour réduire l’impact carbone de l’industrie. « La principale conclusion de ce rapport est que les récentes et rapides réductions des coûts du solaire photovoltaïque et de l’éolien peuvent permettre de nouvelles options pour verdir l’industrie », explique-t-il. Soit directement à travers l’électricité, soit à travers la production de biocarburants et produits chimiques riches en hydrogène. Un marché important pourrait être lié à la réduction par l’hydrogène de l’utilisation de minerai de fer pour la sidérurgie, qui est une source très importante d’émissions de CO2. L’hydrogène pourrait également être combiné avec du CO2 recyclé ou pris dans l’air, pour fabriquer du méthanol et toute une série de produits chimiques, voire d’hydrocarbures, donc de combustibles et de carburants. Des marchés qui pourraient dépasser le premier marché de l’hydrogène propre, lié aux usages actuels de l’hydrogène : production d’ammoniac pour la fabrication d’engrais azotés, appoint d’hydrogène au raffinage, notamment. « EDF peut se revitaliser grâce aux renouvelables… Son intérêt n’est pas de se cacher la tête dans le sable comme une autruche, mais d’être comme une girafe et de regarder au loin », explique Nicolas Hulot, dans le Financial Times du 14 novembre. « Demain, la norme ne doit plus être l’énergie nucléaire mais les énergies renouvelables. C’est un bouleversement complet de notre modèle », ajoute le ministre de la Transition écologique et solidaire. Et de demander à l’énergéticien EDF, dont l’État est actionnaire à hauteur de 83,40 %, un « plan précis » pour assurer le développement des énergies renouvelables en France et la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. « Tout est sur la table, nous sommes en phase de discussion », déclare Nicolas Hulot, qui, selon le journal britannique, réfléchit notamment à l’architecture de l’entreprise, mais ne remet pas nécessairement en cause sa direction actuelle. « EDF a deux priorités : gérer l’énergie nucléaire d’un côté, et les renouvelables de l’autre. Comment EDF doit-il faire face aux défis du XXIe siècle ? Une réflexion est en cours », confie le ministre, qui a récemment repoussé l’échéance de 2025 admise pour la réduction à 50 %, de la part du nucléaire dans la production d’électricité en France (contre près de 75 % actuellement). OpenHydro, filiale de Naval Group (ex. DCNS), et EDF ont annoncé le 6 novembre l’arrêt de l’expérimentation d’hydroliennes au large de Paimpol-Bréhat, en Bretagne. Les deux partenaires expliquent que « le retour d’expérience [tiré] de la construction, de l’immersion et des essais des hydroliennes OpenHydro sur le site expérimental de Paimpol-Bréhat […] conduit à clore cette phase importante de développement ». Ils prévoyaient pourtant de remettre les deux machines de 16 mètres de diamètre à l’eau d’ici la fin de l’année. En raison d’un problème sur l’un de leurs composants, les hydroliennes avaient dû être sorties de l’eau début 2017 pour être réparées à Cherbourg, là où elles avaient été assemblées. EDF et Naval Energies assurent toutefois que, malgré l’arrêt de cette expérimentation, ils « poursuivent le projet de ferme pilote Normandie Hydro, qui vise l’installation de sept hydroliennes en mer dans le raz Blanchard ». Naval Group développe, par ailleurs, un projet de parc hydrolien expérimental (Cape Sharp) au Canada. « Une fois la technologie confirmée sur le projet expérimental canadien de Cape Sharp, EDF sera en capacité de lancer la phase industrielle du projet Normandie Hydro », indiquent les deux groupes. Sous la pression de derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, États-Unis inclus, se retrouve depuis le 6 novembre, et jusqu’au 17 novembre, à Bonn (Allemagne). La mission est délicate : avancer sur une mise en œuvre urgente de l’accord de Paris contre le réchauffement. L’enjeu est donc désormais de conduire les pays à réviser leurs ambitions. L’autre mission, très concrète, de cette COP23 est d’avancer sur les règles d’application de l’accord de Paris. Le tout, sur fond d’inconnue américaine. Washington, qui veut sortir de l’accord mais ne pourra le faire concrètement avant novembre 2020, a réaffirmé son intention de participer aux débats sur les règles d’application, dans l’idée de « protéger (ses) intérêts » nationaux. Une lueur d’espoir, cependant : la part du solaire et de l’éolien a franchi cette année la barre des 10 % de l’électricité totale produite aux États-Unis en un mois, selon les autorités. Ainsi, en mars, 8 % provenaientt de l’éolien et 2% du solaire. Le climatologue Michael Mann, de l’université d’Etat de Pennsylvanie, cité par l’AFP, estime « possible » que les États-Unis atteignent leurs objectifs de réduction des émissions carboniques fixés par l’accord de Paris, « avec ou sans Trump ». Et de citer en ce sens « les progrès suffisants réalisés au niveau local et des Etats, l’engagement de nombre de grandes entreprises et l’élan inéluctable des énergies renouvelables ». En négociation avec Quadran depuis juin dernier, Direct Energie a annoncé, le 31 octobre, la finalisation de l’acquisition du producteur d’énergies renouvelables. « Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’intégration verticale menée par Direct Energie, et vient renforcer la présence du nouvel ensemble sur les activités de production », explique le fournisseur d’énergie dans un communiqué. L’opération concerne les activités éoliennes terrestre, solaires, hydrauliques et biogaz en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Fin 2016, le parc installé par Quadran totalisait plus de 360 MW bruts, et le producteur compte atteindre 800 MW d’ici fin 2018. « Depuis le 1er janvier 2017, plus de 150 MW ont déjà été raccordés », est-il précisé. Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot présentera « dans la première partie de 2018 » un « green deal » pour soutenir « la transition énergétique, l’efficacité énergétique, le développement des renouvelables, les nouvelles filières industrielles », a-t-il annoncé le 28 octobre dans un entretien à nos confrères du Monde. « Si nous voulons réduire la part du nucléaire, il faut que les Français acceptent la présence des énergies renouvelables sur leur territoire », poursuit Nicolas Hulot. Autre annonce dans laquelle le ministre est impliqué, le memorandum d’entente entre l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes (initiée à la suite du projet Solar Impulse) et l’Ademe. C’est en effet en présence de Nicolas Hulot que Bertrand Piccard, Président de la fondation Solar Impulse, et Bruno Lechevin, président de l’Ademe, ont signé cet accord le 30 octobre. Il renforce leur coopération pour promouvoir les technologies propres et rentables pour lutter contre le réchauffement climatique, selon le communiqué ministériel du 30 octobre. La direction régionale Île-de-France de l’Ademe et la Région Île-de-France ont annoncé le 25 octobre le lancement de leur 4e appel à projets commun visant à « impulser le développement de la méthanisation durable ». L’objectif du Schéma régional climat air énergie (SRCAE) de la région vise à couvrir 11 % de la consommation énergétique régionale par les énergies renouvelables à l’horizon 2020 dont un cinquième par le biogaz issu de la méthanisation. Celui-ci pouvant être valorisé par combustion, cogénération ou encore injection dans le réseau. Les projets peuvent être de différentes tailles (à la ferme, territoriaux, industriels ou en station d’épuration) et « le caractère innovant et reproductible en Île-de-France des projets sera également un facteur pris en compte », précise l’Ademe sur son site. La clôture des candidatures est fixée au 11 janvier et sera suivie de l’audition des candidats en mars. « La plus importante unité de méthanisation de France, créée par des agriculteurs pour des agriculteurs, est entrée en fonction courant octobre à Vihiers (Maine-et-Loire) », se félicitent le département et la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire dans un communiqué publié le 27 octobre. Quatre années de travail sous la houlette de la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire et 8 M€ auront été nécessaires pour que ce projet, en gestation depuis 2011, voit le jour. L’unité de méthanisation de Vihiers, exploitée par la société Bioénergie, fédère aujourd’hui 44 actionnaires « exploitations agricoles » représentant 100 associés. « Un exemple unique en France pour une unité de cette taille », explique le communiqué. Bioénergie traitera ainsi chaque année environ 56 000 tonnes d’effluents d’élevage dont la transformation permettra de produire de l’électricité correspondant à la consommation de 4 000 foyers. La chaleur fournie par le moteur alimentera également les équipements publics situés à proximité (halte-garderie, pôle santé, piscine, futurs logements,…). Les digestats liquides et solides, quant à eux, feront l’objet d’un épandage pour l’enrichissement des cultures des exploitations des actionnaires. La Chine et l’Inde sont les pays les plus attractifs pour les énergies renouvelables, selon un classement établi par le cabinet d’audit EY, cité par l’AFP. La Chine s’est notamment fixé de nouveaux objectifs pour se passer de ses vieilles centrales à charbon, ouvrant la voie à une place encore plus importante pour les énergies vertes, note EY. L’Inde est aussi engagée dans un vaste effort de développement, notamment du solaire. Le pays veut ainsi multiplier par huit les capacités actuelles de son parc solaire, pour atteindre 100 GW en 2022. Toutefois, « le doute grandit » sur la capacité du pays à atteindre cet objectif, du fait de questions sur la rentabilité des investissements et la qualité des équipements installés, note EY, plus optimiste quant au développement de l’éolien. En revanche, le discours pro-charbon et pro-hydrocarbures du président américain Donald Trump fait redescendre les États-Unis à la troisième place de ce classement, avec notamment en ligne de mire des interrogations sur le soutien fédéral aux énergies vertes. En Europe, l’Allemagne et le Royaume-Uni, moteurs du développement des énergies vertes sur le continent, sont dans le top 10 du classement, respectivement 4e et 10e. De son côté, la France, 6e, gagne une place par rapport à l’an dernier, le programme d’Emmanuel Macron augurant des mesures « positives » pour le secteur des énergies renouvelables, selon EY. La préfecture de région Bretagne, la préfecture du Finistère et la préfecture maritime de l’Atlantique ont annoncé le 23 octobre l’organisation d’une consultation du public sur l’identification d’une zone pour une ferme commerciale d’hydroliennes dans le passage du Fromveur (Finistère), à la demande du ministère en charge de la transition écologique et solidaire. Dans ce cadre, l’État met à la disposition du public et des membres de la Conférence régionale de la mer et du littoral (CRML), un document de synthèse des travaux de concertation menés dans le cadre du groupe de travail de la CRML, dédié aux énergies marines renouvelables. Pour rappel, la société quimpéroise Sabella a immergé dans le Fromveur une hydrolienne de 1 MW qui, depuis fin 2015, fournit au réseau insulaire d’Ouessant une partie de son électricité. Près de neuf multinationales sur dix, parmi les plus importantes, et celles ayant le plus fort impact environnemental, ont désormais des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, selon le 2e bilan annuel du CDP, plateforme de communication environnementale à but non lucratif. 20 % des entreprises évaluées par le CDP se sont notamment fixé des objectifs de long terme, au-delà de 2030, contre 14 % il y a un an, lors du premier rapport. Surtout, les entreprises « s’alignent de plus en plus sur les niveaux de réduction d’émissions carbone considérés comme nécessaires par les scientifiques pour éviter des changements climatiques dangereux », constate le CDP. 14 % se sont ainsi donné des objectifs alignés sur le niveau de décarbonisation nécessaire pour limiter le réchauffement de la planète sous les 2 degrés. Si ces actions sont positives, le CDP note toutefois que cela ne représente toujours qu’un peu moins d’un tiers du chemin à parcourir pour être en ligne avec l’ambition mondiale issue de l’accord de Paris. Malgré un marché qui ne cesse de reculer depuis plus de quatre ans, les professionnels du solaire thermique français affichent encore une inébranlable combativité pour renverser la tendance. Le message principal des quatrièmes États généraux de la filière pourrait être que l’histoire n’est pas encore écrite, et que le solaire thermique peut faire preuve de résilience pour se redresser. Au premier rang des raisons qui poussent à y croire se trouve la décision portée par le récent plan climat du ministre Nicolas Hulot, de renforcer la montée en puissance de la taxe carbone d’ici à 2030. Les acteurs du solaire y voient un vrai signal prix, qui devrait être pris en compte par les investisseurs, notamment dans le secteur des bâtiments collectifs et industriels. La filière ne compte cependant pas que sur le réglementaire pour s’en sortir. Une diminution des coûts du solaire est nécessaire pour être compétitif à l’heure de la prochaine réglementation thermique. En complément des présentations de cette journée, qui seront prochainement disponibles sur le site d’Enerplan, Observ’ER a réalisé une étude approfondie, disponible en ligne, des applications solaires thermiques collectives en France, à travers des indicateurs de marché et l’interrogation d’un panel de professionnels. Le gouvernement a demandé à General Electric d’améliorer les modalités de son plan, lancé cet été, de suppression de 345 postes à l’usine GE Hydro/Alstom de Grenoble, a affirmé mardi 17 octobre le secrétaire d’État au ministère de l’Économie, Benjamin Griveaux. « Un groupe qui a la taille, et [qui est] à la mesure d’un marché mondial comme GE, doit faire mieux sur le PSE [plan de sauvegarde de l’emploi, ndlr] qui a été présenté », a-t-il expliqué à l’Assemblée nationale, au lendemain d’une rencontre avec la direction. Le groupe américain s’était engagé à ne fermer aucun site en France, et à créer 1 000 emplois nets d’ici 2018. Après une grève et un blocage du site durant neuf jours, les représentants des salariés ont été reçus jeudi 12 octobre au ministère de l’Économie. Une nouvelle rencontre est prévue cette semaine. Le secrétaire d’État a aussi précisé qu’un comité de suivi sur les engagements pris par le conglomérat américain au moment du rachat de la branche énergie d’Alstom se réunirait début décembre. « Un cabinet permettra d’évaluer les progrès qui auront été réalisés », a-t-il précisé. Google bouclera l’année 2017 en ne consommant que des énergies renouvelables, à la fois pour ses data centers et ses bureaux. Dans son rapport environnemental publié en octobre 2017, la firme américaine annonce avoir atteint son objectif plus vite qu’elle ne l’avait prévu. Pour ce faire, Google s’est fourni auprès de producteurs d’énergie éolienne et solaire pour une capacité de 2,6 GW, ce qui la place à la première marche du podium des entreprises en termes d’achat d’électricité renouvelable. Elle a ainsi déjà consacré 3,5 milliards de dollars à sa politique d’investissements dans la production d’énergies renouvelables, dont deux tiers aux États-Unis. Cet engagement ne date pas d’hier, puisque Google affiche un bilan carbone neutre depuis 2007, grâce à l’achat de crédits carbone pour compenser ses émissions excessives. Le think tank France Biométhane a publié, le 9 octobre, la mise à jour du 2e Observatoire dédié au biométhane, dont la première mouture, également élaborée avec Sia Partners, avait été dévoilée au 2e trimestre 2017. En France, le secteur du biométhane enregistre une forte hausse du nombre d’unités, « mais manque de capacité pour rejoindre les leaders européens, contrairement au Danemark, qui possède, en moyenne, les unités les plus volumineuses d’Europe », peut-on lire dans le communiqué du think tank. « Cinq ans après le lancement de la filière avec la sortie des tarifs d’obligation d’achat en novembre 2011, un premier bilan s’impose : 36 unités d’injection gaz en service aujourd’hui (contre 7 en 2017) sont capables de produire annuellement 0,5 TWh », précise Cédric de Saint-Jouan, président de France Biométhane, cité dans le communiqué. Au-delà du cas français, fin 2016, la filière comptait ainsi 480 unités de production de biométhane dans les neuf pays de l’étude (France, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche, Suède, Pays-Bas, Danemark et Finlande). L’Allemagne domine le marché européen, avec plus de 200 unités (soit plus de 50 % de la capacité de production des neuf pays), tandis que le Royaume-Uni enregistre une forte croissance, « en dépassant en moins de six ans la Suède, pays historique de la filière, qui connaît, comme les Pays-Bas, une stagnation sur les deux dernières années ». La tendance à la hausse au niveau européen peut notamment s’expliquer par le fait que les neuf pays en question bénéficient « d’au moins un mécanisme d’aide directement lié au biométhane (…), qui vise à atteindre les objectifs fixés par les autorités européennes ou nationales », avance l’observatoire. Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, a annoncé le 10 octobre la mise en œuvre de trois axes prioritaires dans la mise à disposition des données d’énergie pour les collectivités locales : la mise en place progressive d’un nouveau dispositif, plus complet, d’accès aux données énergies, intégré à la plateforme nationale data.gouv.fr – la création, afin d’accompagner les collectivités locales dans la préparation de leur plan climat-air-énergie, d’une boîte à outils « socle », que les startups de la Green Tech verte sont invitées à déployer, enrichir ou adapter – l’ouverture d’un « lab » sur les données énergie dans les incubateurs de la GreenTech verte, pour échanger et partager la connaissance. Pour bâtir cette première boîte à outils « socle » pour les collectivités locales, le ministère de la Transition écologique et solidaire va lancer, dans les prochaines semaines, un concours de data visualisation des données locales d’énergie. Ces annonces, en lien avec la connaissance des données locales énergie, ont eu lieu à l’occasion d’une « Data Session », journée de mobilisation d’intelligence collective, organisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire en collaboration avec la mission Etalab. 17 fabricants et importateurs français de chaudières bois de petite et moyenne puissances, représentant plus de 80 % du marché français, ont annoncé s’être fédérés au sein du Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB). L’objectif affiché est de promouvoir le chauffage central au bois dans le domestique, le collectif et le tertiaire. Le SFCB propose ainsi la mise en place de plusieurs mesures : des mesures incitatives différenciées, qui favorisent la chaleur renouvelable – une meilleure prise en compte de l’énergie bois dans les outils de calculs règlementaires et ceux utilisés pour l’attribution des aides de l’ANAH – l’augmentation du fonds chaleur, la simplification des démarches administratives, particulièrement sur les plus petites puissances – la mise en place d’aides favorables au chauffage central au bois performant sur les zones concernées par des Plans de protection de l’atmosphère (PPA) – La mise en place d’une prime à la casse sur les chaudières bois de plus de 15 ans, pour favoriser le renouvellement par des chaudières plus performantes et plus propres. La Commission européenne a annoncé, le 29 septembre, avoir validé quatre régimes d’aides à la production d’électricité, en France, à partir d’installations d’éoliennes terrestres et d’installations solaires sur les bâtiments et au sol. Ces régimes permettront à la France de produire plus de 7 GW supplémentaires d’énergie à partir de sources renouvelables. Le régime en faveur de l’énergie éolienne terrestre (complément de rémunération) est doté d’un budget provisoire de 188 M€/an (soit un total de 3,8 milliards d’euros sur vingt ans) et les deux régimes en faveur de l’énergie solaire, d’un budget provisoire de 232 M€/an (soit un total de 4,6 milliards d’euros sur vingt ans). Le dernier régime soutiendra tant les installations éoliennes terrestres que solaires, grâce à un budget provisoire de 6 M€/an (ou, au total, 124 millions d’euros sur 20 ans). Les bénéficiaires des aides seront sélectionnés au moyen d’appels d’offres qui seront organisés entre 2017 et 2020. Les quatre régimes sont accompagnés d’un plan d’évaluation détaillé, destiné à en évaluer l’incidence. Les résultats de cette évaluation seront communiqués à la Commission en 2022, un rapport intermédiaire devant lui être transmis en 2018. Selon un rapport publié par le cabinet américain Transparency Market Research (TMR) le marché du biométhane pourrait atteindre 2,6 milliards de dollars d’ici 2025, contre une estimation en 2016, de 1,5 milliard. Intitulé Biomethane market, Global Analysis, size, share, growth, trends and forecast 2017–2025, ce rapport indique que la recherche de technologies permettant de produire des énergies moins polluantes va tirer la filière biométhane vers le haut dans les années à venir. Toujours d’après cette étude, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les principaux producteurs et consommateurs de biométhane, la France faisant partie des pays clés de la filière en termes de marché. Une convention de partenariat vient d’être signé par Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Stéphanie Savel, présidente de l’association Financement participatif France (FPF), afin de labéliser les projets de “financement participatif de la croissance verte”. Ce nouvel outil de contrôle concerne toutes les formes de financement (dons, prêts, capital, royalties…) hébergées sur des plateformes de financement participatif. Pour prétendre au label, un projet devra répondre à 3 critères principaux : l’éligibilité du programme, la transparence de l’information et la mise en évidence des impacts positifs du projet. Les plateformes qui souhaitent le label peuvent se rendre dès à présent sur le site dédié. Les premiers projets seront labellisés en fin d’année 2017, et seront présentés lors d’une conférence à l’occasion de World Efficiency, un évènement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris. Avec 35 unités de production de biométhane à fin juin 2017 et une capacité d’injection d’environ 500 GWh, la filière du biométhane est en pleine expansion. Malgré ces chiffres encourageants, le think tank France Biométhane fait remarquer dans un communiqué qu’il existe encore de fortes disparités entre les différents types de projets et diverses technologies utilisées. À ce jour, seules les installations agricoles peuvent prétendre à un véritable retour d’expérience en termes de durée et de volume de projets. De plus, les autres technologies de production n’ont pas toutes été testées. Pour France Biométhane, il faut prolonger le contrat d’achat de 15 à 20 ans. En 2018, selon les projections de la CRE, la somme engagée en soutien à la filière sera de 100 millions d’euros, à comparer avec les 5,4 milliards en soutien à l’électricité d’origine renouvelable. Une bonne nouvelle, cependant : le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé pour les producteurs, dans un communiqué en date du le 25 septembre, une forte réduction des coûts de raccordement aux réseaux des installations de production d’électricité renouvelable, ou de biométhane injecté dans le réseau de gaz. Cette baisse sera prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux électriques (Turpe) et pourra atteindre jusqu’à 40 %, en fonction de la taille des projets, notamment. Dans le cadre du deuxième colloque Énergie industrie organisé du 25 au 27 septembre par l’Ademe, cette dernière et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont lancé, mercredi 27 septembre, un nouvel appel à projets, financé par le fonds chaleur, pour la production de chaleur renouvelable à partir de la biomasse pour l’industrie, l’agriculture et le tertiaire privé. Il s’adresse aux entreprises agricoles, de l’industrie et du tertiaire privé situées sur le territoire national, outre-mer compris. Pour les projets de grandes installations (plus de 1 000 tep/an), l’appel à projets Biomasse chaleur industrie agriculture et tertiaire (BCIAT) est ouvert jusqu’au 31 janvier 2018. Pour les projets de petites et moyennes installations, (moins de 1 000 tep/an), les projets seront instruits selon le calendrier de la direction régionale de l’Ademe concernée. Dans les 2 cas, les dépôts des candidatures se font sur une seule plateforme en ligne. Posée en mer au large de Marseille depuis mai 2016, la bouée Lidar (Light Detection and Ranging), mise au point par la PME française Eolfi, en collaboration avec NKE Instrumentation, l’Ifremer et l’IRSEEM, a été relevée le 21 septembre. Elle permet des mesures de vent par laser allant jusqu’à 200 mètres de hauteur, sur des sites potentiels de parcs éoliens flottants. Les résultats de ce test sont en cours d’analyse et seront validés par un organisme indépendant. L’objectif, pour Eolfi, est de sortir de la phase prototype pour une mise sur le marché, ce qui pourrait contribuer à l’essor de l’éolien flottant en France, notamment dans le golfe du Lion et en région Bretagne. Eolfi a également annoncé avoir déployé, le 20 septembre, une bouée Lidar sur la zone d’étude du projet de parc éolien flottant pilote de Groix et Belle-Île. Cette bouée, installée pour une durée d’un an à proximité de la zone du projet, est spécialement adaptée à des fonds de plus de 50 mètres. Total a annoncé un accord qui le fait entrer au capital d’Eren Renewable Energy (RE) à hauteur de 23 %. Le document prévoit aussi que Total pourra prendre le contrôle de la société au bout de 5 ans. Ce rapprochement indique que la firme française souscrit à hauteur de 237,5 millions d’euros à une augmentation de la société afin d’accélérer son développement dans les renouvelables. Fondée en 2012, par deux anciens d’EDF Énergies Nouvelles, Eren RE compte à ce jour en exploitation ou en construction une capacité de 650 MW dans l’éolien, le solaire et l’hydraulique. « La production d’électricité renouvelable de Total va ainsi croître significativement en vue d’atteindre une capacité de 5 GW d’ici cinq ans » a déclaré Philippe Sauquet, directeur général Gas Renewables & Power de Total, cité dans un communiqué. « Notre positionnement est mondial et la puissance du Groupe Total à l’international constitue un accélérateur formidable », a déclaré de son côté Pâris Mouratoglou, président d’Eren RE. Cet entrepreneur n’en est pas à son premier “coup” puisqu’en 2000, il cédait 35 % de SIIF Énergies à EDF, puis 15 % supplémentaires en 2002, avant que SIIF ne devienne, 2 ans plus tard, EDF EN. Il finira par céder la totalité de ses parts à EDF en 2011. Avant de créer Eren RE l’année suivante. Total a annoncé le 20 septembre un second investissement. Le groupe pétrolier renforce son activité dans le domaine de l’efficacité énergétique en rachetant la société française GreenFlex. Avec un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros prévus en 2017, GreenFlex, fort de 230 salariés, propose des solutions intégrées depuis l’optimisation des besoins et des sources d’énergies au financement des solutions, jusqu’à la mesure et la réduction des émissions. « L’acquisition de GreenFlex permet à Total d’accélérer le développement de son offre sur le marché de l’efficacité énergétique, en complément de la croissance de ses filiales BHC en France et Tenag en Allemagne », explique la compagnie dans un communiqué. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017. Le 16 octobre prochain EDF proposera à ses clients particuliers une nouvelle gamme de fourniture d’électricité d’origine renouvelable, grâce à des certificats, a annoncé l’énergéticien le 19 septembre dans un communiqué. L’offre se décompose en deux abonnements : “Vert électrique” ou “Vert électrique week-end”, ce dernier permettra de faire des économies en déplaçant sa consommation de la semaine vers le week-end, pour les clients disposant d’un compteur Linky. « Nous visons un million de clients à l’horizon 2020 », explique Henri Lafontaine, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle clients, services et action régionale, cité dans le communiqué. De son côté, Engie annonce l’offre “Mon gaz vert” avec un gaz naturel contenant 10 % de biométhane d’origine française. Les clients pourront choisir entre trois sites de méthanisation : Wannehain (Nord), Cran-Gevrier (Haute-Savoie) et Saint-Maximin (Oise). Ces sites traitent chacun des matières organiques variées : résidus agricoles, boues d’épuration ou encore déchets ménagers et industriels. Les énergies renouvelables représentent 15,7 % de la consommation finale brute d’énergie en 2016, selon un récent rapport du Commissariat général au développement durable, intitulé « Les énergies renouvelables en France en 2016 ». Si cette part a progressé de 6,5 points en l’espace de onze ans, dont 0,5 point entre 2015 et 2016, la France accuse un retard par rapport à son Plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (PNA EnR), lequel établit des trajectoires à suivre pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la directive 2009/28/CE (23 % en 2020), explique le document. Avec 24,1 Mtep réalisés contre 29,1 Mtep attendus en 2016, l’écart est de 17 %. Un déficit qui concerne les consommations d’électricité et de chaleur. A contrario, dans le secteur des transports, la part des énergies renouvelables dépasse légèrement la trajectoire prévue initialement. La consommation finale brute d’énergies renouvelables est en hausse (+ 8,7 Mtep depuis 2005, soit une progression de 57 %), à l’inverse de la consommation finale énergétique, en baisse (- 13,3 Mtep depuis 2005, soit un recul de 8 %). Les plus gros contributeurs à la croissance des énergies renouvelables depuis 2005 sont : les biocarburants (près de 30 %, + 2,5 Mtep), les pompes à chaleur (près de 25 %, + 2,0 Mtep), suivis de l’éolien (+ 1,8 Mtep), de la biomasse solide pour le chauffage (+ 1,6 Mtep) et du solaire photovoltaïque (+ 0,7 Mtep). À l’inverse, l’hydroélectricité s’est repliée de 9 % sur la même période, ne représentant plus que 21 % de la consommation d’énergie renouvelable en 2016, contre 37 % en 2005. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude annuelle sur le marché 2016 des installations solaire thermiques individuelles. Une nouvelle fois, les chiffres sont en forte baisse par rapport à 2015 (- 32 %, pour un marché total de 32 610 m2). Les CESI (chauffe-eau solaires thermiques) constituent le segment qui souffre le plus, avec – 33 %. Ces équipements n’arrivent pas à s’implanter de manière suffisante dans le secteur du neuf, où ils sont concurrencés par le chauffe-eau thermodynamique (CET), moins cher à l’achat et ne nécessitant pas de monter sur le toit lors de l’installation. En rénovation, la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique n’a pas eu d’impact sur les ventes. L’étude présente également des indicateurs d’évolution des prix moyens des installations et du chiffre d’affaires global de l’activité. En 2016, celui-ci était évalué à 40 millions d’euros, soit une diminution de 32 % en un an. Mal en point, le secteur espère une réglementation environnementale (RE 2018) qui prenne réellement en compte les apports et les performances de ses applications pour rebondir. McPhy a remporté un contrat d’1,3 M€ auprès de RAG, spécialiste autrichien du stockage souterrain de gaz, pour fournir le système de production d’hydrogène qui équipera son projet “Underground Sun Conversion”, lequel entre dans une phase d’industrialisation. « Alimenté par de l’électricité d’origine renouvelable, le générateur de McPhy produira de l’hydrogène vert qui sera utilisé dans un process de méthanation souterrain très novateur », explique McPhy dans un communiqué du 7 septembre. L’hydrogène sera issu d’énergies renouvelables et de microbactéries. « Le gaz naturel de synthèse sera produit et stocké directement dans un réservoir naturel situé à plus de 1 000 mètres sous terre, puis injecté dans le réseau pour être délivré à la demande en fonction des besoins des consommateurs », explique l’entreprise française, qui, avec ce nouveau contrat disposera d’une capacité de plus de 13 MW pour ses équipements de power to gas. Observ’ER lance la 16e opération “Architecture Solaire Architecture d’Aujourd’hui”, anciennement connue sous l’appellation “Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui”. Elle a pour but de promouvoir l’architecture bioclimatique et l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment. La sélection finale présentera des réalisations exemplaires dans leur utilisation des règles de l’architecture solaire passive, la prise en compte de la qualité des ambiances et le recours aux énergies renouvelables. La sélection cherchera à donner une approche de la diversité régionale (métropole et DOM) des réalisations architecturales. Elle fera l’objet d’une publication en 2018. Dans cette perspective, nous sommes à la recherche de bâtiments avec une approche bioclimatique forte, dans les maisons individuelles, les logements collectifs et les bâtiments tertiaires, que ce soit pour de la construction neuve ou de la rénovation. Les bâtiments tendant vers la basse consommation énergétique (BBC), le passif ou le bâtiment à énergie positive (Bepos) sont recherchés. Tous les bâtiments doivent avoir été mis en fonctionnement au plus tard en septembre 2016, afin de pouvoir faire état d’une année complète d’utilisation. Architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage, pour participer ou pour signaler un bâtiment remarquable, contactez Marion Blein marion.blein@energies-renouvelables.org ou au 06 75 94 76 45. La production de biométhane injecté dans les réseaux poursuit sa progression au deuxième trimestre 2017. « À 97 GWh, elle augmente de 13 % par rapport au premier trimestre 2017 », indique le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire, dans son tableau de bord “biométhane injecté dans les réseaux de gaz” du deuxième trimestre 2017. Fin juin 2017, la capacité des 35 installations injectant du biométhane s’élevait, au total, à 533 GWh/an, soit une progression de 30 % par rapport à la fin de l’année 2016. Une capacité supplémentaire de 123 GWh/an a ainsi été installée au cours du premier semestre 2017, soit deux fois plus qu’au cours des 6 premiers mois de 2016. Si les unités de méthanisation constituent l’essentiel du parc (78 % de la capacité totale), les petites installations, de capacité unitaire inférieure à 15 GWh/an, représentent la moitié de la capacité de production totale du parc national. Côté biogaz pour la production d’électricité, le bilan est moins enthousiasmant. « Au cours du premier semestre 2017, 15 MW ont été raccordés, soit un rythme de raccordement comparable à celui du premier semestre 2016 », annonce le tableau de bord du deuxième trimestre 2017. La production d’électricité s’est ainsi élevée à 920 GWh au premier semestre 2017, en baisse de 1 % par rapport au second semestre 2016. Le 16 septembre aura lieu, dans 5 usines en France, la Fête du granulé de bois. À l’initiative de Propellet France, l’association nationale du chauffage au granulé de bois, cet événement a pour objectif de mieux faire connaître ce mode de chauffage. Des visites pédagogiques et des animations seront ainsi proposées tout au long de la journée sur les différents sites partenaires. L’occasion de découvrir comment les coproduits de bois sont valorisés et transformés en granulés. Les cinq usines concernées sont : SGA à Arlanc (63), Vert Deshy à Meximieux (01), MG granulés à Argenteuil-sur-Armançon (89), Siat Braun à Urmatt (67) et 3bois à Varennes-sur-Allier (03). L’ensemble du programme de cette journée est à retrouver ici. « Il faudra accélérer (sur les énergies renouvelables) car la France est en retard sur les objectifs de la loi de transition énergétique » (32 % en 2030), a expliqué Nicolas Hulot le 6 juillet, lors de la présentation de son plan climat. « Des mesures seront prises pour simplifier encore le développement des énergies en mer, de la géothermie, de la méthanisation, et des expérimentations seront réalisées afin de permettre de réduire le temps moyen de développement de ces projets », a promis le ministre de la Transition écologique et solidaire. La programmation des appels d’offres sur la durée du quinquennat d’Emmanuel Macron sera présentée d’ici fin 2018, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, a-t-il également assuré. Une liste d’appels d’offres sera également publiée par le gouvernement dans le cadre des assises de l’outre-mer. L’augmentation des moyens du fonds chaleur sera étudiée par le gouvernement et « BPI France mettra en place un prêt sans sûreté de longue durée dédié au développement des méthaniseurs. » Enfin, le ministre entend « faire de la place de Paris le pôle international de la finance verte », en soutenant notamment la création de labels de référence, et l’émission d’obligations vertes (green bonds). Le groupe américain General Electric, qui avait racheté fin 2015 l’ensemble des activités énergie d’Alstom, envisage la suppression de 345 emplois sur les 800 du site de sa filiale General Electric Hydro à Grenoble (spécialisée dans la production de turbines hydrauliques). Dans un courrier interne, le PDG de General Electric Hydro, Yves Rannou, mentionne des « difficultés majeures », notamment « une structure de coût excessivement élevée ». Les postes visés sont « essentiellement la fabrication des turbines hydrauliques, mais aussi l’ingénierie ». Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) va être enclenché le 19 juillet. GE, qui avait fait de la France son siège mondial pour l’activité hydraulique, avec 3 sites situés à Grenoble, Belfort et au siège de GE Renewable Energy dans les Hauts-de-Seine, s’était engagé au moment du rachat, à créer 1 000 emplois nets d’ici fin 2018. Les analystes de la banque Morgan Stanley ont publié, le 6 juillet, une étude estimant que les énergies renouvelables deviendront l’option la moins chère et la plus rapide pour la production d’électricité et de chaleur, d’ici à 2020, du fait de choix économiques favorables.« Nous prévoyons que d’ici 2020, les énergies renouvelables seront la forme la moins coûteuse d’une nouvelle génération d’énergie pour toute la planète », à l’exception de quelques pays d’Asie du Sud-Est. Les énergies renouvelables seraient sur le point de s’imposer de façon inéluctable, et en dépit de toute entrave, y compris politique : « indépendamment de l’intention annoncée par le président Trump de se retirer de l’accord de Paris, nous prévoyons que les États-Unis dépasseront l’engagement de Paris de réduire de 26 à 28 % leurs émissions de gaz à effet de serre en 2025 par rapport à 2005 ». En Europe, décrite comme une « carte postale du futur », les objectifs de Paris pourraient également être dépassés. Collecte, riche et complète, de données sur les sources d’énergies renouvelables de l’Union européenne, l’édition 2016 de L’État des énergies renouvelables en Europe, publié depuis 17 ans par Observ’ER, est en ligne ! Un tour d’horizon de l’état et de la dynamique des filières, éolienne, photovoltaïque, solaire thermique, pompes à chaleur, biocarburants, biomasse solide, petite hydraulique, biogaz, énergies géothermique, solaire thermodynamique, incinération des ordures ménagères ou encore énergies marines renouvelables. De nouveaux indicateurs ont été ajoutés, sur les coûts, les combustibles fossiles évités, l’innovation et la compétitivité, et la flexibilité du système électrique. Téléchargement libre. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les dernières nouvelles des énergies renouvelables revient dès le 6 septembre. Toute l’équipe de l’Observatoire des énergies renouvelables et du Journal des Énergies Renouvelables vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un très bel été ! Le Premier ministre, Edouard Philippe, dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet, a repris l’objectif ambitieux souhaité par Nicolas Hulot, d’une “neutralité carbone” à l’horizon 2050, soit au-delà de ce que préconise la loi de transition énergétique. La France s’engage ainsi, non pas à cesser d’émettre du CO2, mais à compenser ces émissions par divers procédés : plantations d’arbres, essor des nouvelles technologies et des énergies renouvelables… Le directeur général du WWF, Pascal Canfin, a qualifié d’ « intéressants » ces objectifs, tout en attendant de « voir concrètement les moyens mis à disposition ». Il s’en est toutefois félicité, « puisque c’est finalement le grand objectif de l’accord de Paris », qui « donne le cap pour les arbitrages liés à l’annonce du plan climat », que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, doit dévoiler jeudi 6 juillet. Les nominations de deux femmes ont été annoncées, le 29 juin, à la tête d’Enercoop et de France Hydro Électricité (FHE). Du côté du fournisseur coopératif français d’électricité issue à 100 % des énergies renouvelables, Amandine Albizzati, 38 ans remplace Mathieu Richard. Elle dirigeait les relations institutionnelles de la banque éthique La Nef depuis 2010, ce qui l’a amenée, en février, à faire avec Enercoop, dont elle était administratrice depuis 2013, une levée de fonds de 1,5 M€. Christine Etchegoyhen, 45 ans, gérante de la société familiale Forces Motrices de Gurmençon, a pour sa part été désignée à l’unanimité par le conseil d’administration de FHE. Elle succède à Anne Penalba, qui a dirigé le syndicat professionnel représentant la petite hydroélectricité pendant 11 ans, et à qui elle a rendu hommage : « Je m’attacherai à défendre au mieux les intérêts (de FHE), pour que la petite hydroélectricité perdure et se développe en respectant son caractère patrimonial, en améliorant son savoir-faire et en renforçant les liens entre les différents acteurs. Je poursuivrai les efforts engagés par Anne Penalba pour accompagner les producteurs d’hydro, en tant qu’acteurs économiques attachés à leurs territoires, dans leur volonté de produire une énergie renouvelable locale, propre et décarbonée. » Engie a inauguré le 4 juillet, à Saint-Denis, une chaufferie biomasse, en service depuis cet hiver, qui alimentera de façon désormais majoritaire le troisième plus grand réseau de chauffage urbain de France, le réseau Plaine Commune Energie, long de 60 km. Un investissement qui représente 33,5 millions d’euros, soutenu par l’Ademe à hauteur de 4,4 millions d’euros et par la Région Île-de-France pour 2 millions d’euros. D’une puissance de 26,5 MW, cette chaufferie biomasse sera alimentée par 38 000 tonnes de bois par an issues de plaquettes forestières, de broyat de palette, de résidus de scierie et d’élagage. Elle procurera chauffage et eau chaude à des appartements, bureaux, bâtiments publics représentant l’équivalent de 40 000 logements, « permettant de préserver l’environnement et de lutter contre la précarité énergétique », a déclaré le maire de Saint-Denis, Laurent Russier. Engie estime pour sa part, que la chaufferie permettra d’éviter l’émission de 56 250 tonnes de CO2 par an. Par son arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de cassation confirme que la garantie décennale doit jouer dans l’hypothèse où la défaillance de l’élément d’équipement, qu’il soit dissociable ou non, provoque une impropriété à destination de l’ouvrage. Cet arrêt intéressera tout particulièrement les propriétaires de pompes à chaleur mais sa portée pourrait concerner d’autres domaines. L’intérêt de la distinction entre les éléments d’équipement dissociables et indissociables est limité à l’hypothèse dans laquelle la défaillance de l’élément d’équipement ne provoque pas une impropriété à destination de l’ouvrage. Dans le cas contraire, les dommages relèvent de l’article 1792 du Code civil, en vertu duquel la garantie décennale peut être mise en jeu lorsque l’impropriété à destination résulte d’une atteinte, soit à l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, soit à l’un de ses éléments d’équipement. C’est exactement ce que réaffirme la Cour de cassation dans son arrêt en date du 15 juin 2017, s’agissant d’une pompe à chaleur, ce qui confirme une tendance jurisprudentielle. Avant même de s’interroger sur le caractère d’éléments d’équipement dissociables et indissociables d’un ouvrage, il est donc essentiel de déterminer si les désordres affectant l’élément d’équipement rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble puisque, dans une telle hypothèse, la garantie décennale s’applique de droit. (Analyse d’Aurélien Boudeweel, du cabinet Green Law Avocat) La startup bordelaise newHeat a annoncé, le 26 juin, avoir réalisé une levée de fonds de 1,8 million d’euros. Une somme qui devrait lui permettre « d’accélérer son développement et de financer la réalisation de ses premières centrales solaires thermiques, tout en poursuivant ses efforts de R&D », indique la société dans un communiqué. Après la réalisation d’un banc de tests en 2016, la société créée en 2015 lancera cet été les travaux de sa première centrale solaire thermique, qui sera aussi la plus grande centrale thermique de France. D’une puissance de 3 MW, elle fournira de la chaleur solaire sur 15 ans à un premier client industriel basé en Dordogne. À horizon 2024, l’objectif de newHeat, qui s’adresse principalement aux réseaux de chaleur urbains et aux sites industriels, est de réaliser environ 50 centrales solaires thermiques, d’une taille unitaire moyenne de 10 MWth, représentant chacune environ 4 hectares au sol, et situées à l’international pour 80 % d’entre elles. Avec des prix de marché qui ont chuté d’un tiers depuis 2010, et une pression accrue de la fiscalité et des normes environnementales, « on arrive à la fin de la résilience de la filière », a expliqué à l’AFP Anne Pénalba, présidente du syndicat professionnel France Hydro Electricité, en présentant, le 27 juin, un livre blanc sur l’état de la filière. À titre d’exemple, les taxes locales ont grimpé ces dernières années, pour atteindre environ 10 €/MWh, soit un tiers du prix de vente sur le marché. Pour y remédier, la filière réclame des exonérations fiscales sur les nouveaux projets, ou, par exemple, sur les investissements réalisés pour protéger la biodiversité et qui sont assujettis à la taxe foncière. Plus généralement, le document intitulé « L’hydroélectricité à la croisée des chemins » en appelle à une « meilleure cohérence » entre les réglementations et les objectifs de développement des énergies renouvelables. Toujours selon Anne Pénalba, il serait possible de produire 11,7 TWh d’électricité supplémentaire (+ 17 % par rapport à aujourd’hui), mais « deux tiers du potentiel sont bloqués par des réglementations environnementales ». Le nouveau président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, veut guider son pays vers la sortie du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Il l’a annoncé lors de la cérémonie marquant l’arrêt définitif du premier réacteur du pays, Kori 1, qui fonctionnait depuis 40 ans. Il envoie là un signal fort : la Corée du Sud, avec 25 réacteurs produisant un tiers de l’électricité du pays, était classée cinquième producteur d’énergie nucléaire dans le monde en 2016. Le président Moon veut développer le solaire et l’éolien en mer, afin de porter la part des renouvelables dans le mix énergétique sud-coréen, de 6,6 % à ce jour à 20 % d’ici 2030. Taïwan aussi entend sortir du nucléaire (16 % de la fourniture d’électricité) d’ici 2025. Le gouvernement taïwanais vient d’annoncer qu’il cherche 59 milliards de dollars de capitaux privés pour atteindre 20 % de renouvelables dans son mix énergétique en 2025. Les prix moyens des pompes à chaleur (PAC) individuelles sont en stagnation, voire en diminution, ainsi que le relève l’étude réalisée et mise en ligne par Observ’ER sur le marché et les prix 2016 des PAC individuelles. Le segment de la géothermie a vu ses ventes chuter de 19 % entre 2015 et 2016, pour des tarifs qui n’ont presque pas évolué. Le segment aérothermique est le plus dynamique. Il est porté par les PAC air/air, dont les ventes ont progressé de 12 % (372 270 unités vendues en 2016), pour des prix en baisse de 8 %. Le marché des PAC air/eau est plus stable (+ 1 %) mais ses prix diminuent également (- 7 %). Cette tendance à la baisse était déjà observée en 2015. Des installateurs font part d’un durcissement de la concurrence sur les équipements air/eau et air/air. D’ici 2040, 7 400 milliards de dollars pourraient être investis dans de nouvelles centrales d’énergie renouvelable, soit 72 % des 10 200 milliards de dollars d’investissements prévus dans les nouveaux équipements de production d’énergie, de par le monde. Publiée le 15 juin par Bloomberg New Energy Finance, l’étude New Energy Outlook 2017 précise la part du solaire (2 800 milliards de dollars) et de l’éolien (3 300 milliards de dollars) dans ces investissements. Solaire et éolien représenteront dès lors 48 % des capacités installées mondiales, et 34 % de la production d’électricité, contre 12 % et 5 % actuellement. Le coût actualisé de l’électricité solaire photovoltaïque (intégrant les dépenses pendant toute la durée de vie de l’installation) devrait baisser de 66 % d’ici 2040. Celui de l’éolien en mer chuterait de 71 %, et celui de l’éolien terrestre, de 47 % sur la même période. C’est un joli contrat qu’EDF vient de décrocher à Dubaï : environ 14 millions d’euros pour mener à bien la conception, les études, la supervision du chantier, les tests in situ et la livraison d’une station de pompage-turbinage de 250 MW. Située à Hatta, dans une zone montagneuse près de la frontière avec Oman, cette dernière représentera un investissement total de 466 millions d’euros. Elle s’appuiera sur un réservoir existant d’une capacité de 6,5 milliards de litres, et sur la construction d’un autre réservoir, 300 mètres plus haut, de 3 milliards de litres. L’objectif : faire couler l’eau, lorsque les coûts de production de l’électricité sont élevés, à travers la centrale hydroélectrique du réservoir supérieur, et pomper l’eau durant les heures creuses, de l’aval vers l’amont, grâce à des turbines fonctionnant à l’énergie solaire. « L’étude d’impact n’est pas proportionnée à l’importance et à la nature du projet », estime le tribunal administratif de Marseille, qui, en conséquence, annule, à la demande de plusieurs associations, l’autorisation d’exploitation de la centrale biomasse de Gardanne. Cependant, au lendemain de cette décision, le 9 juin, le préfet des Bouches-du-Rhône a signé un arrêté, donnant un sursis à l’exploitant, qui pourra, à titre provisoire, poursuivre sa phase de test. Ce site est la plus importante centrale de production électrique biomasse de France. Les juges du tribunal administratif ont notamment considéré qu’Uniper, l’exploitant, n’a pas analysé les effets environnementaux indirects de cette installation de 150 MW, en particulier ceux en lien avec l’approvisionnement en bois. La centrale devrait en effet consommer, à pleine puissance, 850 000 tonnes de bois par an pour fournir 6% de la production d’électricité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces volumes représenteraient au moins 25% des ressources forestières locales disponibles. Uniper, qui dispose de neuf mois pour constituer une nouvelle demande d’autorisation, annonce avoir fait appel de la décision. Les énergies renouvelables pourraient-elles être le prochain gros chantier des pétroliers ? Telle est la question que s’est posée le consultant Wood MacKenzie. Et, selon le rapport qui l’a étudiée, la réponse est oui. « L’éolien et le solaire sont voués à transformer radicalement le marché de l’énergie, et les opportunités de croissance dans les renouvelables ne peuvent pas être ignorées », note le consultant. Celui-ci a ainsi évalué que les “Majors” devraient investir plus de 310 milliards d’euros dans l’éolien et le solaire d’ici 2035, pour garder la part de marché de 12 % qu’elles ont actuellement avec le gaz et le pétrole. Si le scenario est improbable, les analystes estiment que le secteur des renouvelables pourrait quand même concentrer plus d’un cinquième des investissements de ces entreprises d’ici 2030. Storengy et TIGF vont désormais permettre l’injection du biométhane de 1e génération dans leurs stockages souterrains, ont-ils annoncé le 1er juin dans un communiqué. « Cette décision, en augmentant de manière significative le potentiel d’injection de biométhane dans les réseaux, représente une avancée majeure vers l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État français », expliquent les deux entreprises, qui affirment que « son intégration dans les stockages souterrains ne génère pas d’impact supplémentaire par rapport au gaz naturel ». Le développement de l’injection de gaz renouvelable dans le réseau « passe notamment par la remontée de flux de biométhane des réseaux de distribution vers les réseaux de transport », avancent les deux partenaires, qui annoncent le lancement de deux sites pilotes (« rebours ») situés à Pontivy (Morbihan) et Pouzauges (Vendée). Depuis cette annonce, les derniers chiffres sur l’injection du biométhane ont été publiés par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et ils sont encourageants. Une capacité supplémentaire de 86 GWh/an a ainsi été installée au cours du premier trimestre 2017, soit plus de trois fois plus qu’au cours de la même période de l’année précédente, et en augmentation de 20 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Fin mars 2017, 32 installations injectaient du biométhane dans les réseaux de gaz naturel. Leur capacité s’élevait au total à 497 GWh/an, en progression de 21 % par rapport à la fin de l’année 2016. Enfin, la capacité des 252 projets en file d’attente atteignait presque 5 600 GWh/an au 31 mars 2017, en hausse de 10 % sur un trimestre. Si un niveau record, à 161 GW, de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable (éolien, solaire, géothermie, etc.) ont été installées dans le monde en 2016, les investissements ont baissé de 23 % par rapport à 2015, notamment dans les pays émergents, avertit le rapport 2017 de REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), publié ce mercredi 7 juin. « Les investissements continuent de se concentrer dans l’éolien et le solaire photovoltaïque, alors que toutes les technologies d’énergies renouvelables ont besoin d’être déployées pour maintenir le réchauffement climatique sous bien en deçà des 2 degrés », note le réseau d’experts. Le document avance toutefois que le solaire et l’éolien deviennent, dans certains pays, « l’option la moins coûteuse » par rapport aux énergies fossiles ou au nucléaire. Pour l’avenir, de nombreux chantiers restent à accomplir, notamment le secteur de la mobilité, qui « n’est pas encore considéré comme une priorité », en particulier dans le transport aérien et maritime. La production de froid et de chaleur renouvelables est aussi à la traîne par rapport au solaire ou à l’éolien. Autre inquiétude, les subventions aux énergies fossiles sont toujours plus de quatre fois supérieures à celles accordées aux énergies renouvelables, dénonce le rapport. Le producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables, Eren RE, a indiqué avoir levé 100 millions d’euros auprès du consortium d’investisseurs mené par Bpifrance et comprenant Next World, Tikehau Capital et FFP. Ces mêmes investisseurs avaient déjà investi la même somme dans la société en 2015. Cette levée de fonds lui permettra d’« accélérer sa croissance à l’international », selon un communiqué publié le 6 juin. « Le succès de cette levée de fonds, qui intervient plus tôt que prévu, est crucial pour l’accélération de la croissance d’Eren RE sur le long terme, dans le secteur des énergies renouvelables », a déclaré son président Pâris Mouratoglou. « Fondée en 2012, Eren Re a mis en service au cours des 18 derniers mois, plus de 80 MW de projets éoliens en Grèce, 72 MW de photovoltaïque en Inde et 10 MW en Ouganda. La société française développe par ailleurs un portefeuille de plus 1 500 MW de projets renouvelables, et son objectif, à moyen terme, est de le porter à 2 000 MW, d’ici à 2020. Une ambition qui nécessite un investissement de 2 à 2,3 milliards d’euros. La Russie a lancé le 30 mai un appel d’offres consacré aux énergies renouvelables visant une capacité maximale de 1,9 GW pour une mise en service des projets entre 2018 et 2022 : 250 MW en 2018, 300 MW en 2019, 350 MW en 2020, 500 MW en 2021 et 500 MW en 2022. Les offres peuvent être déposées jusqu’au 9 juin pour une publication des résultats prévue au plus tard le 30 juin. Si cet appel à projets concerne l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité, l’énergie du vent devrait s’octroyer la plus grande part du gâteau. 450 MW de projets éoliens ont ainsi été déposés dès le jour d’ouverture de l’opération, s’est d’ailleurs félicité l’Association russe pour l’éolien (RIWA). Le finlandais Fortum, qui a récemment conclu une alliance avec Rusnano pour développer des projets éoliens en Russie, sera particulièrement attendu. Autre annonce d’appel d’offres, en Espagne cette fois : fort du succès de celui du 17 mai, le Premier ministre Mariano Rajoy a annoncé le 25 mai qu’une nouvelle enchère de 3 GW, comme la précédente, aurait lieu « avant l’été », sans plus de précisions. Il sera, comme lors du précédent, ouvert aux technologies éoliennes et photovoltaïques. Observ’ER vient de mettre en ligne son étude sur le marché 2016 des pompes à chaleur dans le résidentiel. Les technologies aérothermiques sont en progression de 10 % par rapport à 2015. Les PAC air/eau continuent d’être portées par le secteur des habitations neuves tandis que les appareils air/air restent les plus diffusés avec une activité tournée essentiellement vers le remplacement d’anciens systèmes de chauffage électrique dans l’existant. Pour les appareils géothermiques, 2016 est en revanche marqué par un nouveau recul des ventes (- 6 %). Sur ce segment, l’activité s’est contractée de plus de 60 % en 5 ans. Le secteur des énergies renouvelables a employé 9,8 millions de personnes dans le monde en 2016, en nette hausse par rapport à 2012, a annoncé l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) dans un rapport intitulé « Énergies renouvelables et emplois – Bilan annuel 2017 ». L’institution souligne que si quelque sept millions de personnes étaient employées par le secteur en 2012, le chiffre a augmenté d’environ 2,8 millions d’employés en quatre ans grâce à « la baisse des coûts et l’adoption de politiques favorables, qui ont stimulé les investissements et l’emploi ». Le nombre d’emplois dans le secteur photovoltaïque et le secteur éolien a plus que doublé au cours des quatre dernières années. Hors hydraulique, le nombre d’employés du secteur des énergies renouvelables a atteint les 8,3 millions en 2016. 9,8 millions d’emplois, si l’on compte les emplois directs dans les grands projets hydrauliques. La Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne sont les plus grands pourvoyeurs d’emplois dans le secteur, affirme le rapport. Lors de son conseil d’administration du mardi 23 mai 2017, la Fondation Énergies pour le Monde, reconnue d’utilité publique depuis 1990, a renouvelé sa gouvernance. Jean-Louis Borloo a été élu, à l’unanimité, comme nouveau Président – il succède à Vincent Jacques le Seigneur en poste depuis 3 ans (et par ailleurs président d’Observ’ER, l’éditeur du Journal des Énergies Renouvelables). On ne présente plus cet ancien ministre de l’Écologie de 2007 à 2010, à qui l’on doit notamment l’organisation du Grenelle de l’environnement puis la préparation du « Paquet Climat Energie » adopté par l’Union européenne et qui a fortement stimulé les énergies renouvelables en France comme dans toute l’Europe. Depuis 2015, il s’est fait l’avocat de l’accès à l’énergie dans les pays du Sud, notamment en Afrique, où quelques 640 millions d’hommes et de femmes n’ont pas d’électricité. À ce titre, il a rencontré les 54 chefs d’Etats africains afin de les associer à sa démarche et faire de cette thématique un enjeu majeur de la COP21 à Paris. L’arrivée de Jean-Louis Borloo donne un nouveau souffle à la Fondation Énergies pour le Monde, qui œuvre depuis 30 ans pour l’accès à l’électricité dans les pays du Sud. Principalement active en Afrique et en Asie du Sud-Est, elle a permis d’électrifier déjà plus d’un million de bénéficiaires à partir de sources exclusivement renouvelables. Avec tous les autres acteurs du secteur, Énergies pour le Monde entend ainsi démultiplier son action avec l’appui de ses partenaires privés et l’engagement des pouvoirs publics français et européens. La ministre tunisienne de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Héla Cheikhrouhou, a annoncé le 17 mai le lancement d’un appel d’offres pour la construction de plusieurs installations utilisant des énergies renouvelables pour une capacité totale de 210 MW. Les candidats peuvent déposer leurs dossiers jusqu’au 15 novembre 2017, selon l’agence Ecofin qui précise que l’appel d’offres concerne principalement le photovoltaïque et l’éolien. Les installations auront des capacités de 10 MW et 30 MW, mais il est également prévu des mini-installations de 1 MW et 5 MW. L’investissement est estimé par le ministère à 400 millions de dinars (148 M€). « La première phase de l’appel d’offres sera clôturée le 15 novembre 2017. La seconde, pour sa part, sera clôturée le 15 août 2018 », a déclaré la ministre à l’occasion de l’inauguration du salon international des énergies renouvelables. Et d’ajouter qu’« une commission spéciale a été formée pour choisir les projets à mener. Ce choix sera basé sur plusieurs critères : l’expérience de l’auteur du projet, les compétences techniques, les capacités financières et les retombées environnementales du projet en question ». La Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG) devrait par ailleurs signer des contrats de rachat d’électricité pour 60 MW de projets solaires, 70 MW de parcs éoliens et 10 MW de microcentrales. Engie a annoncé le 23 mai avoir obtenu, avec son partenaire islandais Reykjavik Geothermal (RG), trois licences d’exploration dans la géothermie au Mexique. Délivrées par le ministère mexicain de l’Energie (SENER), ces concessions ont été obtenues à parité à la suite d’un accord de coopération conclu entre Storengy, filiale d’Engie, et RG en décembre 2015. Elles autorisent l’exploration de ressources géothermiques pour une période de trois ans, dans trois zones de 150 km2 chacune, dans l’État de Nayarit (nord-ouest), à Cerro Pinto et dans l’État de Puebla (centre), précise Engie dans un communiqué commun avec RG et le ministère. « L’attribution de ces permis d’exploration à un partenariat franco-islandais marque un jalon important dans la mise en œuvre de la réforme législative en faveur de l’énergie géothermique », a commenté Efrain Villanueva Arcos, directeur général des énergies propres du SENER. « Il s’agit en effet des premières entreprises 100 % étrangères à investir dans le secteur de la géothermie au Mexique », a-t-il ajouté. Pour rappel, le pays s’est doté d’une grande réforme énergétique en 2015. Elle encourage notamment les investisseurs privés à participer à la production d’électricité et l’augmentation de la production d’énergies renouvelables. Dans son ouvrage récemment mis à jour et librement téléchargeable, Vincent Boulanger démontre, sans ignorer ses manques et travers, que la transition énergétique allemande n’est ni un gouffre financier, ni une catastrophe écologique, mais qu’elle peut au contraire être une chance, une opportunité à la fois économique et démocratique. Ainsi, les citoyens apparaissent au cœur de cette transition initiée par le gouvernement de coalition des sociaux démocrates et des verts en 1998 et créatrice de plus de 200 000 emplois entre 2004 et 2013. L’auteur, par ailleurs conseiller éditorial du Journal du Photovoltaïque et du Journal de l’Éolien, décrypte ces enjeux et déconstruit les mythes qui entourent ce grand projet. Qu’on se le dise, le producteur indépendant d’énergies renouvelables Cap Vert Energie veut accentuer son développement, notamment à l’international. « En 5 ans, nous souhaitons multiplier par 10 nos capacités de production pour atteindre près de 820 MWc de puissance installée et en construction, dont plus de 50 % à l’international », annonce Pierre de Froidefond, un des associés fondateurs de Cap Vert Energie avec Christophe Caille et Hervé Lucas. Pour atteindre ces objectifs, Cap Vert Energie a prévu d’investir 1,3 milliard d’euros jusqu’en 2022 (un montant qui inclut les investissements déjà réalisés depuis sa création en 2011) et procèdera à une augmentation de capital « d’ici la fin de l’année ou début 2018 », précise le dirigeant. La société réalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros et emploie 60 personnes aujourd’hui. Présente dans le solaire et le biogaz, elle détient actuellement 75 MW en construction ou en exploitation, essentiellement en France. Mais depuis deux ans, la société réfléchit à son développement à l’international pour profiter de marchés en pleine expansion. Elle a ainsi choisi de se lancer dans trois zones porteuses pour le solaire et la vente directe d’électricité : le Chili, le nord-est des États-Unis et l’Afrique. L’entreprise française Global Bioenergies a inauguré la semaine dernière une unité pilote de production de biogaz à partir de sucre sur le site de l’institut Fraunhofer de Leuna, en Allemagne. La start-up transforme du glucose de maïs (pour l’instant) en bio-isobutène dans un fermenteur où elle a introduit des bactéries génétiquement modifiées. Le gaz obtenu sert aussi bien à produire du biocarburant (iso-octane) que des plastiques, du verre et des cosmétiques. Elle a par ailleurs annoncé la signature d’un accord portant sur la démonstration industrielle d’une nouvelle chaîne de valeur articulant autour de son procédé isobutène les technologies de Clariant et d’INEOS, deux groupes européens de chimie. Il s’agit de convertir la paille de blé résiduelle, mal valorisée aujourd’hui, en isobutène renouvelable de seconde génération. Le programme, d’un coût total de 16,4 M€, est soutenu à hauteur de 9,8 M€ par le Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), le complément restant à la charge des participants. Global Bioenergies recevra 4,4 M€ pour des opérations à mener sur son site de R&D d’Evry et son pilote de Pomacle (tous deux en France), ainsi que sur son démonstrateur industriel de Leuna. Douze finalistes ont été sélectionnés pour l’édition 2017 des Prix européens de l’Énergie durable, qui récompensent des innovations remarquables dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Ces prix sont un événement majeur de la Semaine européenne de l’énergie durable (EUSEW), organisée pour la 12e fois en 2017, du 19 au 25 juin. La remise des prix se tiendra le 20 juin à Bruxelles, lors de la prestigieuse Conférence politique de l’EUSEW. Un français parmi les finalistes (catégorie consommateur) : Topten. Ce portail web multipays oriente les consommateurs vers des appareils économes en énergie, fournit des conseils en matière d’économie d’énergie et facilite la production et la vente au détail de produits plus écologiques, ainsi que le soutien politique dans ce domaine. Le 8 mai, des représentants d’organisations majeures ont lancé une plateforme mondiale pour promouvoir le 100 % renouvelable et les systèmes d’énergie décentralisés. Ce lancement a coïncidé avec le début de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique qui se tient à Bonn (Allemagne) du 8 au 18 mai. Cette plateforme réunit des leaders de la société civile, des entreprises, des Gouvernements et de la science. Elle ambitionne une contribution à la réduction des effets néfastes du changement climatique, en suivant le principe d’après lequel « tous les nouveaux investissements dans les systèmes énergétiques doivent être basés sur du 100 % renouvelable », énonce la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) dans un communiqué du 8 mai. Par ailleurs, « les approches décentralisées et axées sur les personnes constituent le meilleur moyen de transformer les sociétés ». Diverses ONG (World Future Council, ASES – Solar Energy Society et Climate Action Network) travailleront dans ce sens avec les décideurs. « Les énergies renouvelables contribuent à la paix mondiale car elles peuvent éviter les conflits sur les ressources », a déclaré Naoto Kan, ambassadeur de la plateforme et ancien Premier ministre du Japon. S’estimant lésé par la chute des subventions aux renouvelables en Espagne, le fond britannique Eiser Infrastructure Limited a obtenu une indemnisation suite à une décision du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi). Le pays doit ainsi lui payer « 128 millions d’euros plus les intérêts » ainsi qu’à sa filiale luxembourgeoise Energia Solar Luxembourg, explique un communiqué du Gouvernement espagnol, lequel envisage de déposer un recours. Le plaignant avait demandé « plus de 300 millions d’euros ». Le Cirdi aurait réceptionné une trentaine de plaintes similaires visant l’État, lequel pourrait avoir à verser des centaines de millions d’euros. Dans les années 2000, l’Espagne soutenait les énergies renouvelables qui, également aidées par l’abondance de vent et de soleil, y ont connu un développement fulgurant. Eiser avait pris des participations dans trois centrales solaires. La crise de 2008, puis un moratoire sur les aides en 2012 ont stoppé ce développement. Créé en 1966 et placé sous la supervision de la Banque mondiale, le Cirdi est un organisme d’arbitrage des différends entre investisseurs et 161 États, dont l’Espagne. L’IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis – institut étasunien de l’économie de l’énergie et de l’analyse financière) a publié le 8 mai un rapport décrivant la façon dont les énergies solaire et éolienne peuvent remplacer les systèmes « obsolètes » de production d’électricité fonctionnant au carburant dans les petites îles des Philippines. Nombre de leurs réseaux dépendent en effet de gazole importé et souffrent de pannes récurrentes. « Notre recherche établit qu’une transition raisonnablement rapide aux énergies renouvelables est réalisable dans toutes ces îles », a déclaré Sara Jane Ahmed, principale auteure du rapport. « L’hybridation du diesel avec le photovoltaïque, l’éolien, la biomasse, les petites installations hydroélectriques et les batteries est très prometteuse » d’après le rapport, qui indique par ailleurs que les coûts de l’énergie solaire ont chuté de 99 % depuis 1976 et de 90 % depuis 2009. Ceux de la production éolienne ont diminué de 50 % depuis 2009. « Cela peut conduire à la domination finale des énergies renouvelables dans les mix énergétiques », a conclu Sara Jane Ahmed. L’Observatoire du biométhane vient de présenter son panorama 2017 de la filière. Lancé en mars 2016 par le think tank France Biométhane et le cabinet de conseil SIA Partners, cet observatoire propose « une nouvelle analyse de la filière française : contexte et règlementation, état des lieux de la filière, perspectives et zoom sur le biométhane carburant », précise un communiqué du cabinet. En 2016, l’injection de biométhane a atteint 215 GWh (+ 162 % depuis 2015) en France. En mars 2017, la capacité de production sur le territoire a atteint 440 GWh/an, et 241 projets (représentant un potentiel de production annuelle de 5 TWh) étaient en attente sur les réseaux GRDF et GRT Gaz. Le décollage de ce nouveau marché paraît confirmé. « En France, l’injection de biométhane dans les réseaux connait, depuis 2014, une très forte dynamique. Neuf nouveaux sites ont déjà été mis en service en 2016, et trois depuis 2017, portant ainsi à 29 le nombre d’installations depuis 2011 », annonce le communiqué de FB. « En tant que carburant, le biométhane pourra bénéficier de l’essor du GNV, carburant qui dispose de nombreux atouts pour la lutte contre les particules fines : le gaz pourrait ainsi représenter 14 % de l’énergie consommée dans les transports en 2030. » Le gouvernement a fixé un objectif de 10 % de biométhane dans la consommation française de gaz naturel en 2030. Encore au stade de projet pilote, le biométhane 2e génération, produit à partir de biomasse solide par gazéification, pourrait représenter 35 % du gaz consommé en 2050. L’Agence des micro-projets (AMP) et Synergie Solaire s’associent dans le cadre d’un troisième appel à projets “EnR 2017”. Sont concernées les initiatives portant sur le thème des “énergies renouvelables pour le développement des pays du Sud”. Elles doivent « être portées par une association française de plus de deux ans et de moins de 250 000 euros de budget annuel, et intervenir en collaboration avec une association locale dans un pays en voie de développement », précise le communiqué de l’AMP. La session de dotation (jusqu’à 15 000 euros) sera ouverte du 1er mai au 31 août 2017. Un jury d’experts se réunira après chaque instruction de dossier pour sélectionner les projets lauréats. Il se composera des équipes de l’AMP, de Synergie Solaire et d’experts de diverses structures EnR (ONG LaGuilde, association Ventalili, JPEE, Tenergie, etc.). La remise des prix aura lieu le mardi 21 novembre 2017 en présence du parrain de l’appel à projets, Bertrand Piccard, « pilote pionnier de l’avion solaire Solar Impulse ». L’initiative fait de la capitale de la Géorgie la vingt-septième ville étasunienne à s’engager dans l’énergie “100 % verte”, et la première dans son État, selon le Sierra Club (association écologiste californienne). Lundi 1er mai, une mesure visant à alimenter entièrement la ville grâce aux renouvelables d’ici 2035 a été approuvée à l’unanimité par le conseil municipal. Introduite par l’élu Kwanza Hall, cette résolution engage la ville d’Atlanta à élaborer un plan d’ici janvier 2018 pour la transition de tous ses bâtiments à l’énergie propre d’ici 2025, de façon à ce que toute la ville passe au vert une décennie plus tard. L’engagement d’Atlanta suit une promesse similaire de South Lake Tahoe (Californie) le mois dernier. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de se prononcer sur un projet d’appel d’offres bi-technologies (photovoltaïque et éolien). Défavorable au principe de la neutralité technologique, elle recommande au gouvernement d’y renoncer dans sa délibération publiée le 20 avril. Pour le régulateur, ce type d’appel d’offres ne garantit pas « l’atteinte des objectifs de politique énergétique et, en particulier, le développement conjoint des filières photovoltaïque et éolienne, dont les complémentarités permettent pourtant de faciliter l’intégration au réseau des énergies renouvelables ». Par ailleurs, « il est redondant avec d’autres dispositifs de soutien […] et autorise ainsi des arbitrages entre ces dispositifs qui nuiront à l’efficacité du soutien public. » L’appel d’offres concerné porte sur des installations photovoltaïques ou éoliennes de 5 à 18 MW en métropole. S’il devait être maintenu, la CRE préconise notamment d’abaisser la puissance maximale recherchée (actuellement de 200 MW), de supprimer le prix plancher, de clarifier les modalités de dépôt dématérialisé des offres et de supprimer l’exigence des liasses fiscales. Les entreprises britanniques des secteurs de l’énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice exportent à grande échelle des biens et services dans le monde entier. C’est ce que révèle pour la première fois un rapport que vient de publier RenewableUK (association professionnelle de l’énergie renouvelable au Royaume-Uni), intitulé “Export Nation: A Year in UK Wind, Wave and Tidal Exports”. Il révèle qu’en 2016, 36 d’entre elles (« échantillon représentatif ») ont signé plus de 500 contrats pour travailler sur des projets d’énergie renouvelable dans 43 pays. La valeur de ces contrats oscillait entre 59 000 euros et 27 millions d’euros. « C’est la première fois que l’industrie évalue la portée mondiale du Royaume-Uni dans ces technologies innovantes », indique RenewableUK dans un communiqué du 24 avril. « Le leadership britannique sur ces marchés – qui s’élèvent à 290 milliards de dollars – sera encore plus important lorsque nous quitterons l’UE », estime Emma Pinchbeck, directrice générale de RenewableUK. La CRE (Commission de régulation de l’énergie) vient de se prononcer sur le prix d’achat de l’énergie que produiront les installations biomasse d’Albioma (5,3 MW) et de Voltalia (5,1 MW, mise en service fin 2019) en Guyane. Elle a « défini le niveau de la compensation des charges de service public afférentes aux projets de contrats d’achat avec EDF SEI », explique le régulateur dans un communiqué du 20 avril. Un protocole d’accord entre le gouvernement et l’association interprofessionnelle Interprobois Guyane a été signé le 2 avril 2017, en réponse aux revendications de cette dernière. Celui-ci indique notamment que « l’État s’engage à établir une médiation […] afin de défendre et garantir un tarif de 55 €/t pour les plaquettes broyées issues de connexes de scierie et de 90 €/t pour les plaquettes forestières broyées et livrées issues de l’exploitation forestière ». Dans ce contexte, la CRE a retenu « les coûts de la biomasse tels qu’ils lui ont été exposés par le producteur pour l’évaluation de la compensation afférente au projet de contrat d’achat conclu avec EDF SEI », sur une durée d’exploitation de 25 ans. « Au regard de l’incertitude sur les coûts de la filière bois énergie, émergente en Guyane, la CRE prévoit des audits réguliers sur l’ensemble des coûts des installations et de leur approvisionnement ». La définition de prix de référence accompagnera le développement de cette filière, qui représentera 40 MW en 2023, d’après la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le 13 avril, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, lequel avait annulé l’arrêté d’exploitation de la centrale bagasse/biomasse Galion 2. « Tous les griefs soulevés par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) à l’encontre du projet ont été rejetés », a déclaré l’énergéticien français Albioma dans un communiqué du même jour. Depuis début 2015, la construction s’est poursuivie sans discontinuer, et sa mise en service reste prévue pour fin 2017. Cette première centrale de cogénération 100 % biomasse de Martinique (40 MW) fournira 15 % de la consommation électrique de l’île. Elle a vocation à traiter en priorité la biomasse d’origine locale : paille de canne, déchets verts et bagasse (résidu fibreux issu de la canne à sucre après son broyage) de sucrerie (ou ses excédents issus des distilleries). Mûri depuis 10 ans, le projet vise à « faire progresser la part d’énergie renouvelable en Martinique de 7 % à 22 % et, ainsi, favoriser la transition énergétique de l’île dans le respect des normes environnementales les plus strictes ». Aujourd’hui, 350 personnes travaillent à sa construction. D’après le producteur d’énergie indépendant Albioma, son exploitation devrait créer 34 emplois directs et 200 indirects. 130 m2 de panneaux photovoltaïques, deux éoliennes à axe vertical, aile de traction intelligente : voici les dispositifs embarqués du catamaran Energy Observer, mis à l’eau le 14 avril à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ils permettent à ce navire de produire son propre hydrogène, par électrolyse à partir de l’eau de mer en alimentant deux moteurs électriques convertibles en hydrogénérateurs. Energy Observer est ainsi autonome en énergie. Le navigateur Victorien Erussard est l’un des porteurs de ce projet, parrainé par Nicolas Hulot et né de l’aventure de l’avion solaire Solar Impulse. Le catamaran de 30,5 m de long pour 12,80 m de large est d’ores et déjà baptisé le « Solar Impulse des mers ». Après un tour de France, il entamera une « odyssée du futur », tour du monde sans émission de CO2 qui durera six ans. Jadis catamaran de course canadien de 24,38 m construit en 1983, il avait remporté de nombreuses compétitions. La mobilisation d’une cinquantaine de personnes depuis 2015 a permis sa transformation en Energy Observer. La quête d’Apple pour utiliser 100 % d’énergie propre se poursuit. Trois nouvelles sociétés (Compal Electronics, Sunwoda Electronic et Biel Crystal Manufactory) viennent de s’ajouter aux fournisseurs d’Apple engagés dans l’utilisation exclusive d’énergies renouvelables pour fabriquer ses composants, portant ceux-ci à sept. Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales de l’entreprise l’a affirmé lors d’une interview sur Bloomberg TV le 13 avril. 96 % de l’énergie que consomme Apple sont désormais produits à partir de sources renouvelables, a-t-elle ajouté. À court terme, elle compte passer à 100 % pour alimenter ses installations, ce qu’elle accomplit déjà dans 24 pays, y compris les États-Unis. En comptant ses fournisseurs, ce serait plus de 2,5 milliards de kWh par an d’énergie propre d’ici 2018 qui seront produits pour les activités d’Apple, avait annoncé l’entreprise en mars dernier. Les géants du Web (Google, Apple, Facebook, Amazon), qui ont récemment commencé à verdir les gigantesques quantités d’électricité qu’ils consomment, sont aujourd’hui parmi les plus grands acheteurs de renouvelable. Le ministère de l’Énergie, du Tourisme et du Numérique espagnol a approuvé les modalités du prochain appel d’offres pour les énergies renouvelables, qui devrait avoir lieu « dans les prochaines semaines », indique-t-il dans un communiqué. Il met en place la neutralité technologique (toutes technologies confondues, avec le prix comme critère principal de sélection). Les projets devront être opérationnels d’ici 2020 et ambitionner une réduction des coûts pour le consommateur. Cet appel d’offres porte sur une capacité totale de 2 000 MW – auxquels s’ajouteront 1 000 MW si son résultat fait état de prix compétitifs. Il représente une étape clé dans la réalisation des objectifs environnementaux du pays pour 2020 : 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, contre 16 % aujourd’hui. Dans un récent numéro, Le Journal du Photovoltaïque abordait la traversée du désert du pays, marquée par un gel de cinq ans du soutien aux énergies renouvelables. Avec cette initiative gouvernementale, les professionnels entrevoient un renouveau, craignant toutefois un remake du fiasco de l’appel d’offres de 2016 (700 MW), à l’issue duquel aucun projet n’avait été retenu. La chaleur reste l’énergie la plus sollicitée, que ce soit dans l’industrie, les services ou le secteur résidentiel. C’est pourquoi le projet Mapping, un consortium mené par le Fraunhofer et dont Observ’ER fait partie, fournit des analyses et des outils à la Commission européenne sur le sujet. Il établit des scénarios prospectifs d’ici 2030. Et le résultat est sans appel : obliger les énergéticiens traditionnels à proposer un mix énergétique incluant du renouvelable serait plus efficace que des subventions. En plus d’être la moins coûteuse pour les citoyens, cette solution favoriserait effectivement l’accroissement des technologies de production de chaleur renouvelable. Il est évident que ce scénario devrait s’accompagner de la fin des subventions accordées aux énergies fossiles. Pour découvrir le projet Mapping, cliquer ici. En 2016, la bonne tenue des ventes de poêles à granulés a permis de limiter le recul du marché français des appareils de chauffage domestique au bois dans son ensemble. C’est l’un des enseignements de l’étude que réalise chaque année Observ’ER sur la filière, et dont la dernière livraison vient de paraître. Avec 346 225 unités écoulées l’an passé, les ventes de foyers fermés, d’inserts, de poêles, de cuisinières et de chaudières fonctionnant au bois se rétractent de 8,8 % par rapport à l’année précédente. Loin de marquer une désaffection des Français pour ce type de chauffage, cette tendance résulte d’éléments conjoncturels, comme les températures clémentes de 2016 combinées à des énergies fossiles bon marché une bonne partie de l’année. Le dernier trimestre 2016 aurait cependant enregistré un redémarrage des ventes, ce qui laisse espérer aux professionnels un rebond du marché pour cette année. En 2016, la capacité mondiale de production d’énergie renouvelable s’est accrue de 161 GW pour atteindre 2 006 GW (+ 8,7 %). D’après l’Irena (Agence internationale pour les énergies renouvelables), qui a édité ces dernières données dans un rapport le 30 mars, il s’agit d’une année record en termes d’ajouts de capacités. Moteur de cette croissance, les énergies solaires progressent de 71 GW. Pour la première fois depuis 2013, le solaire s’est en effet développé plus rapidement que l’éolien (+ 51 GW). Les capacités hydroélectriques et biomasse ont respectivement augmenté de 30 GW et 9 GW, celle de la géothermie d’un peu moins de 1 GW. L’Asie a concentré la plus forte croissance (+ 13,1 %). L’Afrique a installé 4.1 GW de puissance supplémentaire en 2016, soit deux fois plus qu’en 2015. « Pour contribuer de manière décisive à la décarbonation du secteur de l’énergie et à la réalisation des objectifs climatiques, il faudra accélérer cette dynamique, ce qui nécessitera des investissements supplémentaires », prévoit Adnan Z. Amin, directeur général de l’Irena. Pour la première fois, l’agence édite par ailleurs des données spécifiques aux énergies renouvelables hors réseau, dont la capacité a atteint 2 800 MW fin 2016. L’agence évalue à 300 millions le nombre de personnes bénéficiant de cette électricité renouvelable « off-grid ». La Commission européenne surestimerait la part à venir de la biomasse dans les énergies renouvelables. C’est ce qu’affirme une étude du cabinet indépendant européen CE Delft, publiée fin mars 2017, pour laquelle la Commission sous-estimerait par ailleurs la baisse en cours et à venir du coût des énergies éolienne et solaire. Celle-ci sera significative, d’après CE Delft. « La Commission estime que près des deux tiers (63 %) des énergies renouvelables proviendront de la biomasse sous différentes formes en 2030 », explique Jori Sihvonen, responsable biocarburants de l’association européenne Transport & Environment (T&E). Or, d’après le rapport du cabinet, la part de la biomasse (granulés de bois, déchets et résidus) passerait de 60 % en 2014 à 46 % en 2030. L’usage de données anciennes (2012 pour la Commission, 2015 pour CE Delft) expliquerait ces écarts de précision. Cela conduirait également la Commission à surévaluer les coûts de scenari plus volontaristes en matière de développement des énergies renouvelables, interprète T&E, qui a diligenté l’étude avec BirdLife Europe. Les acteurs du capital-développement continuent de privilégier l’innovation énergétique et la protection environnementale. En 2016, 629 millions d’euros ont accompagné le lancement ou la croissance de jeunes entreprises de ces secteurs (604 millions d’euros en 2015). Avec 247 millions d’euros, la production d’énergies renouvelables devient un domaine d’intervention majeur. Une prépondérance expliquée par la montée en puissance de Voltalia (170 millions d’euros de capital-développement), exploitant de centrales solaires, et par la création de DCNS Energies (100 millions), opérateur d’énergies marines renouvelables. Ces données proviennent du baromètre de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), publié lundi 3 avril. L’argent du capital-développement se dirige toujours majoritairement vers les start-ups (371 millions d’euros l’an dernier – 273 millions en 2015). Parmi elles, on constate une percée de l’écomobilité, avec 130 millions d’euros levés, notamment pour la location de voitures entre particuliers (Drivy) et les véhicules électriques sans chauffeur (Navia) – 30 millions d’euros pour chacune. Première en France : un site industriel non raccordé au réseau de gaz naturel va consommer du biométhane liquéfié (BioGNL), issu des eaux usées. Suez, producteur de ce combustible, l’a annoncé dans un communiqué le 23 mars. Comptant progresser dans la diminution des impacts de son site de Sermaises-du-Loiret (Loiret), la société Chryso va ainsi utiliser ce biogaz liquéfié issu de la fermentation des boues de la station d’épuration du SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), exploitée par Suez à Valenton (94). En 2013, le groupe avait lancé BioGNVAL, un projet pilote dans le domaine, avec le soutien de l’Ademe, du programme d’investissements d’avenir (PIA) et en association avec divers partenaires : SIAAP, GNVert (filiale d’Engie) Cryo Pur et Iveco. Il a abouti en mai 2016, produisant pour la première fois du BioGNL. « Ce démonstrateur industriel est le premier en France à valoriser le BioGNL, une énergie renouvelable, facilement stockable et transportable », explique Pierre Coursan, chef de marché Biométhane chez Suez. « AB InBev va devenir le plus grand consommateur industriel direct d’énergie renouvelable dans le secteur des biens de consommation au niveau mondial, réduisant l’empreinte carbone des opérations de la société de 30 % », affirme le groupe dans un communiqué du 28 mars. D’après son engagement, d’ici à 2025, 100 % de l’électricité qu’il achètera proviendra de sources renouvelables. Ce qui représenterait 6 TWh d’électricité annuelle. Le groupe espère contribuer ainsi à la transformation du secteur énergétique en Argentine, au Brésil, en Inde et en Afrique. Cet accroissement de production d’EnR « soutiendra les initiatives menées pour atteindre les objectifs climatiques établis en vertu des accords adoptés lors de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21). » Des accords d’achat direct d’électricité avec des producteurs de ces pays devraient permettre à AB InBev de couvrir de 75 à 85 % de ses besoins. Les 15 à 25 % restants proviendront pour l’essentiel des technologies sur site, comme les panneaux solaires. Un premier accord d’achat d’électricité renouvelable a été signé au Mexique. Établir une liste des acteurs français susceptibles de proposer des produits, systèmes ou services dans le domaine de l’accès à l’énergie – informer ces acteurs des consultations susceptibles de les intéresser – suggérer des regroupements éventuels d’acteurs aux activités complémentaires pour répondre à des consultations internationales et promouvoir le savoir-faire français souvent méconnu dans le domaine de l’accès à l’énergie. Tels sont les objectifs de l’initiative lancée par les bureaux d’études Gérard Moine Consultant (GM Consultant) et Hacsé. Elle vise à recenser les acteurs français de l’électricité rurale décentralisée (ERD) à l’international. Quelle que soit la taille de leur structure, tous sont invités à remplir une fiche de renseignements précisant leurs activités et leurs offres. Le questionnaire est téléchargeable ici, puis à retourner, sous format électronique, avant le 15 avril 2017 à l’une des adresses suivantes : gm.consultant.pv@free.fr ou info@hacse.eu. Les informations collectées seront bien sûr tenues à disposition des acteurs qui auront répondu à l’enquête. Grande première, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Irena (International Renewable Energy Agency) ont publié le 20 mars un rapport co-réalisé à la demande de la présidence allemande du G20. Intitulé « Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy Transition », il marque la première coopération entre ces deux agences. Ce rapport prend d’ailleurs une importance particulière dans le cadre du G20, où la présidence allemande doit faire face au climato-scepticisme de l’administration Trump. Selon le document, l’investissement nécessaire pour décarboniser le secteur de l’énergie est de 0,4 % du PIB mondial d’ici 2050, tandis que la transition permettra d’accroître le PIB mondial de 0,8 % en 2050 et de créer 6 millions d’emplois nets dans l’énergie au niveau mondial. Les deux entités font état de quelques divergences dans leurs scénarios. Alors que l’AIE met en œuvre toutes les technologies bas carbone pour atteindre l’objectif, l’Irena mise principalement sur le déploiement accéléré des énergies renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique. À noter également, près de 80 patrons d’entreprises ainsi qu’une quarantaine d’autres personnalités ont appelé mardi 21 mars le futur président français et les États européens à se « réveiller » et agir « au plus vite » pour « décarboner l’Europe » afin de « garantir la paix ». Ce « Manifeste pour décarboner l’Europe » est une initiative du think tank The Shift Project. Le producteur français indépendant d’énergie renouvelable Akuo Energy a présenté ce mercredi 22 mars la plateforme de financement participatif Akuo Coop. Elle a pour but d’« associer les riverains aux projets de production d’énergie verte des territoires les concernant directement pour générer des bénéfices environnementaux, sociaux et financiers, selon Axelle Vuillermet, responsable des relations investisseurs d’Akuo Energy. Elle donne l’opportunité aux citoyens, dans un contexte de taux bas et de montée en puissance de la transition énergétique, de donner du sens à leur épargne tout en offrant une rémunération confortable et un investissement de qualité en finançant des projets 100 % renouvelables validés techniquement par les équipes d’Akuo Energy. » Akuo Coop présente une rémunération nette de commission pour le prêteur. Concrètement, la plateforme permet, en quelques clics, à tout citoyen de prêter avec intérêts à partir de 50 euros par projet pour financer des centrales de production de tout type d’énergie verte (éolien, solaire, biomasse, hydro) développées et exploitées par Akuo Energy. Atlantis Resources a annoncé le 16 mars « son intention de pénétrer le marché français de l’énergie marémotrice par le biais d’un accord de coopération avec Innosea, une entreprise française spécialisée dans l’ingénierie marine, implantée à Nantes ». La société prépare ainsi « un plan de déploiement local pour les projets commerciaux d’énergie marémotrice en France pour Atlantis », grâce à l’« annuaire exclusif de capacités industrielles dans l’énergie marine » développé par Innosea, qui lui fournit aussi des conseils à propos de la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement pour la fabrication, l’assemblage et la distribution des turbines marémotrices AR1500. Ce déploiement « sera possible dans un délai d’un à deux ans, explique Tim Cornelius, PDG d’Atlantis. Le système de turbine AR1500 produit déjà de l’électricité à l’échelle commerciale en Écosse ». « Suite aux appels d’offres adressés aux fermes-pilotes françaises par l’Ademe en 2014, Atlantis souhaite soumissionner formellement », ajoute le communiqué. L’Ademe a récemment mis en ligne une étude, « technique, économique et environnementale », sur l’injection portée de biométhane dans le réseau de gaz. Pour rappel, on parle d’injection portée de biométhane lorsqu’une (ou plusieurs) unité(s) de méthanisation transporte par la route son biométhane vers un poste d’injection. Si le développement de cette filière de valorisation est souvent freiné par l’éloignement entre les bassins de gisements agricoles et des réseaux de gaz de capacités adaptées, « délocaliser un point d’injection d’une ou plusieurs unités de méthanisation, et donc réaliser une injection portée, peut être une solution pour développer l’injection de biométhane », explique l’Ademe. Dans cette étude, l’agence se fixe pour objectif de présenter les avantages et les limites des projets d’injection portée et d’aider à évaluer l’intérêt de cette filière au regard des différentes voies de valorisation du biogaz. Pour ce faire, un panel de 9 scénarios pertinents a été défini puis analysé sur des aspects techniques, environnementaux, règlementaires et économiques. Or, un seul schéma était techniquement mature en 2016, révèle le document qui ajoute que « la gestion du CO2 résiduel dans le biométhane liquéfié est un verrou technique notable. » L’étude pointe deux solutions : « augmenter la pression du fluide et ainsi la solubilité du CO2 dans le liquide ou pousser l’épuration du biogaz jusqu’à des puretés extrêmes en CH4. » L’Union européenne a annoncé le 13 mars avoir adopté une série de projets d’un montant de 40 millions d’euros pour soutenir, notamment, les énergies renouvelables. Cette série de projets a été signée à l’occasion de la réunion à haut niveau du Conseil d’association UE-Algérie. Elle vise à financer « le développement des énergies renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique, la modernisation de la gestion des finances publiques et la mise en œuvre de l’accord d’association UE-Algérie », explique un communiqué de la Commission européenne. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé le 9 mars l’adoption d’un cadre d’investissements de 300 millions d’euros afin de soutenir la législation grecque sur les énergies renouvelables. Cette somme « va permettre de financer des investissements dans des projets de production d’électricité à partir de sources renouvelables », explique la BERD dans un communiqué, mais aussi dans l’amélioration des capacités de transport et de distribution d’électricité afin d’augmenter l’efficacité, réduire les pertes et mieux intégrer ces énergies renouvelables sur le réseau. Un des premiers projets soutenus sera un parc éolien de 43 MW mené par le développeur grec Volterra. Pour rappel, l’objectif du pays est d’atteindre 2,4 GW de nouvelles capacités de production à partir de sources renouvelables d’ici 2020. L’entreprise Soprema a mis en route fin février un système de gazéification de biomasse sur son site localisé à Strasbourg (67). « L’unité produira un gaz de synthèse (dit Syngaz) issu de la pyrolyse du bois », indique le spécialiste de l’étanchéité, de la végétalisation et de l’isolation dans un communiqué publié le 6 mars. Et de préciser que « c’est la première fois en France qu’un gazéifieur de ce type est mis en œuvre dans l’industrie des matériaux de construction ». La biomasse utilisée est un bois Sortie du statut de déchet (SSD) et dont l’approvisionnement est situé à moins de 2 km de l’usine de Strasbourg. Ce projet représente un investissement d’environ 2 millions d’euros ayant bénéficié d’un soutien de l’Ademe via un BCIAT (Biomasse chaleur industrie et agriculture). Il permettra la production de 1 125 tep et 13 GWh chaque année, « soit une substitution, à terme, de 60 % de la consommation du gaz naturel utilisé sur le site industriel », précise Soprema, qui espère réduire son rejet de CO2 de 3 300 tonnes environ. L’usine de Sorgues (84) devrait, elle aussi, bénéficier d’une solution de gazéification de biomasse, bien que le procédé devrait différer de celui de Strasbourg. Il « consistera à produire le gaz de synthèse (Syngaz) à partir de tourteaux de raisins », l’usine étant entourée d’industriels oléicoles et d’un large bassin viticole. La start-up suédoise Minesto a levé environ 75 millions de couronnes suédoises (près de 8 millions d’euros), grâce à un programme de souscription qui a duré tout le mois de février, a-t-elle expliqué le 6 mars dans un communiqué. L’offre a été souscrite à 90,7 %, se félicite Minesto, assurant que les fonds récoltés iront au projet de cerfs-volants sous-marins Deep Green que Minesto développe actuellement à Holyhead, au Pays de Galles. La start-up prévoit d’y installer sa première centrale de taille commerciale. Elle a ainsi commandé début janvier une première aile sous-marine d’une puissance de 500 kW, laquelle doit être immergée dans le courant de cette année. Schneider Electric et Engie ont signé un protocole d’accord pour « explorer et déployer de nouvelles solutions digitales pour l’efficacité opérationnelle des champs éoliens et photovoltaïques » développés par Engie, ont annoncé le 27 février les deux partenaires dans un communiqué commun. Ces solutions seront fournies via le système logiciel baptisé Wonderware, déjà développé par Schneider Electric, pour le contrôle, l’acquisition et la gestion des données. De son côté, « Engie a pour ambition de développer la supervision et le contrôle à distance de son parc mondial de production d’énergie renouvelable, et possiblement d’autres actifs énergétiques, afin d’en optimiser l’exploitation », explique Didier Holleaux, directeur général adjoint d’Engie, cité dans le communiqué. L’éco-quartier Clichy-Batignolles, situé dans le nord-ouest de Paris, sera en partie chauffé par une centrale géothermique inaugurée le 23 février. La centrale utilise l’eau chaude puisée par Eau de Paris dans la nappe phréatique de l’Albien à environ 600 m de profondeur. Elle est ensuite vendue à la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) qui la distribue aux bâtiments de l’éco-quartier, expliquent les deux partenaires (la CPCU et Eau de Paris) dans un communiqué. Avec un financement porté à 12 millions d’euros, « ce projet permet de fournir de la chaleur dans le quartier de 54 hectares à partir d’un doublet géothermique (un puits de production et un puits de réinjection) ». Ce seront ainsi 83 % des besoins en chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) qui seront couverts par la centrale. Situé dans le 17e arrondissement de Paris, l’éco-quartier doit accueillir 7 500 habitants en 2020. Comme annoncé récemment par Ségolène Royal, l’arrêté portant à 20 ans contre 15 ans la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz a été publié au Journal officiel le 26 février. Ainsi, pour bénéficier de l’extension du contrat, l’acheteur doit adresser « avant le 30 avril 2017 au producteur concerné un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat », précise l’arrêté. « Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat », est-il ajouté. Avec plus de 2 250 MW de projets renouvelables de grande taille en cours de construction en 2017, cette année pourrait être la meilleure pour la filière australienne depuis plus de 50 ans, se réjouit l’association australienne des industriels du secteur des énergies renouvelables, Clean Energy Council, dans un récent communiqué. La construction du complexe hydroélectrique des Snowy Mountains dans les années 50 (16 barrages et 7 centrales électriques représentant plus de 3 700 MW) est le seul événement à pouvoir faire de l’ombre au dynamisme prévisible du secteur en 2017, ajoute l’association. « Nous tablons sur une énorme année 2017, avec plus de 20 projets en construction ou ayant sécurisé leur financement et dont les travaux commenceront cette année », explique Kane Thornton, délégué général de l’association, citant les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud comme particulièrement dynamiques, avec respectivement 730 MW et 856 MW de projets. Les investisseurs reviennent aux renouvelables, après plusieurs années moribondes du fait de l’action du gouvernement de Tony Abbott, lequel a quitté le pouvoir en septembre 2015, poursuit Kane Thornton. Sup’EnR a eu l’honneur d’une visite du secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur Thierry Mandon, lequel s’est rendu lundi à Perpignan pour soutenir la première école d’ingénieurs de France dédiée aux énergies renouvelables, a rapporté l’AFP. Pour rappel, cette école avait été lancée en 2009 sous le label Polytech. Mais le partenariat formé avec l’école Polytech de Montpellier avait rapidement échoué en raison de mésententes sur les financements. L’université de Perpignan a relancé à l’automne 2016, sous le nom de Sup’EnR, cette formation adossée cette fois à l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse. Xavier Py, enseignant-chercheur au laboratoire Promès et vice-président de l’université de Perpignan, a indiqué que la jeune école d’ingénieurs devrait accueillir pour la deuxième année 50 étudiants (contre 27 en 1re année). La formation ingénieur Sup’EnR dure 5 ans : le 1er cycle (2 premières années) est réalisé au sein du département Science et technologies pour l’ingénieur (STPI) de l’INSA de Toulouse – le cycle ingénieur est effectué intégralement sur le site de l’université de Perpignan pour les 3e, 4e et 5e années. La société d’investissement Ardian Infrastructure va devenir l’unique actionnaire de la joint-venture TRE Solar en rachetant les 35 % de parts détenues par son partenaire italien Tozzi Green. Créée en 2011, TRE Solar, qui sera renommée 3 New à la suite du changement de partenariat, détient 462 MW d’énergies renouvelables en Italie, répartis entre l’éolien (335 MW), l’hydroélectrique (51 MW), le solaire (51 MW) et la biomasse (25 MW). L’investisseur français était déjà l’actionnaire majoritaire de cette coentreprise (à 65 %). « Ardian va acquérir le contrôle total des actifs du portefeuille, à l’exception d’une centrale biomasse d’une capacité de 25 MW, gérée par Agritre et acquise en octobre 2014, qui sera toujours détenue conjointement par Ardian (52 %) et Tozzi (48 %) », explique la société dans un communiqué. Elle ajoute qu’elle gère désormais une capacité de production renouvelable installée de plus d’un gigawatt. La Commission européenne a autorisé trois régimes français de soutien aux producteurs d’énergie solaire et hydroélectrique en France au regard des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Ces régimes permettront à la France d’augmenter sa capacité solaire de quelque 2 600 MW et sa capacité hydroélectrique d’environ 60 MW, évalue le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer dans un communiqué publié le 10 février, au lendemain de cette décision. Ces régimes concernent : les installations solaires à petite échelle de moins de 100 kW placées sur les toits d’habitations ou de commerces (tarif de rachat – 1 500 MW) – les installations solaires de 100 à 250 kW et celles de plus de 250 kW (appel d’offres entre juillet 2011 et mars 2013 – tarif de rachat pendant 20 ans – 1 100 MW) – les nouvelles centrales hydroélectriques (appel d’offres – tarif de rachat pour les installations de puissance inférieure à 500 kW – complément de rémunération pour les installations de puissance supérieure à 500 kW – 60 MW). Les deux régimes en faveur de l’énergie solaire sont dotés, ensemble, d’un budget prévisionnel de 439 millions d’euros par an soit un total de 8,8 milliards d’euros sur vingt ans et le régime en faveur de l’énergie hydroélectrique d’un budget prévisionnel de 25 millions d’euros par an soit un total de 500 millions d’euros sur vingt ans. Pour rappel, la Commission européenne avait validé, le 12 décembre dernier, les dispositifs de soutien à l’éolien terrestre pour 2016, aux petites installations hydroélectriques, à la géothermie et à la méthanisation. 2018 verra la mise en service d’une ferme de 39 hydroliennes immergées dans un fleuve, une « première mondiale » par son ampleur, indiquent dans un communiqué diffusé le 9 février la Compagnie nationale du Rhône (CNR), le fabricant grenoblois d’hydroliennes HydroQuest et l’entreprise de construction navale CMN (Constructions mécaniques de Normandie), partenaires sur ce projet. D’un budget global de 12 millions d’euros, cette ferme intervient dans le cadre d’un appel à projets lancé en août 2015 par l’Ademe. Les 39 hydroliennes seront immergées à l’aval de Génissiat (Ain) sur un site du Haut-Rhône proche de la frontière suisse, dans un secteur « très encaissé », où le courant du fleuve est important, précisent les trois partenaires. Totalisant plus de 2 MW de puissance installée, elles seront fixées par groupes de trois « sur un linéaire de deux kilomètres » et pourront produire 6 700 MWh en moyenne à l’année. Ce projet « permettra de valider la viabilité technico-économique de cette récente et innovante technologie de production d’énergie renouvelable », explique Ahmed Khaladi, chef de projet chez CNR, cité dans le communiqué. Si la plupart des pays d’Afrique subsaharienne ont fait des progrès pour développer un cadre réglementaire et légal permettant la diffusion des énergies renouvelables, cette zone où vit plus d’un demi-milliard de personnes sans accès à l’électricité est en retard sur le reste du monde en matière de politiques encourageant le recours à ce type d’énergie. C’est ce qui ressort d’un rapport de la Banque mondiale couvrant 111 pays abritant 96 % de la population mondiale, publié ce mercredi 15 février et mentionné par l’AFP. Selon la Banque mondiale, plus de 80 % des pays du rapport ont mis en place des politiques visant à fournir de l’électricité provenant du solaire et de l’éolien tout en évitant une forte hausse des prix et plus d’un tiers des pays considérés sont à un stade avancé dans ce domaine, y compris des pays en voie de développement comme le Vietnam. « Dans l’ensemble, les pays africains ont un score très bas pour ce qui est des politiques environnementales favorisant l’accès à l’énergie », souligne Vivien Foster, responsable de la BM pour l’énergie et les industries extractives, cité par l’AFP. « Jusqu’à 40 % d’entre eux sont dans la zone rouge, ce qui veut dire qu’ils ont à peine commencé à prendre des mesures pour accélérer l’accès à l’énergie », ajoute-t-elle. Mais certains obtiennent de meilleures notes comme le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et d’autres se classent honorablement comme l’Afrique du sud, le Maroc et la Tunisie. Ce rapport sera revu tous les deux ans et doit constituer un moyen pour les différents pays de comparer leurs politiques au niveau régional et mondial. Dong Energy, premier producteur d’électricité éolienne en Europe, a annoncé le 2 février qu’il se retirait du charbon d’ici 2023. Conforté par de bons résultats, avec une hausse de son chiffre d’affaires de 36 % dans la production d’électricité éolienne en 2016, le groupe danois avait, en octobre, décidé de sortir de la production de pétrole et de gaz, et fait, avec cette annonce, un pas de plus vers une stratégie totalement renouvelable. « L’avenir est dans les sources d’énergie renouvelables et nous transformons donc les dernières de nos centrales au charbon en centrales utilisant de la biomasse durable », a expliqué le directeur général Henrik Poulsen dans un communiqué. Introduit en Bourse en juin, le groupe, qui appartient à 50,1 % à l’État, avait signalé aux investisseurs qu’il ne voyait pas la production d’hydrocarbures comme une activité stratégique. Il concentre aujourd’hui la grande majorité de ses investissements dans l’éolien. La société de biochimie Global Bioenergies a annoncé, le 2 février, avoir mis la main sur la start-up néerlandaise de biologie industrielle Syngip. Cette acquisition doit lui permettre d’accélérer le développement de son procédé isobutène. L’opération, « est au cœur de la stratégie affichée par Global Bioenergies de diversifier les ressources utilisables dans son procédé isobutène », explique l’entreprise dans un communiqué. Syngip développe un procédé pour convertir les ressources carbonées gazeuses, comme le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone ou des rejets industriels, en composés chimiques d’intérêt industriel. Un procédé concurrentiel dès 45 dollars le baril de pétrole, voire moins compte tenu des incitations fiscales pour les carburants renouvelables, selon Global Bioenergies. Ségolène Royal a annoncé hier, mardi 7 février, avoir transmis à la Commission européenne le cadre d’action français pour le développement des carburants alternatif. Ce plan, basé sur la stratégie nationale de la mobilité propre, définit pour 2020 et pour 2025 des objectifs de déploiement de points de recharge électrique, de ravitaillement en gaz (GNV, bioGNV) et de ravitaillement en hydrogène. La mise en œuvre de l’ensemble des cadres d’action nationaux prévus par la directive européenne 2014/94 devrait permettre aux usagers utilisant des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs de pouvoir circuler en Europe, en ayant l’assurance de pouvoir trouver, le long des grands corridors européens, les points de ravitaillement nécessaires. La Commission européenne a dévoilé ce mercredi 1er février le deuxième rapport sur l’état de l’Union de l’énergie et il est encourageant. « L’Europe est en passe d’atteindre ses objectifs pour 2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et la production d’énergie de sources renouvelables », se félicite en effet la Commission dans ce document examinant les progrès accomplis depuis la publication du premier rapport en novembre 2015. La part croissante des renouvelables dans la production d’énergie de l’Union européenne doit permettre à l’Europe de réaliser ses objectifs, selon le rapport, qui souligne toutefois la nécessité de maintenir les efforts. Pour Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, et cité dans un communiqué, « l’Europe poursuit sa transition vers une énergie propre. Il n’existe pas d’alternative. Et les faits parlent d’eux-mêmes : les énergies de sources renouvelables sont aujourd’hui compétitives et parfois moins coûteuses que les combustibles fossiles, leur production emploie plus d’un million de personnes en Europe, attire davantage d’investissements que de nombreux autres secteurs, et ont permis de réduire notre facture d’importation de combustibles fossiles de 16 milliards d’euros. » Pour faire suite à la modification du mécanisme de soutien à l’éolien terrestre, Ségolène Royal a annoncé hier, mardi 31 janvier, avoir soumis à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et à la Commission européenne un projet d’appel d’offres visant à développer les installations éoliennes terrestres de plus de six éoliennes. Il prévoit d’attribuer 3 GW d’éolien terrestre et s’étalera sur trois ans avec deux périodes de candidature par an, une unique période étant prévue pour 2017, précise un communiqué du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. « Les lauréats de l’appel d’offres, dont la date de la première période de candidature est prévue début novembre, se verront attribuer un contrat de complément de rémunération sur vingt ans », est-il ajouté. Par ailleurs, un deuxième appel d’offres pourrait être lancé afin de favoriser le développement de projets d’autoconsommation électrique, a indiqué Laurent Michel le même jour, à l’occasion du colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables. Le directeur général de l’énergie et du climat a indiqué que cet appel d’offres serait triennal. Engie a annoncé le 27 janvier avoir bouclé le financement de la première phase du projet géothermique Muara Laboh, situé en Indonésie et présenté comme sa toute première centrale de production d’électricité à partir de géothermie haute température. Le groupe énergétique français opère pour ce projet au sein du consortium PT Supreme Energy Muara Laboh, formé également de la société japonaise de trading et d’investissement Sumitomo Corporation et du développeur indonésien de projets d’électricité géothermique PT Supreme Energy. « L’accord de financement portant sur un montant de 440 millions de dollars a été signé par le consortium » avec plusieurs banques, précise un communiqué qui ajoute que la construction de la centrale commencera dans le courant de cette année et durera 30 mois. La première phase du projet, dont la mise en service est prévue en 2019, permettra de générer 80 MW d’électricité sans émission de CO2, soit l’équivalent de la consommation en énergie de près de 120 000 foyers. L’Indonésie dispose de près de 40 % des réserves géothermiques mondiales, soit un potentiel estimé à 28 000 MW, selon l’énergéticien. Le scénario négaWatt s’offre une quatrième édition, 2017-2050. Depuis la publication du premier en 2003 et des suivants en 2006 et 2011, le contexte économique, technologique et énergétique a fortement évolué. L’association qui entend démontrer qu’un autre avenir énergétique est possible se réjouit que « la France soit désormais engagée dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique ». Elle regrette cependant que « l’action reste insuffisante et rencontre de nombreuses résistances ». Au rayon des bonnes nouvelles, ce nouveau scénario indique que la courbe de la consommation d’énergie s’est inversée et qu’il est désormais confirmé qu’il est possible de couvrir la totalité des besoins énergétiques de la France par des sources renouvelables (grâce à, dans l’ordre, la biomasse solide, l’éolien, le photovoltaïque et le biogaz). Cela entraînerait des bénéfices multiples pour la santé et l’environnement, mais aussi pour l’économie et l’emploi. Mais attention, ont prévenu les auteurs du scénario lors d’une conférence de presse ce mercredi 25 janvier, « il n’y a plus de temps à perdre. Dans l’immédiat, nous n’avons pas besoin de nouvelle loi, mais de l’application de la Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte. Son rythme d’application actuel est largement insuffisant, notamment pour la rénovation des bâtiments. » Et d’ajouter que si « le combat pour le climat n’est pas encore perdu, chaque année qui passe obère un peu plus notre avenir énergétique. » « Les progrès technologiques et l’industrialisation des énergies renouvelables ont permis en France une baisse des coûts qui amènent les filières les plus matures à des niveaux compétitifs avec les technologies conventionnelles, constate l’Ademe dans sa nouvelle édition de son étude Coût des énergies renouvelables en France. Il existe encore des marges de progrès importantes pour la plupart des filières », ajoute l’agence. Elle classe ainsi les énergies renouvelables en fonction de leur niveau de compétitivité vis-à-vis des moyens conventionnels. Sans surprise, l’éolien terrestre ressort en tête, talonné par le photovoltaïque, au « potentiel d’innovation très important sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets ». L’Ademe met également en avant les solutions bois énergie chez les particuliers et souligne le « potentiel très important » de l’alimentation en chaleur des bâtiments collectifs, des industriels ou des réseaux de chaleur par les énergies renouvelables. « Certaines des filières les moins matures aujourd’hui ont des gisements inexploités significatifs et verront leur coût d’investissement et leur taux d’actualisation diminuer avec leur développement », avance également l’étude. À l’occasion du Salon Biogaz Europe qui s’est ouvert ce mercredi 25 janvier à Rennes, Ségolène Royal a annoncé l’extension de la durée des contrats d’achat de l’électricité dont bénéficient les installations existantes de méthanisation, de 15 ans à 20 ans. La ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer explique avoir soumis à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un projet d’arrêté étendant de 15 ans à 20 ans la durée de ces contrats d’achat. Pour répondre à la nécessité de mieux encadrer les conditions de cette extension (une demande de la CRE), le bénéfice du contrat sera par ailleurs limité au-delà de la quinzième année : à 7 500 heures par an pour les installations de moins de 250 kWe – à 6 500 heures par an pour les installations entre 250 et 500 kWe – à 5 500 heures par an pour les installations de plus de 500 kWe. Dans un contexte législatif et politique favorable à une production décentralisée de l’énergie, les projets d’énergies renouvelables participatifs et citoyens constituent aujourd’hui un levier essentiel pour porter la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d’électricité en 2030. Tel est le constat porté par l’Ademe, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et l’association Energie Partagée qui publient ensemble un nouveau guide pratique pour les collectivités territoriales. Celui-ci propose une méthodologie basée sur des retours d’expériences de pratiques concrètes : un rappel des spécificités des projets de territoire – une présentation des évolutions législatives – des leviers d’actions précis et concrets à destination des collectivités – des opportunités à saisir par les associations locales et les collectifs de citoyens pour solliciter leurs collectivités locales – des témoignages qui présentent les difficultés et les opportunités suscitées par ces projets – des outils et documents complémentaires à consulter. 17 grands groupes industriels européens et asiatiques ont annoncé hier mardi 17 janvier à Davos la création d’un Conseil de l’hydrogène. Ces entreprises de l’énergie, des transports et de l’industrie entendent lancer « une initiative globale pour partager leurs vision et ambition pour l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique », peut-on lire dans un communiqué publié par l’ensemble des partenaires. Ses membres assurent de leur « volonté d’intensifier leurs investissements dans le développement et la commercialisation de l’hydrogène et des piles à combustible » et chiffre à 1,4 Md€ par an leurs investissements actuels dans la filière. « Cette accélération sera rendue possible par un soutien renforcé des décideurs au rôle de l’hydrogène dans le futur mix énergétique, notamment via les politiques publiques et programmes appropriés », défendent-ils. Les treize membres de ce conseil sont Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW, Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Kawasaki, Shell, Linde, Total et Toyota. La France « a mis en marche des réformes majeures » en faveur d’un modèle énergétique durable et d’une économie plus sobre, souligne l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans un rapport publié hier mardi 17 janvier, sept ans après la précédente édition. « La France est l’un des fers de lance de l’AIE en termes de mix énergétique sobre en carbone : en 2015, seuls 47 % de son énergie étaient issus de combustions fossiles », peut-on encore y lire. Et d’affirmer que « la France a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue ». L’agence distribue ainsi les bons points au pays pour son « cadre politique ambitieux », sa stratégie bas carbone, sa feuille de route énergétique jusqu’à 2023 et la fermeture de 3,3 GW de centrales à charbon depuis 2012. L’AIE souligne également l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale totale d’énergie, mais met en garde : « il lui reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre son objectif de 23 % en 2020 ». La France manque surtout « de visibilité à long terme » sur le financement des mesures annoncées, juge l’agence, assurant qu’elle « devra mobiliser des investissements significatifs afin d’augmenter la part des énergies renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique, de fermer ou prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires ». Si la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique s’élève aujourd’hui à 18 %, elle devrait doubler d’ici 2030 pour limiter la hausse des températures à 2 °C, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). Alors qu’elle tenait ce week-end son assemblée annuelle à son siège d’Abou Dhabi, l’Irena a dénoncé le niveau des investissements dans les énergies renouvelables, insuffisant pour limiter la hausse des températures à 2 °C. Pourtant, les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique pourraient réduire de moitié les émissions de CO2 et de respecter l’objectif de 2 °C, note le rapport. Il chiffre, pour cela, les besoins en investissements dans les énergies renouvelables à environ 900 milliards de dollars par an entre 2016 et 2030, contre quelque 305 milliards de dollars en 2015. Le solaire est l’énergie mise en avant dans le rapport qui indique que le coût des panneaux solaires « a baissé de moitié depuis 2010 et devrait baisser encore de 60 % dans les dix prochaines années ». La filière du solaire thermique voit-elle enfin le bout du tunnel ? Après quatre ans de débats et de procédures autour de la prise en compte des performances énergétiques du solaire thermique dans la réglementation thermique (RT) 2012, le feuilleton pourrait se conclure favorablement. « Suite à la parution, le 4 novembre dernier, du décret modifiant les modalités de prise en compte des boucles d’eau et des systèmes solaires thermiques dans la RT 2012, le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) » a confirmé la revalorisation du solaire thermique dans le moteur de calcul RT 2012, indique la plateforme Socol (initiative d’Enerplan). Cet outil de paramétrage utilisé par les bureaux d’étude pour toute construction se basait jusqu’alors sur des performances pour le solaire thermique sous-évaluées de 20 à 30 %, selon les professionnels du secteur. Cela handicapait le développement de la filière dans le neuf. 2017 s’ouvre donc sur une bonne note. Présents ou non lors du dernier salon Energaïa qui s’est déroulé à Montpellier en décembre dernier, retrouvez grâce à une vidéo accessible en ligne la conférence de présentation du livre Architecture solaire architecture d’aujourd’hui (ASAA). L’occasion d’apercevoir quelques projets parmi les 39 bâtiments émérites sélectionnés, mais aussi d’entendre le témoignage et l’expertise de l’Ademe, d’Engie et d’EDF, partenaires de cet ouvrage édité par Observ’ER. Cet aperçu des initiatives vertueuses en France métropolitaine et ultramarine montre la capacité de l’architecture bioclimatique à concilier parti pris architectural fort, contraintes écologiques et maîtrise des coûts, notamment grâce aux énergies renouvelables. Ce livre est une initiation à l’architecture bioclimatique indispensable à ceux qui souhaitent découvrir l’univers de l’écohabitat et à ceux qui voudraient franchir le pas de la construction. L’Ademe Île-de-France et la Région se sont associées pour lancer deux nouvelles sessions des appels à projets sur le solaire thermique et sur les pompes à chaleur, ont annoncé les deux partenaires le 9 janvier. Sont concernés les maîtres d’ouvrages publics et privés qui « souhaitent bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour développer une installation de chaleur renouvelable performante ». Pour le solaire thermique, il s’agit de la septième session de cet appel à projets, et de la huitième s’agissant des pompes à chaleur. Un comptage énergétique précis devra être mis en place par les lauréats, qui devront fournir à la direction régionale de l’Ademe les relevés de production d’énergie durant la première année de fonctionnement, est-il précisé. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 29 décembre 2017. Les modalités de l’appel à projets et le dossier de candidature sont disponibles en ligne, ainsi que la plateforme destinée à recueillir les candidatures. C’est aujourd’hui la sortie nationale du film Power To Change : la rébellion énergétique. Véritable plaidoyer pour une mise en œuvre rapide de la transition énergétique, Power to Change, dont votre journal est partenaire, suit les pionniers qui, par leurs actions locales, y contribuent. Il nous montre ainsi que chacun d’entre nous, à son échelle, peut devenir un “rebelle énergétique”. De nombreuses projections-débats sont programmées à l’Espace Saint-Michel, à Paris (5e arrondissement), mais aussi à travers toute la France. Carcassonne, Colmar, Meymac, Palaiseau ou encore Lattes sont quelques-unes des villes qui accueilleront une discussion autour du film. La liste complète des projections et des débats organisés autour du film est à retrouver sur son site Internet. Initiative annoncée en avril 2016 par le président de la République, la première obligation verte (ou green bond) souveraine française est sur le point de voir le jour. La France a ainsi lancé le processus pour son émission, ont annoncé hier mardi 3 janvier les ministres des Finances Michel Sapin et de l’Environnement Ségolène Royal. Si le montant que l’État français souhaite lever n’a pas été précisé, « l’Agence France Trésor (AFT) et les équipes chargées de cette opération vont faire un tour auprès des investisseurs internationaux pour présenter ce projet en vue de l’émission de cette obligation verte cette année », a indiqué Michel Sapin lors d’une conférence de presse. Les fonds levés serviront à financer des investissements dans quatre domaines, notamment via le Programme d’investissement d’avenir, ont précisé les deux ministres. La lutte et l’adaptation contre le réchauffement climatique, la protection de la diversité et la lutte contre la pollution sont ainsi concernées contrairement aux énergies renouvelables (hors innovation), lesquelles ne seront pas éligibles, « étant donné l’existence d’autres moyens de soutien public ». La France sera en tout cas le deuxième pays à lancer ce type d’opération, après la Pologne qui a émis 750 millions d’euros en décembre. Les énergies renouvelables ont fourni 98,1 % de l’électricité au Costa Rica en 2016, selon l’Institut costaricain d’électricité (ICE). Principale source utilisée : la grande hydraulique alimentée par les nombreuses rivières du pays et des périodes de pluie très intenses, suivie par la géothermie et l’éolien. Le solaire et la biomasse restent encore des énergies marginales même si elles sont en plein développement. Les énergies fossiles n’ont, elles, compté que pour 1,9 % de la fourniture d’électricité de ce pays de 5 millions d’habitants. Le Costa Rica fait figure de modèle en la matière. L’an dernier déjà, son électricité avait été fournie à 98,9 % par des énergies renouvelables. Et le pays ne compte pas arrêter d’investir dans les énergies vertes puisqu’en mars 2016, il a accueilli la plus grande centrale géothermique d’Amérique centrale. L’Algérie lancera en 2017 un appel d’offres « national et international » pour 4 GW d’électricité renouvelable, a indiqué l’agence de presse algérienne APS en fin d’année 2016. Le ministre de l’Énergie, Bouterfa Nourredine, précise que cet appel d’offres exigerait de l’investisseur de « fabriquer localement une partie des éléments du dispositif transformant l’énergie renouvelable en énergie électrique, à l’instar des panneaux solaires ». Cet appel d’offres en projet s’inscrit dans le programme national de développement des énergies renouvelables, qui vise à produire 22 GW d’ici 2030, afin de porter la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables à plus de 27 % de la production nationale. Pour rappel, l’Algérie dispose actuellement d’une capacité de production d’électricité renouvelable de 400 MW. Dans un petit village isolé et enclavé, une coupure d’électricité peut avoir de graves conséquences. À Pinsot, village de 140 âmes en Isère, à quelque 700 mètres d’altitude, l’histoire est heureuse. Lorsqu’un dimanche de fin novembre, un bûcheron abat, malencontreusement, un arbre sur un pylône électrique, la vallée du Breda se retrouve sans électricité. Diagnostic : trois semaines de travaux sont nécessaires ! Mais grâce à la société Asco Énergie, qui gère une partie du réseau et produit de l’électricité à partir de quatre centrales hydroélectriques, le village est rapidement approvisionné en électricité renouvelable. Le réseau de la vallée du Breda est alimenté en circuit fermé, exclusivement par la centrale hydroélectrique de Veyton. Pour Frank Adisson, président d’Asco Énergie c’est une prouesse technique. « Sur un petit réseau, la fréquence oscille en fonction des besoins de la vallée. Les équipes parviennent à la réguler en adaptant la puissance de la centrale. » La société Asco Énergie est une filiale de l’entreprise Nouvelles Énergies Hydrauliques. Cette dernière, spécialisée dans l’hydroélectricité, possède 18 centrales hydroélectriques dans les Alpes (70 MW installés). Elle produit chaque année 300 GWh, soit la consommation d’environ 300 000 personnes. Une nouvelle centrale est en projet pour le printemps, à La Combe de Lancey (Isère). Placée proche d’un lac, la turbine de 1,5 MW, s’intégrera entre deux autres centrales hydroélectriques. Envinergy, en partenariat avec la fédération électricité autonome française (EAF) et France Hydro Électricité (FHE), organise ”Les Trophées de la Petite Hydro”. Les propriétaires de centrales hydroélectriques d’une puissance inférieure à 4 500 kW sont ainsi invités à concourir dans trois catégories : Patrimoine, Performance et Environnement. Les candidatures sont à envoyer, par mail ou par courrier, à partir de demain jeudi 15 décembre et jusqu’au 15 avril 2017. Le jury, présidé par Anne Penalba, présidente du syndicat national France Hydro Électricité, est composé de neuf professionnels reconnus du monde de l’hydroélectricité. La remise des trophées se tiendra le 29 juin 2017 à Toulouse à l’occasion des 9e Rencontres France Hydro Électricité. Les prix sont constitués d’un shooting photo professionnel, d’images aériennes par drone, d’un reportage publié dans diverses revues spécialisées et de la participation à un ouvrage à paraître. Avant sa sortie nationale le 11 janvier 2017, le film « Power To Change : la rébellion énergétique » s’offre une avant-première parisienne dimanche 18 décembre (à 15 h). Ce documentaire, dont votre Journal est partenaire, est en effet proposé dans le cadre des “Dimanches de la Connaissance” au Publicis Cinémas (Paris 8e). Cette avant-première parisienne sera suivie d’un débat avec Carl-A. Fechner, réalisateur du film, et Richard Loyen, délégué général du syndicat des professionnels de l’énergie solaire Enerplan. Véritable plaidoyer pour une mise en œuvre rapide de la transition énergétique, Power to Change suit les pionniers qui, par leurs actions locales, y contribuent. Il nous montre ainsi que chacun d’entre nous, à son échelle, peut devenir un “rebelle énergétique”. En raison des fêtes de fin d’année, L’Actu EnR fait une petite pause et reviendra mercredi 4 janvier. Toute l’équipe du Journal des Énergies Renouvelables et d’Observ’ER souhaite de très joyeuses fêtes aux lecteurs de L’Actu et leur donne rendez-vous en 2017 pour une année encore plus renouvelable ! Le biométhane se développe à vitesse grand V. En 2016, le nombre de sites d’injection, tous opérateurs confondus, est passé de 17 à 24, dont 20 sur le réseau de distribution de gaz. La clé de cette réussite ? Des retours d’expérience positifs. À l’occasion des Rencontres biométhane (Bretagne — Pays de la Loire), à Nantes le 1er décembre, GRDF a présenté, pour la première fois, les retours d’expérience de 11 sites étudiés depuis un an. La grande majorité d’entre eux fonctionne bien : la quantité annuelle d’énergie injectée pour 10 des 11 sites se situe entre 90 et 104 % du débit maximal théorique. Parmi les 16 sites agricoles mis en service avant 2016, 80 % ont demandé une augmentation de capacité, de 15 à 40 %. Du côté de l’épuration (du biogaz pour obtenir le biométhane), l’offre s’est diversifiée très rapidement. On trouve aujourd’hui des techniques d’adsorption, de séparation membranaire, et bientôt de cryogénie, avec une multitude d’acteurs : Verdemobil, Carbotech, Greenlane, Chaumeca, Air liquide, Biogast, Prodeval… « Toutes les techniques conçues par tous les industriels en service aujourd’hui donnent satisfaction. C’est une belle preuve du dynamisme de la filière », souligne Michel Kersach, responsable des projets biométhane pour GRDF Pays de la Loire. De nouveaux acteurs vont encore arriver sur le marché. Suez vient d’annoncer qu’il équiperait trois sites de stockage de déchets de “Waga Box”, une nouvelle technique d’épuration qui associe une séparation membranaire et la distillation cryogénique. Grâce à ces retours d’expérience positifs, GRDF devrait assouplir ses procédures, notamment lors des contrôles de conformité. Il y a deux mois, le ministère de l’Environnement a lancé le deuxième appel à projets “Green Tech verte – Jeunes Pousses”. Son but : soutenir des start-up qui, grâce à leurs innovations dans le domaine du numérique, favoriseront la transition énergétique. 51 lauréats viennent d’être sélectionnés, dont plus d’une dizaine traitent des énergies renouvelables et de la gestion de l’énergie. Parmi ceux-ci : Ilek (plateforme pour accéder à l’électricité 100 % renouvelable, Elum Energy (gestion intelligente de l’énergie verte dans les bâtiments), Fourmilière lumineuse (lampadaires solaires interconnectés), upOwa (fourniture d’énergie en Afrique grâce à un kit solaire), etc. Elles bénéficieront d’un accompagnement financier et technique et d’une aide à la valorisation économique de leurs résultats. L’Ademe en a fait le constat : « Certaines technologies de production de chaleur à partir de sources renouvelables ou de récupération (solaire, géothermie, bois énergie, chaleur fatale de process, etc.) restent non éligibles au Fonds chaleur par manque notamment de retours d’expérience suffisants sur leurs performances réelles in situ. » Pour remédier à cette situation, l’Agence a créé en 2013 l’appel à projets “Nouvelles Technologies émergentes”. L’édition 2017 de celui-ci vient d’être lancée et vise à accompagner des « opérations pilotes monitorées de manière détaillée dans la perspective de bénéficier d’analyses fines et consolidées pour progresser sur la connaissance de ces technologies en devenir ». Les dossiers doivent être déposés avant le 1er février 2017. Cela devrait être le premier site de biogaz porté en France. MéthaBraye, un projet de méthanisation porté par 34 agriculteurs, entre dans sa phase de travaux. Situé dans le nord du Loir-et-Cher, à Savigny-sur-Braye, le projet possède la particularité de produire du biogaz sur un site, et de l’injecter dans le réseau du gaz (GRDF) à 16 km plus loin, à côté de Vendôme. « La commune de Savigny est raccordée au réseau mais n’aurait pas pu absorber toute la production. C’était plus facile de transporter du gaz à 16 km, plutôt que d’installer le méthaniseur proche d’une ville et de transporter du fumier et du lisier », explique Delphine Descamps, éleveuse, en charge du projet. « Depuis quatre ans, nous y travaillons. C’est long, pourtant, nous n’avons pas perdu de temps ». À partir de l’automne prochain, le digesteur, construit par Naskéo, sera alimenté par 30 000 tonnes de biomasse, des effluents d’élevage en majorité. Le débit de production de biométhane sera de 148 Nm³/h. Après avoir été épuré, le biométhane sera liquéfié par cryogénisation. Les éleveurs et Verdemobile ont préféré cette technique à la compression car elle permet de réduire le volume de gaz d’un facteur de 600. Trois aller-retours de camions sont prévus par semaine entre les deux sites, contre un voyage quotidien avec la compression. ?Le biogaz alimentera une zone d’activités qui aujourd’hui n’est pas reliée au réseau. « La communauté du Pays de Vendôme nous a proposé un terrain et GRDF nous a proposé d’étendre son réseau à notre charge. Méthabraye est un projet de territoire, avec l’implication de nombreux acteurs », ajoute Delphine Descamps, qui chiffre le projet à 6,8 millions d’euros. En plus de permettre des projets partout sur le territoire, le portage permet de répondre aux besoins du réseau de gaz. Le biométhane est regazéifié en fonction de la demande. Un atout majeur pour la production de biogaz. La Commission européenne a présenté ce mercredi son paquet hiver, l’arsenal législatif censé mettre en œuvre les objectifs fixés à l’horizon 2030 par les États membres. Très attendue depuis plusieurs mois, la révision de pas moins de huit législations communautaires (1 000 pages) constitue la traduction législative des objectifs fixés à l’horizon 2030 par les États membres en 2014, un an et demi avant la COP21, et donc l’Accord de Paris. Rare entité à se réjouir de cette publication, la fédération européenne du solaire thermique (ESTIF, selon son acronyme anglais) accueille favorablement le nouvel objectif de chaleur renouvelable établie par la proposition de nouvelle directive sur les énergies renouvelables. Elle dénonce dans le même temps « plusieurs incohérences dans le paquet hiver et le faible niveau général d’ambition en faveur du secteur des énergies renouvelables. » Nombreux sont les détracteurs de ce paquet. Ils dénoncent des lacunes sur l’ensemble des domaines concernés : développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique et gouvernance du secteur de l’énergie. Dans un document commun le CLER Réseau pour la transition énergétique, France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot (FNH), le Réseau Action Climat (RAC) et le WWF, dénoncent, entre autres, l’objectif de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie par rapport à 1990. « Avec cet objectif, le rythme de développement des renouvelables dans la prochaine décennie serait la moitié du rythme annuel », précisent les ONG pour qui, afin de continuer au même pas, les renouvelables devraient représenter en 2030 45 % du mix. Deux projets de fermes hydroliennes pilotes dans le Raz Blanchard, au large de la pointe nord-ouest du Cotentin, ont obtenu l’avis favorable des commissions d’enquête publique, a annoncé le 24 novembre la préfecture de la Manche. Mené par EDF et DCNS, Normandie Hydro prévoit, selon le rapport d’enquête, 7 hydroliennes de 16 mètres de diamètre, à 3,5 km de Goury (Manche), à une trentaine de mètres de profondeur, sur une surface de 28 hectares. Son coût est de 112 millions d’euros. Selon la commission, les hydroliennes de ce projet ont l’avantage de ne pas avoir d’impact visuel négatif, d’être implantées sur des courants marins prévisibles et de ne produire ni CO2, ni déchets. Côté inconvénients, cette même commission pointe, entre autres, le recours périodique aux peintures antisalissures biocides et au relargage d’aluminium ainsi que la création éventuelle de zones de turbulences susceptibles d’influer sur la faune et la flore. L’autre projet, baptisé Nepthyd, porté par Engie et Enedis avec Alstom, prévoit 4 hydroliennes de 18 mètres de diamètre sur 17 hectares, non loin de Normandie Hydro. Il prévoit de son côté de tester des peintures sans biocides. Selon un commissaire enquêteur, cité par l’AFP, EDF espère démarrer les travaux en 2017 et Engie en 2018. Les industriels évaluent à deux ans environ la durée des travaux, selon la même source. Dans un avis publié lundi 21 novembre, l’Ademe affirme que la méthanisation est « une voie d’avenir aux bénéfices multiples ». L’agence établit une liste de recommandations pour encourager le déploiement des méthaniseurs : injection du biométhane dans le réseau, contractualisation des approvisionnements, maximisation de la valorisation énergétique ou non-concurrence entre les projets, par exemple. Alors qu’il y a deux ans, plusieurs études (Association des agriculteurs méthaniseurs de France, Biomasse Normandie pour l’Ademe) pointaient du doigt le difficile équilibre financier du biogaz, l’Ademe juge aujourd’hui la rentabilité des installations « satisfaisante ». « Les retours d’expérience de 80 installations en fonctionnement (intégrant l’augmentation du tarif d’achat électrique de 2015) montrent que, dans la très grande majorité des cas, la rentabilité économique est satisfaisante, en particulier pour les projets à la ferme ou de petits collectifs (moins d’une dizaine d’agriculteurs) ». L’agence met cependant le doigt sur la nécessité d’aides publiques (dispositif de soutien aux investissements ou à l’énergie produite, garantie d’origine…) pour assurer la concrétisation des projets. Elle recommande que les « dispositifs soient les plus stables possibles pour assurer une bonne visibilité aux porteurs de projets comme aux financeurs ». Encore faut-il que les nouveaux tarifs d’achat soient publiés ! L’université de technologie de Lappeenranta (LUT), en Finlande, a dévoilé un modèle montrant comment un système électrique principalement basé sur le solaire et l’éolien pouvait fonctionner, et ce, dans toutes les régions du monde. Baptisé Internet Energy Model, le modèle met en lumière un système électrique 100 % renouvelable à horizon 2030, en ligne avec l’objectif de l’Accord de Paris. Pour ce faire, la LUT a divisé la planète en 145 régions, regroupées en 9 régions principales. « Avec cette simulation, tout un chacun peut explorer ce à quoi ressemblerait un système électrique renouvelable », explique Christian Breyer, professeur à la LUT et coordinateur du projet. Et d’ajouter : « C’est la première fois que des scientifiques ont été capables de réaliser cela à l’échelle mondiale. » Les États membres du « Climate Vulnerable Forum » (CVF), qui réunit près de cinquante pays du sud particulièrement vulnérables au changement climatique, se sont engagés le 18 novembre à Marrakech, au dernier jour de la COP22, à mettre fin aux énergies fossiles et à atteindre 100 % d’énergie renouvelable « le plus rapidement possible », soit au plus tard entre 2030 et 2050. Ces pays d’Afrique, Asie, des Caraïbes, d’Amérique latine et du Pacifique se sont également engagés à préparer des stratégies à long terme, c’est-à-dire à l’horizon 2050, de développement bas carbone. De même, ils vont revoir « le plus vite possible avant 2020 » leur contribution nationale en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, prévue dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Affirmant que « l’action climatique ne limite pas le développement, elle le renforce », l’ensemble des pays membres du CVF se sont engagés à prendre des actions pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C maximum par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’Accord de Paris. Une dizaine d’entreprises adhérentes du pôle de compétitivité S2E2, le cluster Smart Electricity, présente aujourd’hui, à Nantes, ses nouveautés aux professionnels du stockage de l’énergie. Parmi les entreprises, on trouve Powidian. La start-up tourangelle, d’à peine deux ans et née d’un essaimage d’Airbus, a mis au point la solution Sages (Smart Autonomous Green Energy Station), une station de stockage d’électricité grâce à l’hydrogène. L’énergie, issue des panneaux solaires, alimente des batteries court terme et un stockage long terme, avec un électrolyseur produisant, à partir d’eau, de l’hydrogène stocké dans des réservoirs. Sages est utilisé depuis un an dans un refuge du parc national de la Vanoise et en cours d’installation dans le village de Mafate à la Réunion. Peu à peu, les usages se diversifient vers les écoquartiers, le résidentiel ou le commerce. « Les promoteurs de bâtiments à énergie positive préfèrent stocker l’énergie produite plutôt que consommer celle du réseau, et ainsi diminuer le coût de l’abonnement, explique Sylvain Charrier, directeur du développement commercial chez Powidian. Économiquement, la solution hydrogène est avantageuse. » La start-up est en relation avec le ministère de la Défense, un groupe de luxe, les magasins Carrefour… Cette entreprise de 16 salariés n’a pas fini de faire parler d’elle. La start-up toulousaine Ilek lance une offre originale permettant de consommer l’électricité renouvelable produite localement. Ce nouvel agrégateur a ouvert une plateforme d’achat et de vente pour permettre aux consommateurs de choisir la centrale (hydraulique, solaire ou éolienne) dont ils achèteront l’électricité. Ilek s’appuie pour cela sur les garanties d’origine. Sortant la fourniture d’électricité de l’anonymat, la société compare son offre au modèle des AMAP dans le domaine agricole : permettre de mieux rémunérer les producteurs grâce à la vente directe. Le prix proposé aux clients pourrait être jusqu’à 10 % moins cher que le prix du kWh réglementé, assure la société. Pour le moment, le site ne recense que deux producteurs d’hydroélectricité situés en Occitanie, mais la liste devrait s’étendre au solaire et à l’éolien et aux autres régions françaises. La Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) a lancé une campagne de crowdfunding dans le cadre de son projet Micrésol au Burkina Faso. Objectif : récolter 10 000 euros pour équiper 30 entrepreneurs burkinabés avec des kits solaires (panneaux solaires, lampes, batteries, régulateurs, onduleurs…), qui pourraient profiter à 5 000 personnes. Dans la pratique, une fois le matériel solaire disponible, les bénéficiaires pourront obtenir un micro-crédit distribué par le Réseau des Caisses Populaires du Burkina, qui porte sur l’installation et la maintenance du kit solaire pendant toute la durée du remboursement. Depuis le lancement de Micrésol en 2011, plus de 900 kits solaires, pour près de 10 000 utilisateurs, ont déjà été achetés. L’élection de Donald Trump n’a pas tardé à faire réagir à Marrakech où se déroule la COP22 depuis le 7 novembre. La ministre de l’Environnement Ségolène Royal a ainsi estimé que l’arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche n’empêchera pas la mise en œuvre de l’Accord de Paris adopté lors de la COP21 en décembre 2015, malgré des déclarations faites en ce sens par le candidat républicain pendant sa campagne. En effet, Donald Trump avait annoncé son intention d’annuler le traité, expliquant qu’il n’en était pas un grand fan. Il avait également qualifié le réchauffement climatique de canular total. « À l’heure où je vous parle, 103 pays représentant 70 % des émissions de gaz à effet de serre ont ratifié le texte. Donald Trump ne peut pas, contrairement à ce qu’il a dit, le dénoncer », a affirmé sur RTL la ministre française de l’Environnement qui a présidé les négociations internationales sur le climat jusqu’à l’ouverture de cette nouvelle conférence. « L’Accord de Paris dit lui-même que, pendant trois ans, on ne peut pas en sortir », a-t-elle ajouté, alors que l’accord est entré en vigueur le 4 novembre. Fournir des recommandations pour élaborer des bâtiments smart grids ready, voici l’objectif du guide publié par le Club Smart Grids Côte d’Azur et impulsé par la CCI Nice Côte d’Azur. Pour la première fois en France, ce guide décrit les fonctionnalités nécessaires aux bâtiments pour accéder aux réseaux intelligents. Pédagogique et technique, il peut servir aux collectivités et aux différents acteurs de l’aménagement urbain (énergéticiens, promoteurs immobiliers, bureaux d’études…). Ses recommandations concernent prioritairement les bâtiments tertiaires neufs, mais peuvent également s’appliquer à la rénovation et au secteur résidentiel. Le Club Smart Grids Côte d’Azur, qui regroupe une quarantaine de partenaires, propose trois types de bâtiments : le « bâtiment autogéré », le « bâtiment communicant » et le « bâtiment piloté » intégré dans un écoquartier et capable d’échanger de l’énergie avec le réseau. 29 projets ont été labellisés à l’issue de l’appel à projets « Territoires hydrogènes », ont annoncé le 3 novembre le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et le secrétariat d’État à l’Industrie. Cet appel à projets avait été lancé en mai dernier dans le cadre des travaux sur le stockage d’énergie de la solution « Mobilité écologique » de la Nouvelle France industrielle. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement par des financeurs pour mobiliser les dispositifs de soutien permettant de concrétiser leurs projets. Les lauréats sont répartis en huit territoires ayant déposé des projets, trois « projets avec un intérêt territorial fort » et quatre « avec un grand intérêt économique ». En janvier 2017, trois hydroliennes devraient être en test dans la Garonne. Ce site d’expérimentation, baptisé Seeneoh Bordeaux, est le seul au monde à proposer des essais d’hydroliennes en estuaire. Celui de la Gironde reproduit les conditions naturelles d’une rivière, mais également celles d’un océan, avec l’influence des marées. Avec deux ans de retard, le site sera prochainement opérationnel avec notamment un flotteur de 44 tonnes et 27 mètres de long, sorte de catamaran géant en cours de construction. Il permet de ne tester que la turbine de l’hydrolienne. Deux autres raccordements sont prévus le mois prochain pour tester le couple hydrolienne et flotteur du fabricant. Pendant 6 à 24 mois, pour 200 000 €/an, des ingénieurs du site étudient les performances de l’engin : le bureau d’études Energie de la Lune mesure l’impact environnemental, Valorem, spécialiste de l’éolien, les performances énergétiques et Cerenis, un bureau d’études bordelais, les performances mécaniques. « Nous avons mis en place les protocoles nécessaires, avec Bureau Veritas, pour aller jusqu’à la certification de la courbe de puissance. Ce service permet aux fabricants de commercialiser rapidement leur hydrolienne après le test », explique Marc Lafosse, instigateur du projet. Quatre entreprises sont pressenties pour les premiers tests : Hydroquest, Hydrotube, Bertin Technologies (groupe Cnim), et Instream Energy System. Ségolène Royal a publié le 28 octobre au Journal officiel la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE), laquelle fixe la trajectoire des différentes énergies à horizon 2023. Avec plusieurs mois de retard sur le calendrier initial, cette PPE réaffirme les grands objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015, et est censée préciser les moyens d’y parvenir. Prenant la forme d’un décret, ce texte « confirme l’engagement de notre pays dans la transition vers un système énergétique plus efficace et plus sobre, plus diversifié donc plus résilient », s’est félicitée la ministre. À propos du nucléaire, une phrase ajoutée à la synthèse accompagnant le décret précise que la fourchette anticipée de baisse de la production d’électricité nucléaire pourra également être révisée, dans le cadre de la révision de la PPE, en fonction de l’augmentation de la production renouvelable et des efforts d’efficacité énergétique. Par ailleurs, le décret lui-même oblige l’exploitant nucléaire EDF, dans un délai maximal de six mois après sa publication, à établir un plan stratégique compatible avec les orientations de la PPE. Première démonstration en vol pour le « premier hélicoptère conventionnel 100 % électrique ». Baptisé Volta, il a pris son envol sur l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, en présence de Ségolène Royal. Résultat de trois ans de recherche et développement, ce prototype a été développé par la société Aquinea en partenariat avec l’École nationale d’aviation civile (Enac). Son système de batteries, d’une puissance de 80 kW, exclusivement développé pour ce projet, lui assure une autonomie énergétique de 15 minutes en vol stationnaire. S’il a été présenté au stade de prototype, l’objectif est de développer un appareil dédié à la formation des pilotes et au vol de loisir. Pour devenir, à terme, un appareil en mesure d’intégrer le trafic aérien dans des conditions d’utilisation commerciale, promettent ses promoteurs. Il avait bien besoin d’une cure de jouvence ! Le réseau de chaleur de Saint-Pierre-des-Corps, dans l’agglomération de Tours (Indre-et-Loire), qui date des années 70, subit une modernisation de ses canalisations et passera aux énergies renouvelables au deuxième trimestre 2017. La ville et Corpo Energies, filiale d’Engie Réseaux, le délégataire, ont opté pour du bois à 64 % et pour du solaire thermique à 1 %. Les capteurs seront positionnés sur les toits des immeubles et raccordés aux sous-stations. « La part de solaire est modeste, car contrairement à une chaufferie bois, l’emprise foncière est importante, explique Sébastien Gohier, responsable d’exploitation chez Engie Réseaux, mais nous souhaitions mixer les énergies et être le plus efficient possible pour la production d’eau chaude sanitaire », . Deux chaudières biomasse de 2 et 2,5 MW seront installées. Ce montage permet de n’utiliser qu’une chaudière l’été, à son rendement optimum. La ville, très engagée, a fait raccorder neuf bâtiments publics (centre technique, bibliothèque, écoles, etc.). À terme, ce sont environ 3 700 équivalents logements qui seront desservis par un réseau qui atteindra 7 km en 2021 contre 3 km aujourd’hui. L’investissement total s’élève à 10 M€. Engie Réseaux espère une subvention de l’Ademe entre 20 et 30 % de l’investissement. Grâce à cette modernisation et un combustible bon marché, le prix de la chaleur, qui était de 93 € MWh TTC en solution gaz, sera stabilisé sur le long terme et devrait un peu diminuer. 9 000 tonnes de CO2 seront ainsi économisées par an. Signe des temps, Autolib a souscrit à l’offre d’énergie verte de Direct Énergie. Depuis le 1er octobre, les bornes de charge du service d’autopartage de voitures électriques d’Île-de-France s’alimentent en électricité auprès d’un fournisseur qui s’engage à acheter, en France, des garanties d’origine correspondant à la quantité d’électricité consommée par les voitures électriques. « Les autres services d’autopartage français du groupe Bolloré (Bluely à Lyon et Bluecub à Bordeaux) ont choisi, sur le même principe, des offres de fourniture qui garantissent l’injection dans le réseau de l’électricité consommée en énergie renouvelable et reçoivent ainsi leurs garanties d’origine correspondant à la fourniture d’électricité renouvelable », assure le groupe dans un communiqué. Grande nouvelle pour les acteurs des énergies renouvelables ! 42 % de croissance dans les cinq prochaines années avec 825 GW de nouvelles capacités électriques renouvelables, selon le rapport annuel 2016 de moyen terme sur les énergies renouvelables de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Un chiffre revu à la hausse de plus de 13 % par rapport aux estimations de l’Agence en 2015. Résultat : en 2021, les énergies renouvelables représenteront 28 % de la production d’électricité mondiale contre 23 % fin 2015, année record en termes d’investissements et de déploiement. L’AIE explique son optimisme par l’évolution des politiques, notamment aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Mexique, où l’Agence a relevé ses prévisions. En cinq ans, les coûts du solaire devraient aussi encore baisser de 25 %, tandis qu’ils diminueront de 15 % dans l’éolien terrestre. Le biogaz carburant se démocratise. Dans deux semaines, le plus grande station d’Île-de-France ouvrira ses pompes à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Cette station proposera aux transporteurs et aux particuliers, de recharger leur véhicule avec du GNV, du bioGNV ou EcoGNV (30 % de BioGNV), 7 jours sur 7. La proportion de BioGNV sera variable. Le Sigeif (le Syndicat intercommunal de gaz, d’électricité en Île-de-France), propriétaire de la station, estime qu’il y aura un surcoût de l’ordre de 20 c€/kWh entre le GNV et le BioGNV.? Endesa, leader sur le marché électrique espagnol, a obtenu le droit d’exploiter le site pendant 3 ans. À compter du 1er novembre, sur 4 000 m2, deux pompes distribueront du gaz naturel véhicule, puis deux autres pourraient être installées. Pour l’alimentation en biogaz, pas de méthaniseur. Endesa s’appuie sur les certificats d’origine. Néanmoins, les unités de méthanisation se multiplient en Île-de-France, à commencer par le projet porté par le Siaap (syndicat d’assainissement), à 5 km de Bonneuil-sur-Marne. Le but de l’unité BioGNval est de produire du biométhane à partir des eaux usées d’une station d’épuration. Trois autres unités de biogaz agricoles injectent leur production sur le réseau en Seine-et-Marne. En face, l’offre de stations de GNV- BioGNV se structure. D’ici à cinq ans, le Sigeif et la Caisse des Dépôts, via la société Sigeif Mobilités visent une dizaine de stations et Endesa ambitionne d’en déployer une cinquantaine dans l’Hexagone. Le gouvernement a adopté la semaine dernière un projet de loi portant sur l’autoconsommation d’électricité et les énergies renouvelables. Il ratifie « les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ». Le gouvernement veut, par ailleurs, s’assurer de pouvoir recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer des capacités de production de biométhane destiné à être injecté dans le réseau de gaz. Pour ce faire, le projet de loi indique que les objectifs définis par arrêté de la ministre chargée de l’Énergie valent programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), jusqu’à la date de publication de celle-ci. Pour rappel, dans le projet de décret relatif à la PPE, les objectifs d’injection de biométhane dans le réseau de gaz sont, en termes de production globale, 1,7 TWh en 2018 et de 8 TWh en 2023. Présentée comme une première en France et en Europe, une « centrale de géothermie marine » a été inaugurée le 17 octobre par Engie à Marseille. Baptisée Thassalia, l’installation puise de l’eau de mer à 7 mètres de profondeur dans le port de Marseille. L’eau salée (à 14° C l’hiver et 22° C l’été), passe ensuite dans des pompes à chaleur pour alimenter en froid ou en calories le réseau de chauffage d’une partie d’Euroméditerranée, le nouveau quartier d’affaires de la cité phocéenne. Au total, trois kilomètres de réseau sont prévus, dans cet ensemble encore en partie en construction, pour alimenter 500 000 m2 de bâtiments, assure le groupe dans un communiqué. Cette centrale d’une puissance de production de 19 MW de chaud ou de froid représente un investissement de plus de 35 M€, dont près de 7 M€ d’argent public. Engie développe un projet comparable sur l’île de la Réunion, à Sainte-Marie et Saint-Denis, pour assurer notamment la climatisation de l’aéroport, de l’hôpital et de l’université. Une petite révolution s’annonce dans le solaire thermique. Alors que la filière résidentielle peine à trouver un nouveau souffle, que les réseaux de chaleur solaire sont encore au stade expérimental en France, Newheat, une start-up bordelaise, entend proposer de la chaleur solaire aux industriels, à grande échelle. Un montage calqué sur le modèle du photovoltaïque. « Au sein de la filière, il manque un acteur pour investir et porter le risque, explique Hugues Defréville, l’un des deux associés. Nous proposons à nos clients de financer et de construire une centrale solaire thermique et de leur vendre la chaleur avec un contrat sur 15 à 20 ans. » Pour réaliser leurs installations, les associés ont mis au point des innovations techniques. Les panneaux sont installés sur des trackers, ce qui optimise la production et évite les surchauffes. Un logiciel de prévision permet de connaître les quantités de chaleur produite et de modéliser les courbes de températures. Ces procédés, soutenus par l’Ademe, sont pour l’instant testés à l’échelle d’un pilote de 100 kW, pendant 18 mois. Mais, dès 2017, Newheat souhaite développer des installations de 1 à 2 MW. Un projet est déjà bien avancé avec un papetier en Aquitaine. Pour 2018, il vise des centrales de 5 à 10 MW pour atteindre un meilleur niveau de rentabilité. Selon une étude dévoilée récemment, un approvisionnement énergétique basé sur 100 % d’énergies renouvelables est possible en Inde dès 2030. La publication, réalisée par la Lappeenranta University of Technology et l’Energy Watch Group, avance que cette solution serait la plus efficace d’un point de vue économique. « Les énergies solaire et éolienne, fluctuantes, complétées par les énergies hautement flexibles que sont la bioénergie, l’hydroélectricité, la géothermie et le stockage, peuvent fournir à l’Inde l’électricité au coût le moins élevé d’ici 2030 tout au long de la journée et en toute saison, y compris durant la mousson », explique Christian Breyer, professeur d’économie solaire et principal auteur du rapport. Dans le scénario présenté, les capacités installées de solaire et d’éolien devront atteindre respectivement 727 GW et 191 GW et représenter 59 % and 18 % du mix électrique indien. EDF Énergies Nouvelles a annoncé, mardi 11 octobre, avoir remporté pas moins de 648 MW de nouveaux projets solaires et éoliens en Amérique latine. Au Mexique, le groupe a gagné un projet éolien de 252 MW et fait son entrée dans le solaire en remportant le projet « Bluemex », d’une puissance de 90 MWc, dans le cadre d’un appel d’offres national. Déjà présent dans l’éolien au Brésil, EDF EN investit le secteur solaire avec l’acquisition, auprès de Canadian Solar, de 80 % du projet de « Pirapora I » (191 MWc). Enfin, au Chili, EDF EN poursuit son développement dans le photovoltaïque avec “Santiago Solar”, un parc de 115 MWc détenu à parité avec le développeur local Andes Mining Energy (AME). L’ensemble de ces nouveaux programmes porte à 1 368 MW les projets du groupe, déjà opérationnels ou à mettre en service dans les prochaines années en Amérique latine, explique EDF EN dans un communiqué. Dans quelques mois, 10 micros-centrales hydroélectriques seront en fonctionnement dans le Haut-Rhin. Une des raisons du développement de cette énergie sur le département, outre le potentiel intéressant de la ressource, est sans doute la forte volonté de la collectivité. Les syndicats fluviaux ont délégué leur compétence au conseil départemental du Haut-Rhin, qui finance les travaux. Un SPIC, un service public industriel et commercial, a été créé pour percevoir les recettes de la vente de l’électricité. Une turbine est installée sur la Lauch depuis 5 ans. En 2014, trois micro-centrales ont été construites sur le canal déclassé Rhin-Rhône, propriété départementale. Elles sont équipées de vis d’Archimède couplée à un générateur. D’une puissance de 45 à 52 kW, elles permettent d’alimenter en électricité l’équivalent de la consommation annuelle de 1 100 personnes. Deux nouvelles micro-centrales sont déjà construites, mais ne tournent pas encore, comme l’explique René Junker, responsable Énergie au conseil départemental du Haut-Rhin : « Nous attendons la revalorisation du tarif d’obligation d’achat de l’électricité, de 9 à 13 c€, qui devrait être confirmée prochainement ». Une nouvelle consultation va être lancée pour la construction de trois turbines, deux sur le canal et une sur un barrage, appartenant aussi au département. Le financement participatif pourra désormais contribuer à hauteur de 2,5 M€ aux projets d’énergies renouvelables, contre 1 million d’euros jusqu’alors, selon un décret paru le 30 septembre au Journal officiel. Cette mesure vise à favoriser l’ancrage territorial des projets et leur appropriation par les citoyens. Dans le même sens, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a annoncé la semaine dernière son intention de créer un label financement participatif pour la croissance verte qui sera opérationnel dès l’an prochain. Enfin, le gouvernement a instauré dans les appels d’offres un bonus de rémunération pour les projets d’énergies renouvelables incluant du financement participatif. Ainsi, s’agissant de l’appel d’offres solaire (centrales au sol) lancé fin août, ce bonus atteindra 3 €/MWh. Enercoop est devenu le premier acteur à être agréé pour la gestion des contrats d’achat d’électricité renouvelable, mettant ainsi fin au monopole d’EDF sur l’achat d’électricité renouvelable issue des nouvelles installations, explique le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et 100 % coopératif dans un communiqué. Selon les modalités de cet arrêté publié le 29 septembre au Journal officiel, Enercoop est agréé pour un nombre maximal de 75 contrats d’achat et une puissance installée correspondante maximale de 100 MW. « Il est désormais possible pour les producteurs d’énergies renouvelables d’assurer la viabilité de leur installation en bénéficiant du soutien public de l’État, tout en choisissant de vendre leur production à l’acheteur agréé de leur choix », explique Emmanuel Soulias, DG d’Enercoop. Dans quelques jours, l’unité de méthanisation de Cler Verts sera en fonctionnement. Cette entreprise familiale d’une vingtaine de salariés, installée au sud de Toulouse, est spécialisée dans le traitement des déchets organiques. Jusqu’à maintenant, elle disposait de trois plateformes : deux de compostage et l’autre pour le recyclage de bois. L’unité de méthanisation s’intègre naturellement sur cette plateforme multifilières. « La chaleur de méthanisation servira à sécher le bois pour obtenir un meilleur combustible, explique Élodie Lanta-Laborie, responsable du projet. Et les lagunes de compostage alimenteront en partie le digesteur ». Cette unité de 630 kW, construite par EnviTec Biogas, traitera 18 000 tonnes de déchets par an, dont 7 000 de biodéchets collectés auprès des cantines, des supermarchés et des industries agroalimentaires. L’investissement est de 5,6 M€, subventionné par l’Ademe (900 000 €) et la région Midi-Pyrénées (480 000 €). « S’occuper des procédures administratives et aller chercher des financements de 3,7 M€ sont très lourds quand on est une PME avec un chiffre d’affaires d’ 3,5 M€ lors de la signature de la convention. Il faut s’accrocher ! » conclut Élodie Lanta-Laborie. Permettre de sécuriser le cadre économique des méthaniseurs dans l’attente de la publication du nouvel arrêté tarifaire, actuellement en cours de notification à la Commission européenne, tel est l’objet de l’arrêté publié le 25 septembre au Journal officiel et qui prolonge le bénéfice du tarif d’achat d’électricité pour les installations de méthanisation existantes de moins de 500 kW. « Une fois validé par la Commission européenne, le nouveau dispositif de soutien pour les nouveaux sites de méthanisation sera le suivant, précise la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer Ségolène Royal dans un communiqué. Les méthaniseurs de moins de 500 kW seront soutenus par un tarif d’achat de l’électricité garanti pendant 20 ans – les méthaniseurs de plus de 500 kW seront soutenus dans le cadre d’appels d’offres ouvrant droit à un complément de rémunération garanti pendant 20 ans. » Un premier appel d’offres, sur un volume de 10 MW, a été lancé en février. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) instruit actuellement les offres. Les lauréats de la première tranche seront désignés avant la fin de l’année. La start-up de chimie verte Global Bioenergies a annoncé avoir signé un accord en vue de produire un carburant haute performance à partir de ressources forestières en Suède. Il rejoint ainsi un consortium composé de trois groupes suédois, la compagnie pétrolière Preem, le chimiste Sekab et le groupe forestier Sveaskog, afin de mener « l’étude conceptuelle de l’implantation de cette première usine », indique la société française dans un communiqué. L’objectif est de produire du bio-isooctane, un biocarburant haute performance dérivé du bio-isobutène et présentant un indice d’octane de 100, c’est-à-dire totalement résistant à l’auto-inflammation. En partie financé par l’Agence suédoise de l’énergie, ce projet coopératif devra rendre ses conclusions en début d’année prochaine. Renforcer les partenariats entre l’industrie et la recherche : l’objectif est réaffirmé par la filière géothermie profonde aux Journées de la géothermie et European Geothermal Congress 2016, qui se déroulent cette semaine à Strasbourg (67). Après le LabEx G-EAU-THERMIE PROFONDE (laboratoire d’excellence labellisé « Investissements d’Avenir » ouvert en 2012) porté par l’opérateur Électricité de Strasbourg, l’Université de Strasbourg (École et Observatoire des Sciences de la Terre) et sa chaire de géothermie industrielle, la démarche essaime désormais aux Antilles avec l’étude d’un centre caribéen d’excellence sur la géothermie volcanique qui pourrait être porté par la région Guadeloupe et d’autres partenaires. « Avec les Antilles et l’Alsace, l’objectif serait de disposer à terme de deux pôles français d’activité en géothermie, l’un sur la géothermie volcanique et l’autre sur la géothermie EGS, qui soient interactifs, alliant R&D et formation, en accompagnement de projets industriels réalisés localement », indique Philippe Laplaige, ingénieur expert en géothermie à l’Ademe. À partir du 26 septembre, le développeur d’énergies renouvelables RES proposera une opération de financement participatif d’un montant de 100 000 euros via la plateforme Lendosphere. Les montants prêtés par des particuliers (entre 50 € et 1 000 €) serviront à l’installation d’un mât de mesures anémométriques sur le site du futur parc éolien « Les Closeaux », à Choisy-en-Brie en Seine-et-Marne (21,6 MW). Le prêt court sur une période de deux ans et le taux d’intérêt annuel est fixé à 5 % brut, bonifié à 7 % pour les habitants des communes avoisinantes, détaille RES dans un communiqué. L’énergéticien a par ailleurs annoncé qu’il allait réduire le nombre de ses salariés au Royaume-Uni en charge du développement de l’éolien terrestre. Raison invoquée : « l’évolution des conditions de marché » outre-Manche. D’ici 2050, General Motors (GM) compte utiliser exclusivement de l’électricité d’origine renouvelable (éolienne, solaire et gaz de décharge) pour faire fonctionner ses 350 sites répartis dans 59 pays. Le constructeur automobile américain a utilisé 9 TWh d’électricité pour l’ensemble de ses activités en 2015, peut-on lire dans un communiqué. GM annonce « économiser 5 millions de dollars par an grâce à l’utilisation des énergies renouvelables » et revendique 80 M$ d’économies depuis le début de son engagement dans les énergies alternatives, il y a plus de 20 ans. Le groupe américain prévoit également de continuer à améliorer l’efficacité énergétique de ses sites. Pour tracer un réseau de chaleur, on s’appuie actuellement sur les données météorologiques retenues en périphérie des villes. Néanmoins, la température est plus élevée à l’intérieur des agglomérations. Ces îlots de chaleur, qui font diminuer les consommations énergétiques de chauffage en hiver et font augmenter la production de froid en été, ne sont donc pas pris en considération. Jérémy Bernard, doctorant à l’Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV), a mis au point une méthode pour les quantifier à l’échelle d’une agglomération. Elle repose sur l’analyse de données de mesures réalisées au sein de l’agglomération nantaise pendant plusieurs années, mises en relation avec les données géographiques du territoire (densité de bâtiments, de végétation, etc.). À partir des résultats obtenus, elle permet de cartographier les différences de température de n’importe quelle agglomération située en France métropolitaine. Cette modélisation est disponible pour tous les territoires auprès de l’IRSTV. Les énergies renouvelables ont représenté 26 % de la consommation d’électricité en France au cours du deuxième trimestre, peut-on lire dans la 7e édition du Panorama de l’électricité renouvelable publiée la semaine dernière par le Syndicat des énergies renouvelables (SER). Si cet excellent chiffre est à mettre sur le compte d’une production d’hydroélectricité à un niveau exceptionnel au printemps, le deuxième trimestre enregistre la plus forte progression de raccordement trimestriel depuis quatre ans avec 728 MW raccordés. « Sur une année glissante, 2 140 MW, répartis à 90 % sur les filières éolienne et solaire, ont été raccordés », assure le SER dans un panorama plus synthétique qu’à l’accoutumée. Désormais trimestriel, il présente l’ensemble des indicateurs sous forme d’infographie pour chaque filière. L’Inde a porté plainte devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les États-Unis à propos de subventions versées par huit États fédéraux dans le domaine des énergies renouvelables, a dévoilé lundi l’AFP. L’Inde estime que ces subventions sont contraires aux règles du commerce international, car moins favorables pour les produits importés. Elle a ainsi demandé des consultations bilatérales avec les États-Unis sur ce dossier, première étape de la procédure de règlement des conflits commerciaux, arbitrés par l’OMC. Il faut savoir que le gouvernement américain a, lui aussi, porté plainte contre l’Inde dans un autre dossier, concernant l’énergie solaire. Un premier arbitrage a été rendu sur ce dossier le 24 février dernier en défaveur de l’Inde qui a fait appel. Ouessant, Molène et Sein ont donné, mardi 6 septembre, le coup d’envoi à un programme visant 100 % d’approvisionnement énergétique renouvelable d’ici à 2030. Ces trois îles situées au large du Finistère ne sont pas raccordées au réseau électrique du continent et dépendent aujourd’hui exclusivement de centrales au fioul, à l’exception d’Ouessant qui bénéficie de la production de l’hydrolienne Sabella. Cette dernière a injecté à partir de 2015 et pendant plusieurs mois de l’électricité sur l’île, avant d’être relevée et ramenée à Brest en juillet pour une série de tests. Elle devrait être à nouveau immergée dans le puissant courant à l’automne et la PME quimpéroise prévoit à terme l’implantation d’une ferme pilote dans le courant du Fromveur. Avec ce programme, les trois îles bretonnes misent désormais sur l’efficacité énergétique et sur des parcs hydroliens, éoliens ou solaires. Il a vocation à être décliné, dans douze des îles réunies au sein de l’association des îles du Ponant. Avec 12 MW d’installations produisant de l’électricité à partir de biogaz au premier trimestre de cette année, la France connaît une baisse de deux tiers par rapport au premier semestre 2015, nous apprend le Commissariat général au développement durable (CGDD) dans son tableau de bord du biogaz publié fin août. « La puissance des nouvelles installations est la plus faible atteinte pour un premier semestre depuis 2009 », souligne le CGDD. Fin juin 2016, 463 installations correspondant à une puissance totale installée de 379 MW étaient dénombrées par le ministère de l’Environnement. À noter, les unités de méthanisation représentent plus de la moitié du nombre et de la puissance des installations nouvellement raccordées. « La France lancera la première obligation souveraine verte dès l’année prochaine », se sont félicités les ministères de l’Économie et de l’Environnement le 2 septembre dans un communiqué commun. Les obligations vertes, aussi appelées green bonds, sont des titres de dettes qui servent à financer des projets à vocation environnementale. Au total, plusieurs milliards d’euros devraient être levés, « sous réserve des conditions de marché ». Cette première mondiale pourrait permettre à la France de définir le standard de la mise en place des obligations vertes. L’OCDE a rendu lundi 11 juillet son Examen sur la politique environnementale de la France dans lequel elle plaide pour des mesures fortes dans l’agriculture, les transports, mais surtout l’énergie. Après avoir alerté sur le vieillissement du parc nucléaire français, elle rappelle que « la France est en retard sur ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Ils représentent actuellement 14,6 % de la consommation finale brute d’énergie, l’objectif 2020 de 23 % de renouvelables sera difficile à atteindre ». Et Angel Gurría, secrétaire général de l’OCDE, d’exhorter la France à « fixer les trajectoires de développement des différentes énergies pour donner de la visibilité de long terme aux investisseurs ». Il invite la France à « mettre en œuvre la loi de transition énergétique ». L’Examen recommande de même d’instaurer rapidement la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). « Cette feuille de route permettra de planifier et ainsi favoriser les investissements, en cohérence avec la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). » Dans un communiqué commun diffusé le 8 juillet, collectivités territoriales et professionnels s’inquiètent du retard pris dans la mise en place des aides annoncées pour développer les réseaux de chaleur et de froid. Quatre organisations (Amorce, Fedene, SNCU et Via Séva) demandent ainsi à la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, « l’augmentation réelle et immédiate » du Fonds chaleur dont le doublement de sa dotation a été à plusieurs reprises annoncé par la ministre. Les organisations souhaitent également « l’indexation des aides aux réseaux de chaleur sur l’évolution réelle du prix du gaz », la mise en place opérationnelle du Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) pour le raccordement aux réseaux de chaleur vertueux, une accélération de l’augmentation de la Contribution climat énergie et le lancement d’un appel à projet « Nouveaux écoréseaux de chaleur ». Greensolver a annoncé lundi 11 juillet avoir été retenu par le groupe Caisse des dépôts pour former ses collaborateurs. La société qui se définit comme « expert technique indépendant dédié à l’éolien et au solaire » sera ainsi en charge de la formation de 220 collaborateurs du groupe Caisse des dépôts, tous membres de la Direction des investissements et du développement local. « Il est impératif que les acteurs publics, souvent situés en première ligne, soient sensibilisés et formés par les experts du secteur. Cela ne pourra que favoriser et faciliter la bonne expansion des énergies renouvelables en France », commente Guy Augier, PDG de Greensolver, cité dans un communiqué. Greensolver s’est vu confier cette « nouvelle mission » suite à un appel d’offres lancé en février dernier. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les dernières nouvelles des énergies renouvelables revient dès le 7 septembre. Toute l’équipe de l’Observatoire des énergies renouvelables et du Journal des Énergies Renouvelables vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un très bel été ! Comme attendu (cf. L’Actu du 16 mars 2016), Géothermie Bouillante appartient officiellement au groupe américain Ormat à partir de ce mercredi 6 juillet. L’accord final a été signé hier mardi par Ségolène Royal au ministère de l’Environnement. Ormat rachète ainsi 60 % de la centrale guadeloupéenne pour un montant d’environ 50 M€. La France garde cependant un pied dans l’entreprise : le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) par sa filiale Sageaos et la Caisse des dépôts et consignations conservent chacun 20 % de participation. « Cette opération va se traduire par des investissements à hauteur d’au moins 10 M€ pour développer la centrale, optimiser son fonctionnement et tripler sa capacité installée pour atteindre 45 MW en 2021 », assure la ministre dans un communiqué, précisant qu’elle se rendra prochainement en Guadeloupe pour « s’assurer de la bonne exploitation de la ressource géothermale et du respect des engagements du nouvel exploitant ». France Biométhane a publié hier mardi 5 juillet un « Benchmark des filières européennes ». L’occasion pour le think tank lancé en avril dernier (cf. L’Actu du 6 avril 2016) regroupant des acteurs du secteur (développeurs de projets, producteurs et distributeurs de gaz, etc.) d’exposer des mesures pour développer la filière en France et ainsi « rattraper le retard pris par la France par rapport à ses voisins européens ». À savoir, entre autres : une simplification de la réglementation (limitation de la période de recours, développement du biométhane comme carburant, etc.), un tarif d’achat pour le biométhane injecté dans le réseau étendu au biométhane non injecté, et un maintien du niveau du tarif d’achat et son extension à 20 ans. Dans un communiqué, le think tank explique avoir « entamé un tour de France auprès de différents institutionnels afin de leur présenter ce programme ». Mirova a annoncé lundi 4 juillet avoir conclu la levée de son troisième fonds d’investissement dédié aux projets d’énergies renouvelables : Mirova-Eurofideme 3. Ainsi, 350 M€ ont été levés, dépassant l’objectif initial de 200 M€, se félicite la filiale de Natixis Asset Management dans un communiqué. « La Banque européenne d’investissement a notamment investi 40 M€ aux côtés d’institutionnels, de fonds, de fondations et de family offices », précise Mirova. Eurofideme 3 a déjà réalisé huit investissements pour un montant cumulé de près de 100 M€ et 300 MW de projets solaires, éoliens et hydrauliques à travers l’Europe, en particulier en France et dans les pays nordiques. Il a en outre reçu le label « Transition énergétique et écologique pour le climat », lancé en mai dernier par le ministère de l’Environnement. Depuis lundi, une nouvelle période de souscription a été ouverte par Méthanor, société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable. Celle-ci cherche à lever 2 M€ d’ici le 12 juillet, afin de « financer de futurs projets d’énergie renouvelable, dont le prochain devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année 2016 », révèle la société dans un communiqué. De son côté, Allianz Global Investors vient de boucler un deuxième tour de table pour son fonds fermé « Allianz Renewable Energy Fund 2 », au cours duquel « des investisseurs institutionnels ont souscrit 190 M€ d’actifs », annonce l’entreprise. Allianz espère doter ce fonds de 300 M€ d’ici la fin du troisième trimestre 2016, afin d’investir dans des parcs éoliens et solaires en Europe. Les spécialistes de l’environnement outre-Manche s’inquiètent des possibles répercussions du Brexit. Car en matière d’énergie, par exemple, c’est la directive européenne sur l’énergie qui imposait jusqu’ici au Royaume-Uni de produire 15 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2020. Cet objectif sera-t-il abandonné ? Les signaux ne sont pas encourageants… La réforme du marché de l’électricité menée depuis deux ans au Royaume-Uni n’est pas favorable aux EnR et les politiciens en faveur du Brexit sont climatosceptiques, ce qui ne risque pas d’arranger les choses. Quant à l’accord de Paris, Christiana Figueres, l’une des architectes de l’accord, avait prévenu : il devra être recalibré en cas de Brexit. Il n’est donc pas sûr qu’à long terme, le Royaume-Uni continue à suivre la voie la plus verte. C’est officiel : à partir du 1er janvier 2017, les professionnels qui interviennent dans les activités géothermiques de minime importance (moins de 200 mètres de profondeur et inférieures à 500 kW) devront être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier causé à des tiers. Le décret paru le 26 juin dernier, permettant la mise en application de ce que prévoyait la loi pour la transition énergétique, précise notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter. Il étend également le champ des activités géothermiques de minime importance à celles relatives au refroidissement, et non plus uniquement au chauffage. Pour admirer la plus puissante hydrolienne du monde, affichant 2 MW de capacité, 64 mètres de long et un poids de 550 tonnes, il faudra se rendre ce 25 juin sur l’île écossaise d’Orkney. Une journée portes ouvertes est en effet organisée pour présenter la SR 2000, mise au point après plus de 12 ans de R&D par l’entreprise britannique Scotrenewables Tidal Power. Pour parvenir à cette première machine à l’échelle commerciale, la société a déjà bénéficié de plus de 32 millions d’euros d’investissements, de la part d’ABB, du gouvernement écossais, de DP Energy, du Fred. Olsen Group et de Total New Energies. L’hydrolienne est arrivée à Orkney, au Centre européen des énergies marines (EMEC), le 9 juin et va y subir une campagne de tests de raccordement au réseau. Cet après-midi du 22 juin, à Manneville-es-Plains (76), aura lieu une démonstration inédite en France : la coupe et l’exportation en une seule étape d’ajonc d’Europe dans le cadre d’une ouverture de milieu. Une machine spécifique a pour cela été mise au point par l’entreprise Biomasse Écologie Énergie (BEE). Construite sur la base d’une dameuse de pistes de ski, elle a été dotée d’un broyeur à l’avant et d’une escarcelle à l’arrière et peut récolter la végétation en un seul passage, tout en minimisant le tassement des sols et en détectant la faune cachée dans le milieu. L’ajonc d’Europe, un arbuste ligno-cellulosique qui peut atteindre 6 mètres de haut, dispose d’un fort pouvoir calorifique. Le récolter permettrait l’utilisation de ressources locales à des fins énergétiques sans endommager l’environnement. Dans sa Lettre Stratégie n°48, l’Ademe fait le point sur les marchés des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie entre 2006 et 2014. Et malgré un contexte économique morose, ceux-ci « ont connu une progression annuelle moyenne de 9,8 % » sur la période, chiffre l’étude. L’évolution entre 2013 et 2014 n’est que de + 0,1 % mais, pour l’Ademe, des progrès ont été réalisés (accord de Paris, loi pour la transition énergétique…) qui ouvrent la voie à une reprise de la croissance en 2015 et peut-être au-delà. Côté emploi, l’étude note la même dynamique : le nombre de postes directs liés à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en France est passé de 179 310 en 2006 à 297 420 en 2013 et devrait avoir dépassé la barre des 310 000 en 2015 ! Le Français Enertime a annoncé ce mercredi 15 juin le lancement de son introduction à la Bourse de Paris avec l’objectif de lever 5 millions d’euros. Les actions du groupe, qui seront cotées sur Alternext, peuvent être souscrites depuis ce mercredi et jusqu’au 1er juillet, précise le concepteur de modules à cycle organique de Rankine (ORC). « Les actionnaires historiques, Siparex, Amundi, Calao et le Management se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de 2,1 M€ », selon le communiqué du groupe. « Avec 2 unités déjà installées et un carnet de commandes de 4 nouvelles unités, nous avons amorcé notre déploiement commercial », explique l’entreprise qui a récemment signé un contrat de plus de 2 M€ pour la reconstruction et le développement, pour la fourniture d’un ORC de 1,6 MW en Ukraine (cf. L’Actu du 8 juin). Enertime assure en outre avoir « identifié une quarantaine de projets qui […] pourraient représenter un volume d’affaires total d’environ 100 M€ dans les cinq prochaines années. » « Les prix du gaz et du charbon vont rester bas, mais cela n’empêchera pas la transformation fondamentale du système électrique mondial dans les prochaines décennies vers les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire », peut-on lire dans le « New Energy Outlook 2016 » mis en ligne le 13 juin par Bloomberg New Energy Finance (BNEF) et qui se projette en 2040. Cette forte expansion des renouvelables sera permise par la baisse continue des coûts des technologies éoliennes (- 41 % d’ici 2040) et solaires (- 60 %). Elles seront les sources d’électricité les moins chères dans de nombreux pays dans la décennie 2020 et dans la quasi-totalité du monde à partir de 2030, selon le cabinet d’experts. Au total et au niveau mondial, 7 800 Md$ seront investis dans les énergies « vertes » entre 2016 et 2040, quand les énergies fossiles attireront 2 100 Md$. « Mais cela ne suffira pas pour respecter la trajectoire de l’accord international sur le climat et limiter le réchauffement climatique sous les 2 °C par rapport à la période pré-industrielle », note BNEF. Il chiffre le besoin à 5 300 Md$ supplémentaires d’investissements dans l’électricité bas carbone. « Signer c’est bien, ratifier c’est mieux », a déclaré François Hollande après avoir signé ce mercredi 15 juin à l’Élysée le décret de promulgation permettant la ratification de l’accord sur le climat conclu le 12 décembre à Paris à l’issue de la COP21. Ce texte, définitivement adopté par le Parlement le 8 juin, « fait de la France le premier pays industrialisé (membres du G7 et G20) à boucler l’adoption de ce traité historique », avait avant cela souligné la ministre de l’Environnement et actuelle présidente de la COP21 Ségolène Royal. Le président français a aussi appelé à une mobilisation pour que l’Europe puisse être en ordre de marche afin de ratifier avant la fin de l’année l’accord de Paris. Le Solar Heat Worldwide Report 2014 Edition 2016, auquel a collaboré Observ’ER, éditeur du Journal des Énergies Renouvelables, vient de sortir et dresse le bilan du solaire thermique à l’échelle mondiale. Il révèle ainsi qu’à fin 2014, 410,2 GWth, correspondant à 586 millions de m² de capteurs solaires (en grande majorité à tubes), étaient installés dans le monde. La Chine et l’Europe étant toujours les deux plus importants marchés, avec respectivement 289,5 GWth et 47,5 GWth installés. Mais le marché connaît pour la première fois une croissance en recul par rapport aux années précédentes, avec seulement 46,7 GWth installés durant l’année 2014. Une tendance, qui d’après les premières estimations de l’institut autrichien pour les énergies renouvelables, auteur du rapport, s’est poursuivi en 2015, avec environ 25 GWth installés sur l’année. La centrale de géothermie profonde de Rittershoffen, qui permettra d’approvisionner en vapeur le site de production du Groupe Roquette à Beinheim (67), a été mise en service officiellement hier mardi 7 juin. Cette installation permet de puiser de l’eau à 165 °C à 2 500 mètres de profondeur. La capacité espérée est de 24 MWth. Couplée à une chaudière bois existante et à une unité de production de biogaz, elle permettra de couvrir de façon renouvelable 75 % des besoins en vapeur du site. A l’occasion de l’inauguration, Ségolène Royal a annoncé l’accélération de la mise en place du fonds GEODEEP de partage du risque de forage (sans plus de précision) ainsi que le lancement, à partir de 2017, de deux appels d’offres pour engager la conversion progressive des cogénérations industrielles au gaz naturel, vers la biomasse et le biogaz. Enertime, concepteur français de modules à cycle organique de Rankine (ORC), vient de signer un contrat de plus de 2 M€, financé par la banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour la fourniture d’un ORC de 1,6 MW en Ukraine. Les modules ORC permettent de transformer la chaleur, à partir de 90 °C, en électricité et celui-ci sera donc installé sur le réseau de chaleur biomasse de la ville de Kamianetz-Podilskyï. Cet accord a été signé dans le cadre de la fourniture clé en main d’une centrale de cogénération biomasse, obtenue par un consortium d’entreprises dont Enertime fait partie. La centrale couvrira 30 % des besoins en chaleur de cette ville de 100 000 habitants et devrait être livrée en juillet 2017. 2015 fut une année record pour les investissements dans les énergies renouvelables, avec 286 milliards de dollars ! Pour autant, des efforts sont particulièrement nécessaires s’agissant des agrocarburants et de la production de chaleur et de froid ”verts”, selon le rapport 2016 sur la situation des énergies renouvelables du réseau REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), lequel s’appuie notamment sur les données et informations du baromètre EurObserv’ER (publié par Oberv’ER, éditeur du Journal des Énergies Renouvelables). Le rapport note ainsi que les secteurs de l’éolien et du solaire ont été les principaux bénéficiaires de la hausse des investissements dans les EnR. À l’inverse des autres technologies de production d’EnR et les biocarburants, pour lesquels les investissements ont baissé par rapport à 2014 : – 42 % pour la biomasse, – 35 % pour les agrocarburants et – 23 % pour la géothermie. Ne l’appelez plus ERDF mais Enedis ! C’est en effet le nom que s’est choisi le gestionnaire du réseau français de distribution d’électricité qui a confirmé l’information lundi 30 mai après que la CGT ne lui a grillé la politesse sur fond de polémique concernant le coût de l’opération. Le syndicat avançait la somme de 300 millions d’euros, contre une facture de 20 à 25 M€, selon l’estimation d’ERDF. Enedis s’inscrira en tout cas désormais en lettres bleues sur fond blanc, ou en blanc sur fond, exception faite pour le second e de Enedis, de couleur verte. La signature du groupe depuis l’an dernier, « L’électricité en réseau », est conservée, explique le groupe dans un communiqué. Ce changement est une réponse à une exigence de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). C’est aussi l’occasion de réaffirmer « son engagement en faveur de la transition énergétique au cœur des territoires […] notamment pour accompagner et faciliter le déploiement massif des énergies renouvelables, décentralisées sur tous les territoires ». Seuls 4,4 MW de biogaz ont été raccordés au cours du premier trimestre 2016, selon le tableau de bord trimestriel publié le 27 mai par le Commissariat général au développement durable (CGDD), lequel note « une baisse de moitié par rapport au premier trimestre 2015 ». La puissance cumulée des installations produisant de l’électricité à partir de biogaz est ainsi passée de 365 à 370 MW de début janvier à fin mars 2016, soit la plus faible progression pour un premier trimestre depuis 2009. 17 installations, principalement de petite taille et relevant de la méthanisation, ont été raccordées, portant leur nombre total à 439. Le CGDD comptabilise 167 projets en file d’attente, correspondant à une puissance de 109 MW. Par ailleurs, « les injections de biométhane dans les réseaux de gaz naturel sont en constante progression, atteignant 35 GWh au premier trimestre 2016 », souligne le tableau. Aujourd’hui à Paris a lieu le premier colloque national dédié à l’autoconsommation photovoltaïque. Enerplan vient d’y dévoiler les résultats de deux enquêtes sur les Français et l’autoconsommation. Celles-ci révèlent que les particuliers sont prêts : 68 % des Français savent que produire et consommer de l’électricité avec des panneaux solaires peut s’avérer moins cher que de l’acheter chez un fournisseur d’énergie et 47 % des sondés sont prêts à investir dans un système d’autoconsommation PV. Un chiffre qui monte à 62 % parmi les adhérents de Périfem, professionnels du commerce et de la distribution ! Reste à leur faire franchir le pas et pour cela, Ségolène Royal, par la voix de Virginie Schwarz (DG de l’énergie au ministère de l’Environnement), a également annoncé lors de ce colloque le lancement d’un appel d’offres dédié à l’autoconsommation pour des installations de 100 à 500 kW et pour un volume total de 50 MW. À suivre… Les centres de données (datacenters) consomment énormément d’énergie, et comme l’écrit Brad Smith, président de Microsoft, sur le blog de l’entreprise : « D’ici le milieu de la prochaine décennie, les datacenters feront partie des plus gros consommateurs d’électricité de la planète ». D’où la nécessité de les rendre le plus « verts » possible. Dans le même article, Brad Smith révèle ainsi que Microsoft s’engage à utiliser 50 % d’énergie renouvelable pour ses datacenters d’ici fin 2018, contre 44 % aujourd’hui et à franchir la barre des 60 % aux alentours de 2020. Aujourd’hui, via un système de type garantie d’origine, Microsoft affiche déjà un bilan carbone nul pour ses datacenters, mais l’entreprise souhaite continuer à investir directement dans des moyens de productions renouvelables là où elle s’implante. Publiée tous les cinq ans par la direction générale des entreprises, l’étude prospective Technologies clés 2020 vise à accompagner les entreprises dans leurs orientations stratégiques et à leur permettre d’identifier les marchés d’avenir. La dernière version vient de sortir et bien sûr, les énergies renouvelables y sont inclues ! Parmi les 47 technologies sélectionnées figurent ainsi les systèmes énergétiques intégrés à l’échelle du bâtiment, les technologies de récupération de chaleur à basse température, le solaire photovoltaïque et les énergies éoliennes. L’étude indique pour chacune de ces solutions les enjeux technologiques à relever et les facteurs de réussite et recommandations pour les acteurs français. Rapport à consulter en ligne sur www.entreprises.gouv.fr Ségolène Royal a annoncé la semaine dernière l’accélération des calendriers des appels d’offres commerciaux hydroliens et éoliens flottants, sans donner pour autant de date précise pour leur lancement. À l’occasion de l’inauguration de l’installation de la seconde hydrolienne DCNS/OpenHydro du projet de parc démonstrateur hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat, la ministre de l’Environnement a précisé que les résultats de l’appel à manifestation d’intérêt PIA pour la réalisation de fermes pilotes éolien flottant seront annoncés en juillet 2016 au lieu du mois de septembre, comme prévu initialement. De plus, le gouvernement a décidé « de ne pas se limiter à l’enveloppe de 150 millions d’euros initialement envisagée pour la sélection des lauréats », souligne le communiqué du ministère. Ségolène Royal a par ailleurs annoncé une enveloppe d’un million d’euros pour soutenir les projets de transition énergétique dans onze îles bretonnes, dont l’île de Sein. Du 7 mai au 11 mai et pendant plus de 107 heures consécutives, la consommation électrique du Portugal a été entièrement couverte par des énergies renouvelables, une première pour le pays mais aussi au niveau mondial ! L’association portugaise APREN a annoncé ce record lundi 16 mai, après avoir épluché le rapport du Réseau national de l’énergie. De quoi faire le pied de nez aux détracteurs des EnR, au Portugal ou ailleurs. Simultanément, on apprenait que l’Allemagne avait atteint un pic de production d’EnR. Un dimanche 8 mai particulièrement ensoleillé et venteux a en effet permis à la consommation électrique du pays d’être couverte à 95 %, par des sources renouvelables durant quelques heures. Les États-Unis, la Chine et l’Inde demeurent, dans l’ordre, sur les trois marches du podium des pays les plus attractifs pour les énergies renouvelables, selon un baromètre établi par le cabinet EY. À la 4e place et malgré un marché énergétique relativement petit en termes absolus, le Chili continue d’attirer une pléthore de projets de plusieurs GW et constitue l’un des premiers marchés au monde où des projets viables économiquement peuvent concurrencer directement les autres sources d’énergie, souligne EY. L’Allemagne et la France, les deux seuls pays européens figurant dans le top 10, cèdent pour leur part du terrain, arrivant à la 5e place pour la première et à la 8e pour la seconde. Moins d’un mois après l’annonce de sa réorganisation avec la création d’une nouvelle branche Gas Renewables & Power (cf. L’Actu EnR du 20 avril), Total a déposé une offre publique d’achat volontaire en vue d’acquérir le spécialiste du stockage par batteries Saft pour 950 millions d’euros, ont annoncé mardi 9 mai les deux groupes dans un communiqué commun. Le Conseil de surveillance de Saft a approuvé cette opération qui lui permettra « de devenir le fer de lance du groupe [Total] dans le secteur du stockage d’électricité », selon Patrick Pouyanné, PDG de Total cité dans le communiqué. « L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de se développer dans les métiers des énergies renouvelables et de l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011. (…) Elle nous permettra d’intégrer dans notre portefeuille d’activités des solutions de stockage d’électricité, compléments indispensables à l’essor des énergies renouvelables », ajoute-t-il. Engie a annoncé lundi 9 mai le lancement des travaux de construction de son premier projet solaire thermique à concentration (concentrated solar power, CSP). D’une capacité de 100 MW, le parc solaire de 100 MW de Kathu est situé en Afrique du Sud et devrait être opérationnel au second semestre 2018, précise l’énergéticien dans un communiqué. Kathu utilise la technologie cylindro-parabolique et sera dotée d’un système de stockage à sels fondus qui offre 4 heures et demie d’autonomie, « permettant ainsi de limiter le caractère intermittent de l’énergie solaire », ajoute Engie. La signature d’un contrat d’achat d’une durée de 20 ans avec la société publique sud-africaine de production et de distribution d’électricité Eskom donne le coup d’envoi à ce projet opéré par un consortium mené par Engie (45,8 %) et composé de partenaires sud-africains. La ministre de l’Environnement a confirmé la semaine dernière le lancement d’un appel à projets pour le développement de « Territoires Hydrogène », dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle. Son objectif est de « montrer qu’un territoire, dès lors qu’il utilise une source d’hydrogène décarbonnée pour satisfaire plusieurs utilisations, peut générer un développement économique rentable et écologique », explique Ségolène Royal. L’appel à projets est en ligne et se clôturera le 30 septembre 2016. Les projets attendus devront intégrer « une chaîne complète de production, conditionnement, distribution et valorisation d’hydrogène dans des applications finales » et pourront servir à différents usages, notamment de stockage d’énergie et de mobilité. General Electric (GE) considère avec « intérêt » une possible « évolution du capital » d’Adwen, co-entreprise entre Areva et Gamesa dans l’éolien offshore, a indiqué hier mardi 3 mai Jérôme Pécresse, président de la division Énergies renouvelables du groupe américain. « Nous avons vocation à être un des trois principaux acteurs de l’offshore (…) et nous ne pouvons que regarder avec intérêt une évolution du capital d’Adwen », a-t-il affirmé, selon l’AFP. Pour rappel, l’avenir d’Adwen, créée en mars 2015, est au cœur des discussions entre le fabricant espagnol d’éoliennes Gamesa et l’Allemand Siemens, qui ont entamé il y a plusieurs mois des négociations en vue d’un rapprochement. Or, pour faciliter sa fusion avec Siemens, Gamesa aurait proposé à Areva de rompre leur alliance (cf. L’Actu Éolien du 5 avril), ouvrant la voie aux spéculations sur l’identité des futurs propriétaires d’Adwen. Le décret relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions a été publié samedi 30 avril au Journal officiel. Cette publication permettra notamment « d’engager d’ici la fin de l’année les premiers regroupements de concessions, et le renouvellement de concessions échues, le cas échéant avec la création de sociétés d’économie mixte hydroélectriques », a souligné Ségolène Royal dans un communiqué. Ce décret permettra également de répondre « aux enjeux soulevés par la Commission européenne dans le cadre du contentieux ouvert à l’encontre de la France, dans le respect des principes du modèle français de l’hydroélectricité », ajoute la ministre de l’Environnement en référence à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en octobre 2015. Les travaux d’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) et des schémas régionaux biomasse (SRB) ont démarré avec la mise en consultation, du 2 au 23 mai, du projet de décret. Prévus par la loi de transition énergétique, ces deux documents couvrent 18 régions (la France métropolitaine, ainsi que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte) et doivent permettre « le développement de l’énergie biomasse et l’approvisionnement des installations de production d’énergie dans les meilleures conditions économiques et environnementales ». La biomasse-énergie, qui comprend la production d’énergie à partir de biomasse solide (bois, déchets, résidus organiques), gazeuse (biogaz) ou liquide (biocarburants), est la première source d’énergie renouvelable en France, rappelle le ministère de l’Environnement. Adopté le 15 avril par le Conseil supérieur de l’énergie (cf. L’Actu EnR du 20 avril), l’arrêté modifiant les Programmations pluriannuelles des investissements (PPI) de production d’électricité et de chaleur de décembre 2009, soit la feuille de route pour les EnR jusqu’en 2023, a été publié au Journal officiel d’hier, mardi 26 avril. Selon les objectifs énoncés par le texte, la capacité installée des énergies renouvelables électriques sera augmentée de plus de 50 % à l’horizon 2023 par rapport à 2015. La puissance installée des éoliennes terrestres sera plus que doublée, tout comme celle de production électrique à partir de bois-énergie, et la puissance installée du parc solaire photovoltaïque sera plus que triplée. Pour rappel, ce texte a été pris dans l’attente de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dossier sur lequel les consultations seront lancées d’ici au 1er juillet pour une publication à l’automne, comme l’a annoncé le président François Hollande en ouverture de la Conférence environnementale, ce lundi 25 avril. En clôture de la conférence environnementale hier, le mardi 26 avril, Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, a lancé le premier appel d’offres pour le développement de petites installations hydroélectriques. « Il vise à développer près de 60 MW de nouvelles capacités, ne relevant pas du régime de la concession, pour relancer cette filière », a-t-elle détaillé par voie de communiqué. Trois types de projets sont éligibles à l’appel d’offres. Le premier, « La construction de nouvelles installations complètes (barrage + installation électrique) dans les zones propices », soit des installations de puissance supérieure à 500 kW et jusqu’à quelques mégawatts. Cette catégorie représente un volume de 25 MW dans l’appel d’offres. Le deuxième, « L’équipement d’ouvrages existants, mais ne produisant à ce jour pas d’électricité, d’une puissance supérieure à 150 kW ». Cette catégorie couvre 30 MW de l’appel d’offres. Enfin, « L’équipement de petits seuils (entre 36 et 150 kW), et en particulier la réhabilitation de sites d’anciens moulins, suivant une procédure allégée ». Cinquante projets seront retenus dans cette catégorie. Nul doute que la filière de la petite hydroélectricité saura trouver quelque satisfaction dans ces annonces (lire Le Journal des Énergies Renouvelables n° 232). Avec 82 GWh injectés dans les réseaux français de gaz, l’injection de biogaz a progressé de 160 % l’an dernier par rapport à 2014, selon une étude réalisée par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et des gestionnaires de réseaux de gaz, et dévoilée la semaine dernière. Il faut dire que l’année 2015 a vu émerger 11 nouveaux sites d’injection de gaz renouvelable, portant à 17 leur nombre total, ce qui permet d’augmenter la capacité maximale installée de 334 %, comme le détaille le document. « Cette évolution s’explique par l’investissement de l’ensemble des acteurs de la filière méthanisation ces dernières années, qui ont pu notamment s’appuyer sur des textes réglementaires en vigueur depuis 2011 », indiquent les acteurs du secteur. Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe en effet à 10 % la consommation de gaz renouvelable à l’horizon 2030. « Nos ambitions à 20 ans sont multiples (…) : être dans le top 3 de l’énergie solaire, se développer dans le trading d’électricité, dans le stockage d’énergie, être leader sur les biocarburants, notamment les biojets destinés à l’aviation, mais aussi envisager des développements possibles dans les autres énergies renouvelables », a expliqué Patrick Pouyanné, PDG de Total, dans un communiqué publié hier mardi 19 avril. Et de préciser que « L’ambition est de doter Total d’un nouveau métier qui contribuera à en faire la major de l’énergie responsable ». Pour ce faire, le groupe pétrolier et gazier a donc dévoilé sa future organisation interne, mise en place à partir de septembre prochain pour porter sa stratégie à horizon 2035. Cette nouvelle organisation se fera sans aucune suppression d’emploi et sans mobilité géographique contrainte, assure le groupe. » Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a adopté le 15 avril, à une large majorité, le projet d’arrêté relatif à la programmation des capacités de production d’énergies renouvelables. Prenant la forme d’un arrêté modifiant les Programmations pluriannuelles des investissements (PPI) de production d’électricité et de chaleur de décembre 2009, ce projet « va permettre, en particulier, de plus que doubler le parc éolien terrestre d’ici 2023 et de tripler la puissance du parc photovoltaïque », a souligné dans un communiqué le Syndicat des énergies renouvelables (SER). Ce dernier a d’ailleurs porté plusieurs amendements dont une révision à la hausse des objectifs 2018 et 2023 de l’éolien terrestre et un texte de calendriers indicatifs de lancement des appels d’offres. « Au chapitre des déceptions, le SER note que les objectifs pour les énergies marines renouvelables, l’éolien offshore posé et la cogénération biogaz n’ont pas été relevés », déplore l’organisation professionnelle. » EDF Énergies nouvelles a annoncé lundi 18 avril avoir remporté trois contrats pour la construction de deux parcs solaires et d’un parc éolien au Canada, d’une puissance cumulée de 82 MW. Ces contrats de vente d’électricité de vingt ans ont été signés avec Siere, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en Ontario, précise la filiale d’EDF dédiée aux énergies renouvelables dans un communiqué. Dans le détail, l’électricité fournie proviendra des centrales solaires de Pendleton et Barlow, de respectivement de 12 et 10 MW et situées dans l’est de l’Ontario, et le parc éolien Romney, de 60 MW et localisé dans le sud-ouest de la province. Ces trois installations permettront d’alimenter annuellement environ 30 000 foyers en électricité, indique EDF EN. Les 4 et 5 avril, Bloomberg New Energy Finance (BNEF), fournisseur de données et prospectives sur les énergies propres, a tenu son « Future of Energy Global Summit » à New York. L’occasion de découvrir de bonnes nouvelles pour les EnR. Outre le record d’investissement atteint en 2015, la baisse du prix de l’électricité renouvelable est également confirmée : – 50% depuis 2009 pour l’éolien et – 80% depuis 2008 pour le PV. Michael Liebreich, président du comité consultatif de BNEF, a aussi profité de l’occasion pour souligner les bienfaits des mécanismes type appel d’offres sur ces prix. « Dans les pays où les appels d’offres sont mis en place, nous observons une diminution du prix des renouvelables, dans l’année qui suit, de 15 à 50 %. », a-t-il déclaré. Une information précieuse pour les décideurs politiques. Le ministère de l’Environnement a présenté le 7 avril une ordonnance portant sur le développement du biogaz en France. Celle-ci « permet aux pouvoirs publics d’avoir recours à une procédure d’appel d’offres en cas d’écart avec la trajectoire de développement prévu pour le biométhane. Ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs des particuliers ou des collectivités dans les sociétés de projets », précise un communiqué du ministère. Pour rappel, les objectifs fixés concernant l’injection de biométhane sur le réseau sont de 6 à 8 TWh/an en 2023. Aujourd’hui, plus de 300 projets d’injection techniquement réalisables se sont déclarés auprès des gestionnaires de réseaux de gaz naturel. Mais seuls 18 sites injectent actuellement du biométhane dans les réseaux. Ségolène Royal a soumis pour avis au Conseil supérieur de l’énergie sa feuille de route pour le développement des énergies renouvelables, qui s’inscrit dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le projet d’arrêté fixe des objectifs de capacité installée pour 2018 et 2023 : 14 300 MW puis 21 800 à 23 300 MW pour l’éolien terrestre – 500 MW puis 3 000 MW pour l’éolien en mer – 10 200 MW puis entre 18 200 et 20 200 MW pour le PV – 540 MW puis entre 790 MW et 1 040 MW pour le bois-énergie… Mais les ONG n’en sont pas satisfaites : « Sans orientations sur l’évolution de la consommation et sur les autres sources de production, le nucléaire et les énergies fossiles, les objectifs d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique resteront des voeux pieux », regrette Réseau Action Climat dans un communiqué. La filière du biométhane en France a annoncé la naissance, ce mercredi 6 avril, de l’association France Biométhane, soit le « premier think tank dédié au biométhane », d’après un communiqué diffusé le même jour. L’objectif affiché de cette nouvelle structure est de montrer « comment le gaz vert joue un rôle important dans la transition énergétique actuelle ». Pour ce faire, et en collaboration avec le cabinet Sia Partners, France Biométhane a publié un observatoire de la filière, lequel « permettra de suivre le marché et les perspectives du biométhane en France et en Europe », explique l’association. Cette annonce n’est pas sans rappeler l’étude parue la semaine dernière par l’Académie des technologies et qui « appelle les pouvoirs publics à lever les freins techniques, économiques et réglementaires pour développer la filière biogaz ». » Ségolène Royal a chargé l’ancien ministre Pascal Canfin, le PDG d’Engie Gérard Mestrallet et l’économiste Alain Grandjean de lui faire des propositions concrètes sur la mise en place d’un prix du carbone. Ce dernier devra permettre « d’orienter les investissements des citoyens, des élus, des entreprises vers les projets et les produits les plus favorables au climat », détaille la ministre de l’Environnement dans un communiqué publié le 2 avril. Cette mission devra rendre ses conclusions avant le 1er juillet 2016. Elles contribueront, espère la ministre dans sa lettre de mission, aux travaux sur la révision de la directive du marché du carbone européen et la mise en place d’un corridor de prix du carbone ou d’un prix plancher. Ce groupe de travail entend également « donner une suite opérationnelle » aux propositions du rapport Canfin-Grandjean, remis à François Hollande en amont de la COP21. » Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du nord (Mena) pourraient effectuer de sacrées économies s’ils réalisaient leurs objectifs en matière d’utilisation des énergies renouvelables à l’horizon 2030, a indiqué le 4 avril à l’AFP Adnan Amin, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (Irena). « Nous aurons un bénéfice net d’environ 750 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie dans la région Mena » si ces pays réalisent chacun leur objectif d’utilisation d’EnR (entre 5 et 15 % d’ici 2030 selon les pays),a-t-il expliqué en marge d’une conférence sur les énergies renouvelables à Koweït. Bassam Fattouh, directeur de l’Oxford Energy Institute Studies, a de son côté jugé trop ambitieux les objectifs de la région Mena en matière d’EnR. Toujours selon l’AFP, plusieurs défis entravent la production d’énergies renouvelables dans la région, comme les monopoles d’État sur le secteur et un manque de capacités institutionnelles, a détaillé le spécialiste. Les investissements dans les énergies renouvelables au niveau mondial ont atteint en 2015 le montant record de 286 milliards de dollars, avance une étude réalisée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) avec Bloomberg New Energy Finance et l’université de Francfort. Un chiffre en hausse de 5,9 % par rapport aux 270 milliards de dollars investis en 2014 et qui vient dépasser le précédent record établi en 2011, à 278,5 milliards de dollars. Les pays émergents représentent la majeure partie de ces investissements, la Chine ayant investi à elle seule 103 milliards de dollars. Fait notable, en 2015, les investissements dans les EnR ont largement dépassé ceux dans les énergies fossiles, lesquels représentent 130 milliards de dollars. » Abengoa, dont la période de pré-dépôt de bilan arrivait à échéance hier mardi 28 mars (cf. L’Actu du 16 mars ), a annoncé avoir fait adopter par 75 % de ses créanciers une clause de « »standstill » » (gel de procédure), suspendant toute demande de paiement anticipé de leur part et la vente de participations pendant sept mois. Ce délai doit permettre au spécialiste des énergies renouvelables de finaliser son plan de sauvetage et la restructuration de sa dette afin d’éviter une faillite qui aurait été parmi les plus importantes d’Espagne. Le groupe espagnol affirme par ailleurs qu’il n’aura pas besoin de la totalité des sept mois pour parachever la négociation de son plan de sauvetage et que celui-ci sera prêt fin avril ou début mai. » L’Australie va investir un milliard de dollars australiens (environ 675 millions d’euros) dans un fonds dédié à l’innovation dans les énergies propres, a annoncé la semaine dernière le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Ce fonds pour l’innovation dans les énergies propres investira chaque année 100 millions de dollars australiens dans les entreprises et les technologies australiennes les plus pointues en matière d’énergie propre, a-t-il ajouté. Avec cette annonce, le Premier ministre semble vouloir se démarquer de son prédécesseur Tony Abbott, qu’il avait renversé en septembre 2015 lors d’un « »putsch » » interne. Ce dernier s’était distingué par une politique extrêmement conservatrice sur le dossier climatique, cédant notamment à la puissance des lobbys d’un secteur minier particulièrement important en Australie. » Les chiffres du marché 2015 des appareils domestiques de chauffage au bois publiés hier mardi 22 mars par Observ’ER (éditeur du Journal des Énergies Renouvelables) marque un nouveau recul des ventes après une année 2014 également décevante. L’an passé, l’activité des segments poêles, foyers fermés, chaudières et cuisinières s’est contractée de 12,4 % pour s’établir à 380 000 unités vendues. Loin de marquer une désaffection des Français pour ce type de chauffage, cette tendance est davantage le résultat d’éléments conjoncturels. L’hiver doux, le second après celui de 2014, et le faible coût des combustibles fossiles tels que le gaz ou le fioul ont pénalisé la filière bois. Cette dernière espère un rebond en 2016 à l’image des poêles à granulés qui est le seul segment à avoir vu ses ventes augmenter en 2015 (+7,5 %). » La campagne participative pour le financement du parc éolien de Soulanes de Nore à Albine, dans le Tarn, a connu un succès inespéré avec un montant de plus de 540 000 € prêtés par 368 personnes, ont annoncé le producteur du parc Valorem et la plateforme de financement participatif Lendosphere. Prévue initialement pour atteindre 250 000 €, cette campagne a été déplafonnée jusqu’à 500 000 € au bout de 21 jours. Un nouveau plafond dépassé une semaine avant le terme de la campagne, laquelle proposait un taux d’intérêt annuel brut bonifié, à 7 %, pour les habitants des communes proches du futur parc, expliquent les deux partenaires dans un communiqué publié lundi 21 mars. Après une première campagne au printemps 2015, rapidement déplafonnée elle aussi, 660 000 € ont été prêtés au total pour cette installation qui comptera huit éoliennes de 2 MW chacune, mises en service en 2017. » « Le scénario négaWatt doit aujourd’hui être renforcé, enrichi et mis à jour », explique l’association dans un communiqué publié hier mardi 22 mars, soit 5 ans après sa première mouture. Afin d’« alimenter le débat public sur la transition énergétique », négaWatt entend proposer « cet automne un nouveau scénario prospectif, encore plus complet » et qui intègrera le retard pris dans la transition énergétique et les évolutions du contexte depuis cinq ans. L’association a lancé pour cela une campagne de campagne de financement participatif, laquelle s’achève le 30 avril prochain et a pour objectif de réunir 40 000 €. « Si le scénario 2011 a été réalisé quasi-exclusivement grâce au bénévolat, ce ne sera plus possible en 2016, compte tenu des ambitions de l’association », indique-t-elle. » Selon les calculs, encore préliminaires, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les rejets carbonés du secteur énergétique se sont stabilisés en 2015 au niveau mondial, à 32,1 milliards de tonnes, alors que le monde a connu une croissance économique globale de plus de 3 %. C’est la deuxième année consécutive que l’agence observe un tel découplage entre émissions de gaz à effets de serre et croissance économique, se réjouit le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un communiqué publié ce mercredi 16 mars. L’année 2014 avait été également marquée par une stagnation des émissions de CO2 (principale source des émissions de gaz à effets de serre) malgré une croissance mondiale de 3 %. Tombant quelques mois après l’accord obtenu à la COP21, cette annonce constitue « un autre encouragement à lutter contre le changement climatique », ajoute-t-il. Et de souligner la baisse des émissions de la Chine et des États-Unis l’an dernier, ainsi que « le rôle crucial » joué par les renouvelables dans ce découplage. » Ormat a annoncé lundi 14 mars la signature d’un accord d’investissement et de participation avec Sageos, filiale à 100 % du BRGM, pour acquérir progressivement 85 % de Géothermie Bouillante (GB) qui détient et exploite une centrale géothermique d’environ 10 MW en Guadeloupe et possède deux permis d’exploration d’une capacité additionnelle de 30 MW. GB est actuellement détenue à 97,8 % par Sageos et à 2,2 % par EDF. Lors du bouclage de cet investissement, attendu au 2e trimestre 2016, l’entreprise américaine paiera 22 millions d’euros à Sageos pour une première acquisition de 79,6 % des parts de GB, puis investira 10 M€ supplémentaires dans les deux prochaines années, pour augmenter sa participation dans GB à 85 %. Ormat compte développer GB jusqu’à une puissance de 45 MW en 2021 après avoir, d’ici à mi-2017, retrouvé le niveau normal de production de l’installation existante, soit 14,75 MW. Abengoa a trouvé en fin de semaine dernière un préaccord avec ses créanciers. S’il est validé avant le 28 mars, ces derniers pourraient en prendre le contrôle, lui évitant de justesse la faillite. Très fortement endetté et ayant essuyé une perte nette de 1,2 milliard d’euros en 2015, le groupe espagnol d’énergies renouvelables, qui a démis son PDG au début du mois (cf. L’Actu EnR du 2 mars) ne peut plus fonctionner sans le soutien de ses créanciers. On devrait en savoir plus ce mercredi 16 mars, une conférence téléphonique étant programmée à 15h30. » Plus d’un million de personnes travaillaient en 2014 dans le secteur des énergies renouvelables au sein de l’Union européenne, selon la 15e édition de l’État des énergies renouvelables en Europe éditée par EurObserv’ER et mise en ligne hier mardi 8 mars. Un chiffre en légère baisse par rapport aux 1,15 million d’emplois totalisés l’année précédente, « conséquence de l’inquiétude des investisseurs face à l’affaiblissement des politiques d’incitation en faveur des énergies renouvelables dans de nombreux États membres et suite aux retombées indirectes de la crise financière au cours des dernières années », explique le document. L’éolien fait la course en tête des emplois dans les EnR (314 000) devant la biomasse (306 000), tandis que les emplois dans le solaire ont été particulièrement impactés. L’Allemagne (347 000 emplois), la France (170 000 emplois), le Royaume-Uni (98 000) et l’Italie (82 500) représentaient les plus gros marchés de l’UE en 2014. » Ségolène Royal a annoncé hier mardi 8 mars « l’ouverture d’une nouvelle enveloppe de 250 millions d’euros » en direction des 400 territoires à énergie positive (Tepos) « pour réaliser des travaux d’économies d’énergie, développer les énergies renouvelables et investir dans les transports propres ». Dans un communiqué, la ministre de l’Environnement précise que « cette enveloppe nouvelle va abonder le fonds de financement de la transition énergétique » et se félicite qu’en 2015, ce fonds ait permis de soutenir les projets de 260 Tepos, 153 territoires “zéro déchet, zéro gaspillage“ et « 25 villes respirables en cinq ans qui comptent 15 millions d’habitants ». » 40 MW d’installations produisant de l’électricité à partir de biogaz ont été raccordés en 2015, un niveau similaire à ceux observés depuis 2011, selon le tableau de bord Biogaz pour la production électrique publié récemment par le Commissariat général au développement durable (CGDD) Fin 2015, la France comptait ainsi 421 installations pour une puissance installée de 365 MW, un chiffre « conforme aux objectifs fixés pour la filière par le plan national d’action en faveur des énergies renouvelables ». Et de préciser que « L’année 2015 se distingue toutefois par un rythme de raccordements bien plus soutenu au premier semestre qu’au second ». 162 projets étaient en file d’attente fin décembre 2015, ajoute le CGDD. Ils représentent 116 MW, soit 18 % de plus que la puissance des projets enregistrés au 3e trimestre. » Ségolène Royal, via le fonds déchets de l’Ademe, a lancé hier, mardi 1er mars, le premier appel à projets « Energie CSR – produire de la chaleur à partir de combustibles solides de récupération issus de déchets ». Il soutiendra la création d’unités de production d’énergie à partir de combustibles solides de récupération (CSR) issus de déchets non recyclables et contribuera ainsi à la structuration d’une filière de valorisation énergétique des déchets, dans une logique d’économie circulaire, de préservation des ressources et d’indépendance énergétique, explique le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Son objectif est de susciter d’ici 2025 le développement de nouvelles unités permettant la valorisation de 1,5 million de tonnes supplémentaires de CSR par an, soit un potentiel énergétique de 100 MW/an. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 juin 2016. » Abengoa, au bord de la faillite, a annoncé ce mercredi 2 mars avoir démis de ses fonctions José Dominguez Abascal, son PDG nommé six mois plus tôt. Précédemment vice-président et conseiller coordinateur, Antonio Fornieles Melero, arrivé en 2015 du cabinet d’audit KPMG, lui succède. Une décision prise pour « faciliter l’accord de restructuration » de sa dette avec les créanciers d’ici la fin du mois, a expliqué le groupe espagnol d’énergies renouvelables dans un communiqué. En septembre 2015, Abengoa avait déjà remercié Felipe Benjumea, fils du fondateur, qui présidait le groupe depuis 25 ans. Pour rappel, l’industriel, placé en pré-dépôt de bilan le 25 novembre dernier, est engagé dans une course contre la montre pour éviter la faillite. Il a jusqu’au 28 mars pour éviter un dépôt de bilan, en parvenant à conclure une restructuration de sa dette et a annoncé mardi 1er mars des pertes de 1,2 milliard d’euros en 2015 et une dette brute de 9,4 milliards d’euros, au 31 décembre. Rendre obligatoire l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour tout projet d’éolienne visible depuis ou avec un monument historique situé dans un rayon de 10 kilomètres, c’est l’objet d’un nouvel article de loi adopté en première lecture au Sénat le 27 février et qui inquiète la profession. « Cette mesure entraînerait d’inévitables et nombreux blocages », explique le Syndicat des énergies renouvelables (SER) dans un communiqué du 29 mars qui rappelle l’existence de plus de 44 000 monuments historiques en métropole et leur proximité, de fait, avec les projets éoliens. Avec cette décision, l’ABF aurait « un pouvoir de codécision, pour ne pas dire un droit de veto » sur les futurs projets, déplore le SER. Le texte est à l’Assemblée nationale depuis le 1er mars pour une deuxième lecture. » Le réseau des incubateurs des Écoles des Mines et leurs partenaires organisent, en partenariat avec l’événement EVER Monaco 2016, un concours désigné METHA EUROPE 2016. Ce concours de projets innovants sur le thème de la ville durable porte sur 3 catégories : La société française spécialisée dans la gestion des parcs solaires et éoliens Greensolver a annoncé la semaine dernière sa fusion avec son homologue néerlandais PLY Energy. « Cette fusion fait de Greensolver le seul conseiller technique complet (due diligence, construction, gestion d’actifs) à avoir une si large présence, puisque six pays européens sont désormais couverts par nos équipes », s’est félicité Guy Auger, PDG de Greensolver, qui conserve ses fonctions suite à l’opération. PLY Energy, de son côté, apporte ses compétences « particulièrement pointues » en construction et HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), avance le communiqué. L’entité ainsi créée dispose désormais d’un effectif de 30 collaborateurs, d’un portefeuille d’actifs de 688 MW, d’une expérience de 804 MW en construction et négociation de contrat, et de 5,2 GW d’expérience en audit technique. À l’occasion de la réunion du Comité stratégique de la filière bois, Ségolène Royal a annoncé le 22 février le lancement du deuxième Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Dynamic Bois, doté de 20 millions d’euros. À travers cet AMI, le but est d’utiliser la ressource forestière de mauvaise qualité comme bois-énergie et de replanter des espèces plus nobles. L’Ademe vient par ailleurs de publier sur ce sujet deux documents : une présentation et une synthèse sur « les disponibilités forestières pour l ‘énergie et les matériaux à l’horizon 2035 ». Sur un autre sujet, la désormais ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a annoncé la semaine dernière la signature et la publication du décret simplifiant les appels d’offres pour les installations de production d’électricité, lequel « va permettre de réduire de 6 à 8 mois les délais de procédure ». » Statkraft et ses partenaires (TrønderEnergi et Nordic Wind Power) ont annoncé hier, mardi 23 février, un accord pour la construction du plus grand champ éolien onshore d’Europe, au centre de la Norvège. Représentant un investissement d’environ 1,1 milliard d’euros, ce projet d’une capacité installée totale de 1 GW comprendra six parcs éoliens, dont la construction devrait démarrer au printemps pour une mise en exploitation en 2020, précise le producteur norvégien d’électricité. Les 278 turbines de 3,6 MW chacune ont, elles, été commandées au Danois Vestas. Pour rappel, Statkraft avait renoncé une première fois en juin 2015 à un projet de cet ampleur, mais a repris les études en novembre pour trouver une solution plus économique sous la pression de l’État norvégien, son actionnaire à 100 %. Il faut dire que ce nouveau projet représentera plus que la capacité éolienne actuelle du pays. Ségolène Royal a annoncé ce mercredi 17 février qu’elle allait prendre la présidence de la COP21 jusqu’au passage de flambeau au Maroc, pays hôte de la prochaine conférence sur le climat, en novembre. Elle succède ainsi à Laurent Fabius, lequel avait annoncé lundi 15 février qu’il renonçait à la présidence de la COP21 afin d’éviter toute controverse. Jusqu’alors, il espérait cumuler cette fonction avec celle du Conseil constitutionnel. La désormais « ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat » a vu son portefeuille s’élargir à la faveur du remaniement de la semaine dernière. Dans le cadre de cette présidence, elle devra notamment préparer la réunion de l’Onu du 22 avril, qui doit lancer le processus de signature de l’accord de Paris sur le climat adopté en décembre et mettre en œuvre plusieurs grands projets initiés lors de la COP21. Signe des temps, Statoil a annoncé mardi 16 février le lancement d’un nouveau fonds de capital-risque voué « à investir dans des sociétés intéressantes et ambitieuses dans les énergies renouvelables, afin de soutenir sa stratégie de croissance dans de nouvelles solutions énergétiques ». Dénommé Statoil Energy Ventures, ce fonds investira 200 millions de dollars sur une période de quatre à sept ans, précise le groupe pétrolier norvégien. Il s’agit de « l’un des plus importants fonds de capital-risque d’entreprise au monde dédié aux énergies renouvelables », explique Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive en charge des nouvelles solutions énergétiques, citée dans un communiqué. Éolien terrestre et offshore, énergie solaire, stockage, transport, efficacité énergétique et smart-grids sont cités comme « thèmes de potentiels investissements » par Statoil. Un appel à projets régional pour des installations solaires thermiques collectives est ouvert depuis fin janvier, a rappelé mardi 16 février la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Il concerne la mise en place de nouvelles installations solaires thermiques, supérieures ou égales à 25 m2, pour des bâtiments neufs ou existants. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 29 avril. L’Ademe rappelle que l’aide sur l’étude de faisabilité solaire est toujours en vigueur et que, par ailleurs, il existe une dernière session en 2016 de l’appel à projets national spécifique aux grandes surfaces. » Les ministres de l’Écologie et de l’Économie ont lancé hier, mardi 9 février, l’appel à projets « GreenTech ». Ouvert aux « start-ups de la transition écologique pour la croissance verte », il sera doté d’une enveloppe d’environ 15 millions d’euros et cible huit secteurs clés, à commencer par les économies d’énergie (installation de compteurs intelligents, objets et applications connectés). D’autres applications seront encouragées dans le domaine des énergies renouvelables, pour « favoriser l’autoconsommation et l’effacement chez les particuliers ». Jusqu’à 50 projets pourront bénéficier d’un fonds de pré-amorçage de 150 000 euros chacun, soit 7,5 millions d’euros au total. Un supplément de 500 000 euros maximum sera accordé aux projets les plus prometteurs. Ségolène Royal a lancé lundi 8 février un appel d’offres de 60 MW par an sur trois ans pour les filières bois-énergie et méthanisation. Pour le volet bois-énergie, l’appel d’offres concerne les installations de moins de 25 MW et porte sur un volume de 50 MW par an, dont 10 MW réservés à des projets de moins de 3 MW. Son cahier des charges impose « la mise en œuvre des technologies de cogénération à haut rendement, le respect d’un seuil minimal d’efficacité énergétique de 75 % et l’utilisation de bois issu de forêts gérées durablement », afin de minimiser l’impact sur la ressource et d’éviter les conflits d’usage, indique le communiqué du ministère. S’agissant de la méthanisation, l’appel d’offres, d’un volume annuel de 10 MW, concerne les installations de moins de 5 MW et son cahier des charges restreint l’éligibilité aux projets ne créant pas de conflits d’usages, notamment avec les terres agricoles. Le soutien financier prendra la forme d’un complément de rémunération, est-il précisé. Les candidatures peuvent être déposées avant le 8 août 2016, pour une publication des résultats avant la fin de l’année. » L’objectif que la France s’est fixé en matière de développement de l’essence contenant de l’éthanol « ne semble pas atteignable à court et moyen termes », juge ce mercredi 10 février la Cour des comptes dans son rapport annuel. Celle-ci recommande de plus fortes incitations fiscales. Tout en notant les « progrès indéniables » réalisés pour respecter les objectifs d’incorporation de biocarburants (biodiesel et éthanol) dans les carburants classiques depuis son précédent rapport sur le sujet en 2011, la Cour estime qu’il faut encore faire évoluer certains des instruments de soutien, surtout pour l’essence. Car, si la cible pour le biodiesel (incorporation de 7 % au gazole) a été atteinte dès 2013, la France peine toujours à satisfaire son ambition dans l’éthanol (incorporation de 7,7 % à l’essence), dont le taux d’incorporation dépassait à peine les 6 % fin 2014, « pénalisée par une distribution insuffisante », déplore l’institution. » « La Réunion est désormais en mesure d’intégrer davantage d’énergies renouvelables et d’atteindre, pour la première fois en France, un taux d’énergies intermittentes instantané de 32 % », a annoncé hier mardi 2 février le patron d’EDF, Jean-Bernard Lévy, à l’occasion de l’inauguration d’un dispositif associant équipements photovoltaïques et technologie de batteries à hydrogène dans une zone isolée de l’île. Cette annonce est une première en France, où le seuil d’intégration d’électricité d’origine renouvelable sur un réseau était jusqu’alors plafonné à 30 %. Une avancée « permise par les performances de la batterie EDF de Saint-André (dans le nord-est de l’île) d’une puissance d’1 MW, l’un des plus gros stockages d’énergie existants en Europe », assure EDF. « En repoussant la limite de sécurité à 32 %, EDF pourra diviser par trois en 2016 le nombre de jours de connexion des producteurs d’énergies renouvelables. L’énergie perdue par la collectivité sera ainsi réduite de 80 % », se réjouit l’énergéticien. RES fait une première incursion en Auvergne, avec la mise en service du parc éolien de Bajouve, situé sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze (Puy-de-Dôme). Composé de six éoliennes Vestas dont les mâts sont fournis par Francéole, « seul fabricant français de mâts acier d’éoliennes », précise RES. D’une puissance totale de 12 MW, cette installation permettra une production annuelle de 26,4 GWh, avance l’installateur, s’appuyant sur « les mesures de vent réalisées sur site depuis plusieurs années ». Cette nouvelle réalisation, qui sera inaugurée au printemps, porte à 499 MW les capacités éoliennes installées par la compagnie française sur le marché national, se félicite le groupe. Et d’ajouter que « Le parc éolien de Bajouve est le premier de ces cinq parcs à être mis en service et la dynamique se poursuivra tout au long de l’année 2016 ». La ville de Dammarie-les-Lys a renouvelé à Engie Réseaux, pour 27 ans, le contrat pour l’exploitation de son réseau de chaleur, lequel sera désormais alimenté à près de 90 % en énergie géothermique. Selon les termes de ce contrat de délégation de service public, la filiale d’Engie s’engage à mener d’importants travaux de conversion des installations, jusqu’à présent alimentées au gaz. « La modernisation du réseau de chaleur, rebaptisé Géodalys, débutera ainsi fin 2016 avec le forage d’un doublet géothermique à 1 800 mètres de profondeur, puis la construction de la centrale géothermique », annonce la ville, Engie Réseaux et Géodalys dans un communiqué commun. Le réseau actuel de 5 km sera, dans un second temps, rallongé de 1,5 km. Le réseau de chaleur ainsi constitué aura une puissance totale de 30 MW, pour un budget de 20 millions d’euros. France Énergie Éolienne (FEE) a un nouveau président depuis hier, mardi 26 janvier. Son nouveau conseil d’administration, élu à l’occasion de son assemblée générale tenue le même jour, a nommé Olivier Perot pour un mandat de deux ans. Directeur de Senvion Europe Sud-Ouest, il succède à Frédéric Lanoë, qui assurait la présidence de FEE depuis novembre 2013. Contacté par Le Journal des Énergies Renouvelables, ce dernier souhaite à son successeur « Des actions gouvernementales en 2016, même si la loi de transition est dernière nous. Il faut maintenant se donner les moyens du 40 % d’électricité renouvelable ». À l’heure de tirer un bilan de son action, le désormais ancien président affiche trois satisfactions : « Avoir restauré le marché de l’éolien terrestre », « avoir forgé France Énergie Éolienne, qui devient le bras armé de la transition énergétique » et l’essor de l’éolien flottant, « puisque la France, avec le récent appel à projets, est dans la course internationale ». Frédéric Lanoë confesse cependant un bilan « en demi-teinte » sur l’offshore fixe.Enfin, l’ancien président identifie plusieurs priorités pour FEE, dont la Programmation pluriannuelle de l’énergie : « Il faut une ambition de 2 GW d’éolien terrestre par an d’ici à 2023 ». Mais le « grand chantier » est « que les décrets de la loi de transition arrivent et soient ambitieux pour limiter les temps de raccordement des parcs et rendre les contraintes militaires plus transparentes ». Et de rappeler que « 40 % du territoire est neutralisé de manière abusive ». Frédéric Lanoë évoque également le « chemin de croix des recours. Les recours offshore ont été accélérés, alors pourquoi pas dans le terrestre ? », soulève-t-il. La première hydrolienne du projet Paimpol-Bréhat d’EDF a été mise à l’eau avec succès mercredi 20 janvier, ont annoncé EDF et le constructeur naval DCNS. La turbine de 16 mètres de diamètre est la première d’un parc démonstrateur de deux hydroliennes, lesquelles « formeront le premier parc, en France et dans le monde, d’hydroliennes raccordées au réseau national de distribution d’électricité », se félicitent les deux groupes. Implantées à près de 40 mètres de profondeur au large de Ploubazlanec, dans les Côtes-d’Armor (22), les turbines d’1 MW de capacité seront reliées à un convertisseur sous-marin conçu par General Electric, qui transformera l’énergie produite en courant continu. « En parallèle, l’assemblage de l’hydrolienne numéro deux se poursuit sur le site de DCNS de Brest », indiquent les deux partenaires qui précisent que la « prochaine étape importante » sera le raccordement de la première turbine au réseau électrique. Abengoa a présenté lundi 25 janvier au conseil d’administration un plan d’action pour lui éviter la faillite. Principale mesure de ce plan, la vente d’actifs non fondamentaux dont ceux de la première génération de production de biocarburants, selon un communiqué publié par le producteur espagnol d’énergies renouvelables. Abengoa entend désormais se recentrer sur l’ingénierie et la construction d’installations et donc créer une nouvelle entité, plus petite et moins endettée. Grâce à ce plan de restructuration, le groupe va engager des négociations avec ses créanciers concernant une restructuration de sa dette et les ressources nécessaires pour poursuivre son activité. Dans les prochaines années, Abengoa aura des niveaux de revenus de l’ordre des deux tiers de ceux obtenus en 2014 (7 milliards d’euros), prévient le groupe espagnol. Pour rappel, l’entreprise, plombée par une dette brute de près de 9 milliards d’euros, s’était déclarée le 25 novembre 2015 en pré-dépôt de bilan. Dans le cadre de cette procédure, le groupe a jusqu’au 28 mars pour trouver un accord avec ses créanciers.FéVRIER 2026
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2026
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2025
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
À l’issue d’une pré-sélection réalisée par un comité d’experts, les 12 innovations sélectionnées seront mises en valeur au sein d’un espace dédié, la Galerie de l’innovation, au cœur du Forum (Hall B3). Les lauréats seront dévoilés à l’issue de live pitchs devant le jury et les visiteurs, lors d’une cérémonie de remise des prix organisée sur le salon le 12 décembre.
La Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée décernera également un Prix spécial Coup de Cœur à l’un de 12 projets nommés.
Pour découvrir les nominés et assister aux live pitchs, rendez-vous sur le Forum EnerGaïa les mercredi 11 et jeudi 12 décembre.
>> Prenez votre badge visiteur directement en ligne sur www.energaia.frSEPTEMBRE 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
AOûT 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AOûT
JUILLET 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2024
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2023
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2022
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2021
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2020
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
Dans le cadre de son Plan Climat « Une COP d’avance », la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de mettre à la disposition d’investisseurs des surfaces sur l’aérodrome de Berre la Fare afin de réaliser et exploiter des installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque raccordées au réseau.
En application de l’art. L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur lance à cette fin un appel à propositions ayant pour finalité la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels sur le domaine public.
Date limite de remise des candidatures et des offres : 14 octobre 2019 à 12h
Vous pouvez télécharger le dossier de consultation de l’appel à propositions en cliquant iciJUIN 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
Le modèle SG250HX est l’onduleur string, 1500 Vdc le plus puissant au monde avec ses 250 kW. Avec leur tension d’entrée de 1500 Vdc et leur tension de sortie de 800 Vac, il est possible d’économiser sur les câbles DC et AC. L’onduleur présente une efficacité maximale de 99 % et est compatible avec les modules PV biface, ce qui augmente son rendement. Le système comporte par ailleurs 12 MPPT (Maximum Power Point Tracker) et peut s’intégrer à une configuration flexible en blocs totalisant jusqu’à 6,3 MW de puissance. Il s’adapte donc parfaitement à des installations PV en terrain accidenté par exemple.
Grâce notamment à son indice de protection IP66 et à son degré de protection anti-corrosion C5, cet onduleur compact convient particulièrement aux conditions difficiles telles que les déserts et les zones côtières. Avec sa technologie de refroidissement par air forcé, le SG250HX peut fonctionner à des températures extrêmement élevées. Le système intègre aussi les fonctions de diagnostic de panne et de traceur de courbe IV, associées au dispositif de contrôle de Sungrow, qui facilite son fonctionnement et sa maintenance. La fonction anti-PID (anti-PID) intégrée limite nettement la dégradation des modules tandis que le Courant porteur en ligne (CPL) optionnel permet de réduire les coûts d’installation, sans nécessiter de câblage de communication supplémentaire. L’onduleur peut être relié à un dispositif de stockage par l’intermédiaire d’une interface de stockage intégrée et permet donc une évolution des installations aujourd’hui sans stockage.
« C’est pour nous un immense plaisir de présenter une technologie d’onduleur string d’un genre nouveau sur le marché européen. Elle a le potentiel pour permettre à nos clients d’optimiser leur ROI » a indiqué Stefan Froböse, Directeur technique de Sungrow EMEA.
L’Europe enregistre actuellement une hausse d’activité dans le domaine solaire non subventionné. Dans le même temps, les PPA (contrats d’achat direct d’électricité verte) privés gagnent en importance dans le domaine des énergies renouvelables. Sungrow s’est fixé comme objectif d’atteindre une parité réseau en Europe en proposant toujours plus d’innovations techniques et en faisant un pas de plus dans sa recherche internationale « d’énergie verte pour tous ».
À propos de Sungrow
Sungrow Power Supply Co., Ltd (« Sungrow » est l’un des premiers fournisseurs de solutions d’onduleurs au monde pour les énergies renouvelables, avec plus de 82 W installés dans le monde (mars 2019). Fondée en 1997 par le professeur Renxian Cao, Sungrow occupe désormais une place de leader dans la recherche et le développement d’onduleurs solaires. L’entreprise dispose ainsi des plus gros effectifs de R&D du secteur et d’un large portefeuille de produits pour des solutions d’onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie destinés à de grosses centrales PV, à des applications industrielles et à des installations dans des habitations privées, de même qu’à des centrales photovoltaïques flottantes, reconnues au plan international. Sungrow peut s’enorgueillir de 22 années d’expérience fructueuse dans le domaine photovoltaïque. Nos produits alimentent en énergie des installations PV dans plus de 60 pays et notre part de marché s’établit à plus de 15 %. Pour en savoir plus sur l’entreprise, consultez www.sungrowpower.comMAI 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2019
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2018
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
JANVIER 2017
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER
DéCEMBRE 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE DéCEMBRE
NOVEMBRE 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE NOVEMBRE
OCTOBRE 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE OCTOBRE
SEPTEMBRE 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE SEPTEMBRE
JUILLET 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUILLET
JUIN 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JUIN
MAI 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MAI
AVRIL 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE AVRIL
MARS 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE MARS
FéVRIER 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE FéVRIER
Un lauréat sera désigné pour chaque catégorie. Les dossiers très simplifiés et faciles à remplir devront être demandés et retournés par voie électronique, dûment complétés avant le 13 mars 2016 à minuit à : isabelle.ferlin@mines-douai.fr JANVIER 2016
L’ESSENTIEL DES ENR DU MOIS DE JANVIER