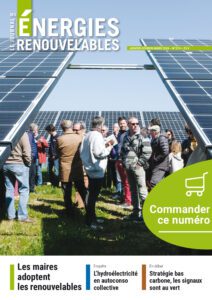Thyssenkrupp rothe erde a équipé son usine de fabrication de couronnes d’orientation et de roulements en acier de Lippstadt, située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d’une unité pilote de pyrolyse de la biomasse. L’usine va ainsi consommer 2 500 tonnes par an de déchets de bois pour produire 5 300 MWh de chaleur, de quoi couvrir 80 % des besoins de chaleur du site. Cela correspond aux besoins annuels de 300 foyers. Le bois sera carbonisé à 700°C par pyrolyse, ce qui permettra de produire également environ 640 tonnes par an de biochar, un sous-produit riche en carbone pouvant notamment servir à amender les terres agricoles. De cette façon, le procédé sera en mesure de séquestrer 1 500 tonnes de CO2 par an. « Une tonne de biochar emprisonne environ 2,5 à 2,8 tonnes de CO2, selon sa teneur en carbone et son utilisation ultérieure. Le biochar est produit dans le cadre d’un processus sans combustion. Lorsqu’il est utilisé comme matériau de remplissage dans les matériaux de construction, le CO2 est stocké dans un puits de carbone permanent pendant des milliers d’années », explique Caspar von Ziegner, président directeur général de Novocarbo, start-up allemande spécialisée dans l’élimination directe du carbone (Carbon Dioxide Removal ou CDR) et négociant les certificats de carbone sur le marché européen.
Archives
Qualit’EnR met en garde contre les éco-délinquants
L’organisme de qualification Qualit’EnR aurait reçu plus de 500 réclamations entre janvier et mi-novembre 2022 portant principalement sur des entreprises se réclamant QualiPAC et Qualibois, et propose donc 10 conseils pratiques pour lutter contre les éco-délinquants. D’après l’organisme, les victimes d’arnaque sont généralement des personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées ou isolées), bénéficiant d’aides financières, ou propriétaires de maisons individuelles anciennes. Il est donc conseillé de vérifier, sur le site de France Rénov’ ou auprès de l’organisme de qualification dont elle se réclame, que l’entreprise effectuant les travaux est bien qualifiée RGE. Il est également recommandé de s’assurer que le document remis au client potentiel pour signature lors de la visite correspond à un devis et non à un bon de commande. Il est rappelé qu’il est nécessaure de comparer plusieurs propositions concurrentes avant de passer commande. Les travaux proposés, même pour une PAC, ne durent généralement pas moins de 1 à 3 jours, suivant les modèles. Enfin pendant le chantier, exiger de l’installateur la remise d’une étude thermique, une facture détaillée avec les différents équipements et la main-d’œuvre, et une proposition de contrat de maintenance. D’après Qualit’EnR il est possible d’identifier les entreprises éco-délinquantes car elles présentent certaines caractéristiques récurrentes : leurs discours se concentrent rapidement sur le chiffrage et la rentabilité, et elles proposent des crédits de façon quasi-systématique. Elles ne font pas d’évaluation technique de l’installation en place ou du bâti, se déplacent souvent avec une imprimante et invitent à signer directement sans possibilité de rétractation prétextant une « promotion à saisir ». Pour rappel, si vous êtes victime d’arnaques vous pouvez contacter Qualit’EnR avec le formulaire suivant https://www.qualit-
Un réseau de chaleur alimenté au bois près de Toulouse
Le 21 novembre, Charnwood Energy a annoncé la mise en service d’un réseau de chaleur urbain alimenté au bois énergie près de Toulouse. Cette entreprise est spécialisée dans les procédés énergétiques utilisant la biomasse, directement ou par gazéification. Ce réseau a été développé pour le compte de son client Engie Solution, qui exploitera les deux chaudières biomasses d’une puissance totale de 4,7 MW (et deux chaudières gaz de secours) ainsi que les trois kilomètres du réseau de chaleur, comprenant 24 sous stations, et qui desservira à terme 1 200 logements, et 23 300 m2 de surface commerciale et de bâtiments publics de la ZAC Guillaumet à Toulouse.
Du lithium décarboné en Alsace
Le groupe australien, Vulcan Energy, annonce le démarrage en France de son activité de production d’énergies renouvelables et de lithium décarboné. L’entreprise entend engager en Alsace des projets de géothermie profonde exploitant les ressources géothermales de la vallée du Rhin. Les saumures géothermales présentant une forte concentration en lithium (214 mg/l), elles permettent à la fois de produire de la chaleur renouvelable et du lithium destiné à l’industrie des batteries. Vulcan Energy a déposé dans le nord de l’Alsace une première demande d’octroi de permis exclusif de recherches (PER) de mines de lithium et autres substances connexes, intitulé « Les Cigognes ». Le groupe déposera prochainement d’autres demandes de permis exclusifs de recherche. Vulcan est en discussion avec des entreprises implantées dans la région pour développer en Alsace des projets combinés de géothermie et de lithium, permettant de soutenir les industriels et les municipalités dans leur approvisionnement en énergies renouvelables et la consommation le cas échéant d’un lithium décarboné. En Allemagne, l’entreprise a déjà obtenu le permis d’exploiter une dizaine de sites.
La Commission européenne souhaite accélérer l’octroi de permis
Les 20 et 21 octobre dernier, le Conseil européen a appelé à accélérer les procédures d’octroi de permis pour le développement des énergies renouvelables, prévues par le plan REPowerEU. C’est pourquoi la Commission européenne a proposé le 9 novembre de mettre en œuvre un nouveau règlement temporaire d’urgence intitulé « Proposal for a Council Regulation laying down a framework to accelerate the deployment for renewable energy ». La récente détérioration de la situation des marchés et la volonté européenne de s’émanciper de l’énergie fossile russe ont conduit à proposer des mesures d’urgence supplémentaires, après celles déjà mises en place par REPowerEU. Concrètement, si ces mesures étaient adoptées, elles permettraient aux procédures d’octroi de permis pour les installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier d’une évaluation simplifiée pour les dérogations spécifiques en matière d’environnement, et clarifierait certaines règles relatives aux oiseaux et habitats naturels. La Commission propose également un délai maximal d’un mois pour les autorisations concernant le solaire, leur unité de stockage et leur raccordement au réseau, ainsi que l’exemption de certaines évaluations environnementales. Les projets de repowering seraient quant à eux simplifiés et accélérés en limitant les évaluations environnementales aux seuls effets potentiels résultant de la transformation des sites.
PPA renouvelables sans risque pour les industriels
Afin de soutenir le développement de contrats de long terme d’approvisionnement en électricité (power purchase agreement ou PPA), le gouvernement a présenté un nouveau fonds de garantie destiné aux industriels. Il vise à couvrir le risque de défaut des acheteurs et permettrait de sécuriser une partie du coût d’approvisionnement en électricité renouvelable. Le dispositif sera opéré par Bpifrance, la banque publique d’investissement dont la mission est de financer le développement des entreprises, et pourrait concerner des PPA à partir de 2023. La somme constituant le fonds n’est pas encore précisée, mais ce dernier sera dimensionné pour couvrir la consommation équivalente à une ville comme Bordeaux. Il devrait être en partie alimenté par les revenus excédentaires des contrats de complément de rémunération en période de prix de marché supérieur aux tarifs d’achat public.
Nette progression du marché en 2021
En complément de son travail sur les applications individuelles solaires thermiques, Observ’ER vient de mettre en ligne un second volet consacré aux installations collectives en France. Cette étude associe un suivi quantitatif des ventes du segment à un volet qualitatif, qui commente plus en détail l’actualité des 18 derniers mois. Si, globalement, l’orientation du marché français a été en nette progression en 2021, la bonne activité (33 120 m2, départements et régions d’Outre-mer compris) a surtout été le fait d’opérations de grande taille. En effet, trois réseaux de chaleur (Narbonne, Pons et Cadaujac) ont permis l’ajout d’un total de près de 5 700 m2 de capteurs solaires thermiques. Dans le secteur industriel, les résultats ont été encore plus impressionnants avec notamment la mise en service de la centrale solaire du site de la malterie franco-suisse à Issoudun (15 580 m2). Ces projets sont le plus souvent issus du dispositif d’appels à projets animé par l’Ademe, qui vise spécifiquement ce type de réalisations, et dont les lauréats bénéficient de subventions à l’investissement provenant du Fonds chaleur. Après plusieurs années de gestation, plus d’une quinzaine d’installations solaires thermiques de grande surface sur sites industriels ou réseaux de chaleur sont ainsi dernièrement entrées en service en France. La crise économique a jeté une lumière nouvelle sur les technologies solaires thermiques et plusieurs très grosses réalisations ont été mises en place, venant valider techniquement les solutions. Ce segment est désormais l’un des principaux relais de croissance identifiés par les professionnels de la filière. L’étude est en téléchargement libre sur le site de l’Observatoire des énergies renouvelables.
Énergies marines, un potentiel largement inexploité
Le dernier baromètre EurObserv’ER publié en octobre traite des énergies marines renouvelables dans l’Union européenne. Les énergies marémotrice, houlomotrice, hydrolienne, ou encore thermique des mers, bien que très peu développées à l’échelle industrielle, comptent de nombreux prototypes. Ces sources peuvent présenter plusieurs avantages pour le réseau électrique : leurs productions sont relativement stables dans l’année et sont aisément prédictibles. Surtout, leur potentiel est énorme. En 2021, l’Union européenne comptait 21 sites en activité, soit 249,2 MW installés. Leur production s’est élevée à 502,8 GWh, en grande majorité issue de l’usine marémotrice de La Rance en France qui reste aujourd’hui encore, et de loin, la principale installation d’énergie marine en Europe (240 MW). D’ici 2030, l’Europe souhaite atteindre 1 GW d’installations et 40 GW en 2050. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Commission soutient financièrement la quasi-totalité des projets pilotes à travers différents programmes, tels que Forward-2030 qui vise à accélérer le déploiement des projets marémoteurs. Pour Ocean Energy Europe, l’association regroupant les professionnels de la filière, ce sont près de 100 GW qui pourraient être installés en Europe à l’horizon 2050.
50 % de croissance dans le résidentiel en 2021
Observ’ER vient de mettre en ligne deux études de suivi du marché des applications individuelles solaires thermiques en France. Une première analyse se penche sur les chiffres du marché 2021 et les résultats sont bons. Après plus d’une décennie de bilans décevants, le segment des applications individuelles a connu une croissance particulièrement importante l’an passé. Les ventes de chauffe-eau solaires individuels (CESI) et de systèmes solaires combinés (SSC) ont progressé de plus de 50 % en métropole pour s’établir à 34 550 m2, contre 22 530 en 2020. Dans les territoires d’outre-mer, l’activité enregistre certes un recul en 2021 (89 050 m2 contre 101 285 m2 en 2020) mais reste à un niveau largement supérieur à celui de la métropole. Portés par des subventions finançant une large part des équipements, les chauffe-eau solaires individuels équipent désormais une bonne partie des particuliers des départements et régions d’outre-mer (DROM). La seconde étude est qualitative. Elle se base sur une dizaine d’entretiens avec des professionnels du secteur. Pour les acteurs du marché, la crise énergétique, l’augmentation des prix de l’électricité ou du gaz et la volonté d’autonomie toujours plus affirmée de la part des consommateurs sont les moteurs de ce rebond. Leurs perspectives à moyen terme sont bonnes puisque l’activité au cours du premier semestre 2022 continue de progresser. Les entreprises saluent également le rôle de MaPrimeRénov’, qui a permis d’élargir le nombre de consommateurs concernés, car le dispositif propose des aides financières bonifiées pour les revenus les plus modestes. En revanche, les professionnels estiment que la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE2020, ne valorise pas correctement les solutions solaires, prolongeant ainsi un biais déjà dénoncé dans la précédente réglementation (RT2012). Les deux études sont librement disponibles en téléchargement sur le site d’Observ’ER.
Renouvelables en Europe : le défi à relever d’ici à 2030
Dans sa mission d’observation des dynamiques des énergies renouvelables en Europe, EurObserv’ER propose une première estimation de la part de ces filières dans la consommation brute d’énergie finale pour chacun des États membres de l’Union européenne à fin 2021. Alors que l’UE à 27 avait affiché un ratio global de 22,09 % fin 2020, réalisant ainsi son objectif de 20 %, l’ensemble de l’Union aurait peu progressé en 2021. Les premières estimations avancent une part de 22,45 %, soit 0,36 point de mieux en un an. L’ensemble des filières renouvelables a fourni 15,2 Mtep d’énergie en plus l’an passé, passant de 209,6 à 224,8 Mtep, soit une croissance de 7,3 %. Toutefois, la consommation totale brute d’énergie finale (renouvelable et non renouvelable) de l’Union européenne aurait nettement augmenté, passant de 948,9 à 1 001,6 Mtep (+5,6 %). Ce phénomène s’explique essentiellement par l’effet de rattrapage de l’activité économique après une année 2020 marquée par un exceptionnel ralentissement mondial. La photo détaillée par pays permet de se rendre compte que des États membres auraient reculé en 2021, passant même pour certains en deçà de leur objectif fixé à fin 2020. C’est le cas du Luxembourg (passant de 11,7 % à 10,01 % pour un objectif 2020 à 11 %), de la Belgique (passant de 13 % à 11,4 % pour un objectif 2020 à 13 %) mais surtout de l’Irlande (passant de 16,16 % à 12,87 % pour un objectif 2020 à 16 %). Ces pays avaient utilisé en 2020 un mécanisme de flexibilité prévu par la directive énergies renouvelables permettant d’afficher dans leur bilan des Mtep produits dans un autre pays de l’Union avec lequel ils auraient passé un accord. Les données sur les transferts réalisés en 2021 n’étant pas encore publiques, EurObserv’ER ne les a pas intégrées dans sa simulation. La publication des premiers résultats officiels, probablement fin décembre, sera l’occasion de voir si ces pays ont reconduit ces transferts statistiques. Et la France dans tout cela ? Elle gagne à peine 0,2 point avec 19,3 % de part des énergies renouvelables dans son bilan total. Le pays, qui n’avait pas eu recours à des transferts l’an passé, n’a donc toujours pas atteint le seuil de 23 % fixé pour 2020 et affiche désormais une différence de 13,7 points à combler d’ici à 2030 pour atteindre le prochain objectif de 33 %. Le défi est gigantesque. D’une part, il implique une croissance deux fois plus importante des énergies renouvelables que celle constatée au cours de la dernière décennie. D’autre part, l’objectif national devrait, en toute logique, encore être rehaussé si l’Union européenne valide son programme RepowerEU qui vise une part de 45 % d’énergies renouvelables en 2030, contre 40 % pour l’instant.