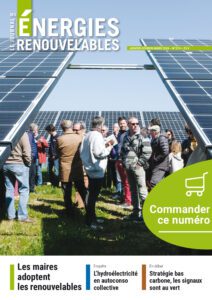Le 14 mars dernier, la commune de Limoux dans l’Aude a inauguré sa nouvelle chaufferie bois, construite sur le site d’une ancienne tuilerie. Sur trois kilomètres de réseau est raccordée toute une série de bâtiments publics, logements collectifs et individuels (l’USSAP-ASM, l’hôpital de Limoux, l’Ehpad Chénier, l’institut Saint-Joseph, le groupe scolaire Jean-Moulin, les HLM d’Alogea, le foyer des jeunes travailleurs, Aude Urgence Accueil…). Ce projet va aussi permettre la valorisation de la filière bois de la Haute Vallée de l’Aude qui approvisionnera la chaufferie avec quelque 2 000 tonnes par an. Le programme a mobilisé un budget de près de 5 millions d’euros pour lequel le Département a été sollicité, au titre de l’aide aux communes, à hauteur de 250 000 €. La Région Occitanie et l’Agence de la transition écologique (Ademe) ont également été partenaires du projet.
Archives
Une plateforme de recherche dédiée au biogaz
Le 15 mars dernier, Teréga, l’INSA de Toulouse et le collecteur de biodéchets Cler Verts, ont inauguré une nouvelle plateforme de recherche et développement baptisée Solidia Biogaz, située sur la commune de Bélesta-en-Lauragais, en Haute-Garonne. Le site, dans sa configuration initiale, accueillait des projets de recherches centrés sur les procédés de méthanisation et la valorisation des déchets organiques. La nouvelle plateforme est dédiée à l’enrichissement et à la valorisation du biogaz en biométhane injecté. La R&D utilisera du biogaz brut issu de l’usine de biodéchets de Cler Verts et de l’hydrogène produit par électrolyse à des pressions allant jusqu’à 10 bars. La plateforme pourra accueillir simultanément jusqu’à six pilotes de taille semi-industrielle : trois emplacements sous une halle couverte et trois emplacements extérieurs. Elle est destinée à tous les acteurs de la filière biogaz : développeurs de technologie, PME, grands groupes, universités et laboratoires de recherche. L’objectif est de réaliser des études de phénomènes à grande échelle et d’accompagner les différents acteurs vers l’industrialisation.
Injection de biogaz hybride dans le Puy-de-Dôme
Le Valtom, syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme va faire appel à Waga Energy pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Puy-Long situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L’unité Wagabox, développée par Waga Energy traitera le gaz émis par les déchets enfouis mais aussi le biogaz d’une usine de méthanisation voisine exploitée par la société Vernéa. Il s’agit d’un projet de production de biométhane à partir d’une source de biogaz hybride. Le mélange de ces deux flux fournira du biogaz suffisant pour réaliser un projet d’injection de biométhane dans le réseau de GRDF. 15 GWh de biométhane par an seront fournis au réseau de distribution de gaz, soit l’équivalent de la consommation de plus de 2 000 foyers.
Yvelines : une copropriété de taille chauffée à la géothermie
Remplacer le gaz par la géothermie, c’est ce que s’apprête à faire le réseau de chaleur de la copropriété de Parly 2 qui comprend 7 500 logements sur 37 résidences au Chesnay-Rocquencourt dans les Yvelines. Construit il y a cinquante ans, il devrait ainsi éviter l’émission de 18 500 tonnes de CO2 par an. La centrale géothermique exploitera les calories de la nappe du Dogger grâce à un doublet géothermal descendant à plus de 1 500 mètres sous terre où l’eau est à 61 degrés, et permettra au réseau d’être alimenté à 75% par de l’énergie renouvelable. Elle sera construite et exploitée jusqu’en 2053 par Engie Solutions, déjà exploitant du réseau de chaleur, sur une parcelle mise à disposition pendant trente ans par le département. Les travaux de forage pour la mise en place du doublet géothermal devraient démarrer à la fin de l’année, la mise en service étant prévue pour octobre 2025. 71 000 MWh d’énergie seront alors livrés par an à la copropriété de Parly 2, mais aussi à la copropriété Nouvelle France, l’hôpital Mignot, plusieurs bâtiments communaux du Chesnay-Rocquencourt, deux groupes scolaires et le collège Charles Péguy, soit l’équivalent de 9 000 logements. Une société de production, baptisée « Géomy3 », a été créée pour l’occasion par Engie Solutions avec la copropriété pour actionnaire ainsi que la Ville du Chesnay-Rocquencourt et le Département des Yvelines. Le montant de l’opération s’élève à 30 millions d’euros. Une deuxième phase est à l’étude afin d’alimenter les communes voisines de Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Bougival et Noisy-le-Roi.
Everfuel et Hy24 s’associent
Le développeur danois de projets d’hydrogène vert, Everfuel, et le gestionnaire français du fonds d’infrastructure d’hydrogène décarboné, Hy24, ont annoncé la création d’une filiale commune pour accélérer le développement de la production d’hydrogène par électrolyse dans les pays nordiques. La coentreprise combinera l’expertise d’Everfuel dans le développement de capacités de production d’hydrogène vert en Europe, et l’expérience industrielle et financière en gestion d’actifs d’Hy24 pour accélérer le développement de nouveaux projets au Danemark, Norvège, Suède, et la Finlande. La nouvelle société prévoit d’investir 200 millions d’euros en fonds propres pour le déploiement de ses projets avec pour objectif d’opérer jusqu’à 1 GW de production d’hydrogène dans ces pays. Une première opération a déjà été réalisée avec l’acquisition du projet HySynergy, un électrolyseur de 20 MW situé à Fredericia au Danemark. Prévu pour entrer en production au second trimestre 2023, ce site contribuera à réduire les émissions des procédés industriels de la raffinerie de Crossbridge Energy, adjacente à l’unité de production d’hydrogène vert, et offrira également de l’hydrogène vert pour la mobilité. La production d’électricité provenait au Danemark en 2021 déjà à 72 % des énergies renouvelables et de récupération, éolien avant tout (55 % en 2022), mais aussi de la biomasse, du solaire et de la valorisation des déchets.
Nouvelle chaufferie biomasse à Rennes
L’usine automobile Stellantis (ex-PSA) de Rennes-La Janais, annonce la signature d’un contrat de chaleur renouvelable avec Engie Solutions. Avec le soutien de l’Ademe pour 3,5 millions d’euros, Engie Solutions va investir dans la construction d’une chaufferie biomasse de 8 MW sur la zone d’activité de La Janais située sur la commune de Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes. Un réseau de trois kilomètres va être construit pour alimenter en chaleur le site, ce qui permettra d’effacer 45 % de la part de gaz dédié au chauffage de l’usine. D’autres bâtiments situés au sein de la zone d’activité pourront aussi bénéficier de cette chaleur renouvelable. Avec plus de 2 000 salariés, Stellantis Rennes est un acteur économique important du bassin rennais. En activité depuis 1961, le site assure chaque année la production des Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross thermiques et hybrides.
Nouveau réseau de chaleur à Garges-lès-Gonesse
Le groupe Coriance annonce la signature d’un contrat de délégation de service public avec la ville de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) pour la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur. La chaleur sera produite localement grâce à de la géothermie (62 %) et à la valorisation de la chaleur fatale issue de la station d’épuration de Bonneuil-en-France (35 %). Du biogaz sera utilisé en appoint (3 %). Les travaux de création du réseau de distribution de la chaleur débuteront en 2023 et fin 2024, les équipements permettant la récupération de chaleur sur les eaux usées de la station d’épuration seront mis en service. Au cours de l’année 2025, la centrale géothermale sera mise en service. Elle comprendra un doublet de géothermie associé à des pompes à chaleur et deux chaudières fonctionnant au biogaz, utilisées en appoint et secours. L’équivalent de 9 300 logements bénéficiera d’une chaleur produite à 100 % par des énergies renouvelables et le réseau rayonnera sur la majorité des quartiers. Des logements de résidences collectives, des bâtiments publics et certaines maisons individuelles seront raccordés.
60 millions d’euros pour la Polynésie
Annoncé lors de sa visite officielle en Polynésie française en juillet 2021 par Emmanuel Macron, le fonds de transition énergétique alloué à la Polynésie française et doté de 60 millions d’euros a été acté le 27 février dernier. Ce fonds vise à renforcer la souveraineté énergétique de la Polynésie française en favorisant le développement de production d’énergies renouvelables sur la totalité du territoire polynésien qui est majoritairement dépendant des énergies fossiles. Il s’adresse aux collectivités territoriales compétentes en la matière (Pays, communes, communautés de communes) et aux entreprises. Plusieurs types de projets pourront être soutenus : installation de production électrique 100 % énergies renouvelables, couvrant de nouveaux besoins ou intervenant en substitution d’installations de production ayant recours aux énergies fossiles ; installation de production hybride permettant de couvrir de nouveaux besoins ou en substitution partielle d’installations fossiles ; installation de production d’énergie renouvelable thermique et investissement d’infrastructures centralisées de réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et infrastructure de stockage pour fluidifier l’injection d’énergies renouvelables variables dans le réseau électrique.
Notre guide des formations est en ligne !
Après l’édition papier, le Guide des formations aux énergies renouvelables édité par l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) est désormais également disponible en ligne et interrogeable grâce à un moteur de recherche. Cette nouvelle base de données permet de choisir la formation souhaitée selon plusieurs critères : région, type de formation, filière, niveau… Ce guide se révélera utile aux étudiants devant renseigner leurs vœux dans Parcoursup : il présente 200 formations ayant trait aux énergies renouvelables et à l’écoconstruction, allant de BAC+2 à Bac+5. Les professionnels en recherche de qualifications supplémentaires pourront consulter les formations continues de longue durée ou de courte durée ou les formations dispensées par des industriels et des bureaux d’études. Le guide en version papier est par ailleurs toujours disponible ICI.
Nouveau réseau de chaleur géothermique à Genève
Celcius Energy, filiale de SLB Nouvelles Énergies spécialisée dans la géothermie de surface, annonce avoir remporté l’appel d’offre de la ZAC Ferney Genève Innovation au côté de Augsburger Géothermie SA, d’Auvergne Forage, de Plantier, de Ménard et de Nabaffa. Il s’agit de la concession d’un projet urbain de la société publique locale (SPL) Terrinnov (détenue à 100 % par les collectivités locales de l’Ain) pour développer une zone d’aménagement de 65 hectares près de l’aéroport international de Genève. Celcius Energy et ses partenaires vont y construire un réseau géothermique de 5 km alimenté par 40 000 mètres linéaires de champs de sondes qui seront installées jusqu’à 230 mètres de profondeur. Ce projet serait ainsi « le plus important projet en termes de mètres linéaires en France », selon Celsius Energy. Une centrale de production et plusieurs sous-stations seront installées pour assurer la distribution de 20 GWh de chaud et 6 GWh de froid à la future ZAC. Le réseau reliera également l’accélérateur de particules du CERN, ce qui permettra de récupérer la chaleur fatale produite par l’installation de recherche et de la stocker dans le sous-sol grâce aux sondes géothermiques. Le chantier doit démarrer en juin prochain.