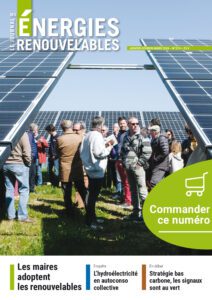Publié le 09/10/2025. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les capacités mondiales d’électricité renouvelable devraient plus que doubler d’ici 2030, avec environ 4 600 GW de nouvelles installations. Le photovoltaïque concentrerait près de 80 % de cette croissance, grâce à la baisse de ses coûts, des procédures d’autorisation simplifiées et une forte acceptation sociale. Viennent ensuite l’éolien, l’hydroélectricité, la bioénergie et la géothermie, cette dernière devant atteindre des niveaux records aux États-Unis, au Japon, en Indonésie et dans plusieurs pays émergents. Les défis liés à l’intégration des renouvelables dans les réseaux ravivent par ailleurs l’intérêt pour l’hydraulique à pompage-turbinage. Portée par la Chine et l’Union Européenne, la capacité éolienne mondiale devrait presque doubler pour dépasser 2 000 GW à l’horizon 2030, et ce, malgré des difficultés persistantes dans les chaînes d’approvisionnement et des retards administratifs. L’éolien offshore voit en revanche ses perspectives revues à la baisse, affecté par des goulets d’étranglement industriels, des coûts en hausse, et de changements de politiques dans plusieurs marchés clés. Toutes filières confondues, l’AIE abaisse légèrement ses prévisions de croissance, en raison notamment de modifications de politiques aux États-Unis et en Chine. Le parc mondial atteindrait 9 529 GW d’ici 2030, en deçà de l’engagement pris à la COP28 de tripler les capacités renouvelables d’ici la fin de la décennie (soit 11 450 GW).
Archives
12e édition du Grand prix de l’AARHSE
Publié le 02/10/2025. Chaque année, l’AARHSE (Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l’énergie), avec le soutien de la FNCCR, organise un prix national récompensant des travaux en histoire ou sociologie de l’énergie. La 12ᵉ édition est ouverte aux candidatures jusqu’au 31 janvier 2027. Depuis 2012, ce prix met en valeur des recherches en sciences humaines et sociales, hors économie et droit. Trois catégories sont ouvertes pour la période 2025-2026. La première concerne les thèses ou HDR (habilitation à diriger des recherches) soutenues dans un établissement français. La deuxième distingue une publication : livre, essai, article, œuvre d’art ou autre support. La troisième est dédiée aux mémoires de master. Au total, 10 000 euros de dotations sont prévus pour valoriser les travaux primés. Les deux premières catégories reçoivent chacune 4 000 euros, répartis entre le lauréat et des actions de diffusion. La troisième catégorie attribue 2 000 euros au mémoire récompensé. En 2025, trois chercheurs ont été distingués, dont Alix Chaplain pour une thèse sur l’électricité au Liban. Radouan Andrea Mounecif a reçu le prix de
Hydrogène renouvelable à partir de déchets ménagers
Publié le 02/10/2025. Le 23 septembre, à Créteil, dans le Val-de-Marne, a été inaugurée une station d’hydrogène renouvelable raccordée à une unité de valorisation énergétique (UVE). Ce projet, baptisé H2 Créteil, a été achevé après 12 mois de travaux. La station est directement alimentée par l’UVE du Syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM), qui traite les déchets de 19 communes du Val-de-Marne. Elle produit une tonne d’hydrogène renouvelable par jour, grâce à l’électrolyse de l’eau. L’électricité nécessaire provient exclusivement de la combustion des déchets ménagers. La capacité pourra être doublée à terme, atteignant deux tonnes quotidiennes. Cette production alimente les acteurs de la mobilité verte du Val-de-Marne. La Banque des Territoires a contribué au financement via le programme européen CEF Transport. Le projet illustre l’intégration entre gestion des déchets et transition énergétique.
Première formation de constructeur de poêle maçonné artisanal
Publié le 02/10/2025. L’Association Française du Poêle Maçonné Artisanal (AFPMA) annonce l’ouverture d’une formation pour le métier de poêlier-constructeur mainteneur de poêle maçonné artisanal. Cette formation, unique en France, permettra aux participants d’obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP), validé en décembre 2023 par les CPNE du Bâtiment (commissions paritaires nationales de l’emploi) et inscrit au registre de France Compétences en mai 2024. Elle donnera aux stagiaires les compétences nécessaires à la conception, la réalisation et l’entretien d’un poêle de masse et de son conduit. En partenariat avec le Greta du Limousin, la formation sera dispensée au sein du lycée des métiers du Bâtiment de Felletin, dans la Creuse. Le contenu pédagogique est organisé en six modules, qui s’étaleront de novembre 2025 à juin 2026. Pour les candidats venant d’autres régions, des possibilités de logement et de restauration sont proposées par le lycée. Le coût de la formation est éligible à différents dispositifs de financement de la formation professionnelle (CPF, OPCO, France Travail). Les poêles de masse représentent une niche (environ 1 500 ventes annuelles) au sein du marché des appareils de chauffage domestiques au bois. Composé d’un foyer et d’un accumulateur de chaleur, le poêle s’intègre dans un ouvrage maçonné qui peut revêtir une grande variété de formes et de finitions. Ses avantages sont une émission de chaleur très homogène et une consommation réduite de bois.
100 milliards pour le réseau électrique : la CRE lance la consultation
Publié le 02/10/2025. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ouvert le 26 septembre une consultation publique sur le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) publié en février par RTE. Le SDDR prévoit près de 100 milliards d’euros d’investissements entre 2025 et 2039, dont 20 milliards pour le renouvellement de 21 000 kilomètres de lignes, 37 milliards pour le raccordement des parcs éoliens en mer (22 GW attendus en 2040), 16 milliards pour les raccordements terrestres, 14 milliards pour l’adaptation du réseau à très haute tension, 4 milliards pour l’ossature numérique et 2,5 milliards pour de nouvelles interconnexions. Ce schéma décennal a fait l’objet d’un examen par la CRE, qui consulte les utilisateurs du réseau public de transport d’électricité sur la base de ses propres évaluations. Selon les projections de la CRE, l’impact de ces investissements sur les tarifs de réseaux d’électricité (TURPE) serait d’environ 1 % par an, hors inflation, jusqu’en 2040 pour les clients résidentiels. Dans ses premières analyses, le régulateur appelle à accélérer le remplacement d’infrastructures vieillissantes pour les adapter au changement climatique, à lancer rapidement les projets les plus structurants malgré les incertitudes sur l’évolution de la consommation et de la production, et à privilégier les lignes aériennes à très haute tension, dix fois moins coûteuses que les solutions souterraines. Il souligne aussi la nécessité de renforcer la flexibilité du système électrique, de simplifier les procédures de raccordement et de conditionner les futures interconnexions à des analyses coûts-bénéfices positives. La consultation, ouverte jusqu’au 15 novembre, sera suivie d’une délibération de la CRE.
Lettre ouverte au premier ministre
Publié le 25/09/2025. Les Métiers de la Couverture et de la Plomberie-Chauffage de la Capeb, associés aux acteurs de la filière biomasse représentés par Propellet, le SER et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB), ont alerté le Premier ministre sur les conséquences de l’exclusion des chaudières biomasse du dispositif MaPrimeRénov’. Dans une lettre ouverte envoyée le vendredi 19 septembre, les signataires dénoncent « une décision incompréhensible pour les professionnels comme pour les ménages, qui va à l’encontre des besoins des Français, des objectifs de transition énergétique et des impératifs économiques ». Les professionnels de la filière mettent en avant la dimension économique et sociale du bois-énergie, qui reste la solution la plus abordable et la plus accessible, notamment dans les territoires ruraux. Cette action a été organisée en réaction à l’annonce faite le 9 septembre dernier de supprimer l’aide aux ménages pour l’acquisition de chaudières biomasse dans le cadre des monogestes du dispositif MaPrimeRénov’. Une décision d’autant plus difficile à accepter que les économies budgétaires espérées ne seraient que d’environ 20 millions d’euros, une somme bien faible au regard de l’activité générée par le segment de marché des chaudières bois (environ 100 millions) et des rentrées fiscales associées. Le retrait des chaudières bois du principal dispositif national de soutien aux équipements renouvelables chez les particuliers constitue une mauvaise nouvelle pour un secteur qui, déjà affecté par la crise énergétique, a perdu plus de 75 % de ses ventes entre 2022 et 2024.
Dugny et Le Bourget : le réseau de chaleur bientôt alimenté par la géothermie
Publié le 25/09/2025. Les travaux de forage géothermique vont bon train à Dugny (Seine-Saint-Denis). Débutés mi-juillet, ils devraient s’achever fin octobre. La chaufferie sera ensuite finalisée et mise en service en début d’année prochaine. Installée avec la chaufferie gaz d’appoint et secours sur un terrain mis à disposition pour 30 ans par le Département, elle permettra de puiser la chaleur géothermale dans le dogger à 1 700 mètres de profondeur où l’eau est à 62°C. Elle pourra alors alimenter le réseau de chaleur des communes de Dugny et du Bourget avec l’objectif de fournir 90 % de l’énergie consommée. D’une longueur prévue à terme de 20 km, le réseau est en cours de construction. Il alimentera à terme 9 000 équivalents-logements dont l’aéroport de Paris-Le Bourget et le Village des médias des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, devenu depuis un quartier à part entière. Plus de 15 600 tonnes de CO2 seront évitées chaque année, soit l’équivalent de l’émission de 13 000 voitures. D’un montant global de 55 millions d’euros, le projet est soutenu par l’État via le Fonds Chaleur à hauteur de 18 millions d’euros, par la Région Île-de-France à hauteur de 2,5 millions d’euros, par la Métropole du Grand Paris à hauteur de 2,5 millions d’euros et par le Groupe ADP à hauteur de 2,6 millions.
SALON Le Forum EnerGaïa tiendra sa 19ᵉ édition les 10 et 11 décembre 2025 à Montpellier
Publié le 25/09/2025. Le Forum EnerGaïa revient les 10 et 11 décembre 2025 à Montpellier pour sa 19ᵉ édition, avec un thème central : l’acceptabilité des projets d’énergies renouvelables dans les territoires. Un thème structurant jugé stratégique à l’approche des municipales de 2026. La plénière d’ouverture traitera du partage de la valeur, clé de l’appropriation locale. Le programme privilégiera retours d’expérience, intelligence collective et interaction. De nombreuses tables rondes aborderont l’éolien, le solaire, le biogaz, l’hydrogène, le recyclage ou encore le repowering. Parmi elles : « Hybridation et éolien + solaire » et « Décarboner l’industrie ». Une matinée spéciale sera consacrée à l’éolien en mer avec deux tables rondes. La seconde journée explorera le solaire thermique, l’autoconsommation, la géothermie et les contrats d’électricité renouvelable. Fidèle à son engagement, le Forum reconduit son Grand Challenge Solidaire avec Énergie Solidaire pour lutter contre la précarité énergétique qui touche 1 Français sur 5. En 2024, l’initiative avait permis de collecter 82 300 € de dons. La collecte 2025, ouverte du 11 septembre au 11 décembre, vise encore plus de dons. Rendez-vous incontournable de la transition énergétique, EnerGaïa 2025 vous attend : réservez dès maintenant votre badge visiteur gratuit sur www.energaia.fr. Le programme complet des tables rondes est à retrouver ICI
Une nouvelle station hydrogène en Occitanie
Publié le 18/09/2025. Qair a lancé officiellement la construction de sa deuxième station hydrogène en Occitanie, située à Narbonne, en partenariat avec l’Arec Occitanie. Implantée dans la zone industrielle Croix-Sud, sur un terrain de la CCI de l’Aude, la station distribuera jusqu’à 600 kg d’hydrogène renouvelable par jour. Elle sera alimentée par l’unité de production d’hydrogène Hyd’Occ qui est actuellement en construction à Port-La Nouvelle. Hyd’Occ disposera d’une puissance initiale de 20 MW, permettant une production annuelle de 2 700 tonnes d’hydrogène. L’hydrogène produit alimentera prioritairement les stations de Béziers et Narbonne. Une seconde phase portera la puissance de l’unité à 40 MW, doublant ainsi la production à 5 400 tonnes par an. Ce développement s’inscrit dans la stratégie régionale de décarbonation de la mobilité et de l’industrie. Ce programme vise à créer un couloir de transport européen zéro émission reliant la Péninsule ibérique au Nord de l’Europe. Il cible principalement la mobilité lourde, en s’appuyant sur l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables. Ce projet bénéficie du soutien de la Région, de la Banque Européenne d’Investissement et de l’Union Européenne. La mise en service de la station de Narbonne est prévue pour fin 2025.
Nouvelle centrale hydroélectrique au cœur des Alpes
Publié le 18/09/2025. CNR inaugure sa nouvelle petite centrale hydroélectrique sur le torrent de la Sarenne, au cœur des Alpes. En service depuis janvier 2025, cette centrale de haute chute se situe sur les communes de La Garde-en-Oisans, Huez et Bourg d’Oisans, dans l’Isère. Le chantier, mené sur trois ans, a permis de construire une infrastructure moderne respectant la biodiversité et l’environnement montagnard. La centrale a une puissance installée de 11 MW et produira annuellement 36 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 16 000 habitants. Les infrastructures principales sont en grande partie souterraines pour limiter l’impact paysager et environnemental. La hauteur de chute naturelle est de 735 mètres avec un débit d’équipement de 1,8 m³/s. Une galerie souterraine de 3 660 mètres relie Huez à Bourg d’Oisans pour le transfert de l’eau. Deux turbines Pelton assurent la production d’électricité dans la centrale de Bourg-d’Oisans. La prise d’eau est équipée d’une passe à poissons, garantissant la continuité piscicole du torrent. Le chantier a inclus des mesures environnementales fortes, comme la re-végétalisation des zones affectées. Le projet représente un investissement de 50 millions d’euros.