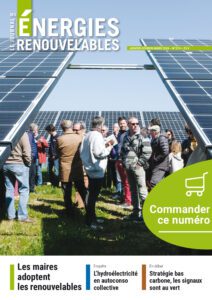Le 8 novembre, les équipes de Plaine Commune Énergie, filiale d’Engie Solutions, ont annoncé que le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis sera alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable issue de la biomasse via un réseau de chaleur. Une opération rendue possible par la mise en service en octobre dernier d’un point de livraison qui permet de fournir chauffage et eau chaude sanitaire aux utilisateurs du centre aquatique. Le réseau de chaleur dessert déjà plusieurs villes, dont Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, l’Île-Saint-Denis et Aubervilliers, alimentant 61 500 équivalents-logements sur 90 kilomètres. D’ici 2024, le centre aquatique sera également raccordé au data center Equinix, augmentant sa part d’énergie renouvelable à 75 %.
Archives
Nouveau prototype en test à Brest
La startup bordelaise Seaturns, en partenariat avec l’Ifremer, teste actuellement un prototype de production d’énergie houlomotrice sur le site d’essais en mer de l’Ifremer de Saint-Anne du Portzic près de Brest. Avec des dimensions de 3,6 mètres de long pour 1,5 mètre de diamètre, le prototype restera à l’essai pendant 10 mois. Le système utilise le mouvement des vagues pour faire osciller un cylindre, similaire à un pendule, générant de l’électricité via une turbine à air. Si les résultats sont concluants, des étapes supplémentaires, telles que la validation de prototypes à plus grande échelle, sont envisagées, avec pour objectif la commercialisation d’unités de production d’électricité très bas carbone à partir de 2025. Le prototype bénéficie du financement de l’État dans le cadre de France 2030 et de l’Union européenne dans le cadre du plan France Relance.
Un réseau de chaleur biomasse pour Évian
Lundi 6 novembre, la chaufferie biomasse et le réseau de chaleur des Hauts d’Évian, située dans le quartier des Hauts à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), a été mise en service. Confiée à Syane’Chaleur, au bureau d’études Menthe et à Engie, la construction a nécessité 15 mois de travaux. La production de chaleur desservira de nouveaux projets immobiliers, des bâtiments municipaux : Ehpad, groupe scolaire, caserne de pompiers. Le réseau alimentera à terme en chauffage et en eau chaude sanitaire 600 à 900 logements. La chaufferie aura au final une puissance de 6 MW et permettra de produire 14 GWh/an de chaleur tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 2 300 tonnes d’équivalent CO2 par an, soit l’empreinte carbone de 1 000 habitants. Le site utilise comme combustible de la plaquette forestière, résultat du broyage des rémanents (petites branches). L’investissement s’élève à 5 millions d’euros, dont 300 000 euros financés par France Relance et 2 053 970 euros financés par le Fonds chaleur de l’Ademe.
Nouvelle station bioGNC en Gironde
Gironde Energies et Engie Solutions ont inauguré une nouvelle station d’avitaillement BioGNC située à Beychac-et-Caillau, en Gironde. Cette station propose un carburant issu de la valorisation de déchets organiques, une alternative propre et renouvelable aux carburants traditionnels, avec une réduction significative des émissions de CO2, des particules fines et du bruit. Elle servira les poids lourds en transit, facilitera l’accès aux zones à faibles émissions, en plein essor dans de nombreuses métropoles et agglomérations, grâce à leur classification environnementale Crit’Air 1 et permettra également la recharge des véhicules électriques grâce à la présence d’un superchargeur de 120 kW. L’installation de Beychac-et-Caillau est dimensionnée pour répondre spécifiquement aux besoins du transport routier de marchandises et des opérateurs logistiques locaux. Elle peut également avitailler 7/7J et 24h/24 tous types de véhicules légers et poids lourds.
Fresnes adopte à nouveau la géothermie
Et de deux ! Le Conseil municipal de la ville de Fresnes (Val-de-Marne) a voté un projet de création d’une seconde unité de géothermie, près du parc des Aulnes, pour alimenter le réseau de chaleur urbain. La centrale sera construite par Sofrege (Société fresnoise de géothermie), filiale à 100 % du Groupe Coriance, qui exploite le réseau de chaleur depuis 2010 dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Un avenant au contrat d’exploitation a été signé en ce sens fin septembre. Cette seconde centrale s’ajoutera à la première située aux abords du centre commercial de la Cerisaie, qui comprend un doublet créé en 1986 et un troisième puits foré en 2014 (68 MW). Elle sera composée d’un doublet géothermique et de deux pompes à chaleur d’une puissance totale de 5 MW. Le réseau sera également étendu de plus de 4,7 km. Il fera ainsi, à l’issue des travaux, 18 km pour un total de 133 sous-stations et 112 GWh de chaleur distribuées par an. La nouvelle installation de géothermie devrait permettre de faire passer le taux de couverture en énergie renouvelable de 60 à 80 %. 17 500 tonnes de CO2 seront ainsi évitées par an, soit l’équivalent de 15 000 voitures en circulation. L’investissement prévu par Coriance s’élève à plus de 31 millions d’euros, avec un soutien financier de l’Ademe et de la région Île-de-France. Les travaux devraient débuter en 2025.
Saint-Malo roule pour le biogaz
Saint-Malo Agglomération, le syndicat d’énergie d’Ille-et-Vilaine et sa SEM Energ’iV, s’associent pour valoriser en biogaz les déchets de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Saint-Malo Agglomération. Pour cela, la construction d’une unité de méthanisation a débuté en octobre, qui doit entrer en service début 2025. Elle alimentera en gaz renouvelable des bus, des bennes à ordures ménagères, des transporteurs et des particuliers. En s’associant, les partenaires visent à réduire de plus de 80 % les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de l’Agglomération, à améliorer la qualité de l’air, à progresser vers l’indépendance énergétique et à améliorer le confort des usagers en ayant des véhicules plus silencieux. La méthanisation réduira de 40 % les quantités de boues de la station d’épuration. Le biogaz produit sera accessible au grand public et aux véhicules locaux grâce à une station d’avitaillement de bioGNV prévue en 2025. Le coût total de l’opération est estimé à 11,16 millions d’euros, financé en grande partie par Saint-Malo Agglomération et dans une moindre mesure par le département de l’Ille-et-Vilaine.
Le Fonds Chaleur au plus près des territoires
Le 20 octobre, le Contrat chaleur renouvelable territorial de la Gironde a été renouvelé pour la période 2022-2025. L’objectif de ce dispositif est de fournir un accompagnement technique et financier aux maîtres d’ouvrage publics et privés du territoire girondin dans la mise en œuvre de leurs projets de chaleur renouvelable. Lors du premier contrat, de 2019 à 2021, 33 installations (géothermie, chaufferie biomasse par plaquettes ou granulés, solaire thermique, récupération de chaleur fatale, création ou extension de réseaux de chaleur) ont bénéficié de 8,2 millions d’euros d’aides à l’investissement accordées par l’Ademe, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine. Avec le prolongement de cette convention, les signataires du contrat affichent désormais une volonté de montée en puissance, avec un objectif de 42 installations réalisées d’ici à 2025. Une enveloppe de 6,15 millions d’euros du Fonds Chaleur a été déléguée au Département de la Gironde. L’exécution de ce nouveau contrat se fera avec l’appui d’un groupement de compétences permanent, pour offrir un accompagnement aux porteurs de projets.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux passe au biogaz
Le Grand Port Maritime de Bordeaux et CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, ont posé la première pierre de l’unité de méthanisation CVE Port de Bordeaux. Cette installation permettra de traiter les matières organiques de la zone industrialo-portuaire de Bassens et de la métropole bordelaise : matières organiques issues de l’activité industrielle du Port (40 %), des activités de l’industrie agroalimentaire (40 %) et des biodéchets de la restauration et des supermarchés (20 %). Opérationnelle en 2024, cette unité pourra traiter jusqu’à 25 000 tonnes de matières organiques par an, équivalant au gaspillage alimentaire annuel de l’ensemble des habitants de Bordeaux Métropole, elle produira du gaz vert pour environ 4 000 foyers. La situation du site réduira considérablement la distance parcourue par les déchets organiques pour leur traitement et valorisation, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone liée au transport. CVE prendra en charge l’ensemble de la filière de valorisation des biodéchets, y compris la collecte, le traitement, la production de gaz renouvelable et la fourniture d’engrais organique naturel qui bénéficiera à 22 agriculteurs. L’unité de méthanisation représente un investissement de 23,8 millions d’euros avec le soutien financier du Fonds Européen Feder et de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine.
Station hydrogène privée en Vendée
Le producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable Lhyfe a inauguré, le 4 octobre dernier, la première station d’hydrogène privée de Vendée sur un site du distributeur de carburants Brétéché. Située à Maché, dans la zone de Bel-Air sur l’axe Challans-La Roche-sur-Yon, la station pourra distribuer jusqu’à 800 kg d’hydrogène par jour. Elle est alimentée grâce à un partenariat avec Lhyfe, qui produit cet hydrogène vert et renouvelable à Bouin à partir d’électricité éolienne et d’eau de mer. Brétéché souhaite continuer le développement de systèmes d’hydrogène dans les six départements où elle est implantée, à proximité des futurs sites de Lhyfe qui veut accroître sa production en 2024. Sa capacité installée s’élève actuellement à 1 MW, soit 300 kg d’hydrogène vert potentiellement produit par jour. Mais l’entreprise vise la production d’une tonne quotidienne courant 2024, soit une capacité installée de 2,5 MW.
Solaire thermique et géothermie, prêts pour fournir la chaleur industrielle
Solar Heat Europe, l’association de l’industrie solaire thermique européenne, et l’EGEC (son homologue sur la géothermie) se sont rapprochés afin de promouvoir ensemble l’utilisation de leur filière respective dans le secteur des processus industriels. L’industrie est un grand consommateur de chaleur, qui compte pour 75 % de ses besoins énergétiques globaux avec souvent une utilisation de chaleur à basse ou moyenne température (jusqu’à 400°C). Les deux structures européennes appellent à un déploiement accéléré de leurs technologies qui sont des solutions très adaptées aux besoins industriels, notamment dans le domaine de la chimie, de l’alimentation ou du textile. Des soutiens financiers à travers des programmes européens sont demandés afin de multiplier des opérations de grande envergure. Solar Heat Europe rappelle que dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables adoptée le 9 octobre 2023, des objectifs contraignants sont désormais fixés pour le déploiement du chauffage et du refroidissement renouvelables, ainsi qu’un objectif indicatif pour la décarbonation du secteur industriel. Si l’on ajoute à cela les préoccupations concernant la sécurité énergétique et les engagements volontaires des principales entreprises européennes à décarboner, il est clair que l’industrie européenne a besoin d’options fiables et compétitives pour satisfaire ses besoins en chaleur. Le solaire thermique et la géothermie sont prêts à relever le défi.